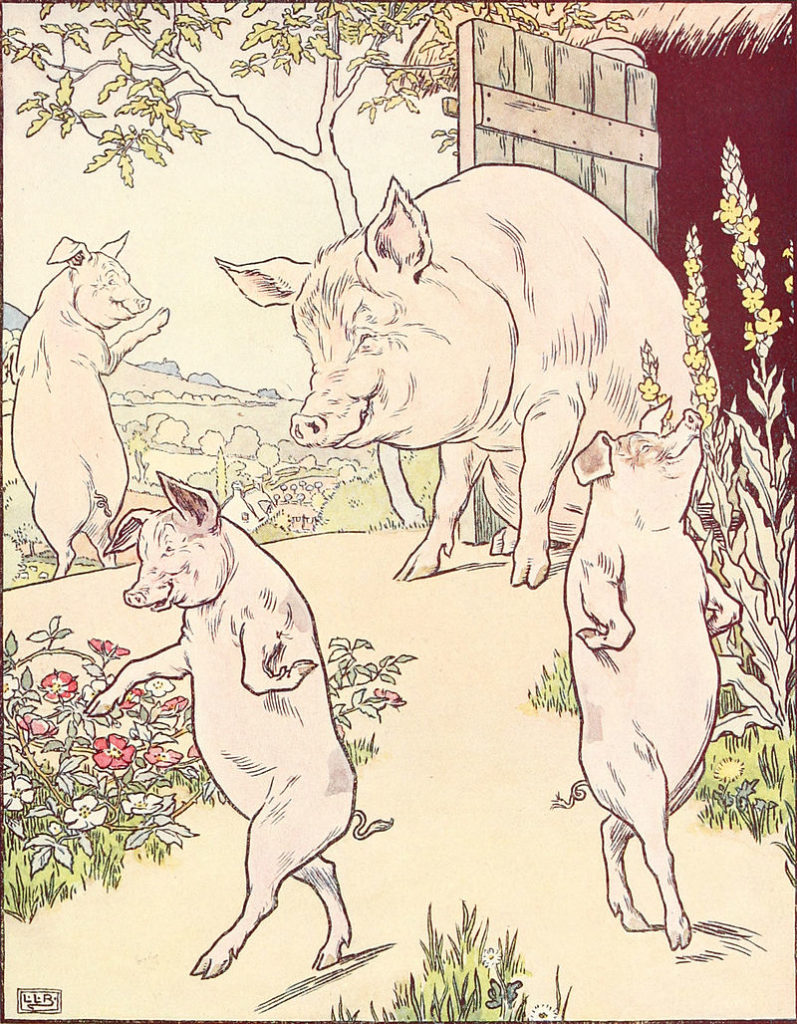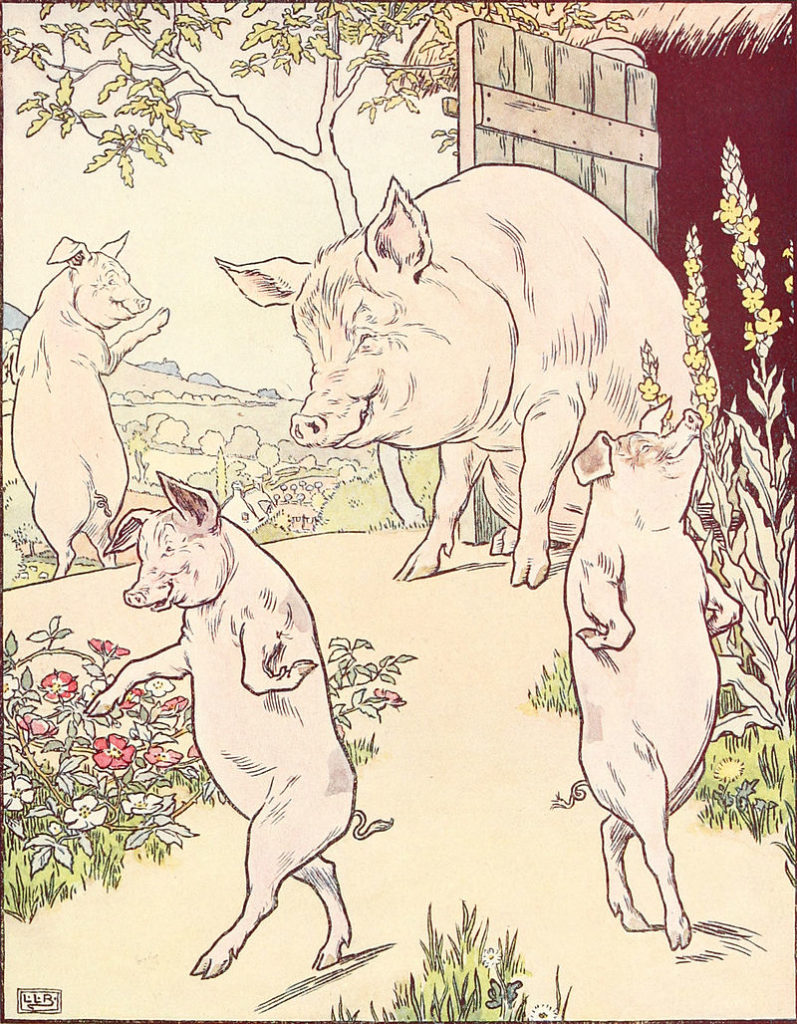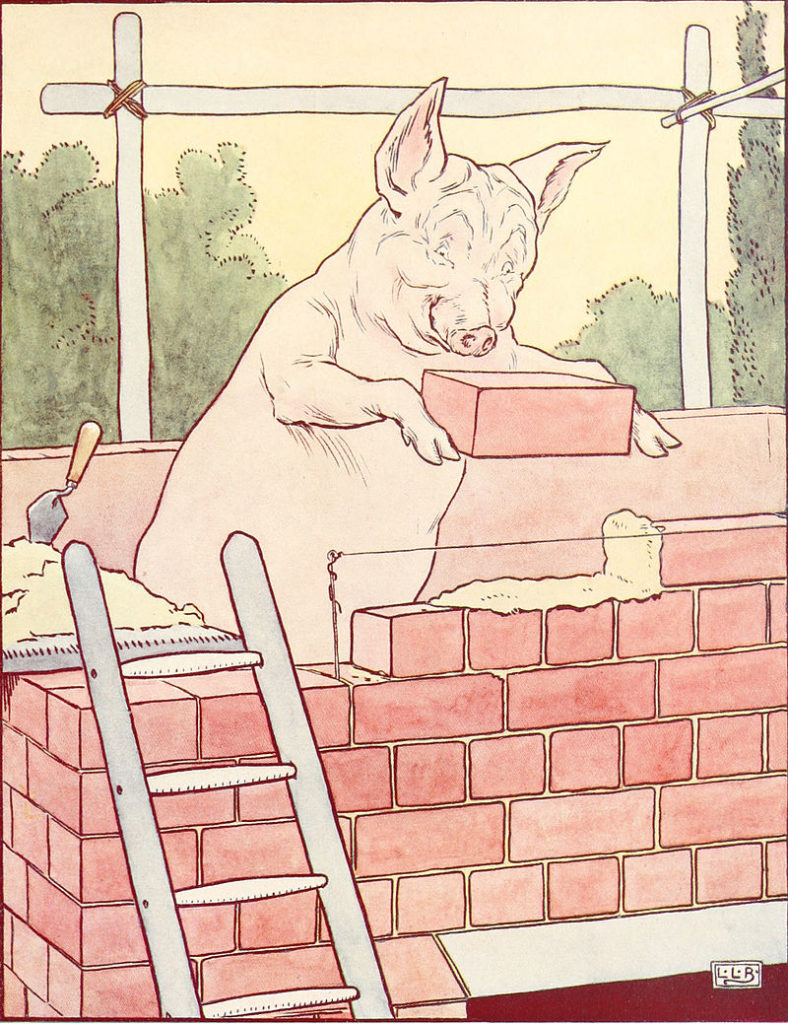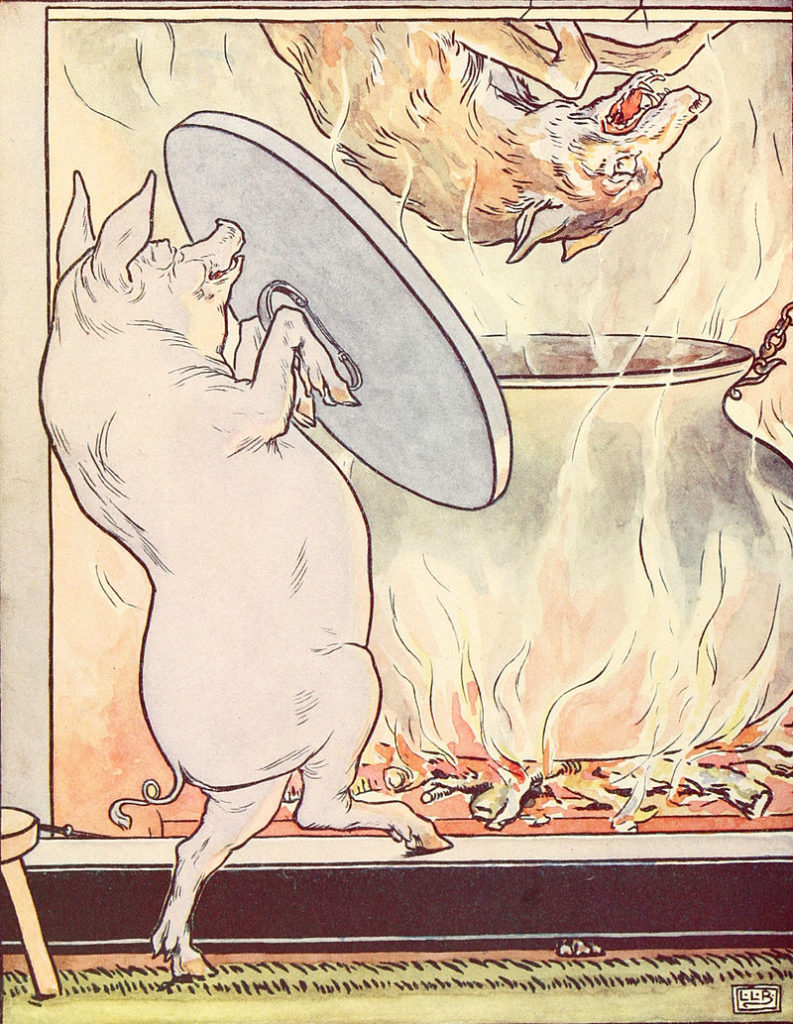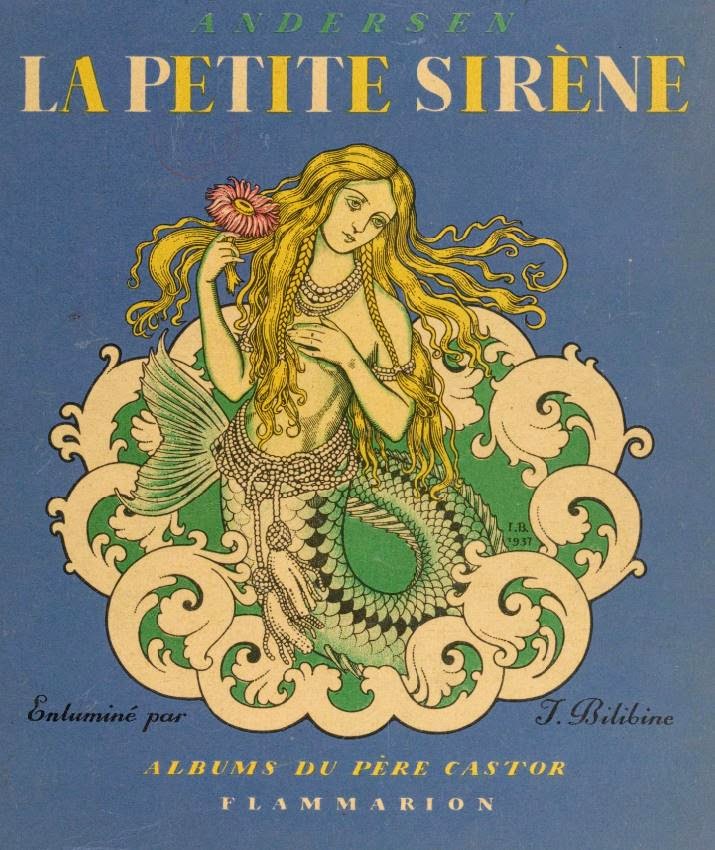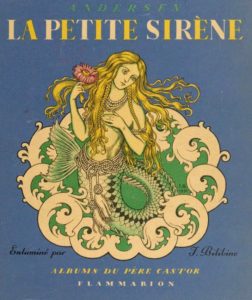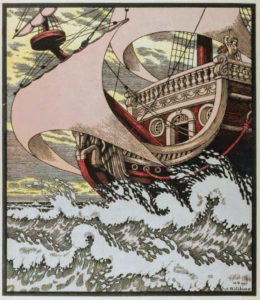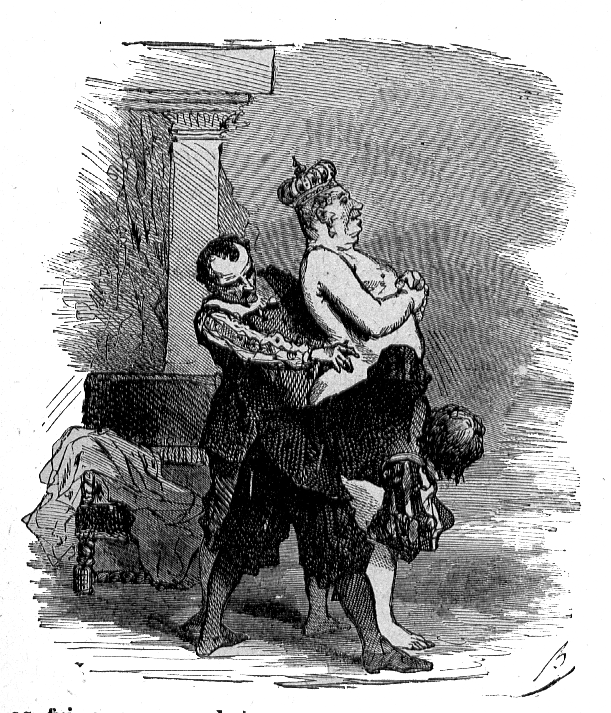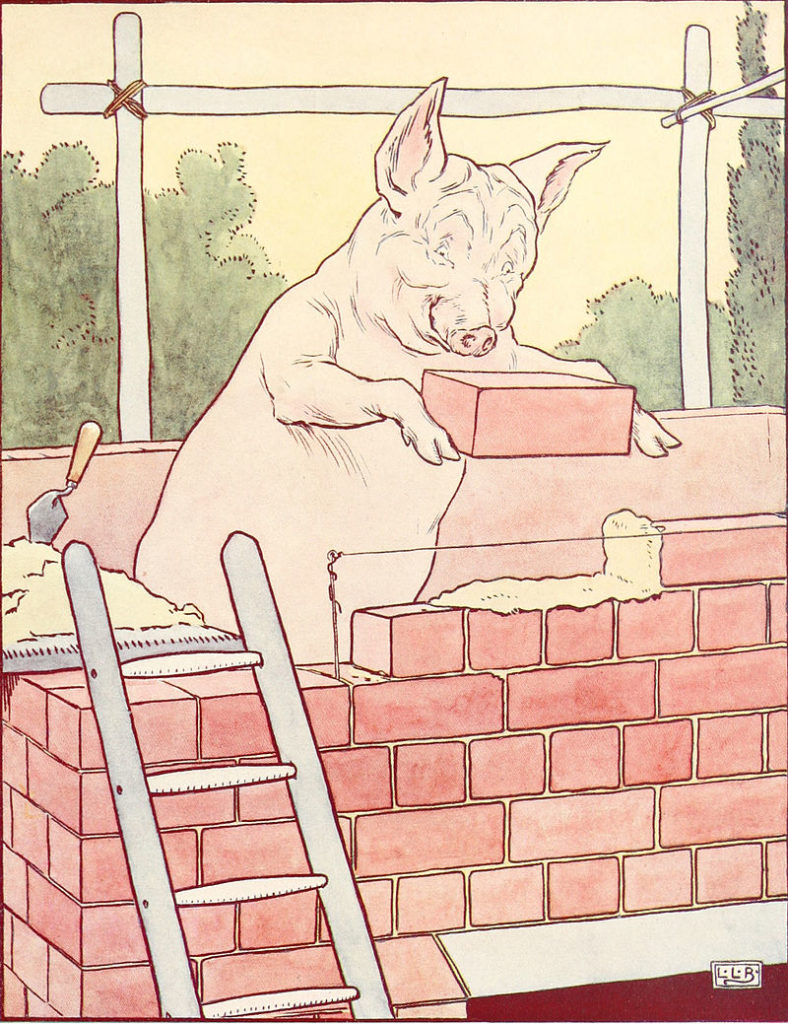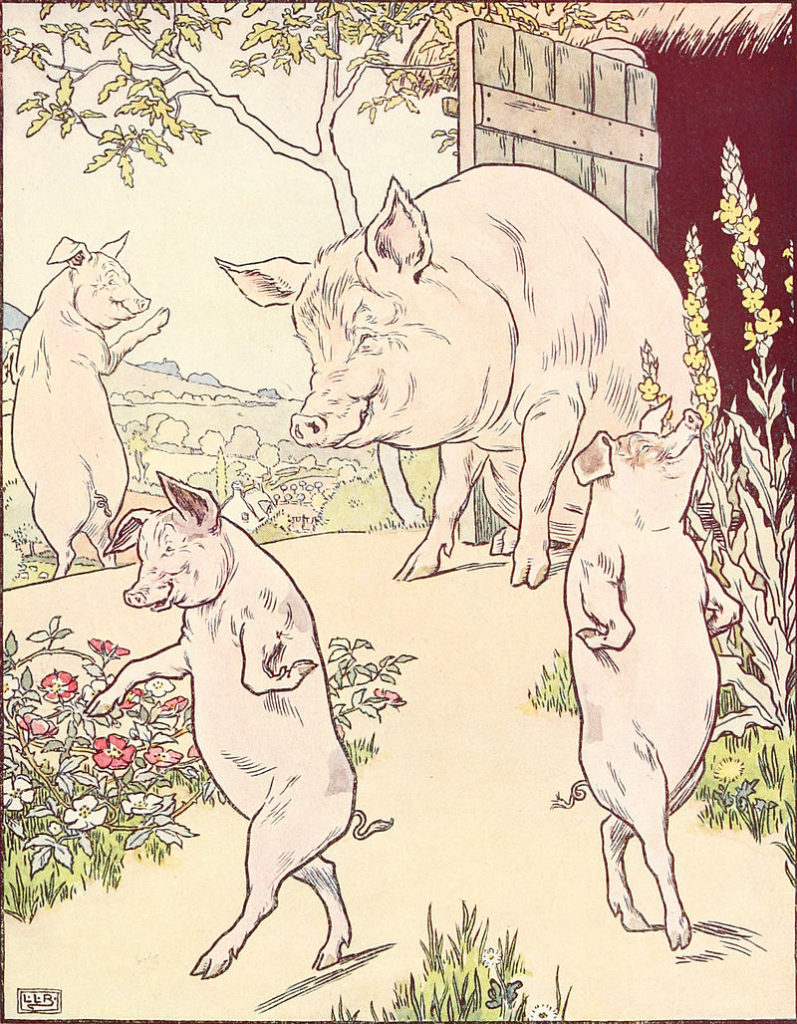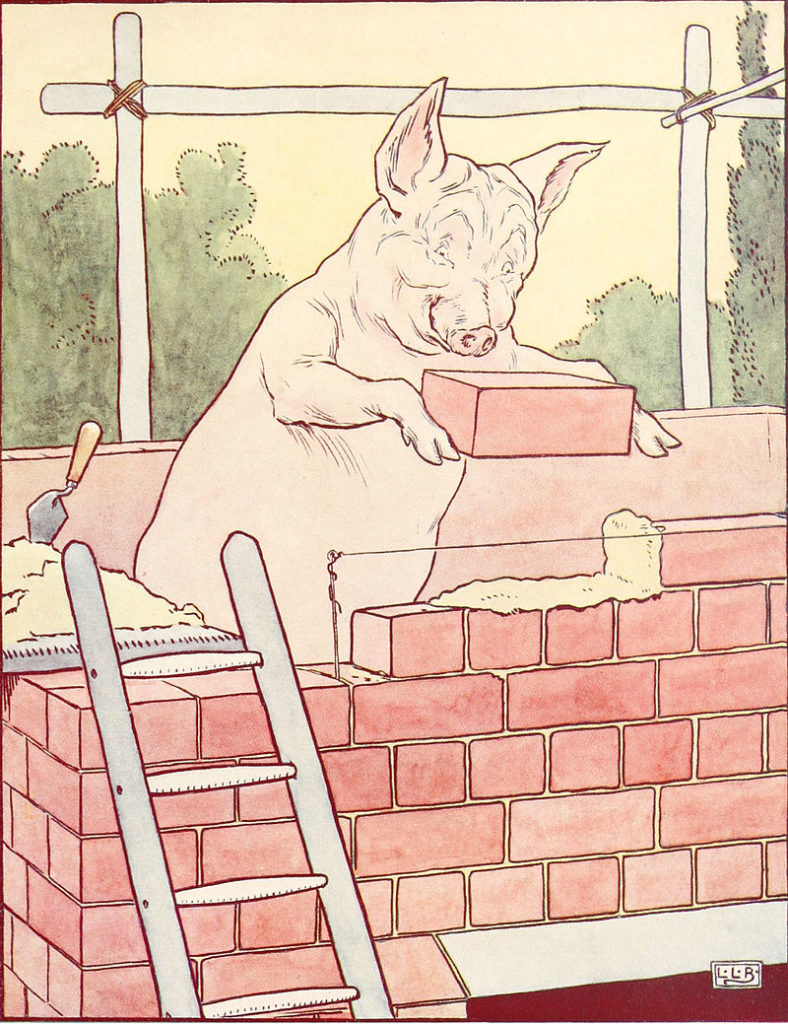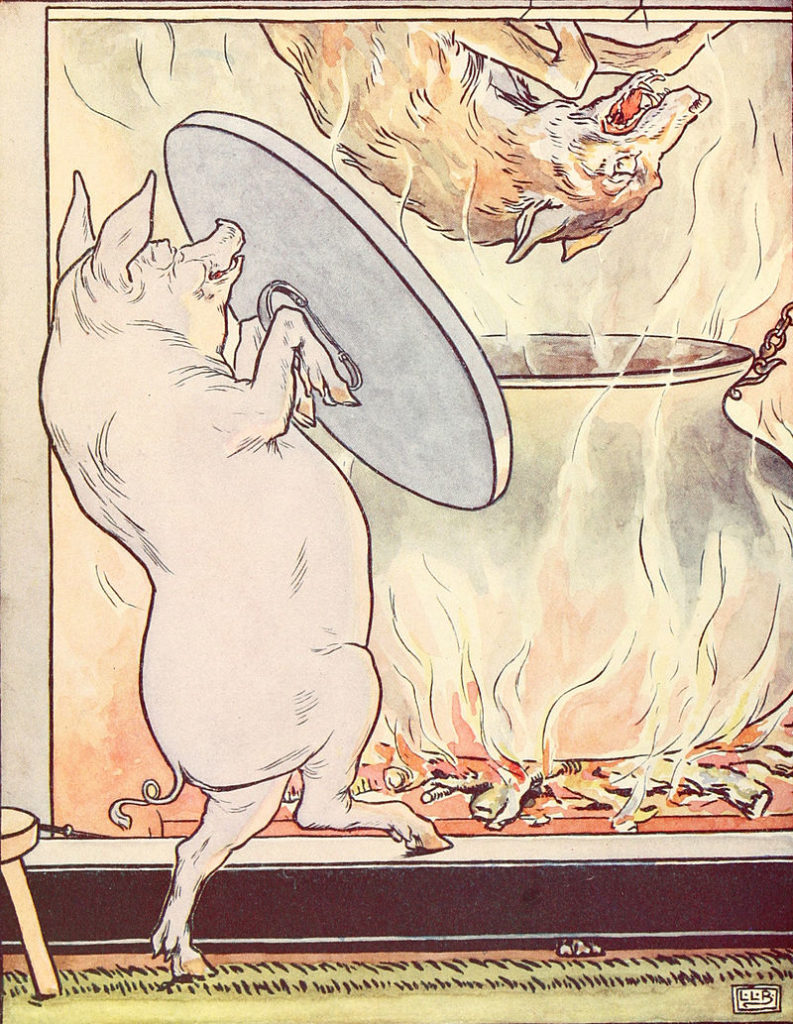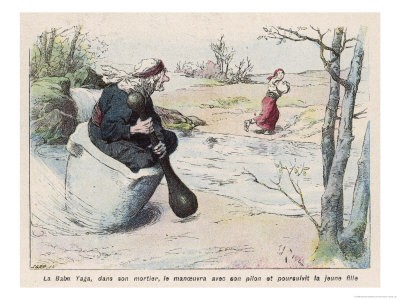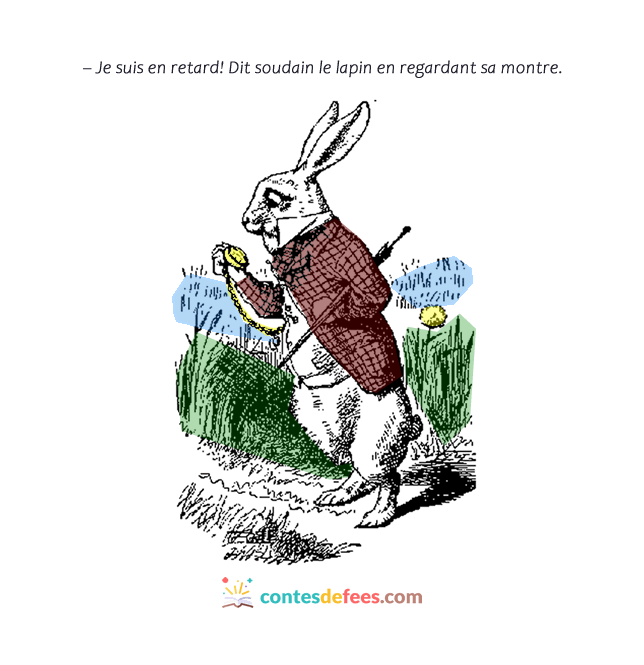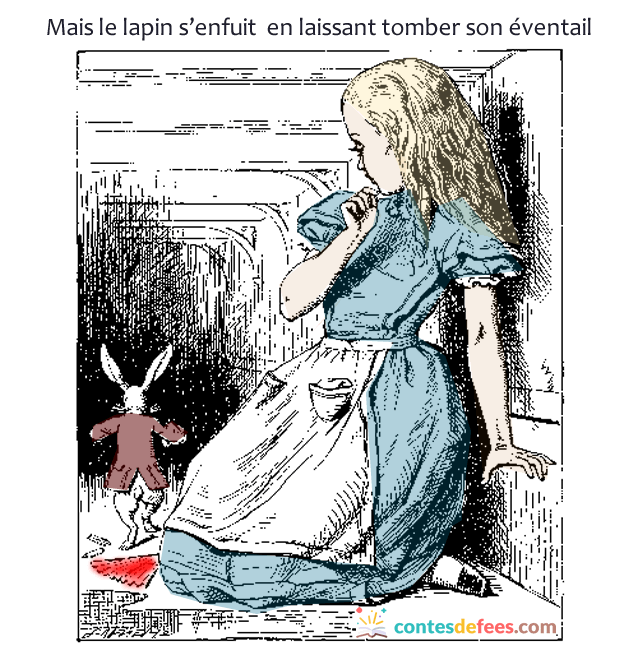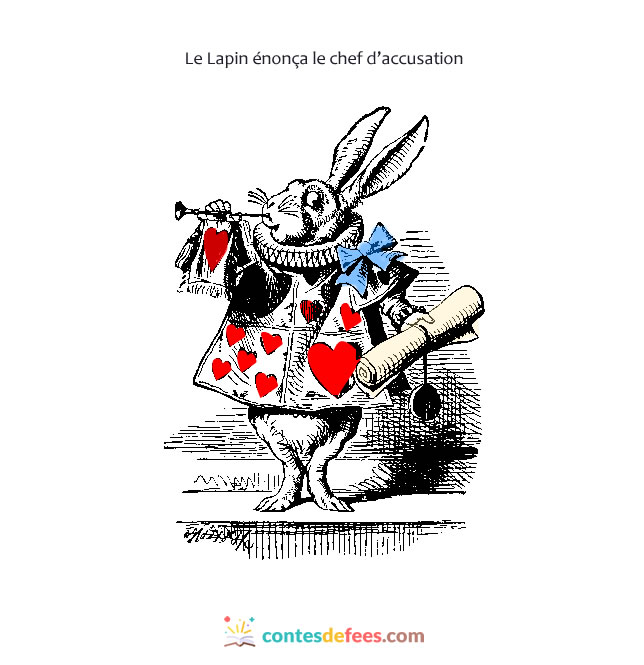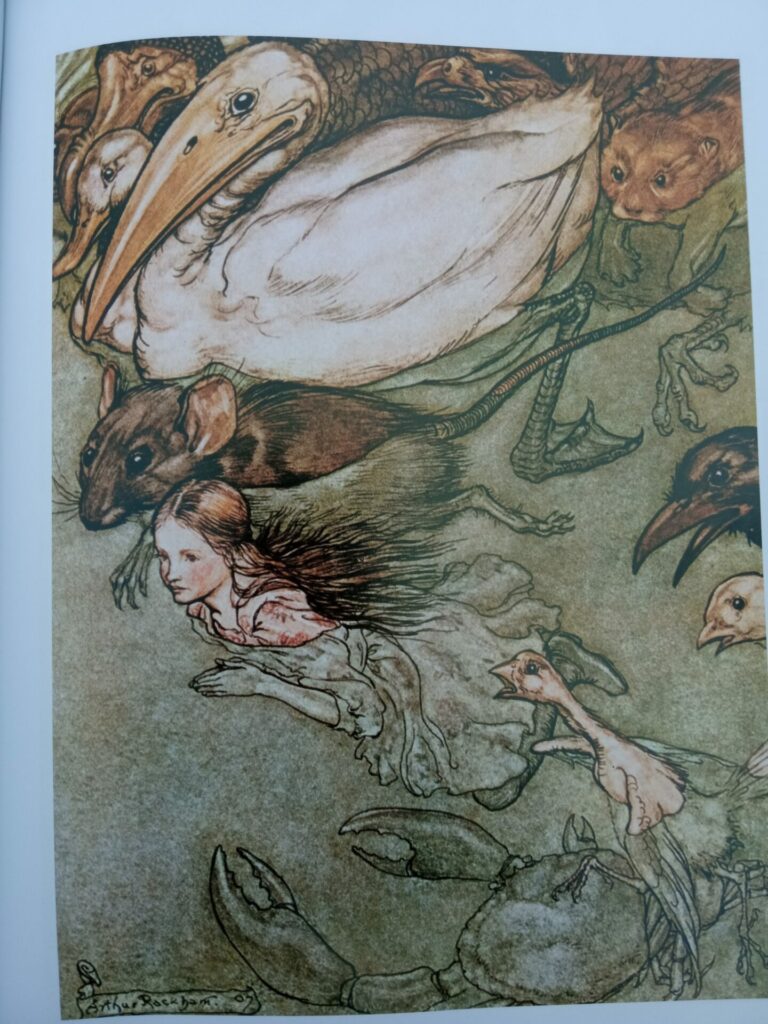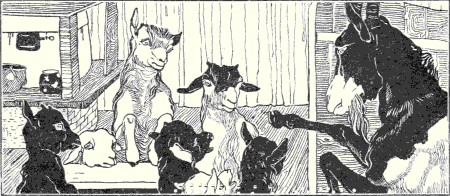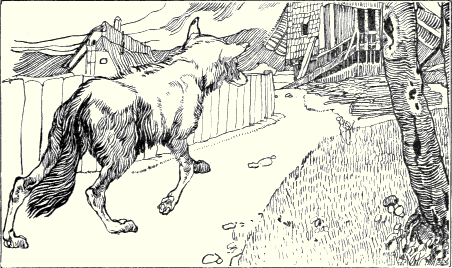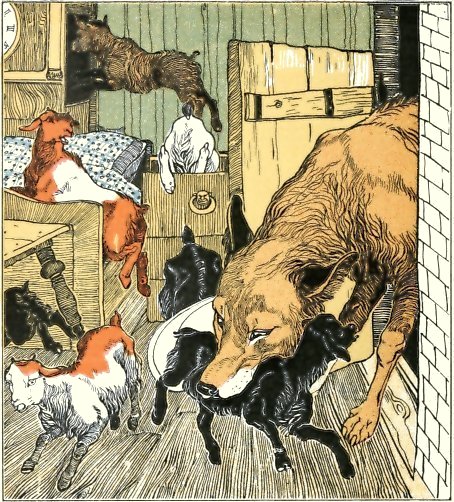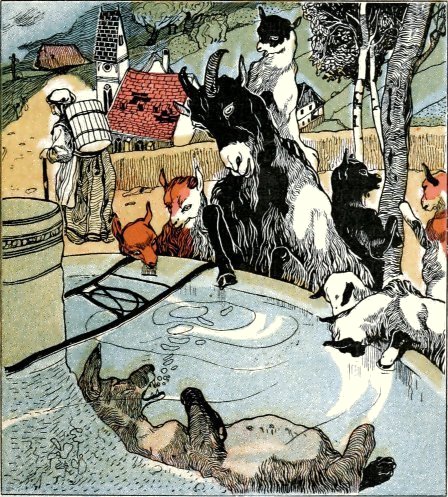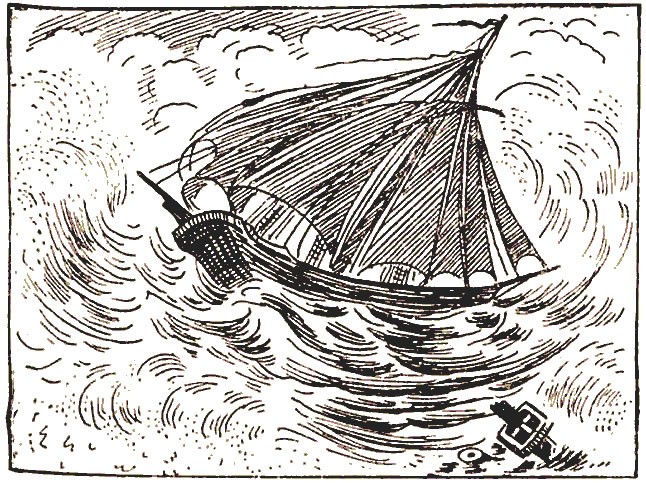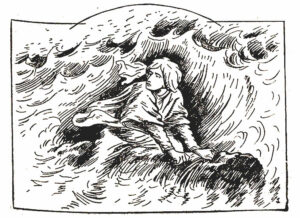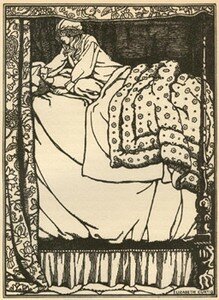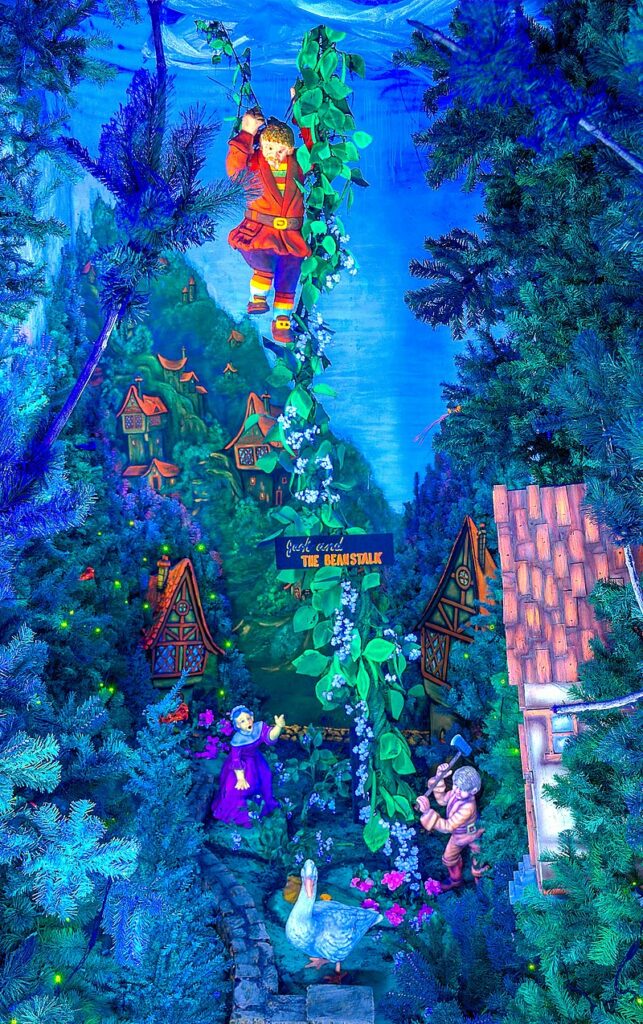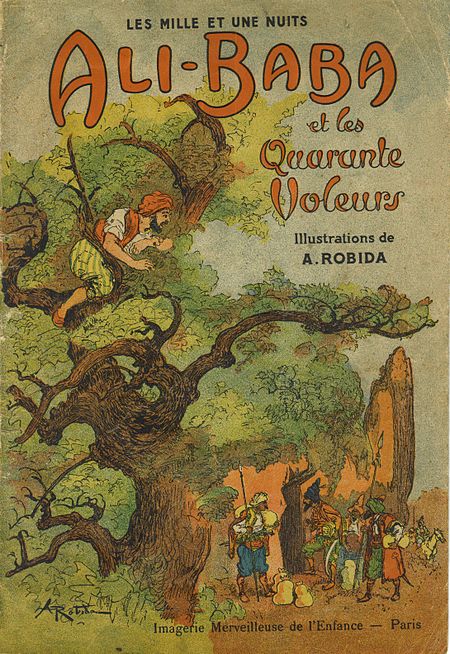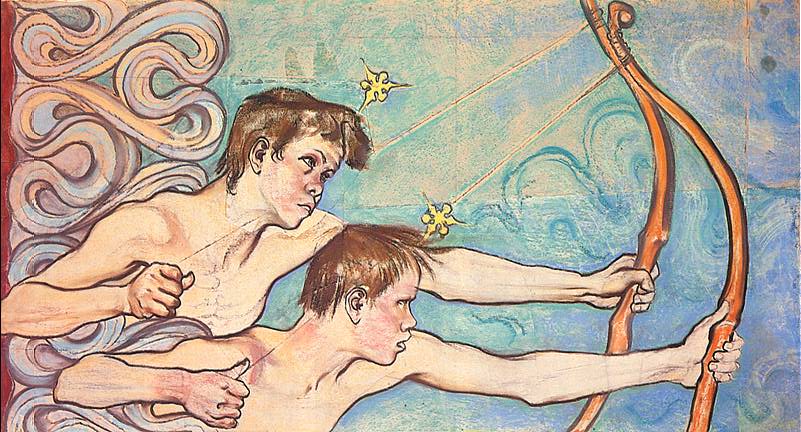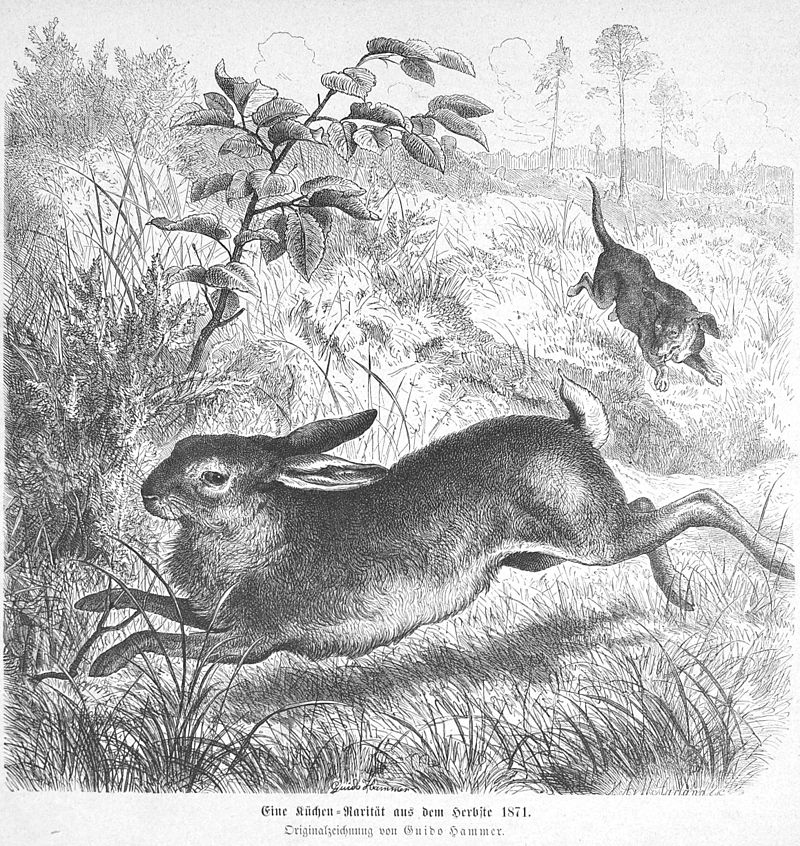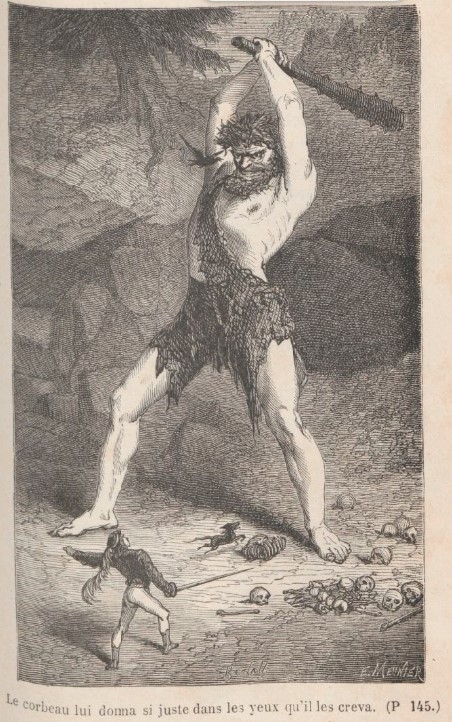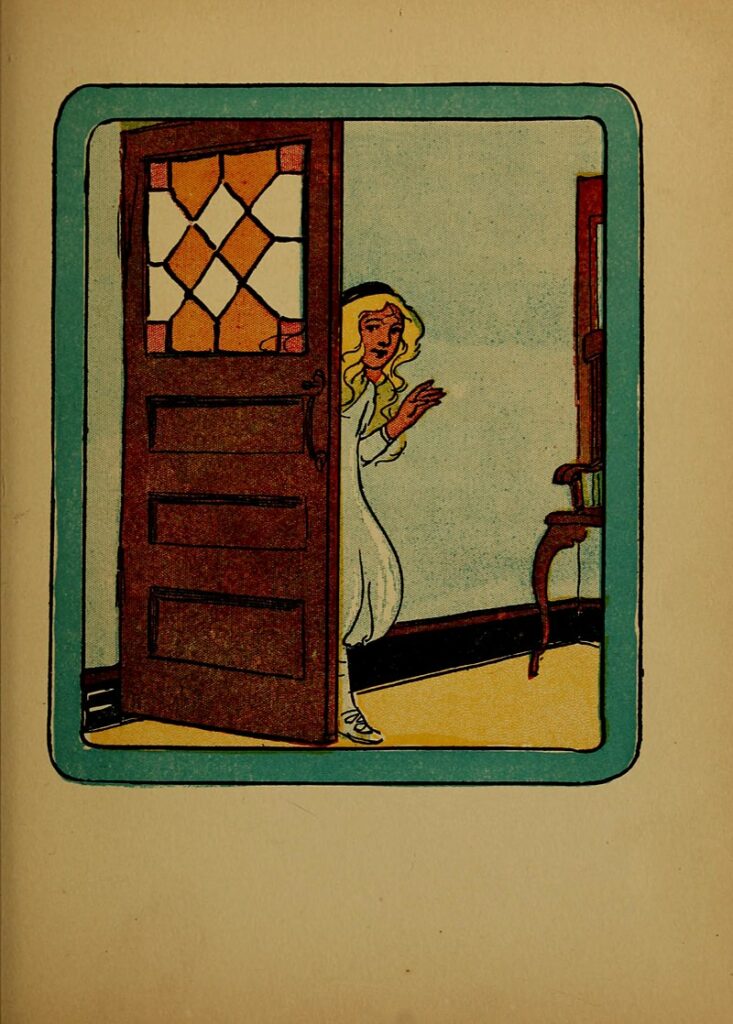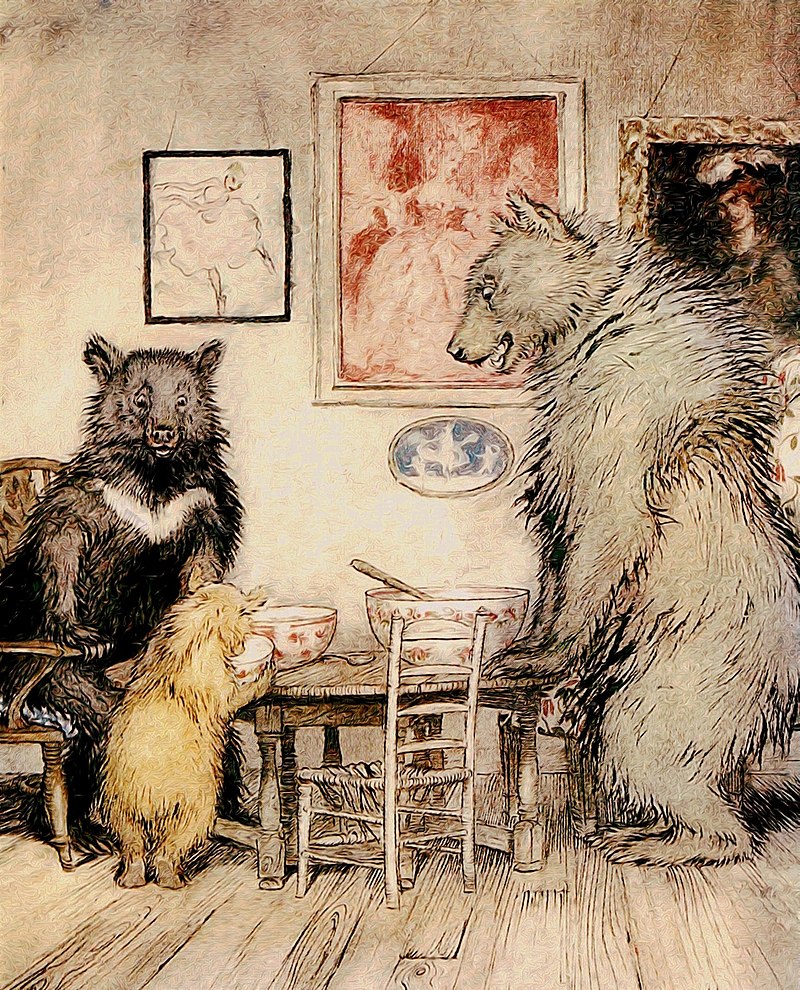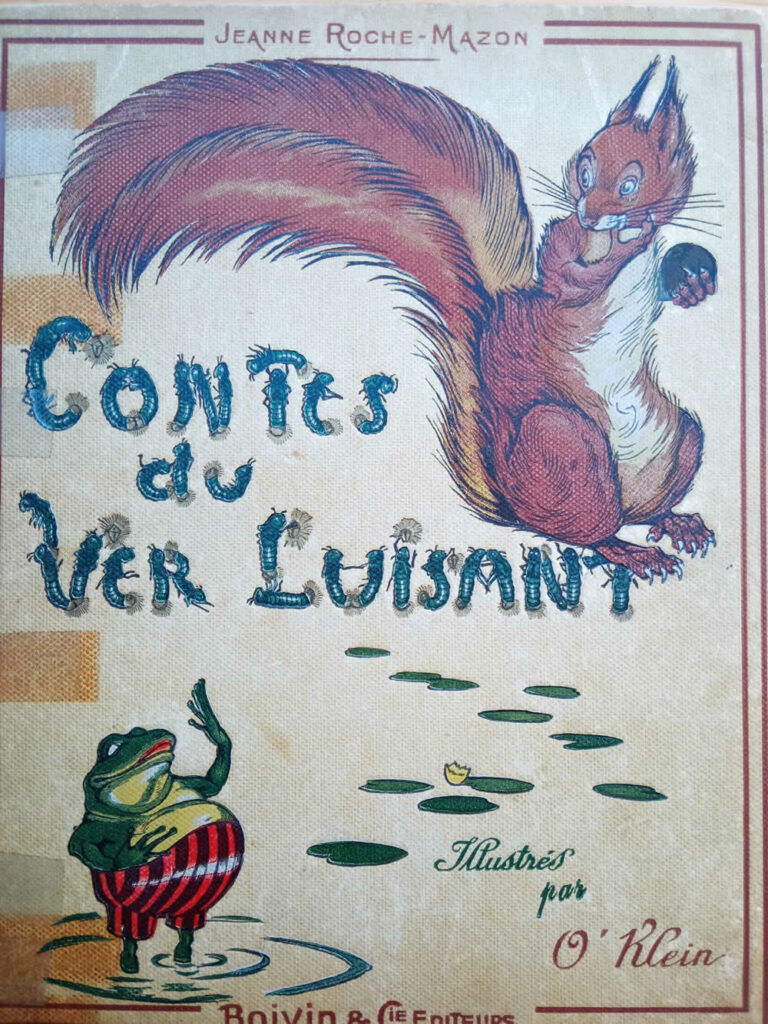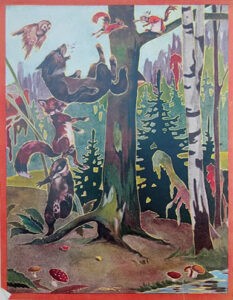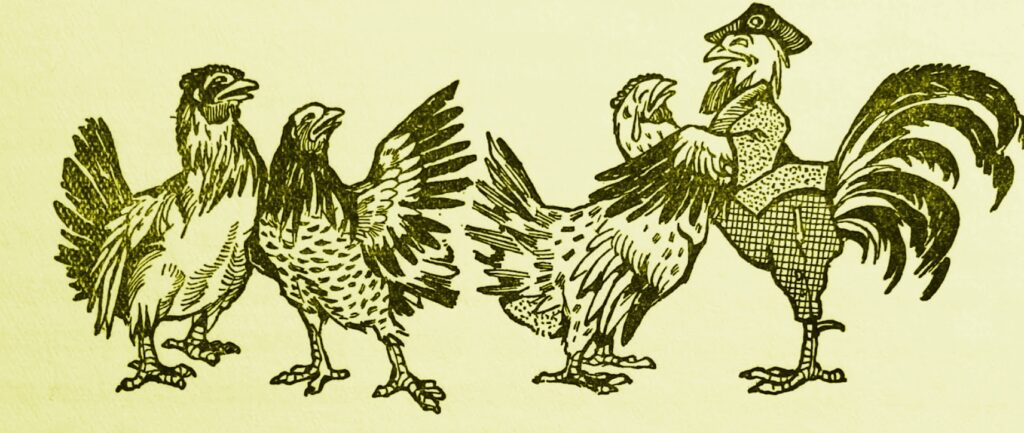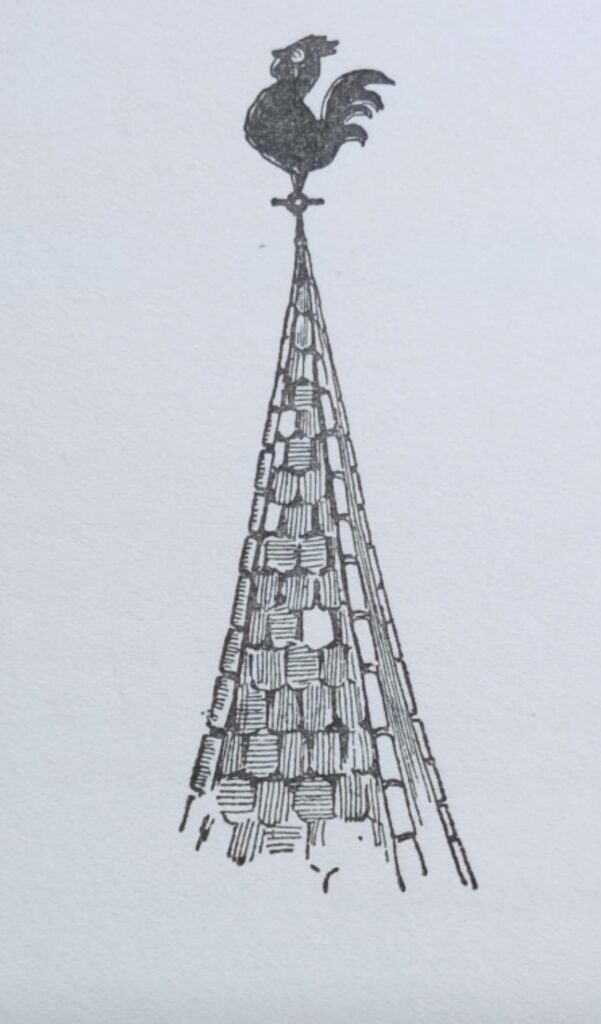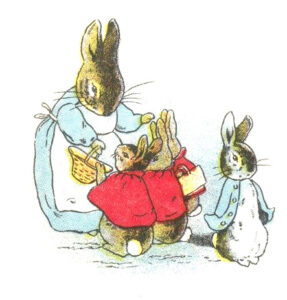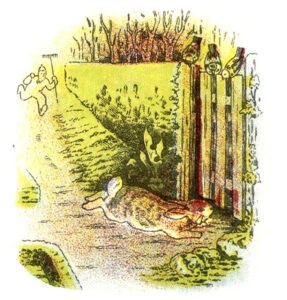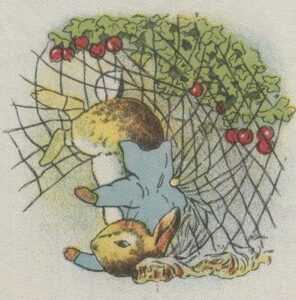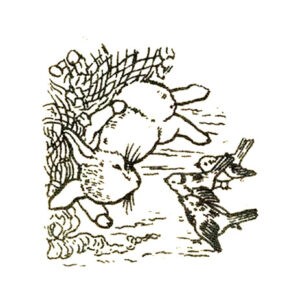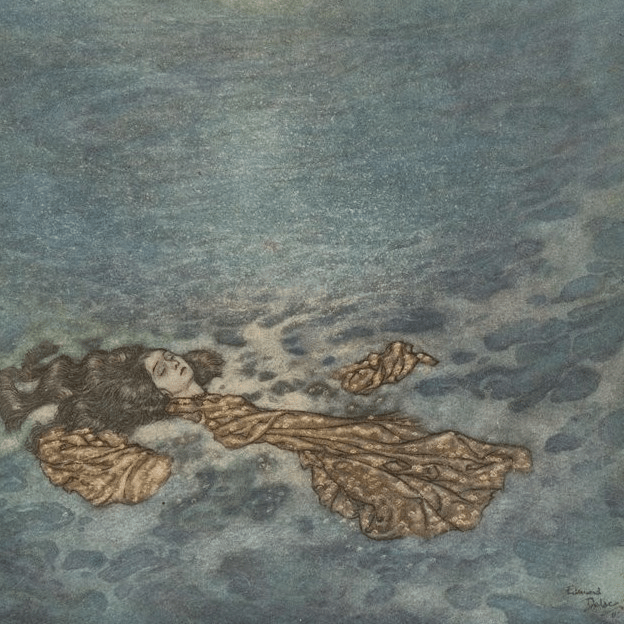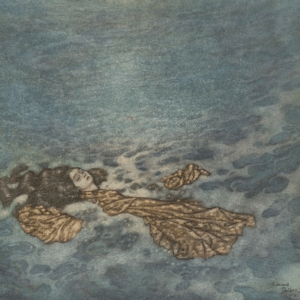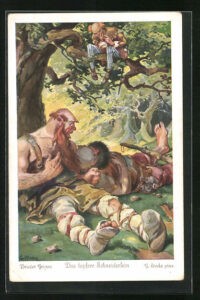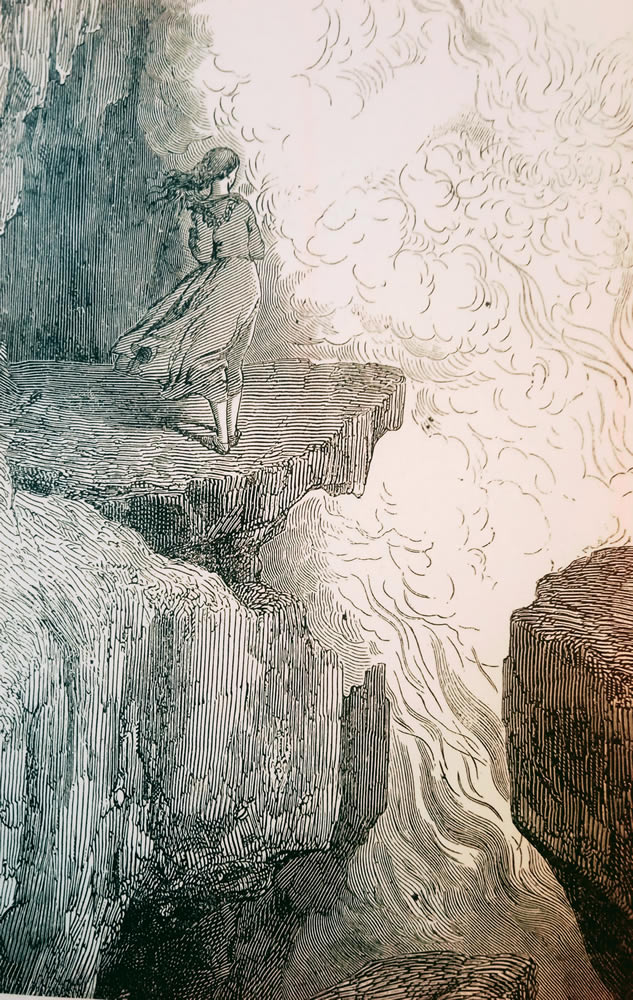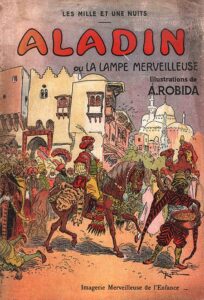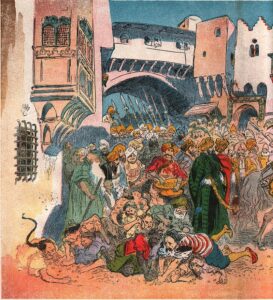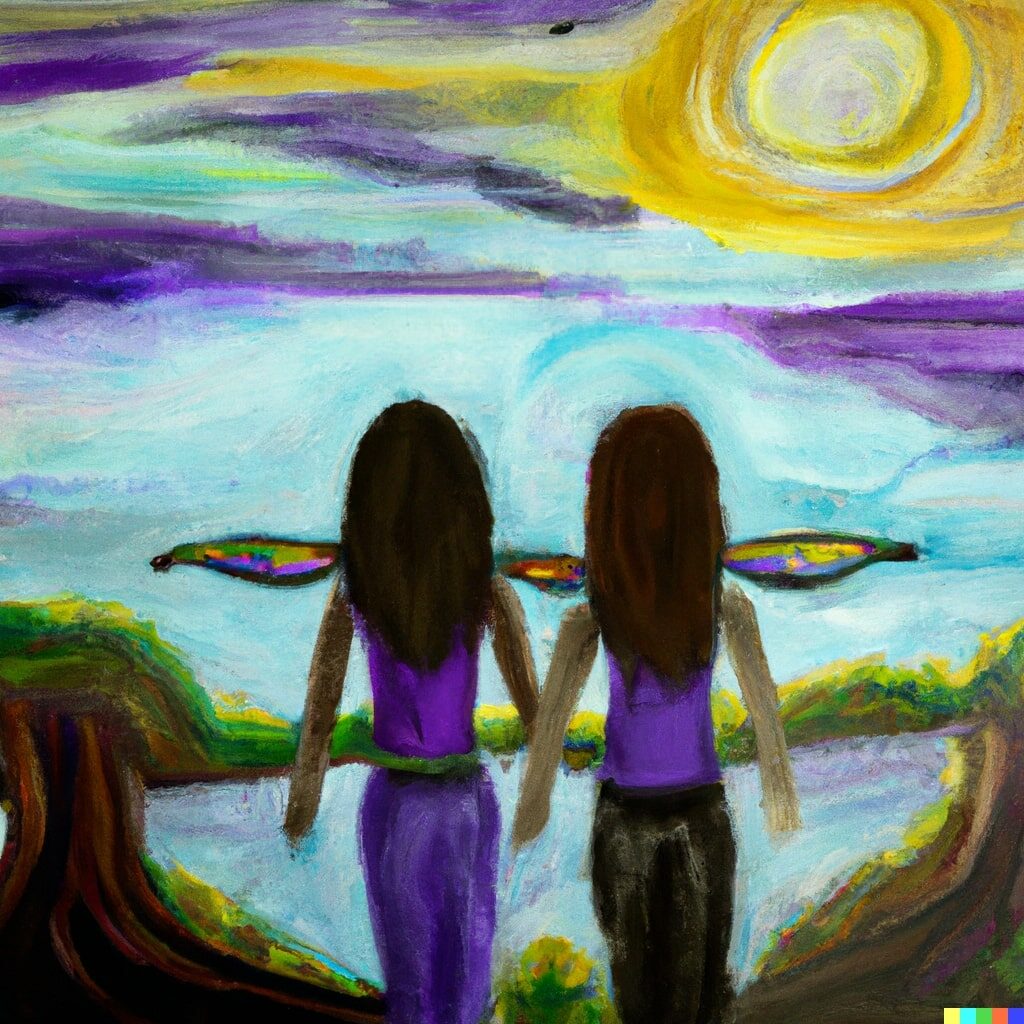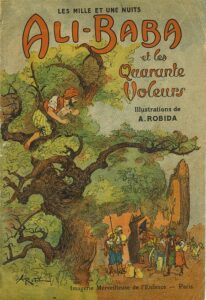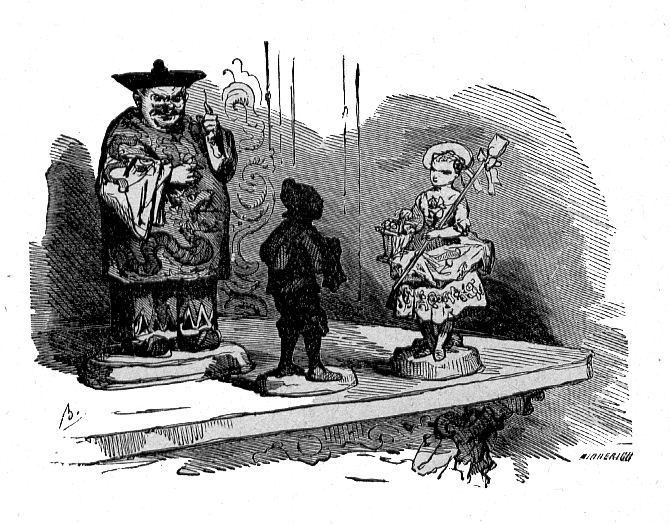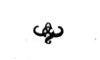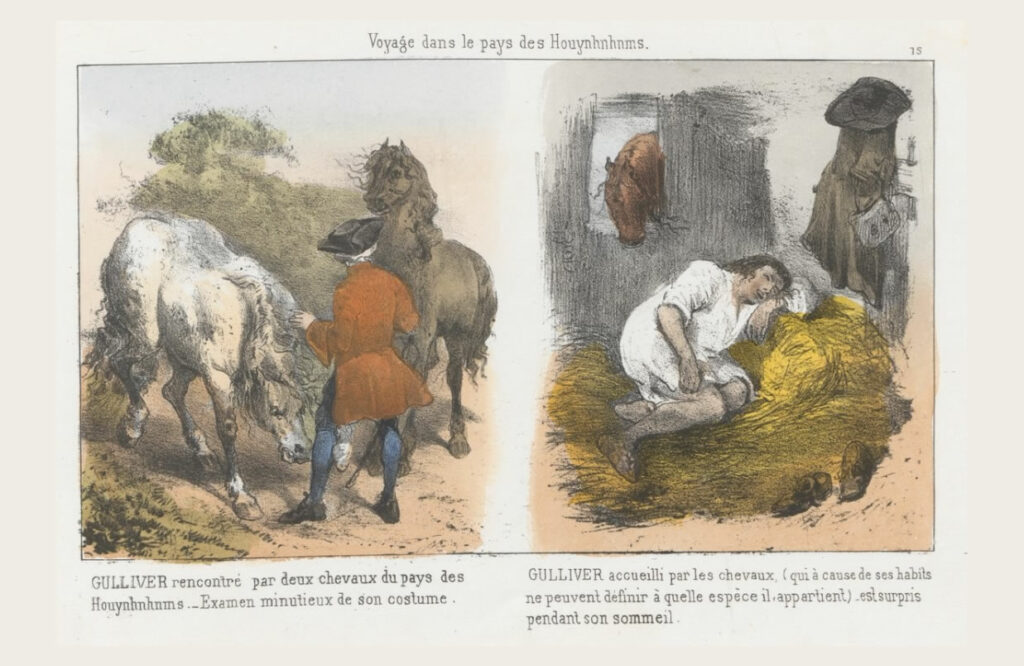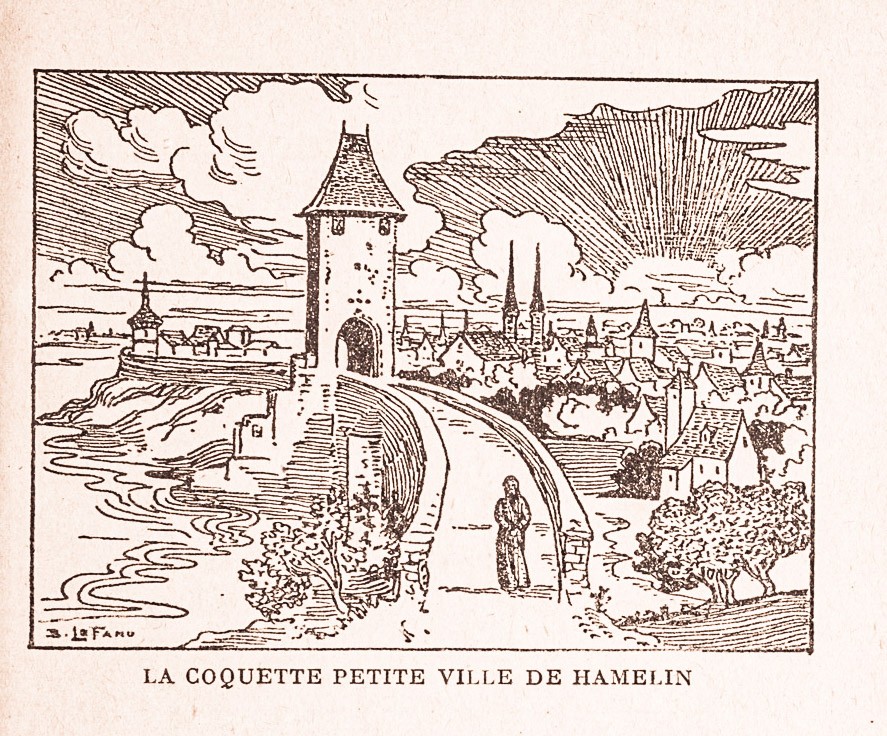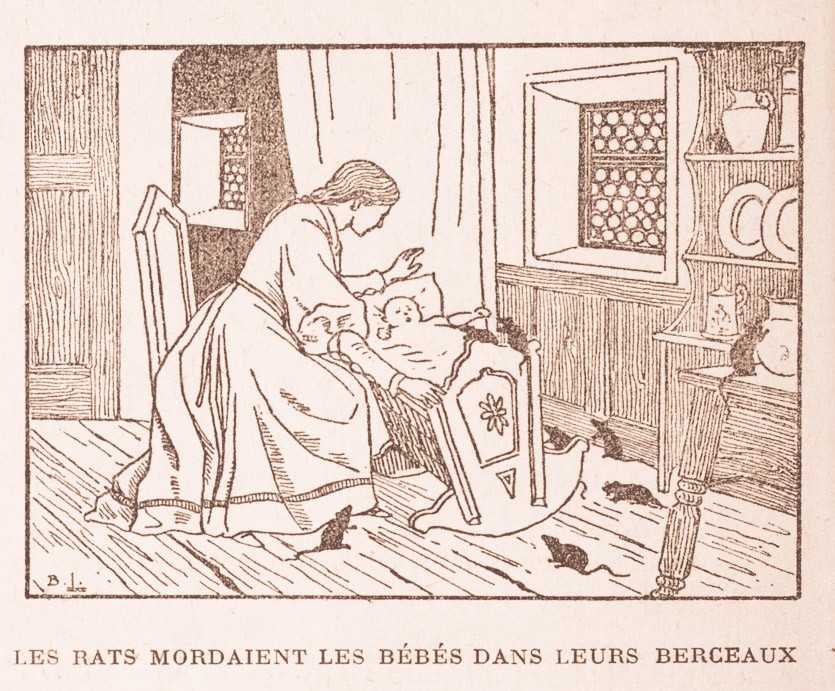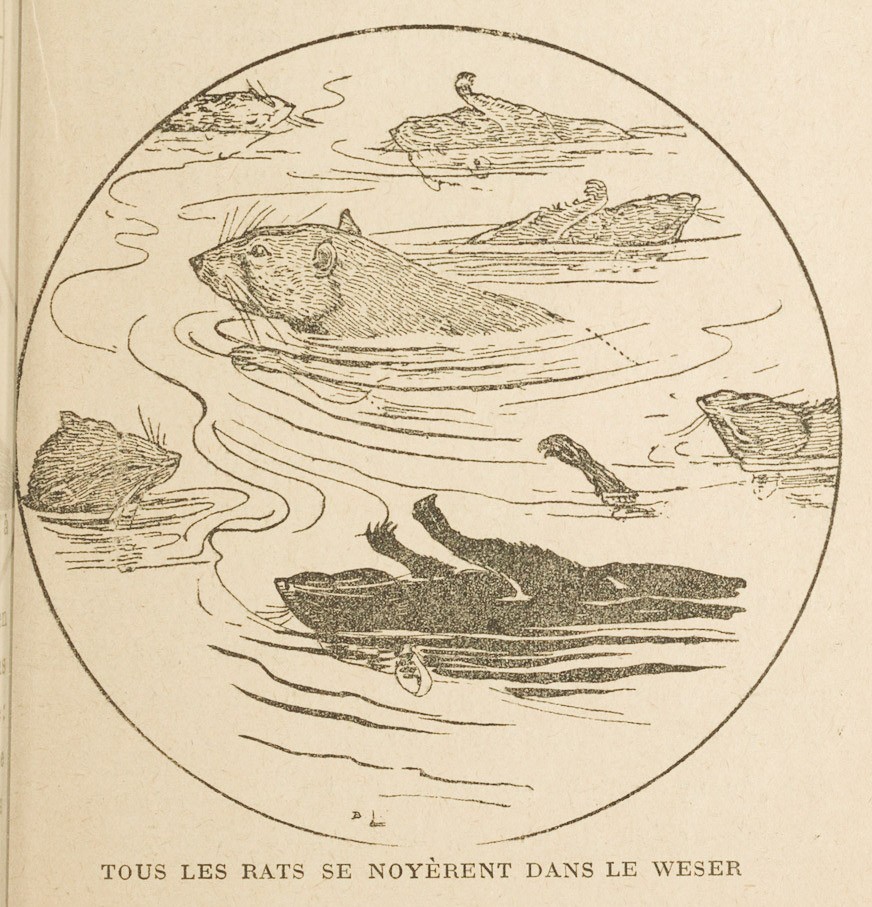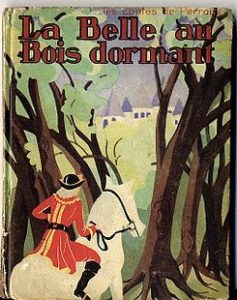Les trois petits cochons
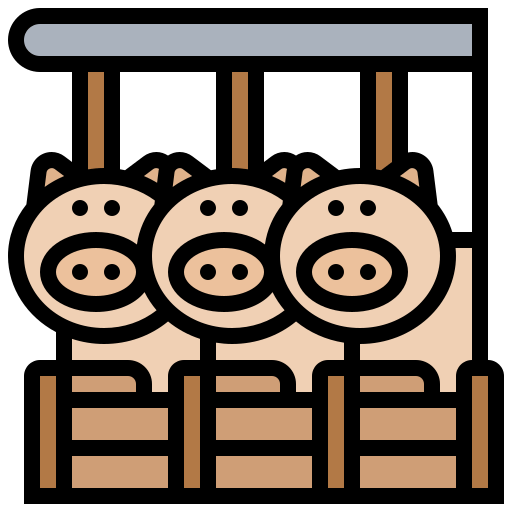
Existe en version plus courte, cliquez ici.
Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison.
Le plus jeune et le plus paresseux s’appelait Nouf Nouf, et jouait de la flûte.
Le second, un peu moins paresseux, s’appelait Nif Nif et jouait du violon.
L’aîné, le plus courageux et travailleur des trois, s’appelait Naf Naf, et jouait du piano.
Il grandissaient heureux en s’amusant et en jouant de la musique.
Mais un jour, leur mère les réunit et leur dit:
“Mes enfants, vous avez beaucoup grandi, et notre maison est bien trop petite pour nous tous maintenant. Il est temps que vous partiez faire votre vie et construisiez chacun votre propre maison. Je vous ai préparé un petit baluchon et demain vous partirez chacun de votre côté.
Mais surtout! Faîtes bien attention au grand méchant loup! S’il venait à rôder dans la région, vous devrez vous défendre et vous protéger, pour ne pas vous faire manger.”
Le lendemain, ils s’embrassèrent tous en versant de chaudes larmes et chacun prit sa route de son côté.
Nouf Nouf le plus jeune gambadait gaiement en jouant une jolie mélodie avec sa flûte, ce qui enchantait les petits oiseaux. Après quelques heures de chemin, il rencontra un paysan et son âne qui tirait une charrette de paille. Il lui dit:
“Bien le bonjour monsieur, pourriez-vous me vendre un peu de paille pour construire ma cabane?”
“Bien sûr mon petit! Tiens! Voilà un beau ballot”
Et non loin de là, le petit cochon construisit sa maison de paille en moins de temps qu’il ne faut pour dire ouf.
Content de lui, il reprit sa flûte et s’en alla en sautillant voir comment ses frères s’en sortaient.
Nif Nif le cadet, qui était presque aussi paresseux que son benjamin, marchait au hasard de la route lorsqu’il rencontra un charpentier transportant une charrette pleine de planches et de fagots de bois.
“Eureka!” Se dit le petit cochon. “Voici ma chance!”
Et il s’adressa ainsi au bonhomme:
“Bonjour Monsieur, auriez-vous un peu de bois pour construire ma maison, s’il vous plaît?”
“Bien sûr mon enfant” Répondit l’artisan, et il lui offrit quelques dizaines de planches et 2 fagots pour toit.
Tout heureux, Nif Nif s’en alla construire sa maison de bois non loin de là. À la fin de la journée, il avait presque fini lorsqu’il entendit s’approcher la jolie mélodie de la flûte de son frère Nouf Nouf. Il se dépêcha de terminer sa cabane pour pouvoir le rejoindre avec son violon et ainsi poursuivre leur route en dansant, à la recherche de leur grand frère Naf Naf.
Naf Naf l’aîné, et le plus intelligent et travailleur des trois avait été voir un maçon et lui avait acheté des briques, des tuiles et du ciment, pour se construire une vraie maison solide et prête à toute épreuve.
Mais évidemment, cette construction demandait beaucoup plus de temps, et lorsque ses frères le trouvèrent, il avaient à peine commencé à poser les briques du rez-de-chaussée.
Nif Nif et Nouf Nouf éclatèrent de rire et se moquèrent de lui à en perdre haleine.
“Ha ha ha ! À quoi bon te fatiguer ainsi! disait Nouf Nouf.
“Hi hi hi ! Viens plutôt jouer de la musique et danser avec nous!” Disait Nif Nif.
“Non!” Dit Nouf Nouf. “Pauvre imprudents sans cervelle! N’avez-vous pas écouté notre maman? Que ferez-vous si vient le loup? Croyez-vous que vos pauvres cabanes vous protégeront?”
Nif Nif et Nouf Nouf éclatèrent de rire encore plus fort, se roulant dans l’herbe jusqu’à en perdre le souffle et lui disaient:
“Quel âge as-tu pour croire à ces histoires de loups? Arrête de perdre ton temps et viens avec nous.”
Naf Naf devint tout rouge et s’écria:
“Non, non et non! Rira bien qui rira le dernier quand le grand méchant loup frappera à vos portes.”
Voyant qu’il ne céderait pas, les deux jeunes frères s’en allèrent en sautillant et retournèrent chacun dans sa cabane à la nuit tombée.
Quelques jours passèrent et ils profitaient gaiement de leur vie insouciante tout en rendant visite à Naf Naf pour s’amuser à ses dépends, en inventant des chansons moqueuses qui lui faisaient répéter:
“Rira bien qui rira le dernier!” En même temps qu’il poursuivait son ouvrage.
Quelques jours plus tard, Naf Naf avait à peine posé la dernière brique de la cheminée de sa maison, que sortit de la forêt un horrible et énorme grand méchant loup. Il était noir et gris, et ses yeux jaunes étaient féroces, ses dents immenses et son ventre creux laissait apercevoir ses côtes saillantes.
Il sentit immédiatement l’odeur alléchante des trois petits cochons tout proches et sa gueule se mit à saliver jusqu’à former une épaisse écume blanche.
“Voici enfin le festin que j’attends depuis des semaines. Je ne vais en faire qu’une bouchée!” Se dit-il.
Il entendit alors la musique des deux petits cochons qui revenaient de chez leur grand frère et commença à courir derrière eux en grognant.
Nif Nif et Nouf Nouf l’entendirent juste à temps, et se mirent à courir de toutes leurs forces vers leurs maisons en se séparant à mi-chemin.
Le loup avait suivis Nouf Nouf et celui-ci avait à peine fermé sa porte qu’il entendit frapper:
“Boum boum boum! Petit cochon, dit le loup, ouvre-moi ta porte ou je soufflerai, et ta maison s’envolera!”
“Non, jamais de la vie” dit Naf Naf en tremblant.
Alors le grand méchant loup remplit ses poumons et commença à souffler de toutes ses forces:
“Pfffffffffff Hoooo Pfffffffffffff!”
En quelques secondes, toute la paille de la fragile maison avait disparu, et le petit cochon se retrouva tout surpris d’être aussi vite démuni.
Il se mit à courir de toutes ses forces vers la cabane de son frère Nif Nif.
“Nif Nif! Nif Nif!” Cria t-il en s’approchant. “Ouvre-moi vite! Le grand méchant loup me poursuit!”
Nif Nif, qui n’en croyait pas ses oreilles en tire-bouchon, ouvrit la porte et la referma juste au moment où le loup arrivait, s’écrasant le museau sur la planche de bois.
Nif Nif dit à Nouf Nouf tout tremblant: “Tu es à l’abri maintenant, ma maison de bois résistera!”
Mais ils entendirent rugir la voix du loup:
“Petits cochons! Petits cochons! Ouvrez-moi la porte!”
“Non non!” S’exclama Nif Nif. “Nous ne t’ouvrirons pas!”
Le loup répondit:
“Puisque c’est comme ça, je vais souffler, souffler, souffler, et votre maison s’envolera.”
Alors il gonfla sa poitrine et se mit à souffler de toutes ses forces:
“Pfffffffffff Hoooo Pfffffffffffff!”
La cabane se mit à trembler en résistant un peu.
Alors le grand méchant loup prit une nouvelle inspiration et souffla encore plus fort.
“Pffffffffffffffffff Hoooooooooooo Pfffffffffffffffffffff!”
Cette fois, les planches s’envolèrent d’un coup, et les deux petits cochons se retrouvèrent avec seulement la porte entre les mains.
Nif Nif jeta la porte au loup et ils se mirent à courir, courir, courir, en direction de la maison de briques de leur frère Naf Naf.
Celui-ci les entendant arriver, regarda ce qu’il se passait par la fenêtre. Il vit le grand méchant loup derrière ses deux frères qui couraient éperdument dans sa direction.
Il eut le temps de fermer les volets et d’ouvrir la porte pour les sauver in extremis.
“Que vous avais-je dit, petits cochons sans cervelle!” Cria t-il à ses deux frères tremblant de peur et de n’avoir jamais couru aussi vite de leur vie.
“Vous êtes bien contents d‘avoir une vraie maison pour vous protéger maintenant!”
“Pardonne-nous Naf Naf!” dirent-ils en pleurant.
À ce moment, de grands coups retentirent à la porte. C’était le loup.
“Boum Boum Boum. Petits cochons, petits cochons! Ouvrez-moi la porte ou je soufflerai, soufflerai, soufflerai, et votre maison s’envolera.”
Naf Naf lui dit d’un ton ferme:
“Souffle si tu veux, loup. Ma maison est trop solide pour toi!”
Le grand méchant loup, furieux d’entendre cela, pris une grande inspiration:
“Huuuuuuuuuu”
Et souffla de toutes ses forces:
“Pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff!”
La maison ne bougea pas d’un pouce.
Enragé, il souffla à nouveau:
“Pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff!”
Mais la maison resista, solide comme un roc.
Il souffla, souffla et souffla encore jusqu’à perdre haleine.
“Hufufufufufu”
Il devait se rendre à l’évidence que cette fois, son puissant souffle ne suffirait pas.
Alors, il commença à rôder autour de la maison, à la recherche d’une autre idée pour atteindre son festin tant désiré.
Pendant ce temps-là, les trois petits cochons se réjouissaient en s’embrassant et en dansant:
“Nous sommes sauvés!” disaient les deux plus jeunes.
Mais Naf Naf, méfiant, leur dit: “Attendez, nous ne sommes pas encore tirés d’affaires, tant que le grand méchant loup rôde dans les parages.
Il ne croyait pas si bien dire, car le loup avait eu une idée en examinant toute la maison de brique. Il avait aperçu la cheminée sur le toit, et avait commencé à escalader le mur pour y accéder et y descendre pour attraper son repas.
Heureusement, Naf Naf, qui était aux aguets, avait entendu les pas du loup sur le toit, et il avait mis rapidement une grande marmite d’eau chaude à bouillir sur le feu.
Lorsque le grand méchant loup descendit par le conduit de la cheminée, il se brûla tellement fort, qu’il sauta à plusieurs mètres en repassant par la cheminée en sens inverse.
Il courut, courut, courut jusqu’à disparaître complètement. Et on ne le revit plus jamais dans la région.
Les trois petits cochons sortirent tout joyeux de la maison de briques et se mirent à danser en rond en chantant:
”Qui a peur du grand méchant loup, c’est peut-être vous? C’est pas nous!”
Naf Naf put enfin se joindre à la flûte de Nouf Nouf et au violon de Nif Nif en les accompagnant gaiement sur son piano.
Finalement, il invita ses frères à vivre dans sa maison en attendant qu’ils construisent chacun leur propre maison de brique.
Version écrite par Roland beaussant de Contesdefees.com
Illustrations de Leonard Leslie Brooke (1862 – 1940)
Le Petit Chaperon Rouge

Adaptation para CDF du texte original de Charles Perrault avec les illustrations de M. Fauron
Il était une fois, dans un village, une petite fille, si jolie et si gentille, que tous ceux qui la connaissaient l’aimaient. Sa mère l’adorait, et sa grand’mère encore plus, si cela est possible.
La vieille dame lui avait fabriqué une cape de couleur rouge ou chaperon. La couleur et la forme de cette cape allaient si bien à la fillette qu’elle s’en habillait tout le temps ; et bientôt, tout le monde aux alentours ne la connut plus que sous le nom de petit Chaperon Rouge.
Un jour, la maman du petit Chaperon Rouge avait fait de belles galettes dorées. Elle appela sa petite fille et lui dit :
— J’ai appris que ta grand’mère était malade, va voir comment elle se porte, et donne-lui ce petit pot de beurre frais et cette galette feuilletée;
mais surtout ne t’amuse pas en route; car tu dois revenir avant le coucher du soleil.
L’enfant embrassa sa mère, et partit gaiment, promettant d’ètre bien sage.
La grand’mère du petit Chaperon Rouge vivait dans le hameau voisin. Elle habitait une jolie maison blanche, près d’un moulin.
Pour y arriver, on devait traverser un bois assez grand, et c’etait une agréable promenade.
Chaperon Rouge marchait d’un pas pressé, sa galette sous le bras et son pot de beurre à la main, suivant une clairière qui aboutissait au moulin.
À peine avait-elle fait un bout de chemin, qu’elle aperçut compère le Loup.
Justement, il était très affamé et fut ravi de la rencontre.
Il lui aurait été facile de sauter sur le petit Chaperon Rouge pour la dévorer; mais il se dit que, sûrement, les cris de l’enfant attireraient les bûcherons qui travaillaient non loin de là.
Il vaut mieux, pensa-t-il, agir par la ruse.
S’approchant doucement de la petite fille, il prit sa voix la plus aimable, pour lui souhaiter le bonjour; et il ajouta :
— Où allez-vous ainsi, ma belle enfant?
— Je vais chez ma grand’mère, répondit Chaperon Rouge, porter un petit pot de beurre et cette galette que ma mère lui envoie.
— Et où demeure votre grand’mère ? demanda encore le rusé personnage.
— Près du moulin qu’on voit tourner la-bas, riposta la naïve enfant.
— Elle habite ainsi toute seule ? insista le Loup.
— Oui, fit Chaperon Rouge, et maintenant elle est faible et malade.
— Ah! ah! repartit l’animal, très intéressant ! Je vais aller la guérir.
Prenez ce chemin-là, et moi celui-ci, nous verrons lequel de nous deux arrivera le plus vite.
La fillette entra dans le sentier que lui désignait le Loup.
Elle y aperçut des noisettes qu’elle se mit à croquer.
Puis elle cueillit du chèvrefeuille, qui paraissait fleurir tout exprès à la portée de sa main.
Pendant ce temps, le Loup, certain de n’être plus vu par la petite fille, continua la clairière et, en quelques bonds, atteignit le moulin.
Quand le Chaperon Rouge eut fait un gros bouquet, elle se laissa entrainer à attraper des papillons. Puis elle s’amusa à poursuivre un écureuil, à voir jouer des petits lapins.
Ils étaient si drôles, l’un rongeant une feuille, l’autre faisant sa toilette ! On aurait dit qu’il se frisait la moustache. Chaperon Rouge en rit si fort qu’elle les mit en fuite.
Tandis que le petit Chaperon Rouge flânait tout à son aise, compère le Loup frappait à la porte de la grand’mère.
— Qui est là? demanda une voix cassée.
— C’est votre petite-fille, Chaperon Rouge, qui vous apporte une galette et un pot de beurre que ma mère vous envoie, répondit le Loup en imitant l’accent de la fillette.
— Tire la chevillette et la bobinette cherra, reprit la voix.
D’un coup de patte, le Loup tira la ficelle, le loquet tomba et la porte s’ouvrit.
Aussitôt, la méchante bête se jeta sur la pauvre vieille femme, qui était dans son lit, et la dévora en deux bouchées.
Puis, mettant son bonnet, il se glissa à sa place sous les couvertures, et attendit.
— Toc! toc! toc! fit-on a la porte au même moment.
— Qui est là? demanda le Loup en imitant la voix enrouée de sa malheureuse victime.
— C’est votre petite-fille, Chaperon Rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie.
— Tire la chevillette et la bobinette cherra, répliqua le Loup d’une voix cassée.
Chaperon Rouge obéit et entra, comme le Loup l’avait fait tout à l’heure.
Lorsque le féroce animal l’aperçut, il se cacha sous les draps, de façon à ne laisser voir que ses yeux et son bonnet.
— Grand’maman, comment vous portez-vous ? demanda Chaperon Rouge.
Un grognement lui répondit.
— Vous paraissez bien enrouée, dit encore l’enfant.
— Oui, je suis très enrhumée, prononça la voix nasillarde du Loup. Mets ta galette et le pot de beurre sur la table, continua l’horrible bête, et viens plus près moi.
Le Petit Chaperon Rouge s’approcha du lit.
Elle fut bien étonnée de voir combien sa grand’mère paraissait changée.
Elle écarta le rideau et s’arrèta effrayée, sans bien savoir pourquoi.
— Sans doute, pensa Chaperon Rouge, c’est ainsi que grand’maman a l’air dans son pijama !
Le Loup, qui jusque-là était resté tourné du côté de la muraille, sortit son museau.
— Oh! ma mère-grand, s’écria Chaperon Rouge, comme vous avez de grands yeux !
— C’est pour mieux te voir, mon enfant, répondit tendrement le Loup.
— Oh ! ma mère-grand, que vous avez un grand nez ! dit la petite fille avec un léger tremblement.
— C’est pour mieux te sentir, mon enfant, répliqua encore le Loup.
— Oh! ma mère-grand, continua Chaperon Rouge, que vous avez de grandes oreilles !
— C’est pour mieux t’entendre, mon enfant.
— Oh! ma mère-grand, comme vous avez de grands bras!
— C’est pour mieux t’embrasser, mon enfant.
— Oh! ma mère-grand, comme vous avez de grandes jambes !
— C’est pour mieux courir, mon enfant.
— Oh! ma mère-grand, comme vous avez de grandes dents !
— C’est pour mieux te manger !!!!!
En disant ces mots, avec un mauvais rire, le Loup se tourna brusquement sur le petit Chaperon Rouge qui tomba par terre en poussant des cris perçants.
Le Loup voulut sauter sur elle pour la dévorer.
Il trébucha dans la couverture et manqua son coup; mais il se dégagea bientôt et saisit l’enfant dans ses griffes.
— Ah! s’écria l’infernal personnage, tu ne m’échapperas pas!
Et ses crocs s’approchaient de la malheureuse petite fille…
Au même instant, la porte vola en éclats; et un homme armé d’un hâche parut sur le seuil.
Cet homme était le bûcheron, le père du petit Chaperon Rouge.
Il revenait de son travail, lorsqu’il rencontra sa femme accourant à travers le bois, remplie d’inquiétudes : Chaperon Rouge, partie depuis longtemps,
n’était pas encore revenue.
Partageant ces craintes, le bûcheron revint précipitamment sur ses pas, le fusil sur l’épaule, pour chercher son enfant.
L’anxiété du père grandissait au fur et à mesure que l’heure s’écoulait.
Il doublait le pas et appelait en vain. Comme il approchait de la maison de la grand’mère, il entendit des cris aigus.
Plus de doute, c’est la voix de sa petite fille. Le désespoir augmentant son énergie, il ne s’arrète pas à ouvrir la porte mais l’enfonce à l’aide de sa hache. Le Loup terrifié lacha sa proie.
Avant que le féroce animal eût pu se défendre, il tombait la tète fendue d’un seul coup de hache, et baignait dans son sang.
Il était temps.
Une minute plus tard, il ne serait rien resté du joli petit Chaperon Rouge…
La pauvrette heureusement n’était que blessée.
Son papa la prit dans ses bras pour la ramener chez lui.
Qu’on juge de la joie de la maman, lorsqu’elle revit sa petite fille, et qu’on lui raconta le danger qu’elle avait couru!
Malheureusment, elle fut bien triste d’apprendre la fin si cruelle de sa pauvre vieille mère.
Longtemps, le petit Chaperon Rouge resta malade de la peur qu’elle avait éprouvée en se sentant sous les griffes de la bête féroce.
Ce fut une rude leçon, qu’elle n’eut garde d’oublier.
Devenue vieille, elle racontait encore son histoire à ses petits-enfants pour les inviter à la prudence.
Le Chat Botté

Il était une fois un meunier qui possédait un moulin, un âne et un chat et avait trois fils. Lorsqu’il mourut, il laissa en testament le moulin à son fils aîné, l’âne au second, et le chat au plus jeune. Ce dernier se sentait défavorisé et se demandait bien ce qu’il ferait avec seulement un chat.
Le chat, qui entendait cela lui dit d’un air posé et sérieux : Ne soyez pas triste, mon maître ; vous n’avez qu’à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller aux champs, et vous verrez que vous n’êtes pas si mal lotis que vous le croyez.
Quoique le maître du chat n’eut pas grand espoir, il lui avait vu faire tant de tours de passe-passe pour prendre des rats et des souris, qu’il se dit qu’il ne perdrait rien à essayer.
Lorsque le chat eut ses bottes et son sac, il courut vers un champ où il y avait de nombreux lapins. Il mit une carotte dans le sac et attrapa vite un jeune lapin inexpérimenté. Tout fier de sa proie, il s’en alla chez le roi et demanda à lui parler.
Arrivé dans la salle du trône, il fit une grande révérence au roi, et lui dit :
– Sire, voici un lapin chassé par M. le marquis de Carabas ( C’était le nouveau nom qu’il avait donné à son maître ). Il m’a chargé de vous l’apporter en cadeau.
– Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie chaleureusement.
Une autre fois il prit deux perdrix dans son sac et il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait avec le lapin. Le roi, fin gourmet, accepta avec joie, et lui fit donner à boire.
Le chat continua ainsi, pendant deux ou trois mois, d’apporter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître.
Un jour il apprit que le roi devait passer près de la rivière durant un voyage en carrosse, avec sa fille, la plus belle princesse du monde
Il dit à son maître : Si vous suivez mon conseil, votre fortune est faite : vous n’avez qu’à vous baigner dans la rivière à l’endroit que je vous indiquerai, et ensuite vous me laissez faire.
Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans rien y comprendre. Alors qu’il se baignait, le cortège du roi arriva, et le chat se mit à crier de toute sa force : Au voleur! Au voleur!
Le roi reconnut le chat qui était devenu son ami, et ordonna à ses gardes d’aller porter secours au M. le marquis de Carabas.
Le chat inventa qu’un voleur avait emporté les habits et le cheval de son maître qui se trouvait bien embêté pour rentrer chez lui. Le roi fit apporter immédiatement de nouveaux habits neuf pour le faux marquis et l’invita à monter dans son carrosse.
En le voyant, la fille du roi tomba éperdument amoureuse du jeune marquis et lui aussi se prit d’amour pour la princesse. Il continuèrent ensemble la promenade. Le chat courut en avant sur le chemin jusqu’à rencontrer des paysans qui fauchaient leurs champs. Il leur dit : Si vous ne dites pas au roi que les prés que vous fauchez appartiennent à M. le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté.
Quelques minutes plus tard le roi arriva et demanda aux paysans à qui étaient les champs qu’ils fauchaient. C’est à M. le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, effrayés par la menace du chat botté. Le roi fut impressionné par la fortune du Marquis de Carabas.
Le chat, qui allait toujours en avance devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu’il rencontrait: Si vous ne dites pas au roi que les prés que vous fauchez appartiennent à M. le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menu comme chair à pâté ; et le roi était étonné des grands biens du marquis.
Le chat botté arriva enfin dans un beau château, appartenant à un ogre très riche. Il était le propriétaire de toutes les terres qu’ils avaient traversé.
– On m’a dit, dit le chat à l’ogre, que vous avez le pouvoir de vous changer en toutes sortes d’animaux, que vous pouviez, par exemple, vous transformer en lion, en éléphant.
Cela est vrai, répondit l’ogre brusquement. Et il se transforma immédiatement en Lion devant le chat botté effrayé qui sauta en l’air.
Une fois l’ogre redevenu lui-même, le chat botté revenu de sa frayeur, lui dit :
– On m’a dit aussi que vous saviez vous changer en petit animaux, les rats ou les souris, mais je ne peux pas le croire…,
Piqué au vif, l’ogre se changea immédiatement en souris et se mit à courir sur le plancher.
Le chat botté se jeta dessus et le mangea.
Quelques minutes après, arrivait le roi et sa troupe.
Le chat s’avança devant le château et prononça gravement:
– Bienvenus chez le Marquis de Carabas, mon maître!
– Comment! S’écria le roi. Ce domaine est à vous, Monsieur le Marquis? Vous m’impressionnez!
Il n’eut pas le temps d’en dire plus car le chat botté les entraîna dans la grande salle pour s’attabler autour d’un magnifique banquet que l’ogre avait organisé pour ses amis. Le roi était si impressionné et se délectait tellement en dégustant les innombrables mets du buffet et les grands vins de la cave, qu’il offrit la main de sa fille au Marquis de Carabas.
Celui-ci accepta et ils se marièrent le jour même.
C’est ainsi que le jeune fils du meunier devint prince, et que le chat botté devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir.
D’après charles Perrault, modernisé par Roland Beaussant, contesdefees.com
Blanche Neige
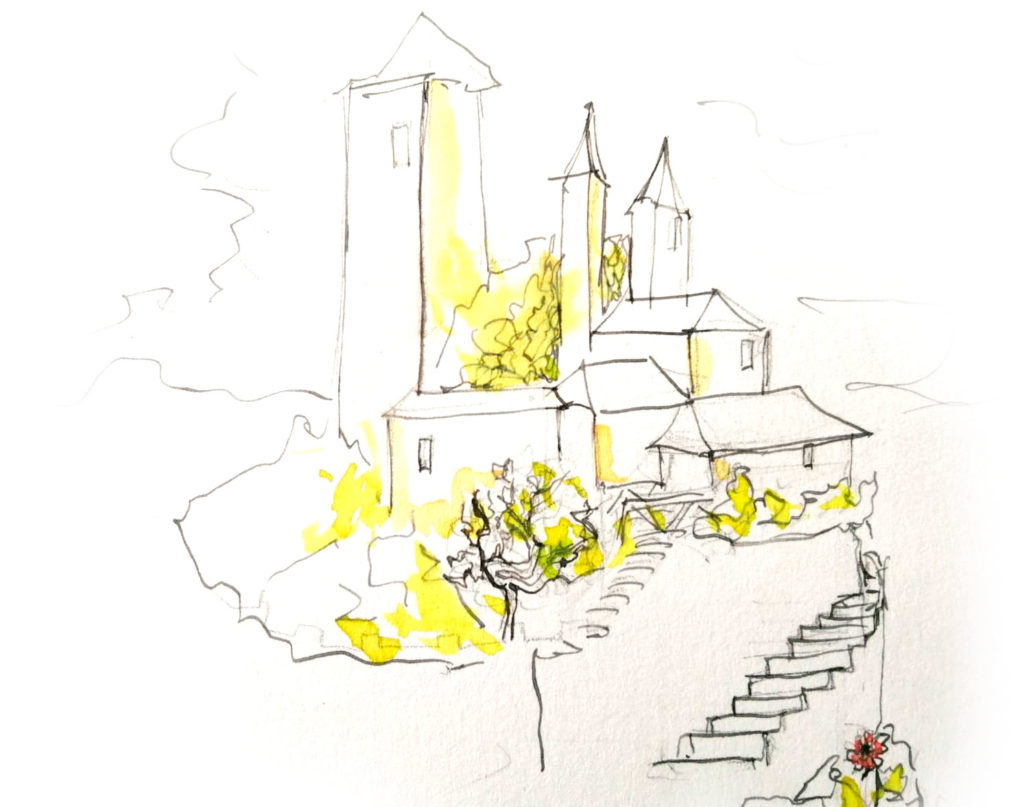 D’après les frères Grimm. Lu par Sophie de Pas (Écuries des Vallées). Illustrations à l’aquarelle d’Isabelle Beaussant – de Pas.
D’après les frères Grimm. Lu par Sophie de Pas (Écuries des Vallées). Illustrations à l’aquarelle d’Isabelle Beaussant – de Pas.
C’était au milieu de l’hiver, et les flocons de neige tombaient comme des plumes. Une reine était assise près de sa fenêtre au cadre d’ébène et cousait. Et comme elle cousait et regardait la neige, elle se piqua les doigts avec son épingle et trois gouttes de sang en tombèrent.
Et voyant ce rouge si beau sur la neige blanche, elle se dit :
« Oh ! si j’avais un enfant blanc comme la neige, rouge comme le sang et noir comme l’ébène ! »
Bientôt elle eut une petite fille qui était aussi blanche que la neige, avec des joues rouges comme du sang et des cheveux noirs comme l’ébène ; ce qui fit qu’on la nomma Blanche-Neige. Et lorsque l’enfant eut vu le jour, la reine mourut.
Un an après, le roi prit une autre femme. Elle était belle, mais fière et hautaine à ne pouvoir souffrir qu’aucune autre la surpassât en beauté. Elle avait un miroir merveilleux ; et quand elle se mettait devant lui pour s’y mirer, elle disait :
« Petit miroir, petit miroir,
Quelle est la plus belle de tout le pays ? »
Et le miroir répondait :
« Madame la reine, vous êtes la plus belle. »
Alors elle était contente, car elle savait que le miroir disait la vérité.
Mais Blanche-Neige grandissait et devenait toujours plus belle ; et quand elle eut sept ans, elle était aussi belle que le jour, plus belle que la reine elle-même. Et lorsqu’elle demanda une nouvelle fois à son miroir :
« Petit miroir, petit miroir,
Quelle est la plus belle de tout le pays ? »
Il lui répondit aussitôt :
« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici,
Mais Blanche-Neige est mille fois plus belle que vous. »
La reine, consternée, devint livide de rage et d’envie. Depuis ce moment, la vue de Blanche-Neige lui bouleversa le cœur, tant la petite fille lui inspirait de haine. L’envie et la jalousie ne firent que croître en elle, et elle n’eut plus de repos ni jour ni nuit. Enfin, elle fit venir un chasseur du palais et lui dit :
« Portez l’enfant dans la forêt ; je ne veux plus l’avoir devant les yeux ; là, vous la tuerez et vous m’apporterez son coeur, comme preuve de l’exécution de mes ordres. »
Le chasseur obéit et emmena l’enfant avec lui ; et quand il eut tiré son couteau de chasse pour percer le cœur de l’innocente Blanche-Neige, voilà que la petite fille commença à pleurer et dit :
« Ah ! mon bon chasseur, laisse-moi la vie ! Je courrai dans la forêt sauvage et ne reviendrai jamais. »
Elle était si belle que le chasseur eut pitié d’elle et dit :
« Va, pauvre enfant ! »
Il pensait en lui-même :
« Les bêtes féroces vont te dévorer bientôt. »
Pourtant, il se sentit le cœur soulagé d’un grand poids à l’idée qu’il avait pu se dispenser de l’égorger. Et comme il vit courir devant lui un sanglier, il le tua et rapporta son coeur à la reine qui se réjouit en croyant sa volonté accomplie.
Pendant ce temps, la pauvre enfant errait toute seule dans l’épaisse forêt, et elle avait si grand’peur qu’elle regardait d’un air inquiet tous les arbres et toutes les feuilles, ne sachant où trouver du secours. Puis elle se mit à courir sur les pierres pointues et sur les épines, et les bêtes féroces bondissaient à côté d’elle, mais sans lui faire aucun mal. Elle courut aussi longtemps que ses pieds purent la porter, jusqu’à la brune, et elle aperçut alors une petite cabane où elle entra pour se reposer. Tout dans cette cabane était petit, mais si gentil et si propre qu’on ne saurait le décrire. Il y avait une petite table recouverte d’une nappe blanche avec sept petites assiettes, chaque assiette avec sa petite cuiller, puis sept petits couteaux, sept petites fourchettes et sept petits gobelets. Contre le mur, il y avait sept petits lits l’un à côté de l’autre, couverts de draps blancs comme la neige.
Blanche-Neige avait très-faim et très-soif. Elle mangea une cuillerée de légumes avec une bouchée de pain dans chaque assiette, et but dans chaque gobelet une goutte de vin, car elle ne voulait pas prendre une seule part tout entière. Puis, comme elle était fatiguée, elle essaya de se coucher dans un des petits lits ; mais l’un était trop long, l’autre trop petit, et enfin il n’y eut que le septième qui fût à sa taille ; elle y resta donc, fit sa prière et s’endormit.
La nuit venue, les maîtres de la cabane arrivèrent ; c’étaient des nains qui cherchaient de l’or dans les montagnes. Ils allumèrent leurs petites lampes, et quand le logis fut éclairé, ils virent bientôt que quelqu’un avait passé par là, car tout n’était plus dans le même ordre où ils l’avaient laissé.
Le premier dit :
« Qui s’est assis sur ma chaise ? »
Le second :
« Qui a mangé dans mon assiette ? »
Le troisième :
« Qui a pris de mon pain ? »
Le quatrième :
« Qui a touché à mes légumes ? »
Le cinquième :
« Qui a piqué avec ma fourchette ? »
Le sixième :
« Qui a coupé avec mon couteau ? »
Et le septième :
« Qui a bu dans mon gobelet ? »
Puis le premier se retourna et il vit que son lit était un peu affaissé.
« Qui s’est couché dans mon lit ? » dit-il.
Et les autres d’accourir et dire :
« Dans le mien aussi, il y a eu quelqu’un. »
Mais le septième, en regardant son lit, aperçut Blanche-Neige qui y était couchée et dormait. Il appela ses frères, qui se hâtèrent de venir et se récrièrent d’étonnement ; et chacun alla chercher sa lampe pour mieux contempler Blanche-Neige.

« Ah ! mon Dieu, ah ! mon Dieu, répétaient les nains, que cette enfant est belle ! »
Ils étaient ravis de l’admirer et se gardèrent bien de l’éveiller ; le septième nain dormit une heure dans le lit de chacun de ses compagnons jusqu’au point du jour. Le matin, quand Blanche-Neige sortit de son sommeil, elle vit les petits hommes et fut effrayée. Mais ils se montrèrent fort aimables et lui demandèrent son nom.
« Je m’appelle Blanche-Neige, » dit-elle.
— Par quel hasard, reprirent les nains, es-tu venue dans notre maison ? »
Alors elle leur conta son histoire : comment sa belle-mère avait voulu la faire tuer, comment le chasseur l’avait épargnée, et comment elle avait couru tout le jour jusqu’à ce qu’elle rencontrât la petite cabane. Les nains lui dirent :
« Veux-tu faire notre ménage, les lits, la cuisine, coudre, laver, tricoter ? En ce cas, nous te garderons avec nous et tu ne manqueras de rien. »
Blanche-Neige leur promit tout ce qu’ils désiraient et resta chez eux. Elle vaquait aux soins du ménage. Le matin, les nains s’en allaient pour chercher dans les montagnes de l’airain et de l’or ; le soir, ils rentraient au logis, où le dîner devait se trouver prêt. Toute la journée la jeune fille était seule, et ils l’avertissaient en partant de se tenir sur ses gardes : « Car, disaient les bons petits hommes, ta marâtre saura bientôt que tu es ici ; n’ouvre à personne ! »
En effet quelques temps après, la reine, qui pensait bien être de nouveau la plus belle femme du pays, voulu en avoir le cœur net, et elle se mit devant son miroir et lui dit :
« Petit miroir, petit miroir,
Quelle est la plus belle de tout le pays ? »
Aussitôt le miroir de répondre :
« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici,
Mais Blanche-Neige au-delà des montagnes,
Chez les sept petits nains,
Est mille fois plus belle que vous. »
La reine pâlit de colère ; elle savait que le miroir ne mentait pas, et elle compris que le chasseur l’avait trompée et que Blanche-Neige vivait encore. Elle songea immédiatement aux moyens de la tuer ; car aussi longtemps qu’elle ne serait pas la plus belle, elle sentait qu’elle n’aurait pas de repos. Enfin, elle imagina de se maquiller le visage et de s’habiller en vieille marchande, de façon à se rendre méconnaissable. Ainsi déguisée, elle alla dans les sept montagnes, chez les sept nains, frappa à la porte de la cabane et cria :
« De belles marchandises ! Achetez, achetez ! »
Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit :
« Bonjour, ma bonne femme ; que vendez-vous là ? »
— De bonnes marchandises, de belles marchandises, reprit l’autre, des lacets de toutes les couleurs ! »
Et elle tira de sa boîte un lacet tressé de soies de diverses couleurs.
« Je peux laisser entrer cette brave femme, » pensa Blanche-Neige.
Et tirant le verrou de la porte, elle ouvrit à la vieille et lui acheta le beau lacet.
« Enfant, dit la vieille, de quelle façon êtes-vous lacée ? Je vais vous montrer comment il faut faire. »
Blanche-Neige, sans aucun soupçon, se plaça devant elle, et se fit lacer avec le nouveau lacet ; mais la vieille le serra si fort que la jeune fille en perdit la respiration et tomba comme morte.
« Maintenant, tu as fini d’être la plus belle, » dit la marâtre, et elle s’en alla au plus vite.
Vers le soir, les sept nains revinrent à la cabane, mais quel ne fut pas leur trouble en apercevant leur chère Blanche-Neige étendue par terre sans mouvement et comme inanimée ! Ils la relevèrent, et quand ils eurent vu le lacet qui l’étranglait, ils le coupèrent ; alors elle commença à respirer faiblement et revint à elle peu à peu. Les nains écoutèrent le récit de ce qui s’était passé et dirent :
« La vieille marchande n’était autre que la reine ; prends garde de n’ouvrir à personne, désormais, en notre absence. »
La méchante reine, dès qu’elle fut de retour chez elle, alla droit à son miroir et lui demanda :
« Petit miroir, petit miroir,
Quelle est la plus belle de tout le pays ? »
Et le miroir magique de répondre :
« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici,
Mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes,
Chez les sept petits nains,
Est mille fois plus belle que vous. »
Lorsque la reine entendit cela, tout son sang se porta au cœur, tant sa colère fut violente à l’idée que Blanche-Neige était en vie.
« A présent, dit-elle, il faut que je trouve un moyen infaillible de la perdre ! »
Et, avec son art de sorcière, elle fabriqua un peigne empoisonné. Puis elle se déguisa de nouveau, sous la figure d’une autre vieille bohémienne. Elle s’en fut par les sept montagnes, chez les sept nains, frappa à la porte, et dit :
« Bonnes marchandises à vendre ! Achetez ! »
Blanche-Neige regarda par la fenêtre ; mais elle répondit :
— Je ne dois faire entrer personne ; passez votre chemin.
— On vous permettra bien de regarder seulement, » repartit la vieille, qui tira le peigne empoisonné et le mit sous les yeux de la jeune fille.
Il plut tellement à celle-ci qu’elle se laissa entraîner à ouvrir la porte. Lorsqu’elle eut acheté le peigne, la vieille dit :
« Attends je vais te peigner comme il faut. »
La pauvre Blanche-Neige, sans nulle méfiance, laissa faire la vieille ; mais à peine avait-elle entré le peigne dans les cheveux de sa victime, que le poison commença à agir, et que la jeune fille tomba par terre, comme frappée de mort.
« Eh bien, ma belle, dit la vieille en ricanant ; cette fois c’en est fait de toi ! »
Puis elle sortit.
Par bonheur, le soir approchait, et c’était l’heure du retour des nains. En voyant Blanche-Neige étendue ainsi, ils pensèrent tout de suite à sa belle-mère et cherchèrent partout la cause de ce qui venait d’arriver. Ils mirent la main sur le peigne empoisonné, et, à peine l’eurent-ils retiré, que Blanche-Neige reprit connaissance et raconta ce qui avait eu lieu. Les nains lui recommandèrent plus vivement que jamais de ne laisser pénétrer personne jusqu’à elle.
Tandis que la charmante enfant se remétait pour la troisième fois de ses frayeurs, la reine, dans son palais, consultait le miroir suspendu au mur :
« Miroir, petit miroir,
Quelle est la plus belle de tout le pays ? »
Et comme naguère il répondait :
« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici,
Mais Blanche-Neige, au-delà des montagnes,
Chez les sept petits nains,
Est mille fois plus belle que vous. »
Lorsque la marâtre entendit cette nouvelle réponse, elle trembla de fureur.
« Blanche-Neige mourra, s’écria-t-elle, quand il devrait m’en coûter la vie ! »
Puis elle s’enferma dans une chambre secrète où personne n’entrait, et y prépara une pomme empoisonnée, superbe à voir, blanche et rose de peau, fraîche à croquer ; cette pomme avait le pouvoir de tuer quiconque en goûterait un morceau. Lorsqu’elle l’eut bien apprêtée, la reine se peignit la figure, et, déguisée en paysanne, retourna dans les sept montagnes, au pays des sept nains. Parvenue à la cabane où demeurait Blanche-Neige, elle frappa, et la jeune fille mit la tête à la fenêtre.
« Je ne dois laisser entrer personne, dit-elle, les nains me l’ont défendu.
— Soit ! répliqua la paysanne, cela m’est égal ; on m’achètera mes pommes ailleurs ; tenez, en voici une, je vous la donne.
— Non, dit Blanche-Neige, je ne dois rien prendre.
— Auriez-vous peur de quelque poison ? dit la vieille ; regardez, voici ma pomme coupée en deux moitiés : mangez la rouge, moi je mangerai la blanche. »
Mais la pomme était préparée avec tant d’art, que le côté rouge seul était empoisonné. Blanche-Neige avait bien envie de la belle pomme, et lorsque la paysanne se mit à en manger la moitié, la pauvre petite ne put y tenir davantage ; elle tendit la main et prit la moitié où se trouvait le poison. A peine ses lèvres s’y furent-elles posées, qu’elle tomba morte sur le sol. La reine la considéra avec des yeux terribles, rit aux éclats et dit :
« Blanche comme neige ! rouge comme sang ! noire comme l’ébène ! cette fois-ci les nains ne te réveilleront point ! »
Et lorsqu’elle interrogea son miroir, selon sa formule habituelle :
« Petit miroir, petit miroir,
Quelle est la plus belle de tout le pays ? »
Il répondit enfin :
« Madame la reine, la plus belle, c’est vous ! »
Alors, le cœur envieux de la marâtre fut satisfait, autant que peut l’être un cœur envieux.
Les nains, en arrivant à la maison, le soir, trouvèrent Blanche-Neige étendue encore une fois par terre, sans haleine et sans mouvement. Ils la relevèrent, cherchèrent la cause de ce nouveau malheur, la desserrèrent, peignèrent ses cheveux, et lui lavèrent le visage avec de l’eau et du vin ; mais rien n’y fit : la pauvre enfant était morte et resta morte.
Ils la couchèrent et se mirent tous les sept autour d’elle, veillant et pleurant pendant trois jours. Puis ils voulurent l’enterrer ; mais elle avait si bien l’air d’une personne vivante, tant ses joues étaient fraîches et roses, qu’ils se dirent :
« Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. »
Ils lui firent un cercueil de verre pour qu’on pût la voir de tous côtés, l’ensevelirent dedans et écrivirent dessus en lettres d’or, qu’elle était fille de roi, et se nommait Blanche-Neige. Ensuite ils placèrent le cercueil sur le haut de la montagne, et l’un d’eux restait toujours auprès d’elle pour la garder. Les oiseaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige : le premier fut un hibou, le second un corbeau, et le troisième une colombe.
Blanche-Neige était ainsi depuis bien longtemps dans son cercueil et ne changeait pas de figure, ne semblant toujours qu’endormie, car elle était toujours blanche comme neige, avec des joues rouges comme du sang, sous ses beaux cheveux noirs comme l’ébène.
Or, il advint qu’un fils de roi, allant par la forêt, arriva chez les nains pour y passer la nuit. Il vit Blanche-Neige couchée dans le cercueil de verre sur la montagne, et lut ce qui s’y trouvait écrit en lettres d’or. Alors il dit aux nains :
« Livrez-moi ce cercueil, je vous donnerai ce que vous voudrez. »
Mais les nains répondirent :
« Nous ne le livrerions pas pour tout l’or du monde !
— Eh bien, reprit-il d’un ton suppliant, faites-m’en présent ; car je ne peux plus vivre sans voir Blanche-Neige. »
Les bons petits nains, touchés de ses prières, eurent pitié de lui et lui permirent d’emporter le cercueil. Les serviteurs du prince le soulevèrent sur leurs épaules ; mais, ayant heurté du pied une grosse racine, ils tombèrent, et par l’effet du choc, le cœur de la pomme sortit de la gorge de Blanche-Neige. Presque aussitôt, elle rouvrit les yeux, se redressa et dit :
« Mon Dieu ! où suis-je ?
— Avec moi qui t’aime plus que tout au monde ! s’écria le fils de roi plein de joie. »
Et il lui raconta ce qui s’était passé.
« Viens avec moi dans le château de mon père, dit-il, et tu seras ma femme. »
Et Blanche-Neige sentit bien qu’elle l’aimait aussi, et elle s’en fut avec lui, et la noce fut préparée en grande pompe.
On n’oublia pas d’inviter la méchante belle-mère à la fête. Lorsqu’elle se fut parée de ses plus riches atours, elle se mit devant son petit miroir et dit :
« Petit miroir, petit miroir,
Quelle est la plus belle de tout le pays ? »
Le miroir répondit :
« Madame la reine, vous êtes la plus belle ici;
Mais la jeune reine est plus belle que vous ! »
La méchante femme se récria de fureur ; dans son trouble, elle ne savait plus que faire. Lorsqu’elle arriva au mariage, elle reconnut Blanche-Neige et resta immobile de terreur et d’angoisse.
Le jeune roi la fit vêtir de haillon et l’enferma dans un cachot avec pour seul compagnon son miroir, qui lui répêta jusqu’à sa mort qu’elle n’était pas la plus belle et qu’elle ne le serait plus jamais.
La petite sirène

Conte de Hans Christian Andersen, Version de Contesdefees.com. lllustrations de Ivan Âkovlevič Bilibin (1876-1942).
Il était une fois un roi qui avait six belles filles. Mais ce roi n’appartenait pas au monde des humains. Son royaume était sous la mer, dans un endroit reculé, où les poissons scintillaient comme de petits bijoux parmi les rochers escarpés et les récifs.
Le roi et les six princesses vivaient dans un palais merveilleux, construit de corail scintillant et de conques luisantes. La mère des filles était décédée, mais la grand-mère prenait grand soin de ses petites-filles.
La plus jeune des princesses était aussi la plus jolie. Ses longs cheveux se gonflaient comme un nuage doré et sa queue brillait d’étincelles vertes, bleues et argentées.
S’il y avait une chose que les princesses aimaient, c’était d’écouter leur grand-mère leur raconter des histoires du monde au-dessus de la mer.
– Là, leur disait la vieille femme, des êtres humains marchent avec des choses étranges appelées jambes. Et des poissons bizarres appelés oiseaux nagent dans les airs en agitant leurs longues nageoires.
Plus la vieille sirène parlait de ce monde mystérieux, plus la petite sirène voulait aller le voir.
– Quand tu auras quinze ans, promit la grand-mère, tu iras le voir.
Lorsque l’aînée des sœurs eut quinze ans, elle nagea jusqu’à la surface, et le lendemain, elle revint pour raconter les merveilles qu’elle avait vue.
-Il y a des villes éblouissantes de lumières et de rires humains, dit-elle. Il y a d’énormes navires, hauts comme des châteaux, qui sillonnent la mer au soleil.
Les princesses grandissaient et chaque année, l’une après l’autre, elles atteignaient toutes l’âge où elles pouvaient nager jusqu’au monde des humains. Elles revenaient et racontaient toutes des histoires étranges et belles. Enfin, la plus jeune des petites sirènes eut quinze ans et pu enfin réaliser son rêve comme ses sœurs.
Quand elle monta à la surface pour la première fois, le soleil couchant peignait le ciel de rose et d’or. Près d’elle, un beau navire glissait lentement sur l’océan, car le vent était léger.
Alors que la petite sirène regardait le bateau, un beau prince sortit sur le pont pour contempler la mer. Il ne savait pas que la petite sirène le regardait, ne pouvant détacher ses yeux de son visage.
Il fit bientôt nuit, et bientôt le vent se renforça, et le navire commença à tanguer.
Une horrible tempête se leva, et arracha les voiles et le gréement, et de gigantesques vagues s’écrasèrent contre le pont et brisèrent la coque. Alors que le navire coulait, la petite sirène vit que le prince était en train de se noyer.
Elle le soutint et nagea avec précaution jusqu’au rivage le plus proche. Le matin, quand le vent se fut calmé et que le soleil se leva, la petite sirène resta là au bord de l’eau à veiller sur le prince endormi.
Peu de temps après, elle vit arriver un groupe de filles de la ville la plus proche qui venaient voir la mer. Quand elles atteignirent la plage où se trouvait le prince, il se réveilla et sourit tandis qu’elles l’aidaient à marcher. La petite sirène, cachée derrière un rocher, se sentit très triste, car elle avait peur de ne plus jamais le revoir.
Après ce jour, la petite sirène remontait souvent à la surface, car elle avait envie de revoir le prince. Elle contemplait son beau palais et pouvait parfois le voir se promener parmi ses courtisans. Elle devint de plus en plus triste, et un jour elle décida d’aller voir la sorcière de la mer et de lui demander conseil.
Cette sorcière vivait dans un endroit sombre et profond de l’océan, où les serpents marins semaient la terreur dans l’eau glacée. Voyant la petite sirène, la sorcière éclata de rire.
« Je sais pourquoi tu es ici ! » dit-elle. Tu veux te rendre dans le monde des humains pour voir ton prince. Tu veux que je transforme ta queue de sirène en jambes humaines, aussi laides soient-elles. Connais-tu le prix à payer ?
« Non, » murmura la princesse, « mais je donnerai tout pour devenir humaine. »
« Tu devras me donner ta voix, avec laquelle tu chantes si bien, » dit la sorcière. Alors je pourrai te transformer en humaine, avec d’affreuses jambes pour marcher. Mais rappelle-toi que si le prince ne t’aime pas de tout son cœur et ne te prend pas pour épouse, tu te transformeras en écume de mer et tu disparaîtras à jamais. Tu ne pourras plus rentrer chez ton père. « D’accord », dit la petite sirène. C’était déjà décidé.
Ensuite, la sorcière de la mer donna à boire une potion magique à la petite sirène. Pendant qu’elle buvait, une profonde tristesse l’envahit, car elle réalisait quel grand sacrifice elle était en train de faire. Lorsqu’elle remonta à la surface et nagea jusqu’au palais du prince, sa tristesse disparut dès qu’elle aperçut le jeune homme qu’elle aimait. Elle avait maintenant de belles jambes mais était incapable de parler car la sorcière lui avait bel et bien pris sa voix. Le prince voulut tout de suite recevoir la belle étrangère, et bien qu’elle ne puisse pas parler, il aimait sa compagnie et voulait que la jeune fille soit toujours à ses côtés.
Chaque jour, la petite sirène aimait davantage le jeune prince, mais elle réalisait qu’il n’avait pas l’intention de l’épouser. Il aimait pourtant sa compagnie et sentait qu’ils étaient unis par quelque chose.
-Tu me rappelles une jeune fille que j’ai connu autrefois, lui disait-il. Elle m’avait sauvé la vie, C’est la seule femme que je pourrais jamais aimer.
La pauvre petite sirène essayait de gesticuler et mimer mais elle ne n’arrivait pas à lui expliquer que cette fille était devant lui. Et elle ne savait pas écrire. Elle était vraiment malheureuse mais le destin semblait en avoir décidé ainsi.
Au bout de quelques mois, le roi et la reine pressèrent le prince de se trouver une fiancée. Après avoir refusé de nombreuses fois, il accepta finalement d’aller rencontrer la princesse d’un pays voisin. La petite sirène, bien sûr, monta à bord du navire royal avec lui, bien qu’elle en eût le cœur brisé.
Lorsque le prince mit le pied sur le rivage et rencontra la princesse voisine, il fut tellement fasciné par sa beauté qu’il se convainquit lui-même qu’elle était la fille qui l’avait sauvé du naufrage.
-C’est toi! s’exclama-t-il, ma sauveuse! J’ai retrouvé la fille que j’aimerai toute ma vie. Veux-tu m’épouser ?
Bientôt commencèrent les préparatifs du magnifique mariage, avec des milliers de fleurs, des robes de soie et des bijoux. Tout le monde était plein d’enthousiasme et criait de joie de voir un couple si heureux. Seule la petite sirène restait silencieuse et de ses yeux, pour la première fois, tombèrent des larmes que personne ne vit.
Cette nuit-là, lorsque le prince et sa femme se rendirent dans leur cabine sur le navire royal, la petite sirène se tenait sur le pont, fixant l’eau sombre. À l’aube, elle se transformerait en écume et ne pourrait plus jamais voir, entendre ou aimer.
Mais à ce moment-là, ses sœurs montèrent à la surface de la mer. Leurs cheveux étaient coupés presque à ras.
« Nous avons donné nos cheveux à la sorcière de la mer, » dirent-elles, « en échange de ce couteau. Si tu tues le prince avec ce couteau pendant la nuit, tu seras libérée du charme et tu pourras revenir au royaume de la mer avec nous. »
La petite sirène prit le couteau, mais lorsqu’elle se retrouva à côté du prince endormi, elle réalisa qu’elle ne pourrait jamais lui faire de mal. En pleurant, elle lança le couteau et se jeta à la mer.
Mais à sa grande surprise, la petite sirène ne se transforma pas en écume, mais elle se mit à flotter dans les airs; le bateau s’éloignait rapidement. Autour d’elle, elle aperçut de merveilleuses créatures de lumière dorée.
« Nous sommes les filles de l’air, lui dirent-elles. Nous sommes heureuses en faisant du bien autour de nous. Maintenant que tu es l’une des nôtres, petite sirène, tu pourras enfin être heureuse.”
Alors la petite sirène regarda une dernière fois vers le soleil, contempla le prince et sa femme, qui étaient sur le pont du navire, et pour la première fois depuis longtemps, elle sourit.
Le vilain petit canard

Conte de Hans Christian Andersen. Traduction originale de 1862. Illustrations de Bertall, Job.
Que la campagne était belle ! On était au milieu de l’été ; les blés agitaient des épis d’un jaune magnifique, l’avoine était verte, et dans les prairies le foin s’élevait en monceaux odorants ; la cigogne se promenait sur ses longues jambes rouges, en bavardant de l’égyptien, langue qu’elle avait apprise de madame sa mère. Autour des champs et des prairies s’étendaient de grandes forêts coupées de lacs profonds.
Oui vraiment, la campagne était bien belle. Les rayons du soleil éclairaient de tout leur éclat un vieux domaine entouré de larges fossés, et de grandes feuilles de bardane descendaient du mur jusques dans l’eau ; elles étaient si hautes que les petits enfants pouvaient se cacher dessous, et qu’au milieu d’elles on pouvait trouver une solitude aussi sauvage qu’au centre de la forêt. Dans une de ces retraites une cane avait établi son nid et couvait ses œufs ; il lui tardait bien de voir ses petits éclore. Elle ne recevait guère de visites ; car les autres aimaient mieux nager dans les fossés que de venir jusque sous les bardanes pour barboter avec elle.
Enfin les œufs commencèrent à crever les uns après les autres ; on entendait « pi-pip ; » c’étaient les petits canards qui vivaient et tendaient leur cou au dehors.
« Rap-rap, » dirent-ils ensuite en faisant tout le bruit qu’ils pouvaient.
Ils regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes, et la mère les laissa faire ; car le vert réjouit les yeux.
« Que le monde est grand ? dirent les petits nouveau-nés à l’endroit même où ils se trouvèrent au sortir de leur œuf.
— Vous croyez donc que le monde finit là ? dit la mère. Oh ! non, il s’étend bien plus loin, de l’autre côté du jardin, jusque dans les champs du curé ; mais je n’y suis jamais allée. Êtes-vous tous là ? continua-t-elle en se levant. Non, le plus gros œuf n’a pas bougé : Dieu ! que cela dure longtemps ! J’en ai assez. »
Et elle se mit à couver, mais d’un air contrarié.
« Eh bien ! comment cela va-t-il ? dit une vieille cane qui était venue lui rendre visite.
— Il n’y a plus que celui-là que j’ai toutes les peines du monde à faire crever. Regardez un peu les autres : ne trouvez-vous pas que ce sont les plus gentils petits canards qu’on ait jamais vus ? ils ressemblent tous d’une manière étonnante à leur père ; mais le coquin ne vient pas même me voir.
— Montrez-moi un peu cet œuf qui ne veut pas crever, dit la vieille. Ah ! vous pouvez me croire, c’est un œuf de dinde. Moi aussi j’ai été trompée une fois comme vous, et j’ai eu toute la peine possible avec le petit ; car tous ces êtres-là ont affreusement peur de l’eau. Je ne pouvais parvenir à l’y faire entrer. J’avais beau le happer et barboter devant lui, rien n’y faisait. Que je le regarde encore : oui, c’est bien certainement un œuf de dinde. Laissez-le là, et apprenez plutôt aux autres enfants à nager.
— Non, puisque j’ai déjà perdu tant de temps, je puis bien rester à couver un jour ou deux de plus, répondit la cane.
— Comme vous voudrez, » répliqua la vieille ; elle s’en alla.
Enfin le gros œuf creva. « Pi-pip, » fit le petit, et il sortit. Comme il était grand et vilain ! La cane le regarda et dit : « Quel énorme caneton. Il ne ressemble à aucun de nous. Serait-ce vraiment un dindon ? ce sera facile à voir : il faut qu’il aille à l’eau, quand je devrais l’y traîner. »
Le lendemain, il faisait un temps magnifique : le soleil rayonnait sur toutes les vertes bardanes ; la mère des canards se rendit avec toute sa famille au fossé. « Platsh ! » et elle sauta dans l’eau. « Rap-rap, » dit-elle ensuite, et chacun des petits plongea l’un après l’autre ; et l’eau se referma sur les têtes. Mais bientôt ils reparurent et nagèrent avec rapidité. Les jambes allaient toutes seules, et tous se réjouissaient dans l’eau, même le vilain grand caneton gris.
« Ce n’est pas un dindon, dit-elle. Comme il se sert habilement de ses jambes, et comme il se tient droit ! C’est mon enfant aussi : il n’est pas si laid, lorsqu’on le regarde de près. Rap-rap ! Venez maintenant avec moi : je vais vous faire faire votre entrée dans le monde et vous présenter dans la cour des canards. Seulement ne vous éloignez pas de moi, pour qu’on ne marche pas sur vous, et prenez bien garde au chat. »
Ils entrèrent tous dans la cour des canards.
Quel bruit on y faisait ! Deux familles s’y disputaient une tête d’anguille, et à la fin ce fut le chat qui l’emporta.
« Vous voyez comme les choses se passent dans le monde, » dit la cane en aiguisant son bec ; car elle aussi aurait bien voulu avoir la tête d’anguille. « Maintenant, remuez les jambes, continua-t-elle ; tenez-vous bien ensemble et saluez le vieux canard là-bas. C’est le plus distingué de tous ceux qui se trouvent ici. Il est de race espagnole, c’est pour cela qu’il est si gros, et remarquez bien ce ruban rouge autour de sa jambe : c’est quelque chose de magnifique, et la plus grande distinction qu’on puisse accorder à un canard. Cela signifie qu’on ne veut pas le perdre, et qu’il doit être remarqué par les animaux comme par les hommes. Allons, tenez-vous bien ; non, ne mettez pas les pieds en dedans : un caneton bien élevé écarte les pieds avec soin ; regardez comme je les mets en dehors. Inclinez-vous et dites : « Rap ! »
Ils obéirent, et les autres canards qui les entouraient les regardaient et disaient tout haut : « Voyez un peu ; en voilà encore d’autres, comme si nous n’étions pas déjà assez. Fi, fi donc ! Qu’est-ce que ce canet-là ? Nous n’en voulons pas. »
Et aussitôt un grand canard vola de son côté, se jeta sur lui et le mordit au cou.
« Laissez-le donc, dit la mère, il ne fait de mal à personne.
— D’accord ; mais il est si grand et si drôle, dit l’agresseur, qu’il a besoin d’être battu.
— Vous avez là de beaux enfants, la mère, dit le vieux canard au ruban rouge. Ils sont tous gentils, excepté celui-là ; il n’est pas bien venu : je voudrais que vous pussiez le refaire.
— C’est impossible, dit la mère cane. Il n’est pas beau, c’est vrai ; mais il a un si bon caractère ! et il nage dans la perfection : oui, j’oserais même dire mieux que tous les autres. Je pense qu’il grandira joliment et qu’avec le temps il se formera. Il est resté trop longtemps dans l’œuf, et c’est pourquoi il n’est pas très-bien fait. »
Tandis qu’elle parlait ainsi, elle le tirait doucement par le cou, et lissait son plumage. « Du reste, c’est un canard, et la beauté ne lui importe pas tant. Je crois qu’il deviendra fort et qu’il fera son chemin dans le monde. Enfin, les autres sont gentils ; maintenant, mes enfants, faites comme si vous étiez à la maison et si vous trouvez une tête d’anguille, apportez-la-moi. »
Et ils firent comme s’ils étaient à la maison.
Mais le pauvre canet qui était sorti du dernier œuf fut, pour sa laideur, mordu, poussé et bafoué, non-seulement par les canards, mais aussi par les poulets.
« Il est trop grand, » disaient-ils tous, et le coq d’Inde qui était venu au monde avec des éperons et qui se croyait empereur, se gonfla comme un bâtiment toutes voiles dehors, et marcha droit sur lui en grande fureur et rouge jusqu’aux yeux. Le pauvre canet ne savait s’il devait s’arrêter ou marcher : il eut bien du chagrin d’être si laid et d’être bafoué par tous les canards de la cour.
Voilà ce qui se passa dès le premier jour, et les choses allèrent toujours de pis en pis. Le pauvre canet fut chassé de partout : ses sœurs mêmes étaient méchantes avec lui et répétaient continuellement : « Que ce serait bien fait si le chat t’emportait, vilaine créature ! » Et la mère disait : « Je voudrais que tu fusses bien loin. » Les canards le mordaient, les poulets le battaient, et la bonne qui donnait à manger aux bêtes le repoussait du pied.
Alors il se sauva et prit son vol par-dessus la haie. Les petits oiseaux dans les buissons s’envolèrent de frayeur. « Et tout cela, parce que je suis vilain, » pensa le caneton. Il ferma les yeux et continua son chemin. Il arriva ainsi au grand marécage qu’habitaient les canards sauvages. Il s’y coucha pendant la nuit, bien triste et bien fatigué.
Le lendemain, lorsque les canards sauvages se levèrent, ils aperçurent leur nouveau camarade.
« Qu’est-ce que c’est que cela ? » dirent-ils : le canet se tourna de tous côtés et salua avec toute la grâce possible.
« Tu peux te flatter d’être énormément laid ! dirent les canards sauvages ; mais cela nous est égal, pourvu que tu n’épouses personne de notre famille. »
Le malheureux ! est-ce qu’il pensait à se marier, lui qui ne demandait que la permission de coucher dans les roseaux et de boire de l’eau du marécage ?
Il passa ainsi deux journées. Alors arrivèrent dans cet endroit deux jars sauvages. Ils n’avaient pas encore beaucoup vécu ; aussi étaient-ils très-insolents.
« Écoute, camarade, dirent ces nouveaux venus ; tu es si vilain que nous serions contents de t’avoir avec nous. Veux-tu nous accompagner et devenir un oiseau de passage ? Ici tout près, dans l’autre marécage, il y a des oies sauvages charmantes, presque toutes demoiselles, et qui savent bien chanter. Qui sait si tu n’y trouverais pas le bonheur, malgré ta laideur affreuse ! »
Tout à coup on entendit « pif, paf ! » et les deux jars sauvages tombèrent morts dans les roseaux, et l’eau devint rouge comme du sang.
« Pif, paf ! » et des troupes d’oies sauvages s’envolèrent des roseaux. Et on entendit encore des coups de fusil. C’était une grande chasse ; les chasseurs s’étaient couchés tout autour du marais ; quelques-uns s’étaient même postés sur des branches d’arbres qui s’avançaient au-dessus des joncs. Une vapeur bleue semblable à de petite nuages sortait des arbres sombres et s’étendait sur l’eau ; puis les chiens arrivèrent au marécage : « platsh, platsh ; » et les joncs et les roseaux se courbaient de tous côtés. Quelle épouvante pour le pauvre caneton ! il plia la tête pour la cacher sous son aile ; mais en même temps il aperçut devant lui un grand chien terrible : sa langue pendait hors de sa gueule, et ses yeux farouches étincelaient de cruauté. Le chien tourna la gueule vers le caneton, lui montra ses dents pointues et, « platsh, platsh, » il alla plus loin sans le toucher.
« Dieu merci ! soupira le canard ; je suis si vilain que le chien lui-même dédaigne de me mordre ! »
Et il resta ainsi en silence, pendant que le plomb sifflait à travers les joncs et que les coups de fusil se succédaient sans relâche.
Vers la fin de la journée seulement, le bruit cessa ; mais le pauvre petit n’osa pas encore se lever. Il attendit quelques heures, regarda autour de lui, et se sauva du marais aussi vite qu’il put. Il passa au-dessus des champs et des prairies ; une tempête furieuse l’empêcha d’avancer.
Sur le soir, il arriva à une misérable cabane de paysan, si vieille et si ruinée qu’elle ne savait pas de quel côté tomber : aussi restait-elle debout. La tempête soufflait si fort autour du caneton qu’il fut obligé de s’arrêter et de s’accrocher à la cabane : tout allait de mal en pis.
Alors il remarqua qu’une porte avait quitté ses gonds et lui permettait, par une petite ouverture, de pénétrer dans l’intérieur : c’est ce qu’il fit.
Là demeurait une vieille femme avec son matou et avec sa poule ; et le matou, qu’elle appelait son petit-fils, savait arrondir le dos et filer son rouet : il savait même lancer des étincelles, pourvu qu’on lui frottât convenablement le dos à rebrousse-poil. La poule avait des jambes fort courtes, ce qui lui avait valu le nom de Courte-Jambe. Elle pondait des œufs excellents, et la bonne femme l’aimait comme une fille.
Le lendemain on s’aperçut de la présence du caneton étranger. Le matou commença à gronder, et la poule à glousser.
« Qu’y a-t-il ? » dit la femme en regardant autour d’elle. Mais, comme elle avait la vue basse, elle crut que c’était une grosse cane qui s’était égarée. « Voilà une bonne prise, dit-elle : j’aurai maintenant des œufs de cane. Pourvu que ce ne soit pas un canard ! Enfin, nous verrons. »
Elle attendit pendant trois semaines ; mais les œufs ne vinrent pas. Dans cette maison, le matou était le maître et la poule la maîtresse ; aussi ils avaient l’habitude de dire : « Nous et le monde ; » car ils croyaient faire à eux seuls la moitié et même la meilleure moitié du monde. Le caneton se permit de penser que l’on pouvait avoir un autre avis ; mais cela fâcha la poule.
« Sais-tu pondre des œufs ? demanda-t-elle.
— Non.
— Eh bien ! alors, tu auras la bonté de te taire. »
Et le matou le questionna à son tour : « Sais-tu faire le gros dos ? sais-tu filer ton rouet et faire jaillir des étincelles ?
— Non.
— Alors tu n’as pas le droit d’exprimer une opinion, quand les gens raisonnables causent ensemble. »
Et le caneton se coucha tristement dans un coin ; mais tout à coup un air vif et la lumière du soleil pénétrèrent dans la chambre, et cela lui donna une si grande envie de nager dans l’eau qu’il ne put s’empêcher d’en parler à la poule.
« Qu’est-ce donc ? dit-elle. Tu n’as rien à faire, et voilà qu’il te prend des fantaisies. Ponds des œufs ou fais ron-ron, et ces caprices te passeront.
— C’est pourtant bien joli de nager sur l’eau, dit le petit canard ; quel bonheur de la sentir se refermer sur sa tête et de plonger jusqu’au fond !
— Ce doit être un grand plaisir, en effet ! répondit la poule. Je crois que tu es devenu fou. Demande un peu à Minet, qui est l’être le plus raisonnable que je connaisse, s’il aime à nager ou à plonger dans l’eau. Demande même à notre vieille maîtresse : personne dans le monde n’est plus expérimenté ; crois-tu qu’elle ait envie de nager et de sentir l’eau se refermer sur sa tête ?
— Vous ne me comprenez pas.
— Nous ne te comprenons pas ? mais qui te comprendrait donc ? Te croirais-tu plus instruit que Minet et notre maîtresse ?
— Je ne veux pas parler de moi.
— Ne t’en fais pas accroire, enfant, mais remercie plutôt le créateur de tout le bien dont il t’a comblé. Tu es arrivé dans une chambre bien chaude, tu as trouvé une société dont tu pourrais profiter, et tu te mets à raisonner jusqu’à te rendre insupportable. Ce n’est vraiment pas un plaisir de vivre avec toi. Crois-moi, je te veux du bien ; je te dis sans doute des choses désagréables ; mais c’est à cela que l’on reconnaît ses véritables amis. Suis mes conseils, et tâche de pondre des œufs ou de faire ron-ron.
— Je crois qu’il me sera plus avantageux de faire mon tour dans le monde, répondit le canard.
— Comme tu voudras, » dit le poulet.
Et le canard s’en alla nager et se plonger dans l’eau ; mais tous les animaux le méprisèrent à cause de sa laideur.
L’automne arriva, les feuilles de la forêt devinrent jaunes et brunes : le vent les saisit et les fit voltiger. En haut, dans les airs, il faisait bien froid ; des nuages lourds pendaient, chargés de grêle et de neige. Sur la haie le corbeau croassait tant il était gelé : rien que d’y penser, on grelottait. Le pauvre caneton n’était, en vérité, pas à son aise.
Un soir que le soleil se couchait glorieux, toute une foule de grands oiseaux superbes sortit des buissons ; le canet n’en avait jamais vu de semblables : ils étaient d’une blancheur éblouissante, ils avaient le cou long et souple. C’étaient des cygnes. Le son de leur voix était tout particulier : ils étendirent leurs longues ailes éclatantes pour aller loin de cette contrée chercher dans les pays chauds des lacs toujours ouverts. Ils montaient si haut, si haut, que le vilain petit canard en était étrangement affecté ; il tourna dans l’eau comme une roue, il dressa le cou et le tendit en l’air vers les cygnes voyageurs, et poussa un cri si perçant et si singulier qu’il se fit peur à lui-même. Il lui était impossible d’oublier ces oiseaux magnifiques et heureux ; aussitôt qu’il cessa de les apercevoir, il plongea jusqu’au fond, et, lorsqu’il remonta à la surface, il était comme hors de lui. Il ne savait comment s’appelaient ces oiseaux, ni où ils allaient ; mais cependant il les aimait comme il n’avait encore aimé personne. Il n’en était pas jaloux ; car comment aurait-il pu avoir l’idée de souhaiter pour lui-même une grâce si parfaite ? Il aurait été trop heureux, si les canards avaient consenti à le supporter, le pauvre être si vilain !
Et l’hiver devint bien froid, bien froid ; le caneton nageait toujours à la surface de l’eau pour l’empêcher de se prendre tout à fait ; mais chaque nuit le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Il gelait si fort qu’on entendait la glace craquer ; le canet était obligé d’agiter continuellement les jambes pour que le trou ne se fermât pas autour de lui. Mais enfin il se sentit épuisé de fatigue ; il ne remuait plus et fut saisi par la glace.
Le lendemain matin, un paysan vint sur le bord et vit ce qui se passait ; il s’avança, rompit la glace et emporta le canard chez lui pour le donner à sa femme. Là, il revint à la vie.
Les enfants voulurent jouer avec lui ; mais le caneton, persuadé qu’ils allaient lui faire du mal, se jeta de peur au milieu du pot au lait, si bien que le lait rejaillit dans la chambre. La femme frappa ses mains l’une contre l’autre de colère, et lui, tout effrayé, se réfugia dans la baratte, et de là dans la huche à farine, puis de là prit son vol au dehors.
Dieu ! quel spectacle ! la femme criait, courait après lui, et voulait le battre avec les pincettes ; les enfants s’élancèrent sur le tas de fumier pour attraper le caneton. Ils riaient et poussaient des cris : ce fut un grand bonheur pour lui d’avoir trouvé la porte ouverte et de pouvoir ensuite se glisser entre des branches, dans la neige ; il s’y blottit tout épuisé.
Il serait trop triste de raconter toute sa misère et toutes les souffrances qu’il eut à supporter pendant cet hiver rigoureux.
Il était couché dans le marécage entre les joncs, lorsqu’un jour le soleil commença à reprendre son éclat et sa chaleur. Les alouettes chantaient. Il faisait un printemps délicieux.
Alors tout à coup le caneton put se confier à ses ailes, qui battaient l’air avec plus de vigueur qu’autrefois, assez fortes pour le transporter au loin. Et bientôt il se trouva dans un grand jardin où les pommiers étaient en pleine floraison, où le sureau répandait son parfum et penchait ses longues branches vertes jusqu’aux fossés. Comme tout était beau dans cet endroit ! Comme tout respirait le printemps !
Et des profondeurs du bois sortirent trois cygnes blancs et magnifiques.
Ils battaient des ailes et nagèrent sur l’eau. Le canet connaissait ces beaux oiseaux : il fut saisi d’une tristesse indicible.
« Je veux aller les trouver, ces oiseaux royaux ; ils me tueront, pour avoir osé, moi, si vilain, m’approcher d’eux ; mais cela m’est égal ; mieux vaut être tué par eux que d’être mordu par les canards, battu par les poules, poussé du pied par la fille de basse-cour, et que de souffrir les misères de l’hiver. »
Il s’élança dans l’eau et nagea à la rencontre des cygnes. Ceux-ci l’aperçurent et se précipitèrent vers lui les plumes soulevées. « Tuez-moi, » dit le pauvre animal ; et, penchant la tête vers la surface de l’eau, il attendait la mort.
Mais que vit-il dans l’eau transparente ? Il vit sa propre image au-dessous de lui : ce n’était plus un oiseau mal fait, d’un gris noir, vilain et dégoûtant, il était lui-même un cygne !
Il n’y a pas de mal à être né dans une basse-cour lorsqu’on sort d’un œuf de cygne.
Maintenant il se sentait heureux de toutes ses souffrances et de tous ses chagrins ; maintenant pour la première fois il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l’entourait, et les grands cygnes nageaient autour de lui et le caressaient de leur bec.
De petits enfants vinrent au jardin et jetèrent du pain et du grain dans l’eau, et le plus petit d’entre eux s’écria : « En voilà un nouveau ! » et les autres enfants poussèrent des cris de joie : « Oui, oui ! c’est vrai ; il y en a encore un nouveau. » Et ils dansaient sur les bords, puis battaient des mains ; et ils coururent à leur père et à leur mère, et revinrent encore jeter du pain et du gâteau, et ils dirent tous : « Le nouveau est le plus beau ! Qu’il est jeune ! qu’il est superbe ! »
Et les vieux cygnes s’inclinèrent devant lui.
Alors, il se sentit honteux, et cacha sa tête sous son aile ; il ne savait comment se tenir, car c’était pour lui trop de bonheur. Mais il n’était pas fier. Un bon cœur ne le devient jamais. Il songeait à la manière dont il avait été persécuté et insulté partout, et voilà qu’il les entendait tous dire qu’il était le plus beau de tous ces beaux oiseaux ! Et le sureau même inclinait ses branches vers lui, et le soleil répandait une lumière si chaude et si bienfaisante ! Alors ses plumes se gonflèrent, son cou élancé se dressa, et il s’écria de tout son cœur : « Comment aurais-je pu rêver tant de bonheur, pendant que je n’étais qu’un vilain petit canard. »
Les habits neufs de l’empereur

Il y a très longtemps, vivait un empereur qui aimait plus que tout les habits neufs, à tel point qu’il dépensait toute sa fortune dans sa garde-robe. Il ne se souciait pas des parades militaires, ni du théâtre, ni de ses promenades dans les bois, sauf si cela lui permettait d’exhiber ses vêtements neufs. Il avait un costume pour chaque heure de chaque jour de la semaine et tandis qu’on dit habituellement d’un roi qu’il est au conseil, on disait toujours de lui : « L’empereur est dans sa garde-robe ! »
Dans la grande ville où il habitait, la vie était gaie et chaque jour beaucoup d’étrangers arrivaient. Un jour, arrivèrent deux escrocs qui affirmèrent être tisserands et être capables de pouvoir tisser la plus belle étoffe que l’on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le motif seraient exceptionnellement beaux, mais les vêtements qui en seraient confectionnés posséderaient l’étonnante propriété d’être invisibles aux yeux des idiots et des incompétents.
« Quels vêtements merveilleux ceux doivent être », se dit l’empereur. « Si j’en avais de pareils, je pourrais découvrir qui, de mes sujets, ne sied pas à ses fonctions et départager les intelligents des imbéciles ! Je dois sur le champ me faire tisser cette étoffe ! » Il donna aux deux escrocs une avance sur leur travail et ceux-ci se mirent à l’ouvrage.
Ils installèrent deux métiers à tisser, mais ils firent semblant de travailler car il n’y avait absolument aucun fil sur le métier. Ils demandèrent la soie la plus fine et l’or le plus précieux qu’ils prirent pour eux et restèrent sur leurs métiers vides jusqu’à bien tard dans la nuit.
« Je voudrais bien savoir où ils en sont avec l’étoffe ! », se dit l’empereur. Mais il se sentait mal à l’aise à l’idée qu’elle soit invisible aux yeux de ceux qui sont sots ou mal dans leur fonction. Il se dit qu’il n’avait rien à craindre pour lui-même, mais préféra envoyer quelqu’un d’autre pour voir comment cela se passait. La rumeur faisant son travail, chacun dans la ville connaissait maintenant les qualités exceptionnelles de l’étoffe et tous étaient impatients de savoir si leur voisin était inapte ou idiot.
« Je vais envoyer mon vieux et honnête ministre auprès des tisserands », se dit l’empereur. « Il est le mieux à même de juger de l’allure de l’étoffe; il est d’une grande intelligence et personne ne fait mieux son travail que lui ! »
Le vieux et bon ministre alla donc dans l’atelier où les deux escrocs étaient assis, travaillant sur leurs métiers vides. Que Dieu nous garde ! », pensa le ministre en écarquillant les yeux. « Je ne vois rien du tout ! » Mais il se garda bien de le dire.
Les deux escrocs l’invitèrent à s’approcher et lui demandèrent si ce n’étaient pas là en effet un joli motif et de magnifiques couleurs. Puis, ils lui montrèrent un métier vide. Le pauvre vieux ministre écarquilla encore plus les yeux, mais il ne vit toujours rien, puisqu’il n’y avait rien. « Mon Dieu, pensa-t-il, serais-je sot ? Je ne l’aurais jamais cru et personne ne doit le savoir ! Serais-je un incompétent ? Non, il ne faut surtout pas que je raconte que je ne peux pas voir l’étoffe. »
« Eh bien, qu’en dites-vous ? », demanda l’un des tisserands.
« Oh, c’est ravissant, tout ce qu’il y a de plus joli ! », répondit le vieux ministre, en regardant au travers de ses lunettes. « Ces motifs et ces couleurs ! Je ne manquerai pas de dire à l’empereur que tout cela me plaît beaucoup ! »
« Nous nous en réjouissons ! », dirent les deux tisserands. Puis, ils décrivirent les couleurs et discutèrent du motif. Le vieux ministre écouta attentivement afin de pouvoir lui-même en parler lorsqu’il serait de retour auprès de l’empereur; et c’est ce qu’il fit.
Les deux escrocs exigèrent encore plus d’argent, plus de soie et plus d’or pour leur tissage. Ils mettaient tout dans leurs poches et rien sur les métiers; mais ils continuèrent, comme ils l’avaient fait jusqu’ici, à faire semblant de travailler.
L’empereur envoya bientôt un autre fonctionnaire de confiance pour voir où en était le travail et quand l’étoffe serait bientôt prête. Il arriva à cet homme ce qui était arrivé au ministre : il regarda et regarda encore, mais comme il n’y avait rien sur le métier, il ne put rien y voir.
« N’est-ce pas là un magnifique morceau d’étoffe ? », lui demandèrent les deux escrocs en lui montrant et lui expliquant les splendides motifs qui n’existaient tout simplement pas.
« Je ne suis pas sot, se dit le fonctionnaire; ce serait donc que je ne conviens pas à mes fonctions ? Ce serait plutôt étrange, mais je ne dois pas le laisser paraître ! » Et il fit l’éloge de l’étoffe, qu’il n’avait pas vue, puis il exprima la joie que lui procuraient les couleurs et le merveilleux motif. « Oui, c’est tout-à-fait merveilleux ! », dit-il à l’empereur.
Dans la ville, tout le monde parlait de la magnifique étoffe, et l’empereur voulu la voir de ses propres yeux tandis qu’elle se trouvait encore sur le métier. Accompagné de toute une foule de dignitaires, dont le ministre et le fonctionnaire, il alla chez les deux escrocs, lesquels s’affairaient à tisser sans le moindre fil.
« N’est-ce pas magnifique ? », dirent les deux fonctionnaires qui étaient déjà venus. « Que Votre Majesté admire les motifs et les couleurs ! » Puis, ils montrèrent du doigt un métier vide, s’imaginant que les autres pouvaient y voir quelque chose.
« Comment !, pensa l’Empereur, mais je ne vois rien ! C’est affreux ! Serais-je sot ? Ne serais-je pas fait pour être empereur ? Ce serait bien la chose la plus terrible qui puisse jamais m’arriver. »
« Magnifique, ravissant, parfait, dit-il finalement, je donne ma plus haute approbation ! » Il hocha la tête, en signe de satisfaction, et contempla le métier vide; mais il se garda bien de dire qu’il ne voyait rien. Tous les membres de la suite qui l’avaient accompagné regardèrent et regardèrent encore; mais comme pour tous les autres, rien ne leur apparût et tous dirent comme l’empereur : « C’est véritablement très beau ! » Puis ils conseillèrent à l’Empereur de porter ces magnifiques vêtements pour la première fois à l’occasion d’une grande fête qui devrait avoir lieu très bientôt.
Merveilleux était le mot que l’on entendait sur toutes les lèvres, et tous semblaient se réjouir. L’empereur décora chacun des escrocs d’une croix de chevalier qu’ils mirent à leur boutonnière et il leur donna le titre de gentilshommes tisserands.
La nuit qui précéda le matin de la fête, les escrocs restèrent à travailler avec seize chandelles. Tous les gens pouvaient se rendre compte du mal qu’ils se donnaient pour terminer les habits de l’empereur. Les tisserands firent semblant d’enlever l’étoffe de sur le métier, coupèrent dans l’air avec de gros ciseaux, cousirent avec des aiguilles sans fils et dirent finalement : « Voyez, les habits neufs de l’empereur sont à présent terminés ! »
« Voyez, Majesté, voici le pantalon, voilà la veste, voilà le manteau ! » et ainsi de suite. « C’est aussi léger qu’une toile d’araignée; on croirait presque qu’on n’a rien sur le corps, mais c’est là toute la beauté de la chose ! »
« Oui, oui ! », dirent tous les courtisans, mais ils ne pouvaient rien voir, puisqu’il n’y avait rien.
« Votre Majesté Impériale veut-elle avoir l’insigne bonté d’ôter ses vêtements afin que nous puissions lui mettre les nouveaux, là, devant le grands miroir ! »
L’empereur enleva tous ses beaux vêtements et les escrocs firent comme s’ils lui enfilaient chacune des pièces du nouvel habit qui, apparemment, venait tout juste d’être cousu. L’empereur se tourna et se retourna devant le miroir.
« Dieu ! comme cela vous va bien. Quels dessins, quelles couleurs », s’exclamait tout le monde.
« Ceux qui doivent porter le paravent au-dessus de Votre Majesté ouvrant la procession sont arrivés », dit le maître des cérémonies.
« Je suis prêt », dit l’empereur. « Est-ce que cela me va bien ? » Et il en se tourna encore une fois devant le miroir, car il devait faire semblant de bien contempler son costume.
Les chambellans qui devaient porter la traîne du manteau de cour tâtonnaient de leurs mains le parquet, faisant semblant d’attraper et de soulever la traîne. Ils allèrent et firent comme s’ils tenaient quelque chose dans les airs; ils ne voulaient pas risquer que l’on remarquât qu’ils ne pouvaient rien voir.
C’est ainsi que l’Empereur marchait devant la procession sous le magnifique dais, et tous ceux qui se trouvaient dans la rue ou à leur fenêtre disaient : « Les habits neufs de l’empereur sont admirables ! Quel manteau magnifique avec sa traîne de toute beauté, comme elle s’étale avec splendeur ! » Personne ne voulait laisser paraître qu’il ne voyait rien, puisque cela aurait montré qu’il était incapable dans sa fonction ou simplement un sot. Aucun habit neuf de l’empereur n’avait connu un tel succès.
« Mais il n’a pas d’habit du tout ! », cria tout à coup un petit enfant dans la foule.
« Entendez la voix de l’innocence ! », dit le père; et chacun murmura à son voisin ce que l’enfant avait dit.
Puis la foule entière se mit à crier : « Mais il n’a pas d’habit du tout ! » L’empereur frissonna de peur, car il lui semblait bien que le peuple avait raison, mais il se dit : » Maintenant, je dois tenir bon jusqu’à la fin de la procession. » Et le cortège poursuivit sa route et les chambellans continuèrent de porter la traîne, qui n’existait pas.
Hans Christian Andersen (1805-1875),
Titre original : Les Habits neufs du Grand-Duc
Adapté par Contesdefees.com de la traduction de David Soldi.
Contes d’Andersen, 1876.
Les trois petits cochons

Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. Ils s’appelaient Nif Nif, Nouf, Nouf et Naf Naf.
Un jour, leur mère les réunit et leur dit:
“Mes enfants, vous avez beaucoup grandit, et notre maison est bien trop petite pour nous tous maintenant. Demain vous partirez pour construire chacun votre maison. Et surtout faîtes bien attention au grand méchant loup”
Le lendemain, ils s’embrassèrent tous et partirent.
Nouf Nouf le plus jeune et le plus paresseux, rencontra un paysan et lui demanda un peu de paille pour construire sa maison en quelques minutes.
Nif Nif le second, un peu moins paresseux, demanda du bois à un bûcheron et se construisit une maison en bois en quelques heures.
Naf Naf, l’aîné et le plus travailleur, acheta des briques à un maçon et se construisit une solide maison de brique en plusieurs jours.
Ses frères qui avait terminé bien avant lui, se moquaient de lui en rigolant et en jouant de la musique devant lui.
Mais Naf Naf leur reprochait leur paresse et leur disait:
– Nous verrons bien quand le loup viendra! Rira bien qui rira le dernier!
Quelques jours plus tard, un horrible et énorme grand méchant loup sortit de la forêt.
Il vit d’abord la maison de Nouf Nouf et cria:
“Petit cochon, ouvre-moi ta porte ou je soufflerai, et ta maison s’envolera!”
“Non, jamais de la vie” dit Nouf Nouf en tremblant.
Alors le grand méchant loup remplit ses poumons et commença à souffler de toutes ses forces:
“Pfffffffffff Hoooo Pfffffffffffff!”
En quelques secondes, la maison s’envola.
Nouf Nouf, se mit à courir de toutes ses forces vers la cabane de son frère Nif Nif.
Nif Nif lui ouvrit la porte juste à temps car ils entendirent rugir la voix du loup:
“Petits cochons! Petits cochons! Ouvrez-moi la porte!”
“Non non!” S’exclama Nif Nif. “Nous ne t’ouvrirons pas!”
Le loup répondit:
“Puisque c’est comme ça, je vais souffler, souffler, souffler, et votre maison s’envolera.”
Alors il gonfla sa poitrine et se mit à souffler de toutes ses forces:
“Pfffffffffff Hoooo Pfffffffffffff!”
La cabane resista un peu mais s’envola bien vite.
Nouf Nouf et Nif Nif se mirent à courir, courir, courir, en direction de la maison de briques de leur frère Naf Naf.
Naf Naf les laissa entrer juste à temps.
De grands coups retentirent à la porte. “Boum Boum Boum ». C’était le loup.
« Petits cochons, petits cochons! Ouvrez-moi la porte ou je soufflerai, soufflerai, soufflerai, et votre maison s’envolera.”
“Non” dit Naf Naf, “Nous ne t’ouvrirons pas”
Alors le Loup souffla de toutes ses forces:
“Pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff!”
La maison ne bougea pas d’un pouce.
Enragé, il souffla à nouveau:
“Pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff!”
Mais la maison resista, solide comme un roc.
Il souffla, souffla et souffla encore jusqu’à perdre haleine.
“Hufufufufufu”
À bout de souffle, le grand méchant loup, chercha une autre idée pour entrer dans la maison. Il aperçut la cheminée sur le toit, commença à escalader le mur pour y descendre et attraper son repas.
Heureusement, Naf Naf, avait entendu les pas du loup sur le toit, et il avait mis rapidement une grande marmite d’eau chaude à bouillir sur le feu.
Lorsque le grand méchant loup descendit par le conduit de la cheminée, il se brûla tellement fort, qu’il sauta à plusieurs mètres en passant par la cheminée en sens inverse.
Il courut, courut, courut jusqu’à disparaître complètement. Et on ne le revit plus jamais dans la région.
Les trois petits cochons sortirent tout heureux de la maison de briques et se mirent à danser en rond en chantant:
”Qui a peur du grand méchant loup, c’est peut-être vous? C’est pas nous!”
Naf Naf put enfin se joindre à la flûte de Nouf Nouf et au violon de Nif Nif en les accompagnant gaiement sur son piano.
Finalement, il invita ses frères à vivre dans sa maison en attendant qu’ils construisent chacun leur propre maison de brique.
Blanche neige
D’après les frères Grimm. Illustrations à l’aquarelle d’Isabelle Beaussant – de Pas.
Il était une fois le roi et la reine d’un beau pays qui vivaient dans un grand château.
Un jour, ils eurent une fille qu’ils appelèrent Blanche-Neige, car sa peau était blanche comme la neige.
Mais peu de temps après la reine mourut, et le roi se remaria avec une femme très belle, mais très orgueilleuse et méchante.
Elle possédait un miroir magique à qui elle demandait:
– Miroir, petit miroir, quelle est la plus belle du pays?
Et le miroir répondait toujours:
– Majesté, vous êtes la plus belle!
Et il lui disait toujours la même chose car c’était vrai.
Mais des années plus tard, alors que Blanche Neige devenait une jeune femme, elle lui demanda comme toujours:
– Miroir, petit miroir, quelle est la plus belle du pays?
Le miroir lui répondit:
– C’est Blanche Neige la plus belle!
Et c’était bien vrai. Blanche Neige était devenue une magnifique femme, tout en cultivant une simplicité admirable. Elle passait de longues heures dans la nature, amie des fleurs et des animaux.
En réalisant cela au travers de son miroir, la reine entra dans une colère sans mesure et demanda à un chasseur d’emmener Blanche Neige dans la forêt et de ne revenir qu’après l’avoir tué et de lui ramener son coeur.
Le chasseur fut pris de pitié et ne fut pas capable de tuer la jeune fille. Il lui dit de courir le plus loin possible et tua un vieux sanglier pour faire croire à la reine qu’il ramenait le coeur de Blanche Neige.
Celle-ci avait suivit son conseil et avait couru pendant des heures et des heures à travers la forêt profonde.
Elle s’arrêta en voyant une petite maison dans une clairière et frappa à la porte. Ne recevant pas de réponse, elle poussa la porte et entra.
Elle vit sept petites chaises autour de la table et s’assit sur la première.
Puis elle vit sept assiettes déjà préparées et goûta une cuillère de chacune d’elles car elle avait très faim.
Puis elle but dans un des sept verres car elle avait très soif.
Et comme elle était très fatiguée elle s’écroula de tout son long sur les sept petits lits et s’endormit.
La nuit venue, les maîtres de la cabane arrivèrent ; c’étaient des nains qui cherchaient de l’or dans les montagnes. Ils allumèrent leurs petites lampes, et quand le logis fut éclairé, ils virent bientôt que quelqu’un était passé par là, car tout n’était plus dans le même ordre où ils l’avaient laissé.
Le premier dit :
« Qui s’est assis sur ma chaise ? »
Le second :
« Qui a mangé dans mon assiette ? »
Le troisième :
« Qui a pris de mon pain ? »
Le quatrième :
« Qui a touché à mes légumes ? »
Le cinquième :
« Qui a piqué avec ma fourchette ? »
Le sixième :
« Qui a coupé avec mon couteau ? »
Et le septième :
« Qui a bu dans mon gobelet ? »
Puis le premier se retourna et il vit que son lit était défait.
« Qui s’est couché dans mon lit ? » dit-il.
Et les autres accoururent et dire :
« Dans le mien aussi, il y a eu quelqu’un. »
Alors ils aperçurent Blanche-Neige qui était couchée en travers des sept petits lits et qui dormait. Ils poussèrent des cris d’étonnement ; et chacun alla chercher sa lampe pour mieux contempler Blanche-Neige.
« Ah ! mon Dieu, ah ! mon Dieu, répétaient les nains, que cette jeune fille est belle ! »
Après s’être remis de leurs émotions, et qu’ils eurent écouté l’histoire de Blanche Neige, les nains lui proposèrent de rester chez eux à l’abri tant qu’elle le voudrait.
Le lendemain ils partirent travailler dans la montagne en lui recommandant de n’ouvrir à personne.
Ils vécurent ainsi quelques jours heureux. Blanche Neige prenait soin de la maison et préparait des plats délicieux faisant la joie de ses hôtes.
Pendant ce temps, la méchante reine interrogea à nouveau son miroir :
– Miroir, petit miroir, quelle est la plus belle du pays?
Le miroir lui répondit:
– C’est Blanche Neige la plus belle!
Elle en perdit le souffle :
– Comment ? Blanche Neige n’est pas morte ?
– Non, dit le miroir, elle habite chez les nains de la montagne.
Elle se rendit compte que le chasseur l’avait trompé et entra dans une colère folle. Elle mis rapidement au point une ruse de sorcière, car c’est bien ce qu’elle était. Elle se déguisa en vieille femme, pris un panier de pommes, et alla cueillir des herbes venimeuses dans la forêt. Elle enduit une des pommes avec son mélange assassin et repartit.
Elle se dirigea vers la cabane des nains.
Lorsqu’elle arriva, Blanche Neige était seule car les nains étaient partis travailler dans la montagne.
– Qui est-ce ? Demanda Blanche Neige lorsqu’elle frappa à la porte.
– Une marchande de pommes, ouvre-moi la porte, mon enfant.
– Je ne peux pas ma bonne Dame. Les nains me l’ont interdit. Dit Blanche Neige
– Regarde mes belles pommes, dit la sorcière en montrant une belle pomme rouge par la fenêtre. Elles sont délicieuses. Goûtes-en une. Je te l’offre.
Et pour appuyer son geste elle croqua une des pommes qui n’étaient pas empoisonnée.
Blanche Neige se laissa convaincre et goûta la pomme que la femme lui offrait. À peine avait-elle croqué un morceau, qu’elle tomba inanimée sur le sol.
La reine s’enfuit en ricanant de folie. Elle se perdit dans la montagne et tomba dans un précipice. On entendit plus jamais parler d’elle.
Lorsque les nains arrivèrent à la maison après leur travail, ils découvrir Blanche Neige effondrée et crurent qu’elle était morte car elle ne respirait plus.
Ils pleurèrent longtemps et finalement décidèrent de mettre son corps sous une cloche de verre qu’il construisirent pour pouvoir continuer à l’admirer.
Elle restait toujours aussi belle jour après jour et ils se relevaient autour d’elle pour la veiller.
Quelques jours plus tard un Prince aperçut la scène et s’approchant par curiosité, il tomba immédiatement amoureux fou de la beauté de Blanche Neige.
Il demanda au nain la permission de retirer la cloche et s’approchant de la jeune femme il lui murmura un secret à l’oreille.
Quelques secondes plus tard, Blanche Neige ouvrait les yeux en souriant à son Prince miraculeux.
Puis il partirent tous les deux avec les nains pour demander la main de la jeune femme au Roi son père et célébrer un beau mariage.
Baba Yaga

Conte populaire russe. Version modernisée par Contesdefees.com.
Il était une fois un vieil homme veuf qui vivait seul dans une hutte avec sa fille Natasha. Ils étaient heureux jusqu’à ce que le vieil homme décide de se remarier.
La nouvelle femme menait la vie dure à la petite fille. Plus de pain et de confiture sur la table, plus de jeu de cache-cache autour du samovar pendant l’heure du thé. C’était même pire que ça, car elle n’avait plus du tout le droit de prendre le thé. La belle-mère disait que les petites filles ne devraient pas prendre de thé, et encore moins manger du pain avec de la confiture. Elle lançait à la fille un morceau de pain et lui ordonnait de sortir dans la cour pour manger. Ensuite, la belle-mère commença à convaincre son mari que tout ce qui n’allait pas était de la faute de la fille. Et le vieil homme croyait sa nouvelle épouse, pensant pouvoir lui faire confiance. La pauvre Natasha restait seule dans la cour, mouillant la croûte de pain sec avec ses larmes et la mangeant toute seule dans le froid. Ensuite, elle entendait la belle-mère lui crier d’entrer et de laver les ustensiles à thé, ranger la maison, brosser le sol et nettoyer les bottes pleines de boue.
Un jour, la belle-mère décida qu’elle ne pouvait plus supporter Natasha une minute de plus. Mais comment faire pour se débarrasser d’elle pour de bon ? Alors elle se souvint de sa sœur, la terrible sorcière Baba Yaga aux jambes squelettiques, qui vivait dans la forêt. Et un horrible plan commença à se former dans sa tête.
Le lendemain matin, le vieil homme s’en alla rendre visite à des amis du village voisin. Dès que le vieil homme fut hors de vue, la méchante belle-mère appela Natasha.
« Va chez ma sœur, ta chère petite tante, qui habite dans la forêt, dit-elle, et demande-lui une aiguille et du fil pour raccommoder une chemise.
« Mais nous avons une aiguille et du fil », dit Natasha en tremblant, car elle savait que sa tante était Baba Yaga, la sorcière, et qu’aucun enfant qui s’approchait d’elle n’était jamais revenu.
« Tait-toi et obéi ! », cria la belle-mère, en grinçant des dents, faisant comme un bruit de pinces qui claquent.
« Comment la trouverai-je ? » dit Natasha en tremblant. Elle avait entendu dire que Baba Yaga poursuivait ses victimes en volant dans un mortier et un pilon géants, et qu’elle avait des dents de fer avec lesquelles elle mangeait les enfants.
La belle-mère saisi le nez de la petite fille et le pinça.
« C’est ton nez, » dit-elle. « Peux tu le sentir? »
— Oui, murmura la pauvre fille.
« Tu suivras la route dans la forêt jusqu’à ce que tu arrives à un arbre tombé, » dit la belle-mère, « puis tu tourneras à gauche, et tu suivras ton nez pour trouver ta tante. Maintenant, vas-y, paresseuse! ». Elle fourra dans la main de la jeune fille un mouchoir dans lequel elle avait mis quelques morceaux de pain rassis, du fromage et quelques morceaux de viande.
Natasha se retourna et regarda sa belle-mère à la porte, les bras croisés, la dévisageant. Elle ne pouvait rien faire d’autre que d’obéir et partir dans la forêt.
Elle marcha le long de la route à travers la forêt jusqu’à ce qu’elle arrive à l’arbre tombé. Puis elle tourna à gauche. Son nez lui faisait toujours mal là où la belle-mère l’avait pincé, alors elle savait qu’elle devait continuer tout droit.
Finalement, elle arriva à la hutte de Baba Yaga, la sorcière aux jambes squelettiques. La hutte étaient entourée d’une barrière très haute. Elle poussa la grille d’entrée qui s’ouvrit en grinçant misérablement, comme si cela lui faisait mal de bouger. Natasha remarqua un bidon d’huile rouillé sur le sol.
« Quelle chance », dit-elle, remarquant qu’il restait de l’huile dans le bidon. Et elle versa les gouttes d’huile restantes dans les gonds de la grille.
À l’intérieur de l’enclos se trouvait la hutte de Baba Yaga. Elle ne ressemblait à aucune autre hutte qu’elle eu jamais vue, car elle se tenait sur des pattes de poule géantes et marchait dans la cour. Alors que Natasha s’approchait, la maison se retourna pour lui faire face et il lui sembla que ses fenêtres étaient des yeux et sa porte une bouche. Une servante de Baba Yaga se tenait dans la cour. Elle pleurait amèrement à cause des tâches que la sorcière lui avait confiées et s’essuyait les yeux sur son jupon.
« Quelle chance que j’ai un mouchoir. » Dit Natasha. Elle dénoua son mouchoir, le secoua pour le nettoyer et mit soigneusement les morceaux de nourriture dans ses poches. Elle donna le mouchoir à la servante de Baba Yaga, qui s’essuya les yeux dessus et sourit à travers ses larmes.
Près de la hutte se tenait un chien énorme, très maigre, qui rongeait un vieil os.
« Quelle chance que j’aie du pain et de la viande. » Dit la petite fille. Cherchant dans sa poche ses morceaux de pain et de viande, Natasha dit au chien : « J’ai bien peur que ce soit un peu rassis, mais c’est mieux que rien, j’en suis sûr. Et le chien l’avala aussitôt et se lécha les lèvres.
Natasha atteignit la porte de la hutte. Tremblante, elle frappa un coup.
« Entrez, » couina une horrible voix.
La petite fille entra. Là était assis Baba Yaga, la sorcière aux jambes squelettiques, assise à tisser sur un métier à tisser. Dans un coin de la hutte, un chat noir maigre observait un trou de souris.
« Bonjour ma tante, » dit Natasha, essayant de ne pas montrer sa peur.
« Bonne journée à vous, ma nièce, » dit Baba Yaga.
« Ma belle-mère m’a envoyé vous demander une aiguille et du fil pour raccommoder une chemise. »
« Vraiment ? » sourit la sorcière ironiquement en montrant ses dents de fer, car elle savait combien sa sœur détestait sa belle-fille. « Assis-toi ici au métier à tisser et continue mon tissage, pendant que je vais chercher l’aiguille et le fil.
La petite fille s’assit au métier à tisser et commença à tisser.
Baba Yaga chuchota à sa servante : « Écoute-moi ! Prépare un bain très chaud et lave ma nièce. Frotte-la. Je vais en faire un délicieux repas. »
Alors que la servante entrait chercher la cruche pour remplir l’eau du bain, Natasha dit: « Je vous en prie, s’il vous plaît ne soyez pas trop rapide pour faire le feu, et s’il vous plaît, portez l’eau du bain dans une passoire, afin que l’eau puisse s’écouler. » La servante ne dit rien mais elle mit en effet beaucoup de temps à préparer le bain.
Baba Yaga s’approcha de la fenêtre et dit de sa voix la plus douce : « Est-ce que tu tisses, petite nièce ? Est-ce que tu tisses, ma jolie ?
« Je tisse, ma tante », répondit Natasha.
Lorsque Baba Yaga s’éloigna de la fenêtre, la petite fille parla au chat noir affamé qui surveillait le trou de souris.
« Que fais-tu? »
« J’attends une une souris », répondit le pauvre chat. « Je n’ai pas mangé depuis trois jours. »
« Quelle chance ! », dit Natasha, « il me reste du fromage ! » Et elle donna son fromage au chat noir, qui l’englouti d’une bouchée. Puis il dit : « Petite fille, veux-tu sortir d’ici ?
« Oh, mon chaton chéri, » dit Natasha, « bien sûr que j’aimerai sortir d’ici ! Car je crains que Baba Yaga essaie de me manger avec ses dents de fer. »
« C’est exactement ce qu’elle a l’intention de faire », dit le chat. « Mais je sais comment t’aider. »
Juste à ce moment, Baba Yaga revenait à la fenêtre.
« Tu tisses, petite nièce ? » Demanda t-elle. « Tu tisses, ma jolie ?
« Je tisse, ma tante », dit Natasha, tandis que le métier à tisser faisait cliquetis, cliquetis, cliquetis.
Baba Yaga s’éloigna à nouveau.
Le chat chuchota à Natasha : « Il y a un peigne sur le tabouret et il y a une serviette pour ton bain. Tu dois les prendre tous les deux et courir pendant que Baba Yaga est encore dans le bain. Baba Yaga te poursuivra. Quand elle le fera, tu jetteras la serviette derrière toi, et elle se transformera en une grande et large rivière. Il lui faudra un peu de temps pour s’en remettre. Quand elle franchira la rivière, tu jetteras la le peigne derrière toi. Il se transforma en une forêt tellement impénétrable qu’elle ne la traversera jamais. »
« Mais elle entendra le métier à tisser s’arrêter », répondit Natasha, « et elle saura que je suis parti. »
« Ne t’inquiète pas, je m’en occupe », dit le maigre chat noir.
Le chat prit la place de Natasha au métier à tisser.
Cliquetis clac, cliquetis clac; le métier à tisser ne s’était jamais arrêté un instant.
Natasha vérifia que Baba Yaga était toujours dans le bain, puis elle sauta hors de la hutte.
Le gros chien bondit pour la mettre en pièces. Mais au moment où il allait lui sauter dessus, il la reconnu et s’arrêta.
« Tu es la petite fille qui m’a donné le pain et la viande », dit-il. « Bonne chance à toi, petite fille », et il s’allongea la tête entre les pattes. Elle lui caressa la tête et lui gratta les oreilles.
Quand elle arriva à la grille, elles s’ouvrit doucement, doucement, sans faire le moindre bruit, grâce à l’huile qu’elle avait versée auparavant dans ses gonds.
Alors, elle se mit à courir de toutes ses forces!
Pendant ce temps, le maigre chat noir était assis au métier à tisser. Cliquetis clac, cliquetis clac, chantait le métier à tisser grâce au chat qui tissais et s’emmêlait dans les fils en désordre.
Baba Yaga revint alors à la fenêtre.
« Tu tisses, petite nièce ? » demanda-t-elle d’une voix aiguë. « Tu tisses, ma jolie ?
« Je tisse, ma tante, » dit le mince chat noir, emmêlant et emmêlant le fil, tandis que le métier à tisser faisait cliquetis, cliquetis, cliquetis.
« Ce n’est pas la voix de mon dîner », s’écria Baba Yaga, et elle sauta dans la hutte en faisant grincer ses dents de fer. Derrière le métier à tisser, elle ne vit pas de petite fille, mais seulement le pauvre chat noir, tout emmêlé dans les fils !
« Grrr! » dit Baba Yaga, et elle sauta sur le chat. « Pourquoi n’as-tu pas arraché les yeux de la petite fille ?
Le chat retroussa sa queue et arqua son dos. « Durant toutes ces années que je t’ai servi, tu ne m’as donné que de l’eau et tu m’as fait chasser pour mon dîner. La petite fille m’a donné du vrai fromage. »
Baba Yaga était folle de rage. Elle attrapa le chat et le secoua de toutes ses forces. Alors, se tournant vers la servante, elle la saisi par le col, et cria : « Pourquoi as-tu mis si longtemps à préparer le bain ?
« Ah ! » trembla la servante, « Durant toutes ces années que je t’ai servi, tu ne m’as jamais offert ne serait-ce qu’un chiffon, alors que la petite fille m’a donné un joli mouchoir. »
Baba Yaga la maudit et se précipita dans la cour.
Voyant la grille grande ouverte, elle cria : « Grille! Pourquoi n’as-tu pas couiné quand elle t’a ouvert ? »
« Ah ! » dit la grille, « Durant toutes ces années que je t’ai servi, tu n’as jamais daigné me verser ne serait-ce qu’une goutte d’huile sur les gonds, et je grinçais tous les jours pour ma plus grande honte. La petite fille m’a huilé et grâce à elle je peux maintenant m’ouvrir et me fermer sans un bruit. »
Baba Yaga claqua la grille. Se retournant, elle pointa son long doigt vers le chien. « Toi! » cria t-elle, « pourquoi ne l’as tu pas mis en pièces quand elle est sortie en courant de la maison? »
« Ah ! » dit le chien, « Durant toutes ces années que je t’ai servi, tu ne m’as jamais jeté autre chose qu’une vieille croûte d’os, mais la petite fille m’a donné de la vraie viande et du vrai pain. »
Baba Yaga se précipita dans la cour, les maudissant et les frappant tous, tout en criant à tue-tête.
Puis elle sauta dans son mortier géant. Battant le mortier avec un pilon géant pour le faire aller plus vite, elle s’envola dans les airs et rattrapa bientôt Natasha en fuite.
Là, loin devant elle au sol, elle aperçut la jeune fille courant à travers les arbres, trébuchant et regardant avec effroi par-dessus son épaule.
« Tu ne m’échapperas pas! » dit Baba Yaga en riant horriblement et elle dirigea son mortier volant droit vers la petite fille.
Natasha courait plus vite qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant. Bientôt, elle put entendre le mortier de Baba Yaga cogner sur le sol derrière elle et ses dents de métal grincer d’un bruit strident. Désespérément, elle se souvint des paroles du maigre chat noir et jeta la serviette derrière elle sur le sol. La serviette devint de plus en plus grosse, de plus en plus humide, et bientôt une rivière large et profonde se dressa entre la petite fille et Baba Yaga.
Natasha continua à courir. Oh, comme elle courait ! Lorsque Baba Yaga atteint le bord de la rivière, elle cria plus fort que jamais et jeta son pilon sur le sol, car elle savait qu’elle ne pouvait pas survoler une rivière enchantée. De rage, elle s’envola vers sa maison à pattes de poule. Là, elle rassembla toutes ses vaches et les conduisit à la rivière.
« Buvez, buvez! » leur cria t-elle, et les vaches burent toute la rivière jusqu’à la dernière goutte. Ensuite, Baba Yaga sauta à nouveau dans son mortier géant et survola le lit asséché de la rivière pour poursuivre sa proie.
Natasha avait pris de l’avance en courant, et elle pensait enfin être libérée de la terrible sorcière. Mais son cœur se glaça de terreur quand elle vit à nouveau fondre sur elle la silhouette sombre depuis le ciel et entendit les dents de fer grincer horriblement.
« Cette fois c’est la fin pour moi! » se désespéra t-elle. Puis elle se souvint soudain de ce que le chat avait dit à propos du peigne.
Natasha jeta le peigne derrière elle, et le peigne devint de plus en plus gros, et ses dents se transformèrent en une épaisse forêt, si épaisse que même Baba Yaga ne pouvait y entrer.
La sorcière aux jambes d’os, grinça des dents et hurla de rage et de frustration, et s’en retourna finalement vers sa hutte à pattes de poule.
La petite fille fatiguée, arriva finalement à la maison.
Elle avait peur d’entrer et de voir sa méchante belle-mère. Alors, au lieu d’entrer, elle attendit dehors dans le hangar.
Quand elle vit passer son père, elle courut vers lui.
« Où étais-tu? » cria son père. « Et pourquoi ton visage est-il si rouge ?
La belle-mère blêmit quand elle vit la petite fille, elle n’en croyait pas ses yeux et ses dents grincèrent au point de se casser.
Mais Natasha n’avait pas peur, et elle courut jusqu’à son père et monta sur ses genoux. Elle lui raconta tout ce qui s’était passé. Lorsque le vieil homme apprit que la belle-mère avait envoyé sa fille se faire manger par Baba Yaga, la sorcière, il était tellement en colère qu’il la chassa de la hutte et ne la laissa jamais revenir.
À partir de ce moment-là, il prit lui-même bien soin de sa fille et ne laissa plus personne s’interposer entre eux.
Autour de la table à nouveau remplie de pain et de confiture, le père et la fille jouèrent à nouveau à cache-cache derrière le samovar, et vécurent heureux pour toujours.
Le petit Poucet

De Charles Perrault, version adaptée de Wikipédia.
Un bûcheron et sa femme n’avaient plus de quoi nourrir leurs sept garçons.
Un soir, alors que les enfants dormaient, les parents se résignèrent, la mort dans l’âme, à les perdre dans la forêt.
Heureusement, le plus petit de la fratrie, âgé de sept ans, surnommé Petit Poucet en raison de sa petite taille, espionnait la conversation.
Prévoyant, il se munit de petits cailloux blancs qu’il laissa tomber un à un derrière afin que lui et ses frères puissent retrouver leur chemin.
Le lendemain, le père mit son sinistre plan à exécution. Mais le Petit Poucet et ses frères regagnèrent vite leur logis grâce aux cailloux semés en chemin.
Les parents furent tout heureux de les revoir car, entre-temps, le seigneur du village avait enfin remboursé aux bûcherons l’argent qu’il leur devait.
Mais ce bonheur ne dura que le temps de cette prospérité éphémère.
Lorsqu’ils se retrouvèrent dans la pauvreté première, les parents décidèrent à nouveau d’abandonner leurs sept enfants dans la forêt.
Cette fois, ils s’assurèrent de fermer la porte de la maison à clef afin que le Petit Poucet ne puisse pas aller ramasser des cailloux.
Il tenta donc à la place, au moment du trajet, de laisser tomber des petits morceaux du pain que leur mère leur avait donné à lui et à ses frères, mais le pain fut mangé par des oiseaux.
Et c’est ainsi que lui et ses frères se retrouvèrent perdus dans la forêt.
Ils arrivèrent alors devant un château où ils demandèrent le logis.
La femme habitant en cette maison essaya de les persuader de ne pas entrer car son mari était un ogre qui mangeait les petits enfants.
Mais le Petit Poucet, préférant l’ogre aux loups de la forêt, insista pour y entrer avec ses frères.
Le soir venu, la femme les cacha sous un lit, mais son ogre de mari attiré par une « odeur de chair fraîche » eut vite fait de découvrir la cachette des jeunes enfants.
« Ça sent la chair fraîche! » dit-il en les attrapant.
Elle réussit toutefois à le convaincre de remettre au lendemain son festin.
Les petits furent ensuite couchés dans la chambre des sept filles de l’ogre.
Durant la nuit, Poucet échangea son bonnet et celui de ses frères contre les couronnes d’or des filles de l’ogre. Il eut for raison, car l’ogre entra dans la chambre pendant la nuit, et, croyant trouver les sept garçons, tua ses sept filles.
L’ogre retourna se recoucher en rêvant au festin macabre qui l’attendait.
Le lendemain matin, les petits s’enfuirent avant l’aube, et en se réveillant, découvrant son erreur, l’ogre fou de rage partit à leur recherche en enfilant ses bottes de sept lieues.
Fatigué, il s’assit sur une pierre sous laquelle les enfants s’étaient justement cachés et il s’endormit.
Le Petit Poucet saisissant cette chance, retira les bottes magiques de l’ogre, en prenant soin de ne pas le réveiller.
Puis il convainquit ses frères de rentrer chez leurs parents tandis qu’il enfilait les bottes de sept lieues et courait jusqu’au château de l’ogre pour s’emparer de son trésor.
Les parents furent heureux de retrouver leurs enfants et d’avoir de quoi les nourrir grâce au courage et à l’intelligence du Petit Poucet.
Moralité de Perrault
« On ne s’afflige point d’avoir beaucoup d’enfants,
Quand ils sont tous beaux, bien faits et bien grands,
Et d’un extérieur qui brille ;
Mais si l’un d’eux est faible ou ne dit mot,
On le méprise, on le raille, on le pille ;
Quelquefois cependant c’est ce petit marmot
Qui fera le bonheur de toute la famille. »
Hansel et Gretel

Dans une chaumière près de la forêt vivait un bûcheron avec ses deux enfants, qui s’appelaient Hansel et Gretel. Sa femme était morte à leur naissance, et il s’était remarié quelques années après. Mais sa nouvelle femme était méchante et égoïste et n’aimait pas les enfants.
Les temps étaient durs et ils ne gagnaient plus d’argent. Un soir la marâtre dit à son mari:
– Il n’y a plus assez d’argent pour nous nourrir tous. Les enfants doivent partir et se débrouiller seuls. Demain, tu vas les emmener dans la forêt et les abandonner.
Le père protesta. Mais sa femme insista tellement et tellement, qu’il finit par céder.
Hansel, qui était dans la pièce voisine, avait tout entendu.
Le lendemain, ils partirent tous, sous prétexte d’aller ramasser du bois dans la forêt. Il marchèrent tant que quand ils s’arrêtèrent, les enfants s’endormirent. Et quand ils se réveillèrent, les parents étaient partis et ils étaient seuls. La nuit tombait et les cris des loups commençaient à s’entendre au loin.
Hansel et Gretel tremblaient de peur, mais le garçon essaya de rassurer sa soeur en lui disant:
– Ne t’inquiète pas Gretel, la nuit dernière, j’ai entendu que notre belle-mère voulait nous perdre, et j’ai semé des bouts de pains tout au long de la journée, pour retrouver notre chemin et revenir à la maison.
Mais ils eurent beau chercher les miettes de pain, ils n’en trouvaient aucune, car les oiseaux les avaient toutes mangé !
Désespérés, ils commencèrent à marcher parmi les arbres et ne voyaient presque plus rien dans la nuit noire. Ils grelottaient de froid, de faim et de peur.
Alors qu’ils avaient perdu tout espoir, ils aperçurent soudain une belle petite maison dans une clairière de la forêt. Mais quelle ne fut pas leur surprise en découvrant qu’elle était entièrement faite de sucreries. Le toit était en chocolat, décoré de bonbons colorés, et les portes et fenêtres étaient en caramel. Il y avait un petit jardin couvert de fleurs en sucre, d’arbres en sucettes, et du sirop de fraise coulait de la fontaine.
Stupéfaits, les enfants s’approchèrent et commencèrent à manger tout ce qui était devant eux.
Après un moment, une vieille femme ridée sortit de la maison et les salua gentiment.
– Je vois que vous êtes perdus et affamés, mes petits ! Dit-elle. Entrez, ne restez pas là ! Dans ma maison, vous serez à l’abri et aurez toutes les sucreries que vous voulez.
Les enfants, heureux et confiants, entrèrent dans la maison sans se douter qu’ils avaient affaire à une méchante sorcière qui avait construit une maison de chocolat et de bonbons pour attirer les enfants et les manger !
Une fois à l’intérieur, elle verrouilla la porte, prit Hansel et l’enferma dans une cage. Gretel, terrifiée, se mit à pleurer.
– Toi, petite, arrête de pleurnicher ! A partir de maintenant, tu seras ma servante et tu devras cuisiner pour ton frère. Je veux qu’il devienne très gros et dans quelques semaines je le mangerai. Si tu n’obéis pas, tu subiras le même sort.
La pauvre petite fille dût obéir. Chaque jour, à contre-coeur, elle apportait des plats, des desserts et des confiseries à son frère Hansel. Le soir, la sorcière venait dans la cellule pour voir si le garçon avait pris du poids.
– Passe ta main à travers la grille, lui disait-elle pour voir si son bras avait grossi.
Hansel avait bien grossis, car il ne pouvait resister à autant de bonnes choses, mais pour tromper la sorcière, il faisait passer un os de poulet à travers les barreaux au lieu de son doigt. La sorcière, qui était presque aveugle, pensait qu’Hansel ne grossissait pas. Pendant des semaines, il réussit à la tromper, mais un jour, la méchante femme en a eu assez.
– Ton frère ne prend pas de poids, et je suis fatiguée d’attendre ! Dit-elle à Gretel. « Prépare le four, je vais le manger aujourd’hui ».
Gretel, malgré sa peur, imagina un stratagème et lui dit qu’elle ne savait pas comment allumer le feu. La sorcière s’approcha donc du four.
– Tu es donc inutile ! Se plaignit-elle en s’accroupissant devant le four, « Je vais devoir le faire moi-même ! »
Alors, lorsque le feu commença à être très chaud, Gretel prit son courage à deux mains, et poussa la sorcière dans le four en refermant la porte derrière elle. La sorcière mourut en quelques instants. Gretel prit les clés de la cage et libéra son frère.
Libres et hors de danger, les deux enfants explorèrent la maison et trouvèrent un tiroir contenant des pièces d’or, des bijoux et des pierres précieuses. Ils en remplirent leurs poches, prirent de la nourriture et des bonbons et s’enfuirent.
Ils s’enfoncèrent à nouveau dans la forêt et retrouvèrent enfin le chemin de la maison familiale, guidés par le soleil et les oiseaux.
Au loin, ils aperçurent leur père qui pleurait, assis dans le jardin. Quand il les vit au loin, il courut pour les embrasser tendrement. Il leur demanda pardon et leur dit qu’il avait chassé sa mauvaise femme.
Hansel et Gretel lui pardonnèrent et lui montrèrent les trésors qu’ils avaient apportés et ils n’eurent plus jamais faim.
Adaptation du conte de fées des frères Grimm. Lu par Womantica. Illustrations de Adrian Ludwig Richter, Arthur Rackham, Theodor Hosemann et Alexander Zick
Alice au pays des merveilles

D’après l’oeuvre de Lewis Carroll. Version courte par Contesdefees.com. Illustrations de John Tenniel (1820-1914).
Par une chaude après-midi d’été, Alice était assise au bord à la rivière et rêvassait. Elle était sur point de s’assoupir quand soudain, elle vit passer devant elle un lapin blanc qui portait une élégante veste en velours et avait l’air très pressé en regardant tout le temps sa montre.
– Je suis en retard! – Dit soudain le lapin en regardant sa montre.
Intriguée, Alice le suivit pendant un moment jusqu’à ce qu’il disparaisse dans un terrier. Sans réfléchir, elle entra après lui et tomba soudain dans un long puits qui finit par déboucher dans une pièce qui avait de nombreuses portes minuscules et fermées. Le lapin n’était plus là.
Au centre de la pièce, il y avait une table en verre et sur cette table était posée une clé en or. Alice prit la clé et essaya d’ouvrir toutes les portes jusqu’à ce que l’une d’elles s’ouvre enfin.
De l’autre côté, elle aperçut un beau jardin mais la porte était trop petite pour qu’elle puisse la traverser. Elle referma la porte et reposa la clé sur la table.
Elle regarda alors à nouveau la table et vit une bouteille sur laquelle était écrit : « Bois-moi ». Elle but quelques gouttes, et commença soudain à rapetisser. Elle devint si petite qu’elle pouvait maintenant passer la porte du jardin. Mais alors, elle réalisa qu’elle avait oublié la clé sur la table et qu’elle ne pouvait plus l’atteindre maintenant qu’elle était minuscule.
Maintenant qu’elle pouvait voir sous la table, et elle découvrit justement une petite boîte contenant un gâteau et sur laquelle était écrit : « Mange-moi ». Alice croqua un morceau du gâteau et commença à grandir et grandir jusqu’à ce qu’elle mesure environ trois mètres de haut et se cogne au plafond avec sa tête. Mais bien sûr, maintenant elle ne pouvait plus aller au jardin et cela la fit pleurer. Des larmes géantes coulaient de ses joues.
À ce moment là, le lapin blanc réapparut dans la pièce avec une paire de gants blancs dans une main et un grand éventail dans l’autre.
« La duchesse sera fâchée si je la fais attendre ! – Dit-il.
– Monsieur Lapin ! Attendez un moment s’il vous plaît – cria Alice.
Mais le lapin s’enfuit à toute vitesse. À tel point qu’il en laissa tomber ses gants blancs et son éventail.
Comme il faisait très chaud dans ce terrier, Alice ramassa l’éventail du lapin et commença à s’éventer avec. Réalisant qu’elle redevenait petite, elle le relâcha rapidement avant qu’il ne soit trop tard. Elle essaya à nouveau de récupérer la clé sur la table, mais elle glissa et se retrouva soudain jusqu’au menton dans de l’eau salée.
Mais ce n’était pas de l’eau salée. C’était la mare de larmes qu’elle avait produit plus tôt en pleurant ! Bientôt l’étang se remplit de toutes sortes d’animaux : une souris, des oiseaux, un canard et même un dodo…
Ils commencèrent à nager ensemble et atteignirent le bord de l’étang. Comme ils étaient tous trempés et voulaient se sécher, le dodo proposa un jeu amusant : chacun devait courrir en rond et s’arrêter quand il voudrait. Alice pensait que c’était un jeu un peu étrange, mais comme ils gagnaient tous, c’était amusant.
Puis le lapin blanc arriva à nouveau. Il était très nerveux et cherchait partout quelque chose.
– Je dois les trouver ! Il faut que je les retrouve sans une égratignure ou bien la duchesse… Alice, en entendant le lapin, sut tout de suite qu’il cherchait ses gants blancs et son éventail.
– Mary Ann va chez toi tout de suite et apporte-moi une paire de gants et un éventail !
Surprise qu’on la prenne pour quelqu’un d’autre, Alice obéit pourtant sans broncher au Lapin, trop curieuse d’en savoir plus sur cette histoire.
Dans la maison qui se trouvait juste à côté, il y avait une table sur laquelle se trouvaient un éventail et deux ou trois paires de petits gants blancs. À côté il y avait une bouteille en verre sans étiquette.
Elle décida de l’essayer et d’un coup, elle grandit tellement qu’elle resta coincée à l’intérieur de la maison sans pouvoir sortir.
Le lapin et les autres animaux essayèrent de l’aider à sortir, la poussèrent, la tirèrent et songèrent même à brûler la maison, mais tout à coup il se mit à pleuvoir des cailloux ! Évidemment ce n’étaient pas des cailloux ordinaires, et Alice découvrit qu’ils se transformaient en biscuits à thé lorsqu’elles tombaient au sol.
Elle en mangea un et…. Que pensez-vous qu’il arriva? Alice redevint petite et courut hors de la maison. Elle entra dans la forêt voisine et décida que la première chose à faire était de retrouver sa taille, et la seconde, d’aller enfin visiter le beau jardin derrière la petite porte du terrier.
Une fois ceci décidé, elle aperçu une chenille géante qui se prélassait sur un champignon géant, en fumant tranquillement sur son grand narguilé et en jetant de mystérieux nuages de fumée.
– Qui es tu? – demanda la chenille
– Je ne suis plus très sûre. J’ai changé de taille tellement de fois que je me sens un peu confuse – dit Alice.
– Quelle taille voudrais-tu faire ?
– J’aimerais être un peu plus grande…
– Voici mon conseil: Un côté te fera grandir et l’autre rétrécir. – Répondit la chenille.
Puis elle descendit du champignon et s’en alla dans l’herbe.
– Un côté de quoi? Pensa Alice.
– Du champignon! Cria la Chenille au loin comme si elle avait lu dans les pensées d’Alice.
Alors Alice mordit du côté droit du champignon. Elle rapetissa tellement vite que son menton cogna ses pieds.
Alors elle mordit du côté gauche du champignon. Mais son cou commença à pousser tellement haut que ses mains n’atteignaient plus sa tête. Un oiseau la prit même pour un serpent.
Elle mordit encore d’un côté et de l’autre plusieurs fois jusqu’à retrouver sa taille normale.
Elle reprit son chemin dans la forêt et arriva à une clairière au centre de laquelle se trouvait une minuscule maison d’un mètre de haut. Elle mangea un autre morceau de champignon pour se mettre à la bonne taille et entra dans la maison.
Dans la cuisine, il y avait une cuisinière qui préparait une soupe qui sentait bon le poivre. À côté d’elle il y avait un chat qui n’arrêtait pas de sourire et au centre il y avait la Duchesse. Elle était assise sur un tabouret et berçait un bébé dans ses bras. C’était certainement un endroit très curieux.
– Excusez-moi, pourriez-vous me dire pourquoi le chat sourit d’une oreille à l’autre ? demanda Alice.
– Parce que c’est un chat du Cheshire – dit la Duchesse.
Puis elle dit:
– Au fait, je dois aller jouer au croquet avec la reine. Prends ça! Tu peux le bercer si tu veux. Attrape!
Et la Duchesse lança le bébé à Alice.
Alice sortit et retourna dans la forêt avec le bébé qui, au bout d’un moment, ressemblait de moins en moins à un enfant. Lorsqu’elle le posa sur le sol, il s’était transformé en un joli petit cochon et il se mit à trotter joyeusement.
Alice commençait à se sentir perdue lorsqu’elle rencontra à nouveau le chat du Cheshire.
– Chat du Cheshire, pourriez-vous me dire quelle direction je dois prendre ?
– Ça dépend où tu veux aller… Si tu continues par là tu rencontreras le Chapelier et si tu vas par là ce sera le Lièvre de Mars. Mais peu importe, car ils sont tous les deux aussi fous.
Alice décida de rendre visite au Lièvre de Mars, car elle connaissait déjà un chapelier et était plus curieuse de connaître un lièvre.
Dans le jardin de la maison du Lièvre, lui et le Chapelier prenaient le thé. Alice décida de s’asseoir à côté d’eux, bien qu’ils ne l’aient pas invité.
– En quoi un corbeau ressemble-t-il à un bureau ? – Demanda le Chapelier à Alice en écarquillant les yeux.
Après quelques instants de réflexion, Alice finit par abandonner.
– je ne sais pas, dit-elle.
– Moi non plus. Je n’en ai aucune idée! – répondit le Chapelier.
Tout à coup, le Lièvre dit:
– Au fait, il est six heures. Il est toujours six heures ici. C’est donc l’heure du thé.
Ils commencèrent à prendre le thé en discutant de choses absurdes. Alice ne comprenait presque rien à ce qu’ils racontaient, alors elle décida de partir.
Elle retourna dans la forêt et y trouva un arbre avec une porte. Elle entra et se retrouva enfin à nouveau dans la pièce du terrier avec au centre la table en verre et autours les petites portes.
Cette fois-ci, Alice s’assura d’abord de prendre la clé en or sur la table, puis elle ouvrit la porte qui menait au jardin. Elle prit le champignon de la chenille et en mangea de petits bouts jusqu’à atteindre environ cinquante centimètres de haut. Enfin elle franchit la porte et entra dans le magnifique jardin.
À peine arrivée dans le jardin, Alice entendit un grand bruit et vit arriver vers elle des soldats, des courtisans et des notables, tous habillés comme des cartes à jouer. À l’avant de ce cortège sonnaient les tambours et les trompettes des soldats de carte. Et au bout de tout cette cour elle reconnut le lapin blanc à sa veste de velours, qui accompagnait le Roi et la Reine de cœur.
– Qui est-ce? – Demanda la reine en désignant Alice
– Je suis Alice, Votre Majesté.
– Tu sais jouer au croquet ?
– Oui – répondit Alice
– Alors viens!
Elle n’avait jamais vu jouer au croquet comme cela auparavant. Les boules étaient des hérissons, les maillets étaient des flamants roses, et les soldats se courbaient pour former les arceaux.
De plus, ils jouaient tous en même temps et se disputaient tout le temps et chaque fois que la reine se mettait en colère, elle criait:
– Coupez-lui la tête !
Mais n’y avait plus de joueurs, car tous avaient déjà été condamnés à mort par la reine, la partie de croquet était terminée.
Après cela, Alice partit et continua ses aventures au pays des merveilles, rencontrant la tortue Mock et le Griffon, un animal fantastique mi-aigle, mi-lion.
Puis elle dut revenir au royaume des cartes car un grand procès avait commencé et elle était appelé à témoigner.
Tous les habitants du pays des merveilles étaient rassemblés dans la salle du tribunal.
Le lapin blanc sonna trois fois de la trompette et annonça les chefs d’accusation :
– La reine de cœur a fait des tartelettes un jour d’été et le valet de cœur les a volé et caché.
Une grande agitation éclata dans la salle. Les témoins commencèrent à témoigner.
Le premier à parler fut le Chapelier, suivi de la cuisinière de la Duchesse, puis arriva le tour d’Alice.
Mais comme elle ne s’était pas rendu compte qu’elle avait grandi à nouveau, en se levant d’un coup, elle renversa tout le banc et avec lui tous les animaux qui étaient assis dessus.
Une fois la calme revenu, Alice déclara qu’elle ne savait rien de cette affaire de tarte.
Le procès se poursuit et, alors que l’accusé, le Valet de Coeur, était sur le point d’être condamné, Alice intervint pour l’aider.
Elle déclara qu’il était absurde de condamner à mort un pauvre valet de cœur pour une simple affaire de tarte.
Mais à ce moment là, la reine entra dans une colère folle.
-Coupez-lui la tête !! – cria t’elle de toutes ses forces en désignant Alice
Puis tout le jeu de cartes s’éleva dans les airs et tomba sur Alice. Mais…
– Alice, réveille-toi ! Tu dors depuis longtemps – lui répétait sa sœur en la secouant doucement.
– Hein? Ah oui… Si tu savais tout ce dont j’ai rêvé… Et la petite fille se mit à raconter à sa sœur, en se rappelant toutes les aventures étranges qu’elle avait vécues au Pays des Merveilles.
Quand elle eut fini, Alice se leva et partit et sa sœur s’endormit en rêvant aux aventures d’Alice. Et devinez qui arriva à cet instant en regardant sa montre…
Autres illustrations de Arthur Rackham


Barbe Bleue

Version originale du livre Les Contes de Perrault, textes originaux modernisés par Pierre Féron (chanoine), Casterman, 1902
Illustrations de Gustave Doré, 1901
Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d’or et d’argent, des meubles en broderies, et des carrosses tout dorés. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue : cela le rendait si laid et si terrible, qu’il n’était personne qui ne s’enfuît de devant lui.
Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles. Il lui en demanda une en mariage. Elles n’en voulaient point toutes deux, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c’est qu’il avait déjà épousé plusieurs femmes, et qu’on ne savait ce que ces femmes étaient devenues.
La Barbe-Bleue, pour faire connaissance, les mena, avec leur mère et trois ou quatre de leurs meilleures amies à une de ses maisons de campagne, où on demeura huit jours entiers. Ce n’étaient que promenades, que parties de chasse et de pêche, que danses et festins, que collations : enfin tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis était un fort honnête homme. Dès qu’on fut de retour à la ville, le mariage se conclut.
Au bout d’un mois, la Barbe-Bleue dit à sa femme qu’il était obligé de faire un voyage en province, de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence ; qu’il la priait de se bien divertir pendant son absence ; qu’elle fît venir ses bonnes amies ; qu’elle les menât à la campagne, si elle voulait ; que partout elle fît bonne chère. « Voilà, lui dit-il, les clefs des deux grands garde-meubles ; voilà celles de la vaisselle d’or et d’argent, qui ne sert pas tous les jours ; voilà celles de mes coffres-forts où est mon or et mon argent ; celles des cassettes où sont mes pierreries, et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clef-ci, c’est la clef du cabinet au bout de la grande galerie de l’appartement bas : ouvrez tout, allez partout ; mais, pour ce petit cabinet, je vous défends d’y entrer, et je vous le défends de telle sorte que, s’il vous arrive de l’ouvrir, il n’y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. »
Elle promit d’observer exactement tout ce qui lui venait d’être ordonné, et lui monte dans son carrosse, et part pour son voyage.
Les voisines et les bonnes amies n’attendirent pas qu’on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elles avaient d’impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n’ayant osé y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue, qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite aux garde-meubles, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sophas des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs où l’on se voyait depuis les pieds jusqu’à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d’argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu’on eût jamais vues. Elles ne cessaient d’exagérer et d’envier le bonheur de leur amie, qui, cependant, ne se divertissait point à voir toutes ces richesses, à cause de l’impatience qu’elle avait d’aller ouvrir le cabinet de l’appartement bas.
Elle fut si pressée de sa curiosité, que, sans considérer qu’il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé, et avec tant de précipitation qu’elle pensa se rompre le cou deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s’y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu’il pourrait lui arriver malheur d’avoir été désobéissante ; mais la tentation était si forte, qu’elle ne put la surmonter : elle prit donc la petite clef, et ouvrit en tremblant la porte du cabinet.
D’abord elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que le plancher était tout couvert de sang caillé, et que, dans ce sang, se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs : c’était toutes les femmes que la Barbe-Bleue avait épousées, et qu’il avait égorgées l’une après l’autre. Elle pensa mourir de peur, et la clef du cabinet qu’elle venait de retirer de la serrure, lui tomba de la main.
Après avoir un peu repris ses sens, elle ramassa la clef, referma la porte, et monta à sa chambre pour se remettre un peu ; mais elle n’en pouvait venir à bout, tant elle était émue.
Ayant remarqué que la clef du cabinet était tachée de sang, elle l’essuya deux ou trois fois ; mais le sang ne s’en allait point : elle eut beau la laver, et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il demeura toujours du sang, car la clef était fée, et il n’y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait : quand on ôtait le sang d’un côté, il revenait de l’autre.
La Barbe-Bleue revint de son voyage dès le soir même, et dit qu’il avait reçu des lettres, dans le chemin, qui lui avaient appris que l’affaire pour laquelle il était parti venait d’être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu’elle put pour lui témoigner qu’elle était ravie de son prompt retour.
Le lendemain, il lui demanda les clefs ; et elle les lui donna, mais d’une main si tremblante, qu’il devina sans peine tout ce qui s’était passé. « D’où vient, lui dit-il, que la clef du cabinet n’est point avec les autres ? — Il faut, dit-elle, que je l’aie laissée là-haut sur ma table. — Ne manquez pas, dit la Barbe-Bleue, de me la donner tantôt. »
Après plusieurs remises, il fallut apporter la clef. La Barbe-Bleue, l’ayant considérée, dit à sa femme : Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clef ? — Je n’en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. — Vous n’en savez rien ! reprit la Barbe-Bleue ; je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet ! Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues.
Elle se jeta aux pieds de son mari en pleurant, et en lui demandant pardon, avec toutes les marques d’un vrai repentir, de n’avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, affligée comme elle était ; mais la Barbe-Bleue avait le cœur plus dur qu’un rocher. « Il faut mourir, madame, lui dit-il, et tout à l’heure. — Puisqu’il faut mourir, répondit-elle, en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. — Je vous donne un demi-quart d’heure, reprit la Barbe-Bleue ; mais pas un moment davantage. »
Lorsqu’elle fut seule, elle appela sa sœur, et lui dit : Ma sœur Anne, car elle s’appelait ainsi, monte, je te prie, sur le haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point ; ils m’ont promis qu’ils me viendraient voir aujourd’hui ; et, si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. — La sœur Anne monta sur le haut de la tour ; et la pauvre affligée lui criait de temps en temps : Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? — Et la sœur Anne lui répondait : Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie.
Cependant la Barbe Bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait de toute sa force à sa femme : Descends vite, ou je monterai là-haut. — Encore un moment, s’il vous plaît, lui répondait sa femme ; et aussitôt elle criait tout bas : Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? — Et la sœur Anne répondait : Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l’herbe qui verdoie.
Descends donc vite, criait la Barbe-Bleue, ou je monterai là-haut. — Je m’en vais, répondait la femme ; et puis elle criait : Anne, ma sœur Anne ne vois-tu rien venir ? — Je vois, répondit la sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci… — Sont-ce mes frères ? — Hélas ! non, ma sœur : c’est un troupeau de moutons…
Ne veux tu pas descendre ? criait la Barbe-Bleue — Encore un moment, répondait sa femme ; et puis elle criait : Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? — Je vois, répondit-elle, deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore… Dieu soit loué ! s’écria-t-elle un moment après ; ce sont mes frères. Je leur fais signe tant que je puis de se hâter.
La Barbe-Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit, et alla se jeter à ses pieds tout épleurée et tout échevelée. « Cela ne sert de rien, dit la Barbe-Bleue ; il faut mourir. » Puis, la prenant d’une main par les cheveux, et de l’autre levant le coutelas en l’air, il allait lui abattre la tête. La pauvre femme, se tournant vers lui, et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. « Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu ; » et, levant son bras…
Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la Barbe-Bleue s’arrêta tout court. On ouvrit, et aussitôt on vit entrer deux cavaliers, qui mettant l’épée à la main, coururent droit à la Barbe-Bleue. Il reconnut que c’était les frères de sa femme, l’un dragon et l’autre mousquetaire, de sorte qu’il s’enfuit aussitôt pour se sauver ; mais les deux frères le poursuivirent de si près qu’ils l’attrapèrent avant qu’il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps, et le laissèrent mort.
La pauvre femme était presque aussi morte que son mari, et n’avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères.
Il se trouva que la Barbe-Bleue n’avait point d’héritiers et qu’ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur avec un gentilhomme, une autre partie à acheter des charges de capitaines à ses deux frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme, qui lui fit oublier le mauvais temps qu’elle avait passé avec la Barbe-Bleue.
Les Fées
Conte de Perrault, modernisé en 1902 par Pierre Féron et en 2021 par Contesdefees.com
Il était une fois une veuve qui avait deux filles : l’aînée lui ressemblait si fort d’humeur et de visage, que, qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses, qu’on ne pouvait vivre avec elles. La cadette était le vrai portrait de son père pour la douceur et l’honnêteté. Comme on aime naturellement son semblable, cette mère était folle de sa fille aînée et, en même temps, avait une aversion effroyable pour la cadette. Elle la faisait manger à la cuisine et travailler sans cesse.
Il fallait, entre autres choses, que cette pauvre enfant allât, deux fois le jour, puiser de l’eau à une grande demi-lieue du logis, et qu’elle en rapportât plein une grande cruche. Un jour qu’elle était à cette fontaine, il vint à elle une pauvre femme qui la pria de lui donner à boire.
« Oui dà, ma bonne mère, » lui dit la jeune fille ; et, rinçant aussitôt sa cruche, elle puisa de l’eau au plus bel endroit de la fontaine et la lui présenta, soutenant toujours la cruche, afin qu’elle bût plus aisément. La bonne femme, ayant bu, lui dit : « Vous êtes si bonne et si honnête, que je ne puis m’empêcher de vous faire un don ; car c’était une fée qui avait pris la forme d’une pauvre femme de village, pour voir jusqu’où irait l’honnêteté de cette jeune fille. Je vous donne pour don, poursuivit la fée, qu’à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou une fleur, ou une pierre précieuse. »
Lorsque cette fille arriva au logis, sa mère la gronda de revenir si tard de la fontaine.
« Je vous demande pardon, ma mère, dit cette pauvre fille, d’avoir tardé si longtemps ; » et, en disant ces mots, il lui sortit de la bouche deux roses, deux perles et deux gros diamants.
« Que vois-je là ! dit sa mère tout étonnée ; je crois qu’il lui sort de la bouche des perles et des diamants. D’où vient cela, ma fille ? » (Ce fut là la première fois qu’elle l’appela sa fille).
La pauvre enfant lui raconta naïvement tout ce qui lui était arrivé, non sans jeter une infinité de diamants.
« Vraiment, dit la mère, il faut que j’y envoie ma fille. Fanchon, tu as bien vu ce qui sort de la bouche de ta sœur, quand elle parle ; cela ne te plairait-il pas d’avoir le même don ? Tu n’as qu’à aller puiser de l’eau à la fontaine, et, quand une pauvre femme te demandera à boire, tu lui en donneras bien honnêtement. — Il manquerait plus que ça!, répondit la soeur, aller à la fontaine ! — Je veux que tu y ailles, reprit la mère, et tout de suite. »
Elle y alla, mais en grommelant. Elle prit le plus beau flacon d’argent qui fût dans le logis. Elle ne fut pas plus tôt arrivée à la fontaine, qu’elle vit sortir du bois une dame magnifiquement vêtue, qui vint lui demander à boire. C’était la même fée qui était apparue à sa sœur, mais qui avait pris l’air et les habits d’une princesse, pour voir jusqu’où irait la malhonnêteté de cette fille.
— Je suis venue ici, lui dit cette brutale orgueilleuse, pour vous donner à boire ! Justement j’ai apporté un flacon d’argent tout exprès pour donner à boire à Madame ? Allez-y, prenez-le et buvez!
— Vous n’êtes guère honnête, reprit la fée, sans se mettre en colère. Eh bien ! puisque vous êtes si peu serviable, je vous donne pour don qu’à chaque parole que vous direz, il vous sortira de la bouche ou un serpent, ou un crapaud.
Quand sa mère l’aperçut, elle lui cria : Eh bien ! ma fille !
— Eh bien ! ma mère ! lui répondit la méchante sœur, en jetant deux vipères et deux crapauds.
— Ô ciel, s’écria la mère, que vois-je là ? C’est la faute de ta sœur : elle me le paiera ; et aussitôt elle courut pour la battre. La pauvre enfant s’enfuit et alla se sauver dans la forêt voisine.
Le fils du roi, qui revenait de la chasse, la rencontra et, la voyant si triste, lui demanda ce qu’elle faisait là toute seule et ce qu’elle avait à pleurer !
« Hélas ! Monsieur, c’est ma mère qui m’a chassée du logis. »
Le fils du roi, qui vit sortir de sa bouche cinq ou six perles et autant de diamants, la pria de lui dire d’où cela lui venait. Elle lui conta toute son aventure. Le fils du roi considérant qu’un tel don valait mieux que tout ce qu’on pouvait donner en mariage à une autre, l’emmena au palais du roi son père, où il l’épousa.
Pour sa sœur, elle se fit tant haïr, que sa propre mère la chassa de chez elle ; et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d’un bois.
Cendrillon

Conte original de Charles Perrault modernisé en 1902 par Pierre Féron, retouché par contesdefees.com. Illustrations de Gustave Doré et Arthur Rackham.
Il était une fois un gentilhomme qui épousa, en secondes noces, une femme, la plus hautaine et la plus fière qu’on eût jamais vue. Elle avait deux filles de son humeur, et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait, de son côté, une jeune fille, mais d’une douceur et d’une bonté sans exemple : elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde.
Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa mauvaise humeur : elle ne put souffrir les bonnes qualités de cette jeune enfant, qui rendaient ses filles encore plus haïssables. Elle la chargea des plus viles occupations de la maison : c’était elle qui nettoyait la vaisselle et les meubles, qui frottait la chambre de madame et celles de medemoiselles ses filles ; elle couchait tout au haut de la maison, dans un grenier, sur une méchante paillasse, pendant que ses sœurs étaient dans des chambres avec parquet où elles avaient des lits à la mode, et des miroirs où elles se voyaient depuis les pieds jusqu’à la tête. La pauvre fille souffrait avec patience et n’osait s’en plaindre à son père, qui l’aurait grondée, parce que sa femme le gouvernait entièrement.
Lorsqu’elle avait fait son ouvrage, elle allait se mettre au coin de la cheminée, et s’asseoir dans les cendres, ce qui faisait qu’on l’appelait communément dans le logis Cendrillon. Cependant Cendrillon, avec ses méchants habits, ne laissait pas d’être cent fois plus digne que ses sœurs, bien qu’elles soient vêtues très magnifiquement.
Un jour le fils du roi donna un bal auquel il invita toutes les personnes de qualité du royaume. Nos deux demoiselles en furent aussi priées, car elles faisaient grande figure dans le pays. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits et les coiffures qui leur siéraient le mieux. Nouvelle peine pour Cendrillon, car c’était elle qui repassait le linge de ses sœurs et qui pliait leurs manchettes. On ne parlait que de la manière dont on s’habillerait. — Moi, dit l’aînée, je mettrai mon habit de velours rouge et ma garniture d’Angleterre. — Moi, dit la cadette, je n’aurai que ma jupe ordinaire ; mais, en récompense, je mettrai mon manteau à fleurs d’or et ma barrière de diamants, qui n’est pas des plus indifférentes. — On envoya quérir la bonne coiffeuse pour dresser les cornettes à deux rangs, et on fit acheter des mouches de la bonne.
Elles appelèrent Cendrillon pour lui demander son avis, car elle avait le goût bon. Cendrillon les conseilla le mieux du monde, et s’offrit même à les coiffer ; ce qu’elles voulurent bien. En les coiffant, elles lui disaient : « Cendrillon, serais-tu bien aise d’aller au bal ? — Hélas ! mesdemoiselles, vous vous moquez de moi ; ce n’est pas là ce qu’il me faut. — Tu as raison, on rirait bien, si on voyait une Cendrillon aller au bal. — Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers ; mais elle était bonne, et elle les coiffa parfaitement bien.
Elles furent près de deux jours sans manger, tant elles étaient transportées de joie. On rompit plus de douze lacets, à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue, et elles étaient toute la journée devant le miroir. Enfin l’heureux jour arriva ; on partit, et Cendrillon les suivit des yeux, le plus longtemps qu’elle put.
Lorsqu’elle ne les vit plus, elle se mit à pleurer. Sa marraine, qui la vit tout en pleurs, lui demanda ce qu’elle avait, « Je voudrais bien… je voudrais bien… » Elle pleurait si fort qu’elle ne put achever. Sa marraine, qui était fée, lui dit : « Tu voudrais bien aller au bal, n’est-ce pas ? — Hélas ! oui, dit Cendrillon en soupirant. — Eh bien ! seras-tu bonne fille ? dit sa marraine, je t’y ferai aller. » — Elle la mena dans sa chambre, et lui dit : Va dans le jardin, et apporte-moi une citrouille. » — Cendrillon alla aussitôt cueillir la plus belle qu’elle put trouver, et la porta à sa marraine, ne pouvant deviner comment cette citrouille la pourrait faire aller au bal. Sa marraine la creusa et, n’ayant laissé que l’écorce, la frappa de sa baguette, et la citrouille fut aussitôt changée en un beau carrosse tout doré.
Ensuite elle alla regarder dans la souricière, où elle trouva six souris toutes en vie. Elle dit à Cendrillon de lever un peu la trappe de la souricière, et, à chaque souris qui sortait, elle lui donnait un coup de sa baguette, et la souris était aussitôt changée en un beau cheval : ce qui fit un bel attelage de six chevaux, d’un beau gris de souris pommelé.
Comme elle était en peine de quoi elle ferait un cocher : « Je vais voir, dit Cendrillon, s’il n’y a pas quelque rat dans la ratière, nous en ferons un cocher. — Tu as raison, dit sa marraine, va voir. » — Cendrillon lui apporta la ratière, où il y avait trois gros rats. La fée en prit un d’entre les trois, à cause de sa maîtresse barbe, et, l’ayant touché, il fut changé en un gros cocher, qui avait une des plus belles moustaches qu’on ait jamais vues.
Ensuite elle lui dit : « Va dans le jardin, tu y trouveras six lézards derrière l’arrosoir ; apporte-les-moi. » — Elle ne les eut pas plus tôt apportés, que sa marraine les changea en six laquais, qui montèrent aussitôt derrière le carrosse, avec leurs habits chamarrés, et qui s’y tenaient attachés comme s’ils n’eussent fait autre chose de toute leur vie.
La fée dit alors à Cendrillon : « Eh bien ! voilà de quoi aller au bal : n’es-tu pas bien aise ? — Oui, mais est-ce que j’irai comme cela, avec mes vilains habits ? » — Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, et en même temps ses habits furent changés en habits d’or et d’argent, tout chamarrés de pierreries ; elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse ; mais sa marraine lui recommanda, sur toutes choses, de ne pas passer minuit, l’avertissant que, si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux des souris, ses laquais des lézards, et que ses beaux habits reprendraient leur première forme.
Elle promit à sa marraine qu’elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, ne se sentant pas de joie. Le fils du roi, qu’on alla avertir qu’il venait d’arriver une grande princesse qu’on ne connaissait point, courut la recevoir. Il lui donna la main à la descente du carrosse, et la mena dans la salle où était la compagnie. Il se fit alors un grand silence ; on cessa de danser, et les violons ne jouèrent plus, tant on était attentif à contempler cette inconnue. Le roi même, tout vieux qu’il était, ne laissait pas de la regarder, et de dire tout bas à la reine qu’il y avait longtemps qu’il n’avait vu une si aimable personne. Toutes les dames étaient attentives à considérer sa coiffure et ses habits, pour en avoir, dès le lendemain, des semblables, pourvu qu’il se trouvât des étoffes assez belles, et des ouvriers assez habiles.
Le fils du roi la mit à la place la plus honorable, et ensuite l’invita à danser. Elle dansa avec tant de grâce, qu’on l’admira encore davantage. Elle alla s’asseoir auprès de ses sœurs et leur fit mille honnêtetés ; elle leur fit part des oranges et des citrons que le prince lui avait donnés, ce qui les étonna fort car en réalité, elles ne la reconnaissaient pas.
Alors qu’elles causaient ainsi, Cendrillon entendit sonner onze heures trois quarts ; elle fit aussitôt une grande révérence à la compagnie, et s’en alla le plus vite qu’elle put. Dès qu’elle fut arrivée, elle alla trouver sa marraine, et, après l’avoir remerciée, elle lui dit qu’elle souhaiterait bien aller encore le lendemain au bal.
Comme elle était occupée à raconter à sa marraine tout ce qui s’était passé au bal, les deux sœurs frappèrent à la porte ; Cendrillon alla leur ouvrir. « Que vous êtes longtemps à revenir ! » leur dit-elle en baillant, en se frottant les yeux, et en s’étendant comme si elle n’eût fait que de se réveiller ; elle n’avait cependant pas eu envie de dormir, depuis qu’elles s’étaient quittées. — « Si tu étais venue au bal, lui dit une de ses sœurs, tu ne t’y serais pas ennuyée ; il est venu la plus gentille princesse, la plus gentille qu’on puisse jamais voir ; elle nous a fait mille civilités ; elle nous a donné des oranges et des citrons. » — Cendrillon ne se sentait pas de joie ; elle leur demanda le nom de cette princesse ; mais elles lui répondirent qu’on ne la connaissait pas, que le fils du roi donnerait toutes choses au monde pour savoir qui elle était. Cendrillon sourit et leur dit : « Elle était donc bien gentille ? Mon Dieu ! que vous êtes heureuses ? ne pourrais-je point la voir ? Hélas ! mademoiselle Javotte, prêtez-moi votre habit jaune que vous mettez tous les jours. — Vraiment, dit mademoiselle Javotte, je suis de cet avis ! Prêter mon habit à un vilain Cendrillon comme cela ! il faudrait que je fusse bien folle. » Cendrillon s’attendait bien à ce refus, et elle en fut bien aise, car elle aurait été grandement embarrassée, si sa sœur eût bien voulu lui prêter son habit.
Le lendemain, les deux sœurs retournèrent au bal, et Cendrillon aussi, mais encore plus parée que la première fois.
La jeune demoiselle ne s’ennuyait point et oublia ce que sa marraine lui avait recommandé ; de sorte qu’elle entendit sonner le premier coup de minuit, lorsqu’elle ne croyait point qu’il fût encore onze heures ; elle se leva, et s’enfuit aussi légèrement qu’aurait fait une biche. Le prince la suivit. Elle laissa tomber une de ses pantoufles de verre, que le prince ramassa bien soigneusement. Cendrillon arriva chez elle, bien essoufflée, sans carrosse, sans laquais, et avec ses méchants habits ; rien ne lui étant resté de sa magnificence, qu’une de ses petites pantoufles, la pareille de celle qu’elle avait laissée tomber.
On demanda aux gardes de la porte du palais s’ils n’avaient point vu sortir une princesse : ils dirent qu’ils n’avaient vu sortir personne qu’une jeune fille fort mal vêtue, et qui avait plus l’air d’une paysanne que d’une demoiselle.
Quand les deux sœurs revinrent du bal, Cendrillon leur demanda si elles s’étaient encore bien diverties, et si la belle dame y avait été ; elles lui dirent que oui, mais qu’elle s’était enfuie, lorsque minuit avait sonné, et si promptement qu’elle avait laissé tomber une de ses petites pantoufles de verre, la plus jolie du monde ; que le fils du roi l’avait ramassée, et qu’assurément il était fort désireux de connaître la personne à qui appartenait la petite pantoufle.
Elles dirent vrai ; car, peu de jours après, le fils du roi fit publier, à son de trompe, qu’il épouserait celle dont le pied serait bien ajusté à la pantoufle. On commença à l’essayer aux princesses, ensuite aux duchesses et à toute la cour, mais inutilement. On l’apporta chez les deux sœurs, qui firent tout leur possible pour faire entrer leur pied dans la pantoufle, mais elles ne purent en venir à bout. Cendrillon, qui les regardait, et qui reconnut sa pantoufle, dit en riant : « Que je voie si elle ne me serait pas bonne ! » Ses sœurs se mirent à rire et à se moquer d’elle. Le gentilhomme qui faisait l’essai de la pantoufle, ayant regardé attentivement Cendrillon, dit que cela était très juste, et qu’il avait l’ordre de l’essayer à toutes les filles. Il fit asseoir Cendrillon, et, approchant la pantoufle de son petit pied, il vit qu’il y entrait sans peine, et qu’elle y était ajustée comme un gant. L’étonnement des deux sœurs fut grand, mais plus grand encore quand Cendrillon tira de sa poche l’autre petite pantoufle, qu’elle mit à son pied. Là-dessus arriva la marraine, qui, ayant donné un coup de baguette sur les habits de Cendrillon, les fit devenir encore plus magnifiques que tous les autres.
Alors ses deux sœurs la reconnurent pour la personne qu’elles avaient vue au bal. Elles se jetèrent à ses pieds pour lui demander pardon de tous les mauvais traitements qu’elles lui avaient fait souffrir. Cendrillon les releva et leur dit, en les embrassant, qu’elle leur pardonnait de bon cœur, et qu’elle les priait de l’aimer bien toujours. On la mena chez le jeune prince, parée comme elle était, et, peu de jours après, il l’épousa. Cendrillon, qui était bonne, fit loger ses deux sœurs au palais, et les maria, dès le jour même, à deux grands seigneurs de la cour.
Riquet à la houppe

Conte original de Charles Perrault modernisé en 1902 par Pierre Féron. Illustrations de Gustave Doré, 1902 et autres gravures non signées.
Il était une fois une reine qui avait un fils si laid et si mal fait, qu’on douta longtemps s’il avait forme humaine. Une fée, qui se trouva à son baptême, assura qu’il ne laisserait pas d’être aimable, parce qu’il aurait beaucoup d’esprit : elle ajouta même qu’il pourrait, en vertu du don qu’elle venait de lui faire, donner autant d’esprit qu’il en aurait à la personne qu’il épouserait.
Tout cela consola un peu la pauvre reine, qui était bien affligée d’avoir pour enfant un si vilain marmot. Il est vrai que cet enfant ne commença pas plus tôt à parler, qu’il dit mille jolies choses, et qu’il avait dans toutes ses actions je ne sais quoi de si spirituel, qu’on en était charmé. J’oubliais de dire qu’il avait une petite houppe de cheveux sur la tête, ce qui fit qu’on le nomma Riquet à la Houppe, car Riquet était le nom de la famille.
La reine d’un royaume voisin avait deux filles. La première était plus belle que le jour. La même fée qui avait assisté à la naissance du petit Riquet à la Houppe, voulut modérer la joie de la reine ; elle lui déclara que cette petite princesse n’aurait point d’esprit, et qu’elle serait aussi stupide qu’elle était belle. Cela mortifia beaucoup la reine ; mais elle eut un bien plus grand chagrin ; car sa seconde fille se trouva extrêmement laide. « Ne vous affligez point tant, madame, lui dit la fée, votre fille sera récompensée d’ailleurs, et elle aura tant d’esprit, qu’on ne s’apercevra presque pas qu’il lui manque de la beauté. — Dieu le veuille, répondit la reine ; mais n’y aurait-il pas moyen de faire avoir un peu d’esprit à l’aînée ? — Je ne puis rien pour elle, madame, du côté de l’esprit, lui dit la fée ; mais je puis tout, du côté de la beauté ; et, comme il n’y a rien que je ne veuille faire pour votre satisfaction, je vais lui donner pour don de pouvoir rendre beau ou belle la personne qui lui plaira. »
A mesure que ces deux princesses devinrent grandes, leurs perfections crurent aussi avec elles, et on ne parlait partout que de la beauté de l’aînée et de l’esprit de la cadette. Il est vrai que leurs défauts augmentèrent beaucoup avec l’âge. La cadette enlaidissait à vue d’œil, et l’aînée devenait plus stupide de jour en jour. Ou elle ne répondait rien à ce qu’on lui demandait, ou elle disait une sottise. Elle était avec cela si maladroite, qu’elle n’eût pu ranger quatre porcelaines sur le bord d’une cheminée, sans en casser une ; ni boire un verre d’eau, sans en répandre la moitié sur ses habits.
Quoique la beauté soit un grand avantage, cependant la cadette l’emportait presque toujours sur son aînée, dans toutes les compagnies. D’abord on allait du côté de l’aînée, pour la voir et pour l’admirer ; mais bientôt après on allait à celle qui avait le plus d’esprit, pour lui entendre dire mille choses agréables ; et on était étonné qu’en moins d’un quart d’heure l’aînée n’avait plus personne au près d’elle, et que tout le monde s’était rangé autour de la cadette. L’aînée, quoique fort stupide, le remarqua bien ; et elle eût donné sans regret toute sa beauté pour avoir la moitié de l’esprit de sa sœur. La reine, toute sage qu’elle était, ne pût s’empêcher de lui reprocher plusieurs fois sa bêtise : ce qui pensa faire mourir de douleur cette pauvre princesse.
Un jour qu’elle s’était retirée dans un bois pour y plaindre son malheur, elle vit venir à elle un petit homme fort laid et fort désagréable, mais vêtu très magnifiquement. C’était le jeune prince Riquet à la Houppe, qui avait quitté le royaume de son père, pour la voir et lui parler. Il l’aborde, avec tout le respect et toute la politesse imaginable. Ayant remarqué, après lui avoir fait les compliments ordinaires, qu’elle était fort mélancolique, il lui dit : « Je ne comprends point, madame, comment une personne peut être aussi triste que vous le paraissez ; car, quoique je puisse me vanter d’avoir vu une infinité de personnes, je puis dire que je n’en ai jamais vu dont la distinction approche de la vôtre.
— Cela vous plaît à dire, monsieur, lui répondit la princesse et en demeura là. — La beauté, reprit Riquet à la Houppe, est un grand avantage, et, quand on le possède, je ne vois pas qu’il y ait rien qui puisse nous affliger beaucoup.
— J’aimerais mieux, dit la princesse, être aussi laide que vous, et avoir de l’esprit, que d’avoir de la beauté comme j’en ai, et être bête autant que je le suis.
— Il n’y a rien, madame, qui montre davantage qu’on a de l’esprit, que de croire ne pas en avoir, et il est de naturel que, plus on en a, plus on croit en manquer.
— Vous avez peut-être raison dit la princesse ; mais je sais que je suis fort bête, et c’est de là que vient le chagrin qui me tue.
— Si ce n’est que cela, madame, qui vous afflige, je puis aisément mettre fin à votre douleur.
— Et comment ferez-vous ? dit la princesse.
— J’ai le pouvoir, madame, dit Riquet à la Houppe, de donner de l’esprit autant qu’on en saurait avoir à la personne que je dois épouser ; et comme vous êtes, madame, cette personne, il ne tiendra qu’à vous que vous n’ayez autant d’esprit qu’on en peut avoir, pourvu que vous vouliez bien m’épouser. »
La princesse demeura toute interdite, et ne répondit rien. « Je vois, reprit Riquet à la Houppe, que cette proposition vous fait de la peine, et je ne m’en étonne pas ; mais je vous donne un an tout entier pour vous y résoudre. »
La princesse avait si peu d’esprit, et en même temps une si grande envie d’en avoir, qu’elle s’imagina que la fin de cette année ne viendrait jamais ; de sorte qu’elle accepta la proposition qui lui était faite. Elle n’eût pas plus tôt promis à Riquet à la Houppe qu’elle l’épouserait dans un an à pareil jour, qu’elle se sentit tout autre qu’elle n’était auparavant : elle se trouva une facilité incroyable à dire tout ce qui lui plaisait, et à le dire d’une manière fine, aisée et naturelle. Elle commença, dès ce moment, une conversation soutenue avec Riquet à la Houppe, où elle brilla d’une telle force, que Riquet à la Houppe crut lui avoir donné plus d’esprit qu’il ne s’en était réservé pour lui-même.
Quand elle fut retournée au palais, toute la cour ne savait que penser d’un changement si subit et si extraordinaire ; car autant qu’on lui avait ouï dire de bêtises auparavant, autant lui entendait-on dire des choses bien sensées et infiniment spirituelles. Toute la cour en eut une joie qui ne se peut imaginer ; il n’y eut que sa cadette qui n’en fut pas bien aise, parce que, n’ayant plus sur son aînée l’avantage de l’esprit, elle ne paraissait plus auprès d’elle qu’une guenon fort désagréable. Le roi se conduisait par ses avis, et allait même quelquefois tenir le conseil dans son appartement.
Le bruit de ce changement s’étant répandu, tous les jeunes princes des royaumes voisins la demandèrent en mariage ; mais elle n’en trouvait point qui eût assez d’esprit, et elle les écoutait tous, sans s’engager avec aucun.
Un jour elle retourna par hasard se promener dans le même bois où elle avait trouvé Riquet à la Houppe, pour rêver plus commodément à ce qu’elle avait à faire. Dans le temps qu’elle se promenait, rêvant profondément, elle entendit un bruit sourd sous ses pieds, comme de plusieurs personnes qui vont et viennent et qui agissent. Ayant prêté l’oreille plus attentivement, elle ouït que l’on disait : «Apporte-moi cette marmite ; » l’autre : « Donne-moi cette chaudière ; » l’autre : « Mets du bois dans ce feu. » La terre s’ouvrit dans le même temps, et elle vit sous ses pieds comme une grande cuisine pleine de cuisiniers, de marmitons et de toutes sortes d’officiers nécessaires pour faire un festin magnifique. Il en sortit une bande de vingt ou trente rôtisseurs, qui allèrent se camper dans une allée du bois, autour d’une table fort longue, et qui tous, la cuillère à la main et le couteau dans l’autre, se mirent à travailler en cadence, au son d’une chanson harmonieuse.
La princesse, étonnée de ce spectacle, leur demanda pour qui ils travaillaient. « C’est, madame, lui répondit le plus bavard de la bande, pour le prince Riquet à la Houppe, dont les noces se feront demain. » La princesse, encore plus surprise qu’elle ne l’avait été, et se ressouvenant tout à coup qu’il y avait un an qu’à pareil jour elle avait promis d’épouser le prince Riquet à la Houppe, pensa tomber de son haut. Ce qui faisait qu’elle ne s’en souvenait pas, c’est que, quand elle fit cette promesse, elle était encore bête, et qu’en prenant le nouvel esprit que le prince lui avait donné, elle avait oublié toutes ses sottises.
Elle n’eut pas fait trente pas, en continuant sa promenade, que Riquet à la Houppe se présenta à elle, brave, magnifique, et comme un prince qui va se marier. « Vous me voyez, dit-il, madame, exact à tenir ma parole, et je ne doute point que vous ne veniez ici pour exécuter la vôtre, et me rendre, en me donnant la main, le plus heureux de tous les hommes.
— Je vous avouerai franchement, répondit la princesse, que je n’ai pas encore pris ma résolution là-dessus, et que je ne crois pas pouvoir jamais la prendre telle que vous la souhaitez.
— Vous m’étonnez, madame, lui dit Riquet à la Houppe.
— Je le crois, dit la princesse, et assurément, si j’avais affaire à un brutal, à un homme sans esprit, je me trouverais bien embarrassée. Une princesse n’a que sa parole, me dirait-il, et il faut que vous m’épousiez, puisque vous me l’avez promis ; mais, comme celui à qui je parle est l’homme du monde qui a le plus d’esprit, je suis sûre qu’il entendra raison. Vous savez que, quand je n’étais qu’une bête, je ne pouvais néanmoins me résoudre à vous épouser ; comment voulez-vous qu’ayant l’esprit que vous m’avez donné, qui me rend encore plus difficile que je n’étais, je prenne aujourd’hui une résolution que je n’ai pu prendre dans ce temps-là ? Si vous pensiez tout de bon à m’épouser, vous avez eu grand tort de m’ôter ma bêtise, et de me faire voir plus clair que je ne voyais.
— Si un homme sans esprit, répondit Riquet à la Houppe, serait bien reçu, comme vous venez de le dire, à vous reprocher votre manque de parole, pourquoi voulez-vous, madame, que je n’en use pas de même, dans une chose où il y va de tout le bonheur de ma vie ? Est-il raisonnable que les personnes qui ont de l’esprit soient d’une pire condition que celles qui n’en ont pas ? Le pouvez-vous prétendre, vous qui en avez tant, et qui avez tant souhaité d’en avoir ? Mais venons au fait, s’il vous plaît. A la réserve de ma laideur, y a-t-il quelque chose en moi qui vous déplaise ? Êtes vous mal contente de ma naissance, de mon esprit, de mon humeur et de mes manières ?
— Nullement, répondit la princesse ; j’aime en vous tout ce que vous venez de me dire.
— Si cela est ainsi, reprit Riquet à la Houppe, je vais être heureux, puisque vous pouvez me rendre le plus aimable des hommes.
— Comment cela se peut-il faire ? lui dit la princesse.
— Cela se fera, répondit Riquet à la Houppe, si vous souhaitez que cela soit ; et afin, madame, que vous n’en doutiez pas, sachez que la même fée qui, au jour de ma naissance, me fit le don de pouvoir rendre spirituelle la personne qu’il me plairait, vous a aussi fait le don de pouvoir rendre beau celui à qui vous voudrez bien faire cette faveur.
— Si la chose est ainsi, dit la princesse, je souhaite de tout mon cœur que vous deveniez le prince du monde le plus beau et le plus aimable ; et je vous en fais le don, autant qu’il est en moi. »
La princesse n’eut pas plus tôt prononcé ces paroles, que Riquet à la Houppe parut, à ses yeux, l’homme du monde le mieux fait et le plus aimable qu’elle eût jamais vu.
Quelques-uns assurent que ce ne furent point les charmes de la fée qui opérèrent cette métamorphose. Ils disent que la princesse, ayant fait réflexion sur la persévérance de Riquet, sur sa discrétion et sur toutes les bonnes qualités de son âme et de son esprit, ne vit plus la difformité de son corps ni la laideur de son visage ; que sa bosse ne lui sembla plus que le bon air d’un homme qui fait le gros dos ; et qu’au lieu que jusqu’alors elle l’avait vu boîter effroyablement, elle ne lui trouva plus qu’un certain air penché qui la charmait. Ils disent encore que ses yeux, qui étaient louches, ne lui en parurent que plus brillants ; et qu’enfin son gros nez rouge eut pour elle quelque chose de martial et d’héroïque.
Quoi qu’il en soit, la princesse lui promit sur-le-champ de l’épouser, pourvu qu’il en obtînt le consentement du roi son père. Le roi, ayant su que sa fille avait beaucoup d’estime pour Riquet à la Houppe, qu’il connaissait d’ailleurs pour un prince très spirituel et très sage, le reçut avec plaisir pour son gendre. Dès le lendemain, les noces furent faites, ainsi que Riquet à la Houppe l’avait prévu, et selon les ordres qu’il en avait donnés longtemps auparavant.
L’Éventail Magique
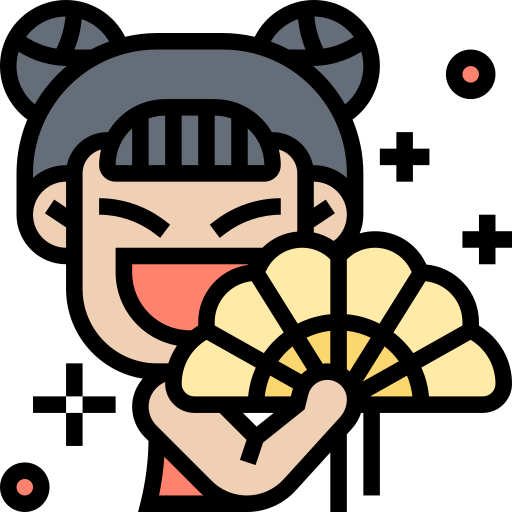
Conte traditionnel chinois – version créée par contesdefees.com
Le jeune Chen-Shao vendait du poisson dans l’échoppe de ses parents au marché. Ils gagnaient tellement peu d’argent qu’ils avaient à peine de quoi survivre. Mais ce qui le préocupait encore plus était, qu’à cause de leur pauvreté, aucune jeune femme ne voulait se marier avec lui.
– Ne t’inquiète pas. Lui disait sa mère. Tu es encore jeune et tu plais aux filles.
En effet, Chen-Shao était grand et beau, et toutes les jeunes femmes soupiraient en pensant à lui. Mais leurs parents les décourageaient, leur disant:
– La jeunesse passe vite. Que pourra t‘offrir cet affamé quand vous aurez trente ans? – Et toutes abandonnaient leur rêve de mariage avec Chen-Shao.
Un jour, le chef des pêcheurs arriva à l’échoppe de mauvaise humeur et avec une liste interminable à la main et s’adressa ainsi au père:
– Voici la liste de tout ce que tu me dois. Avec tout ça, je pourrais m’acheter un bateau tout neuf. Tu n’auras plus de poisson tant que tu ne nous rembourses pas.
– Si tu fais cela, ma famille mourra de faim. Protesta le père.
Alors, Chen-Shao s’approcha du chef des pêcheurs et lui dit:
– M’acceptes-tu comme marin sur ton bateau en paiement de la dette de mon père?
Le pêcheur appréciant sa forte carrure accepta et dit:
– Rendez-vous demain sur la plage, avant le lever du soleil.
Mais Chen-Shao ne porta pas chance à l’équipage car ce jour là, le bateau se brisa en deux et coula. Chen-Shao s’accrocha à un morceau de bois qui flottait et se laissa emporter par les vagues.
Après une nuit de frayeur au milieu des vagues, il arriva sur une île magnifique et vit une maisonnette en haut de la colline.
Lorsqu’il y arriva la porte s’ouvrit sur une jeune femme de toute beauté qui lui dit:
– Enfin te voilà. Cela fait si longtemps que je t’attends
– Tu m’attendais, moi? S’exclama Chen-Shao surpris. Je n’ai malheureusement pas le souvenir de t’avoir vu avant, dit-il, déjà sous le charme de la jeune fille.
– Tu ne m’as peut être jamais vu, mais moi, cela fait de nombreuses années que je te connais.
Elle lui raconta alors qu’elle était la fille du dieu de la mer et qu’elle chevauchait parfois jusqu’à sa maison, et qu’elle le contemplait dans son sommeil.
Chen-Shao se dit que cela devait être un rêve, mais en se réveillant le lendemain matin, il constata que sa bien aimée était toujours là et lui disait:
– Mais bien sûr que ce n’est pas un rêve. Mon père est bien le dieu de la mer et il ne sait pas que cette île que je lui ai demandé en cadeau, était destinée à t’accueillir. Il serait capable de te tuer si il l’apprenait. Tu ne dois sortir sous aucun prétexte.
– Pour toi, ma bien-aimée, je resterai caché dans l’espace d’un coquillage. Dit Chen-Shao.
Ainsi passèrent dix mois de bonheur absolu pour les deux amoureux. Un jour la jeune fille lui dit:
– Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma tante, je dois y aller pour ne pas éveiller les soupçons de mon père.
Chen-Shao était très triste car il ne pouvait plus vivre sans la jeune fille.
– Je serai de retour ce soir-même. Le consola-t-elle. Si tu t’ennuies, tu peux ouvrir la fenêtre du Nord, celle du Sud, celle de l ‘Est, mais en aucun cas celle de l’Ouest.
Puis elle sortit une épée faite de perles et lui dit:
– Si une créature étrange t’attaque, dit simplement: “Épée magique, coupe la tête de ce monstre” et elle te protégera.
La princesse monta sur ton cheval ailé et s’envola dans les nuages.
Le temps passait et Chen-Saho commençait à s’ennuyer. Il pensait à sa bien aimée et ne pouvait supporter l’attente de la revoir.
Il ouvrit la fenêtre du Nord et aperçut toutes les beautés du monde.
Puis il ouvrit la fenêtre du Sud et il vit tous les oiseaux du ciel réunis devant lui.
Il ouvrit la fenêtre de l’Est, et vit toutes les richesses de la mer.
Mais toutes ces merveilles ne pouvait lui faire oublier son amour et, dans sa folie amoureuse, il ouvrit la fenêtre de l’Ouest sans se rappeler du conseil de sa bien aimée.
Par la fenêtre interdite, Il vit deux créatures de la mer qui étaient sur une barque non loin de l’île. Les monstres l’aperçurent aussi car le charme qui cachait l’île était rompu. Ils abordèrent l’île pour le capturer. Mais Chen-Shao se souvint de l’épée et lui cria: “Épée magique, coupe la tête de ce monstre”. Et l’Épée égorgea les deux créatures.
La princesse qui était toujours chez sa tante eut un présentiment et pâlit. Sa tante, croyant à un malaise, lui donna un éventail magique qui, si on l’agitait très fort, avait le pouvoir de grossir les vagues et de créer des tempêtes. La princesse l’emporta avec elle sur son cheval ailé et revint à son île.

Après qu’il eut avoué sa faute et raconté toute sa mésaventure, elle consola Chen-Shao honteux, et lui dit:
– Nous devons partir d’ici car mon père enverra son armée pour te capturer en apprenant que tu as tué deux de ses soldats.
Mais juste à ce moment- là, des milliers de créatures sous-marines sortirent de la mer et entourèrent l’île pour les attaquer.
– Je vais me rendre. Dit Chen-Shao. Je suis responsable de cette situation.
Mais la jeune femme le retint, sortit l’éventail de sa tante et l’agita de toutes ses forces. Ceci provoqua la levée de vagues gigantesques qui balayèrent l’armée de la mer.
– Sauvons-nous d’ici. Dit-elle. Nous avons gagné une bataille, mais nous ne gagnerons pas la guerre.
Ils montèrent sur le cheval volant et se rendirent au village de Chen-Shao ou elle lui dit encore:
– Prends-moi pour épouse, ainsi mon père saura que je t’aime et arrêtera de nous poursuivre.
– Mais je suis pauvre. Dit Chen-Shao.
La jeune femme lui sourit et commença à secouer sa chevelure. Il en sortit perles, coraux, et d’autres nombreux trésors de la mer.
– Si cela te parait peu, nous en demanderons plus à mon père.
Mais Chen-Shao ne vécut pas dans le luxe. Il préféra aider son père au marché et ne sortit plus jamais en mer.
Quand il manquait de poisson, sa femme allait à la plage et chantait une étrange chanson qui faisait s’échouer de nombreux poissons sur le sable.
– Pourquoi es-tu surpris? Demandait-elle avec tendresse. Mon père est le dieu de la mer et c’est sa chanson préférée.
Et elle agitait l’éventail pour grossir les vagues et pour que sa tante sache qu’elle se rappelait d’elle.
Raiponce

Jacob et Wilhelm Grimm, version de Contesdefees.com, illustrations Arthur Rackham et autres.
Il était une fois un couple qui souhaitaient depuis longtemps avoir un enfant. Un jour enfin, leur voeux fut exaucé et la femme tomba enceinte.
Ces gens avaient à l’arrière de leur maison, une petite fenêtre depuis laquelle ils pouvaient apercevoir un splendide jardin où poussaient les plus belles fleurs et surtout de magnifiques raiponces ; mais il était entouré d’un haut mur et personne ne s’y risquait car il appartenait à une puissante magicienne que tous craignaient.
Tous les jours, la femme se tenait devant la fenêtre et regardait dans le jardin. Plus elle voyait les raiponces, plus l’envie d’en manger grandissait en elle.
Elle devint tellement obsédée par ces fleurs comestibles qu’elle commença à dépérir, pâlir et avoir l’air de plus en plus misérable.
Alors son mari prit peur et lui demanda :
— Que te manque-t-il ma chère épouse ?
— Hélas, répondit-elle, si je ne peux manger de ces raiponces du jardin derrière notre maison, je crois que je mourrai. »
L’homme qui aimait sa femme pensa :
— »Eh, laisseras-tu ton épouse mourir ? Va lui chercher des raiponces quoiqu’il put t’en coûter.
Lorsque le crépuscule fut arrivé, il escalada le mur du jardin de la magicienne, cueillit rapidement une pleine poignée de raiponces et les rapporta à son épouse. Elle s’en fit aussitôt une salade et la mangea d’un coup avidement. Elles lui plurent tant que le jour suivant, elle en eut encore trois fois plus envie. Pour la calmer, l’homme dut encore une fois escalader le mur du jardin. Il le fit à nouveau au crépuscule. Mais tandis qu’il grimpait au mur il fut brusquement effrayé car il aperçut la magicienne qui se tenait devant lui.
— Comment oses-tu me voler mes raiponces comme un brigand ? Tu vas être puni ! » , dit-elle avec courroux.
— Pitié ! répondit-il, veuillez me pardonner. Je ne l’ai fait que par nécessité. Mon épouse enceinte a vu vos raiponces depuis notre fenêtre et elle en conçut une telle envie qu’elle serait morte si elle n’avait pu en manger. » La magicienne laissa alors tomber son courroux et lui dit :
— »Prends-en autant que tu voudras, mais ta peine n’en sera pas modifiée: tu devras me donner l’enfant que ta femme mettra au monde. Il sera bien traité et je m’en occuperai comme une mère. »
L’homme par peur acquiesça à tout, et lorsque après quelques semaines sa femme accoucha, apparut immédiatement la magicienne, qui donna le nom de Raiponce à l’enfant et l’emmena avec elle.
Raiponce devint la plus belle enfant qui soit. Lorsqu’elle eut douze ans, la magicienne l’enferma dans une tour qui se dressait au milieu d’une forêt et qui ne possédait ni escalier ni porte ; seule tout en haut, s’ouvrait une petite fenêtre.
Les années passaient.
Quand la magicienne voulait entrer, elle se tenait au bas et criait :
— »Raiponce, Raiponce, dénoue et lance vers moi tes cheveux ! « .
Raiponce avait de très longs et splendides cheveux fins et filés comme de l’or. Elle ne les avait jamais coupé. Lorsque la voix de la magicienne lui parvenait, elle dénouait ses nattes, les passait autour d’un crochet de la fenêtre et les laissait tomber vingt pieds plus bas. Ainsi grâce à la chevelure immense, la magicienne pouvait grimper dans la tour.
Les années passaient lentement pour Raiponce, lorsqu’un jour, le fils du roi qui chevauchait par ces bois vint à passer près de la tour. Il entendit un chant qui était si doux qu’il s’arrêta et écouta. C’était Raiponce, qui dans sa solitude passait le temps en chantant et faisait résonner sa douce voix. Le fils du roi voulut monter auprès d’elle et chercha une porte : mais il n’en trouva aucune. Il s’en retourna alors chez lui. Mais le chant l’avait tellement ému, que chaque jour il partait pour les bois pour l’écouter. Une fois alors qu’il se tenait sous un arbre, il vit la magicienne venir et il l’entendit appeler :
— »Raiponce, Raiponce, dénoue et lance vers moi tes cheveux ! « .
Alors Raiponce laissa tomber ses tresses et la magicienne grimpa.
Le prince ayant compris comment atteindre la fenêtre attendit que la sorcière soit redescendue, puis il s’avança vers la tour et appela :
— »Raiponce, Raiponce, dénoue et lance vers moi tes cheveux ! « .
Aussitôt, la chevelure chut et le prince escalada la tour.
Raiponce fut d’abord bien effrayée qu’un homme vint jusqu’à elle alors qu’elle n’en avait jamais vu de sa pauvre vie de recluse. Cependant le prince commença à lui parler amicalement et lui raconta que son cœur avait été si profondément ému par son chant qu’il ne n’avait pu s’empêcher de revenir et risquer sa vie pour elle.
Il lui demanda immédiatement si elle voulait devenir sa femme et venir avec lui dans le château de ses parents.
Remise de sa frayeur et attendrie par l’amour et la beauté du prince, Raiponce lui prit la main et accepta en disant :
— Je veux bien venir avec toi mais je ne pourrai pas descendre. Va chercher un morceau de soie dont je ferai une échelle et lorsqu’elle sera prête, je descendrai pour que tu m’emportes sur ton cheval. »
Le prince accepta et redescendit par la chevelure de sa bien aimée.
Le lendemain, lorsque la sorcière monta, elle sentit immédiatement qu’un homme était entré dans la tour et elle s’ecria:
— Enfant maudite ! Je pensais t’avoir mise à l’écart du monde pour te garder à moi à jamais mais tu m’as trahie !
Dans sa colère elle attrapa la chevelure de Raiponce, saisit de sa main droite une paire de ciseaux et en un clin d’œil coupa les grandes tresses blondes.
Par un sort maléfique, elle envoya ensuite Raiponce dans une contrée lointaine et désertique, où elle dut vivre dans la privation et la peine.
Le soir même, la magicienne accrocha les tresses à la fenêtre et lorsque le prince arriva et appela :
— »Raiponce, Raiponce, dénoue et lance vers moi tes cheveux ! « .
Elle laissa tomber les cheveux. Le prince monta mais au lieu de sa chère Raiponce, il vit la magicienne qui lui jetait un regard méchant et empoisonné.
— »Ahah ! » ricana-t-elle « tu viens chercher ta bien-aimée, mais le bel oiseau n’est plus au nid et ne chante plus, le chat l’a emporté et il va de plus t’arracher les yeux. Raiponce est perdue pour toi, tu ne la reverras plus jamais ! »
Le prince sentit la douleur l’envahir et de désespoir, bondit par la fenêtre. Il survécut mais les épines du bosquet dans lequel il tomba lui crevèrent les yeux. Il erra aveugle dans la forêt ne mangeant que des racines et des baies et pleurant constamment la perte de sa chère promise.
Il erra ainsi plusieurs années misérablement et atteignit finalement la contrée déserte où Raiponce survivait péniblement avec les jumeaux qu’elle avait mis au monde, un garçon et une fille. Il entendit une voix, qui lui sembla familière. Il s’approcha et Raiponce le reconnut, elle se pendit à son cou et se mit à pleurer.
Deux de ses larmes tombèrent dans ses yeux et il recouvra ainsi la vue qu’il avait perdue.
Il l’emmena dans son royaume où ils furent accueillis avec joie. Ils y vécurent longtemps heureux et sereins.
La Belle et la Bête
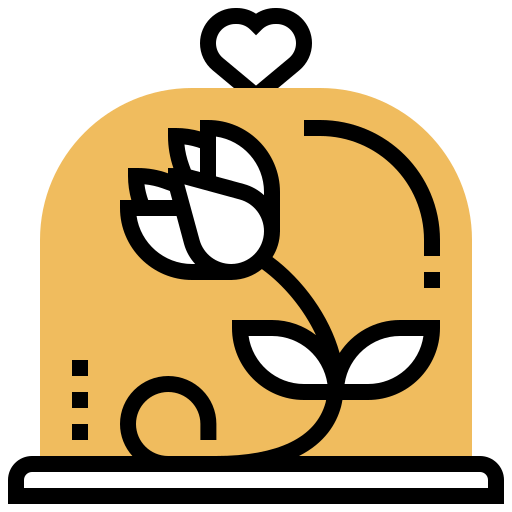
Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait six enfants, trois garçons et trois filles ; et, comme ce marchand était un homme d’esprit, il n’épargna rien pour l’éducation de ses enfants, et leur donna toutes sortes de maîtres.
Ses filles étaient très-belles ; mais la cadette, surtout, se faisait admirer, et on ne l’appelait, quand elle était petite, que La belle enfant ; en sorte que le nom lui en resta ; ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs.
Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu’elles. Les deux aînées avaient beaucoup d’orgueil, parce qu’elles étaient riches ; elles faisaient les dames, et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands ; il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette, qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres.
Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage ; mais les deux aînées répondirent qu’elles ne se marieraient jamais, à moins qu’elles ne trouvassent un duc, ou tout au moins un comte.
La Belle (car je vous ai dit que c’était le nom de la plus jeune), la Belle, dis-je, remercia bien honnêtement ceux qui voulaient l’épouser ; mais elle leur dit : qu’elle était trop jeune, et qu’elle souhaitait de tenir compagnie à son père pendant quelques années.
Or tout d’un coup le marchand perdit son bien, et il ne lui resta qu’une petite maison de campagne, bien loin de la ville.
Il dit en pleurant, à ses enfants, qu’il fallait aller demeurer dans cette maison, et, qu’en travaillant comme des paysans, ils y pourraient vivre.
Ses deux filles aînées répondirent qu’elles ne voulaient pas quitter la ville, et qu’elles avaient plusieurs amans qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu’elles n’eussent plus de fortune : les bonnes demoiselles se trompaient ; leurs amans ne voulurent plus les regarder, quand elles furent pauvres.
Comme personne ne les aimait à cause de leur fierté, on disait : « elles ne méritent pas qu’on les plaigne, nous sommes bien aises de voir leur orgueil abaissé ; qu’elles aillent faire les dames en gardant les moutons ». Mais en même temps, tout le monde disait : « pour la Belle, nous sommes bien fâchés de son malheur ; c’est une si bonne fille ; elle parlait aux pauvres gens avec tant de bonté ; elle était si douce, si honnête ». Il y eut même plusieurs gentilshommes qui voulurent l’épouser, quoiqu’elle n’eut pas un sou ; mais elle leur dit : qu’elle ne pouvait pas se résoudre à abandonner son pauvre père dans son malheur, et qu’elle le suivrait à la campagne, pour le consoler et lui aider à travailler.
La pauvre Belle avait été bien affligée d’abord de perdre sa fortune ; mais elle s’était dit à elle-même : quand je pleurerai bien fort, mes larmes ne me rendront pas mon bien ; il faut tâcher d’être heureuse sans fortune.
Quand ils furent arrivés à leur maison de campagne, le marchand et ses trois fils s’occupèrent à labourer la terre. La Belle se levait à quatre heures du matin, et se dépêchait de nettoyer la maison et d’apprêter à dîner pour la famille.
Elle eut d’abord beaucoup de peine, car elle n’était pas accoutumée à travailler comme une servante ; mais, au bout de deux mois, elle devint plus forte, et la fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait du clavecin, ou bien elle chantait en filant.
Ses deux sœurs, au contraire, s’ennuyaient à la mort ; elles se levaient à dix heures du matin, se promenaient toute la journée, et s’amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. Voyez notre cadette, disaient-elles entre elles, elle a l’âme basse, et est si stupide qu’elle est contente de sa malheureuse situation.
Le bon marchand ne pensait pas comme ses filles. Il savait que la Belle était plus propre que ses sœurs à briller dans les compagnies. Il admirait la vertu de cette jeune fille, et surtout sa patience ; car ses sœurs, non contentes de lui laisser faire tout l’ouvrage de la maison, l’insultaient à tout moment.
Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude, lorsque le marchand reçut une lettre, par laquelle on lui marquait qu’un vaisseau, sur lequel il avait des marchandises, venait d’arriver heureusement.
Cette nouvelle fit tourner la tête à ses deux aînées, qui pensaient qu’à la fin elles pourraient quitter cette campagne, où elles s’ennuyaient tant ; et quand elles virent leur père prêt à partir, elles le prièrent de leur apporter des robes, des palatines, des coiffures, et toutes sortes de bagatelles.
La Belle ne lui demandait rien ; car elle pensait en elle-même, que tout l’argent des marchandises ne suffirait pas pour acheter ce que ses sœurs souhaitaient.
– Tu ne me pries pas de t’acheter quelque chose, lui dit son père.
– Puisque vous avez la bonté de penser à moi, lui dit-elle, je vous prie de m’apporter une rose, car il n’en vient point ici.
Ce n’est pas que la Belle se souciât d’une rose ; mais elle ne voulait pas condamner, par son exemple, la conduite de ses sœurs, qui auraient dit, que c’était pour se distinguer qu’elle ne demandait rien.
Le bon homme partit ; mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises, et, après avoir eu beaucoup de peine, il revint aussi pauvre qu’il était auparavant.
Il n’avait plus que trente milles pour arriver à sa maison, et il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants ; mais, comme il fallait passer un grand bois, avant de trouver sa maison, il se perdit.
Il neigeait horriblement ; le vent était si grand, qu’il le jeta deux fois en bas de son cheval, et, la nuit étant venue, il pensa qu’il mourrait de faim ou de froid, ou qu’il serait mangé des loups, qu’il entendait hurler autour de lui.
Tout d’un coup, en regardant au bout d’une longue allée d’arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là, et vit que cette lumière sortait d’un grand palais qui était tout illuminé.
Le marchand remercia Dieu du secours qu’il lui envoyait, et se hâta d’arriver à ce château ; mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval, qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans ; et, ayant trouvé du foin et de l’avoine, le pauvre animal, qui mourait de faim, se jeta dessus avec beaucoup d’avidité. Le marchand l’attacha dans l’écurie, et marcha vers la maison, où il ne trouva personne ; mais, étant entré dans une grande salle, il y trouva un bon feu, et une table chargée de viande, où il n’y avait qu’un couvert. Comme la pluie et la neige l’avaient mouillé jusqu’aux os, il s’approcha du feu pour se sécher, et disait en lui-même : le maître de la maison ou ses domestiques me pardonneront la liberté que j’ai prise, et sans doute ils viendront bientôt. Il attendit pendant un temps considérable ; mais onze heures ayant sonné, sans qu’il vit personne, il ne put résister à la faim, et prit un poulet qu’il mangea en deux bouchées, et en tremblant. Il but aussi quelques coups de vin, et, devenu plus hardi, il sortit de la salle, et traversa plusieurs grands appartements, magnifiquement meublés. À la fin il trouva une chambre où il y avait un bon lit, et comme il était minuit passé, et qu’il était las, il prit le parti de fermer la porte et de se coucher.
Il était dix heures du matin quand il se leva le lendemain, et il fut bien surpris de trouver un habit fort propre à la place du sien qui était tout gâté. Assurément, dit-il, en lui-même, ce palais appartient à quelque bonne Fée qui a eu pitié de ma situation. Il regarda par la fenêtre et ne vit plus de neige ; mais des berceaux de fleurs qui enchantaient la vue. Il rentra dans la grande salle où il avait soupé la veille, et vit une petite table où il y avait du chocolat. Je vous remercie, madame la Fée, dit-il tout haut, d’avoir eu la bonté de penser à mon déjeuner. Le bon homme, après avoir pris son chocolat, sortit pour aller chercher son cheval, et, comme il passait sous un berceau de roses, il se souvint que la Belle lui en avait demandé, et cueillit une branche où il y en avait plusieurs. En même temps, il entendit un grand bruit, et vit venir à lui une Bête si horrible, qu’il fut tout prêt de s’évanouir. « Vous êtes bien ingrat, lui dit la Bête, d’une voix terrible ; je vous ai sauvé la vie, en vous recevant dans mon château, et, pour ma peine, vous me volez mes roses que j’aime mieux que toutes choses au monde. Il faut mourir pour réparer cette faute ; je ne vous donne qu’un quart d’heure pour demander pardon à Dieu. Le marchand se jeta à genoux, et dit à la bête, en joignant les mains : — Monseigneur, pardonnez-moi, je ne croyais pas vous offenser en cueillant une rose pour une de mes filles, qui m’en avait demandé. — Je ne m’appelle point monseigneur, répondit le monstre, mais la Bête. Je n’aime point les compliments, moi, je veux qu’on dise ce que l’on pense ; ainsi, ne croyez pas me toucher par vos flatteries ; mais vous m’avez dit que vous aviez des filles ; je veux bien vous pardonner, à condition qu’une de vos filles vienne volontairement, pour mourir à votre place : ne me raisonnez pas ; partez, et si vos filles refusent de mourir pour vous, jurez que vous reviendrez dans trois mois. Le bon homme n’avait pas dessein de sacrifier une de ses filles à ce vilain monstre ; mais il pensa, au moins, j’aurai le plaisir de les embrasser encore une fois. Il jura donc de revenir, et la Bête lui dit qu’il pouvait partir quand il voudrait ; mais, ajouta-t-elle, je ne veux pas que tu t’en ailles les mains vides. Retourne dans la chambre où tu as couché, tu y trouveras un grand coffre vide ; tu peux y mettre tout ce qui te plaira ; je le ferai porter chez toi. En même temps, la Bête se retira, et le bon homme dit en lui-même ; s’il faut que je meure, j’aurai la consolation de laisser du pain à mes pauvres enfants.
Il retourna dans la chambre où il avait couché, et, y ayant trouvé une grande quantité de pièces d’or, il remplit le grand coffre, dont la Bête lui avait parlé, le ferma, et, ayant repris son cheval qu’il retrouva dans l’écurie, il sortit de ce palais avec une tristesse égale à la joie qu’il avait, lorsqu’il y était entré. Son cheval prit de lui-même une des routes de la forêt, et en peu d’heures, le bon homme arriva dans sa petite maison. Ses enfants se rassemblèrent autour de lui ; mais, au lieu d’être sensible à leurs caresses, le marchand se mit à pleurer en les regardant. Il tenait à la main la branche de roses, qu’il apportait à la Belle : il la lui donna, et lui dit : la Belle, prenez ces roses ; elles coûteront bien cher à votre malheureux père ; et tout de suite, il raconta à sa famille la funeste aventure qui lui était arrivée. À ce récit, ses deux aînées jetèrent de grands cris, et dirent des injures à la Belle qui ne pleurait point. Voyez ce que produit l’orgueil de cette petite créature, disaient-elles ; que ne demandait-elle des ajustements comme nous ? mais non, mademoiselle voulait se distinguer ; elle va causer la mort de notre père et elle ne pleure pas. Cela serait fort inutile, reprit la Belle, pourquoi pleurerais-je la mort de mon père ? il ne périra point. Puisque le monstre veut bien accepter une de ses filles, je veux me livrer à toute sa furie, et je me trouve fort heureuse, puisqu’en mourant j’aurai la joie de sauver mon père et de lui prouver ma tendresse. Non, ma sœur, lui dirent ses trois frères, vous ne mourrez pas, nous irons trouver ce monstre, et nous périrons sous ses coups, si nous ne pouvons le tuer. Ne l’espérez pas, mes enfants, leur dit le marchand, la puissance de cette Bête est si grande, qu’il ne me reste aucune espérance de la faire périr. Je suis charmé du bon cœur de la Belle, mais je ne veux pas l’exposer à la mort. Je suis vieux, il ne me reste que peu de temps à vivre ; ainsi, je ne perdrai que quelques années de vie, que je ne regrette qu’à cause de vous, mes chers enfants. Je vous assure, mon père, lui dit la Belle, que vous n’irez pas à ce palais sans moi ; vous ne pouvez m’empêcher de vous suivre. Quoique je sois jeune, je ne suis pas fort attachée à la vie, et j’aime mieux être dévorée par ce monstre, que de mourir du chagrin que me donnerait votre perte. On eut beau dire, la Belle voulut absolument partir pour le beau palais, et ses sœurs en étaient charmées, parce que les vertus de cette cadette leur avaient inspiré beaucoup de jalousie. Le marchand était si occupé de la douleur de perdre sa fille, qu’il ne pensait pas au coffre qu’il avait rempli d’or ; mais, aussitôt qu’il se fut renfermé dans sa chambre pour se coucher, il fut bien étonné de le trouver à la ruelle de son lit. Il résolut de ne point dire à ses enfants qu’il était devenu si riche, parce que ses filles auraient voulu retourner à la ville ; qu’il était résolu de mourir dans cette campagne ; mais il confia ce secret à la Belle qui lui apprit qu’il était venu quelques gentilshommes pendant son absence, et qu’il y en avait deux qui aimaient ses sœurs. Elle pria son père de les marier ; car elle était si bonne qu’elle les aimait, et leur pardonnait de tout son cœur le mal qu’elles lui avaient fait. Ces deux méchantes filles se frottaient les yeux avec un oignon, pour pleurer lorsque la Belle partit avec son père ; mais ses frères pleuraient tout de bon, aussi bien que le marchand : il n’y avait que la Belle qui ne pleurait point, parce qu’elle ne voulait pas augmenter leur douleur. Le cheval prit la route du palais, et sur le soir ils l’aperçurent illuminé, comme la première fois. Le cheval fut tout seul à l’écurie, et le bon homme entra avec sa fille dans la grande salle, où ils trouvèrent une table magnifiquement servie, avec deux couverts. Le marchand n’avait pas le cœur de manger ; mais Belle s’efforçant de paraître tranquille, se mit à table, et le servit ; puis elle disait en elle-même : la Bête veut m’engraisser avant de me manger, puisqu’elle me fait si bonne chère. Quand ils eurent soupé, ils entendirent un grand bruit, et le marchand dit adieu à sa pauvre fille en pleurant ; car il pensait que c’était la Bête. Belle ne put s’empêcher de frémir en voyant cette horrible figure ; mais elle se rassura de son mieux, et le monstre lui ayant demandé si c’était de bon cœur qu’elle était venue ; elle lui dit, en tremblant, qu’oui. Vous êtes bien bonne, dit la Bête, et je vous suis bien obligé. Bon homme, partez demain matin, et ne vous avisez jamais de revenir ici. Adieu, la Belle. Adieu, la Bête, répondit-elle, et tout de suite le monstre se retira. Ah ! ma fille, lui dit le marchand, en embrassant la Belle, je suis à demi-mort de frayeur. Croyez-moi, laissez-moi ici ; non, mon père, lui dit la Belle avec fermeté, vous partirez demain matin, et vous m’abandonnerez au secours du ciel ; peut-être aura-t-il pitié de moi. Ils furent se coucher, et croyaient ne pas dormir de toute la nuit ; mais à peine furent-ils dans leurs lits que leurs yeux se fermèrent. Pendant son sommeil, la Belle vit une dame qui lui dit : « Je suis contente de votre bon cœur, la Belle ; la bonne action que vous faites, en donnant votre vie, pour sauver celle de votre père, ne demeurera point sans récompense ». La Belle, en s’éveillant, raconta ce songe à son père, et, quoiqu’il le consolât un peu, cela ne l’empêcha pas de jeter de grands cris, quand il fallut se séparer de sa chère fille.
Lorsqu’il fut parti, la Belle s’assit dans la grande salle, et se mit à pleurer aussi ; mais, comme elle avait beaucoup de courage, elle se recommanda à Dieu, et résolut de ne point se chagriner, pour le peu de temps qu’elle avait à vivre ; car elle croyait fermement que la Bête la mangerait le soir. Elle résolut de se promener en attendant, et de visiter ce beau château. Elle ne pouvait s’empêcher d’en admirer la beauté. Mais elle fut bien surprise de trouver une porte, sur laquelle il y avait écrit : Appartement de la Belle.

« elle fut bien surprise de trouver une porte, sur laquelle il y avait écrit : Appartement de la Belle »
Elle ouvrit cette porte avec précipitation, et elle fut éblouie de la magnificence qui y régnait ; mais ce qui frappa le plus sa vue fut une grande bibliothèque, un clavecin, et plusieurs livres de musique. On ne veut pas que je m’ennuie, dit-elle, tout bas ; elle pensa ensuite, si je n’avais qu’un jour à demeurer ici, on ne m’aurait pas fait une telle provision. Cette pensée ranima son courage. Elle ouvrit la bibliothèque, et vit un livre où il y avait écrit en lettres d’or : Souhaitez, commandez ; vous êtes ici la reine et la maîtresse. Hélas ! dit-elle, en soupirant, je ne souhaite rien que de voir mon pauvre père, et de savoir ce qu’il fait à présent : elle avait dit cela en elle-même. Quelle fut sa surprise ! en jetant les yeux sur un grand miroir, d’y voir sa maison, où son père arrivait avec un visage extrêmement triste. Ses sœurs venaient au-devant de lui, et, malgré les grimaces qu’elles faisaient pour paraître affligées, la joie qu’elles avaient de la perte de leur sœur paraissait sur leur visage. Un moment après, tout cela disparut, et la Belle ne put s’empêcher de penser que la Bête était bien complaisante, qu’elle n’avait rien à craindre d’elle.
À midi, elle trouva la table mise, et, pendant son dîner elle entendit un excellent concert, quoiqu’elle ne vît personne. Le soir, comme elle allait se mettre à table, elle entendit le bruit que faisait la Bête, et ne put s’empêcher de frémir. La Belle, lui dit ce monstre, voulez-vous bien que je vous voie souper ? — Vous êtes le maître, répondit la Belle en tremblant. — Non, répondit la Bête, il n’y a ici de maîtresse que vous. Vous n’avez qu’à me dire de m’en aller si je vous ennuie ; je sortirai tout de suite. Dites-moi, n’est-ce pas que vous me trouvez bien laid ? — Cela est vrai, dit la Belle, car je ne sais pas mentir ; mais je crois que vous êtes fort bon. — Vous avez raison, dit le monstre, mais, outre que je suis laid, je n’ai point d’esprit : je sais bien que je ne suis qu’une Bête. — On n’est pas Bête, reprit la Belle, quand on croit n’avoir point d’esprit : un sot n’a jamais su cela. — Mangez donc, la Belle, lui dit le monstre ; et tâchez de ne vous point ennuyer dans votre maison, car tout ceci est à vous ; et j’aurais du chagrin, si vous n’étiez pas contente. — Vous avez bien de la bonté, lui dit la Belle. Je vous avoue que je suis bien contente de votre cœur ; quand j’y pense, vous ne me paraissez plus si laid. — Oh dame, oui, répondit la Bête, j’ai le cœur bon, mais je suis un monstre. — Il y a bien des hommes qui sont plus monstres que vous, dit la Belle ; et je vous aime mieux avec votre figure que ceux qui, avec la figure d’hommes, cachent un cœur faux, corrompu, ingrat. — Si j’avais de l’esprit, reprit la Bête, je vous ferais un grand compliment pour vous remercier ; mais je suis un stupide, et tout ce que je puis vous dire, c’est que je vous suis bien obligé.
La Belle soupa de bon appétit. Elle n’avait presque plus peur du monstre ; mais elle manqua mourir de frayeur, lorsqu’il lui dit : « La Belle, voulez-vous être ma femme ? » Elle fut quelque temps sans répondre : elle avait peur d’exciter la colère du monstre, en le refusant : elle lui dit pourtant en tremblant : non la Bête. Dans ce moment, ce pauvre monstre voulut soupirer, et il fit un sifflement si épouvantable, que tout le palais en retentit ; mais Belle fut bientôt rassurée, car la Bête lui ayant dit tristement : Adieu donc la Belle, sortit de la chambre, en se retournant de temps en temps pour la regarder encore. Belle se voyant seule, sentit une grande compassion pour cette pauvre Bête : Hélas ! disait-elle, c’est bien dommage qu’elle soit si laide, elle est si bonne !
Belle passa trois mois dans ce palais avec assez de tranquillité. Tous les soirs, la Bête lui rendait visite, l’entretenait pendant le souper, avec assez de bon sens, mais jamais avec ce qu’on appelle esprit, dans le monde. Chaque jour, Belle découvrait de nouvelles bontés dans ce monstre. L’habitude de le voir l’avait accoutumée à sa laideur ; et, loin de craindre le moment de sa visite, elle regardait souvent à sa montre, pour voir s’il était bientôt neuf heures ; car la Bête ne manquait jamais de venir à cette heure-là. Il n’y avait qu’une chose qui faisait de la peine à la Belle, c’est que le monstre, avant de se coucher, lui demandait toujours si elle voulait être sa femme, et paraissait pénétré de douleur lorsqu’elle lui disait que non. Elle dit un jour : « Vous me chagrinez, la Bête ; je voudrais pouvoir vous épouser, mais je suis trop sincère pour vous faire croire que cela arrivera jamais. Je serai toujours votre amie ; tâchez de vous contenter de cela. — Il le faut bien, reprit la Bête ; je me rends justice. Je sais que je suis bien horrible ; mais je vous aime beaucoup ; cependant je suis trop heureux de ce que vous voulez bien rester ici ; promettez-moi que vous ne me quitterez jamais ». La Belle rougit à ces paroles. Elle avait vu dans son miroir que son père était malade de chagrin de l’avoir perdue ; et elle souhaitait de le revoir.
« Je pourrais bien vous promettre, dit-elle à la Bête, de ne vous jamais quitter tout-à-fait ; mais j’ai tant d’envie de revoir mon père, que je mourrai de douleur si vous me refusez ce plaisir. — J’aime mieux mourir moi-même, dit ce monstre, que de vous donner du chagrin. Je vous enverrai chez votre père ; vous y resterez, et votre pauvre Bête en mourra de douleur. — Non, lui dit la Belle en pleurant, je vous aime trop pour vouloir causer votre mort. Je vous promets de revenir dans huit jours. Vous m’avez fait voir que mes sœurs sont mariées, et que mes frères sont partis pour l’armée. Mon père est tout seul, souffrez que je reste chez lui une semaine. — Vous y serez demain au matin, dit la Bête ; mais souvenez-vous de votre promesse. Vous n’aurez qu’à mettre votre bague sur une table en vous couchant, quand vous voudrez revenir. Adieu, la Belle ». La Bête soupira selon sa coutume, en disant ces mots, et la Belle se coucha toute triste de la voir affligée. Quand elle se réveilla le matin, elle se trouva dans la maison de son père ; et, ayant sonné une clochette qui était à côté de son lit, elle vit venir la servante qui fit un grand cri en la voyant. Le bon homme accourut à ce cri, et manqua mourir de joie en revoyant sa chère fille ; et ils se tinrent embrassés plus d’un quart-d ’heure. La Belle, après les premiers transports, pensa qu’elle n’avait point d’habits pour se lever ; mais la servante lui dit, qu’elle venait de trouver dans la chambre voisine un grand coffre plein de robes toutes d’or, garnies de diamants. Belle remercia la bonne Bête de ses attentions ; elle prit la moins riche de ces robes, et dit à la servante de serrer les autres, dont elle voulait faire présent à ses sœurs ; mais à peine eut-elle prononcé ces paroles, que le coffre disparut. Son père lui dit que la Bête voulait qu’elle gardât tout cela pour elle ; et aussitôt les robes et le coffre revinrent à la même place. La Belle s’habilla ; et, pendant ce temps on fut avertir ses sœurs qui accoururent avec leurs maris ; elles étaient toutes deux fort malheureuses. L’aînée avait épousé un gentilhomme, beau comme le jour ; mais il était si amoureux de sa propre figure, qu’il n’était occupé que de cela, depuis le matin jusqu’au soir, et méprisait la beauté de sa femme. La seconde avait épousé un homme qui avait beaucoup d’esprit ; mais il ne s’en servait que pour faire enrager tout le monde, et sa femme toute la première. Les sœurs de la Belle manquèrent de mourir de douleur, quand elles la virent habillée comme une princesse, et plus belle que le jour. Elle eut beau les caresser, rien ne put étouffer leur jalousie, qui augmenta beaucoup, quand elle leur eut conté combien elle était heureuse. Ces deux jalouses descendirent dans le jardin pour y pleurer tout à leur aise, et elles se disaient : « Pourquoi cette petite créature est-elle plus heureuse que nous ? Ne sommes-nous pas plus aimables qu’elle ? — Ma sœur, dit l’aînée, il me vient une pensée ; tâchons de l’arrêter ici plus de huit jours ; sa sotte Bête se mettra en colère de ce qu’elle lui aura manqué de parole, et peut-être qu’elle la dévorera. — Vous avez raison, ma sœur, répondit l’autre. Pour cela, il lui faut faire de grandes caresses ; et, ayant pris cette résolution, elles remontèrent, et firent tant d’amitié à leur sœur, que la Belle en pleura de joie. Quand les huit jours furent passés, les deux sœurs s’arrachèrent les cheveux, et firent tant les affligées de son départ, qu’elle promit de rester encore huit jours chez son père.
Cependant Belle se reprochait le chagrin qu’elle allait donner à sa pauvre Bête, qu’elle aimait de tout son cœur, et elle s’ennuyait de ne plus la voir. La dixième nuit qu’elle passa chez son père, elle rêva qu’elle était dans le jardin du palais, et qu’elle voyait la Bête couchée sur l’herbe et près de mourir, qui lui reprochait son ingratitude. La Belle se réveilla en sursaut, et versa des larmes. — Ne suis-je pas bien méchante, disait-elle, de donner du chagrin à une Bête qui a pour moi tant de complaisance ? Est-ce sa faute si elle est si laide, et si elle a peu d’esprit ? Elle est bonne, cela vaut mieux que tout le reste. Pourquoi n’ai-je pas voulu l’épouser ? Je serais plus heureuse avec elle, que mes sœurs avec leurs maris. Ce n’est ni la beauté, ni l’esprit d’un mari qui rendent une femme contente : c’est la bonté du caractère, la vertu, la complaisance ; et la Bête a toutes ces bonnes qualités. Je n’ai point d’amour pour elle, mais j’ai de l’estime, de l’amitié, de la reconnaissance. Allons, il ne faut pas la rendre malheureuse : je me reprocherais toute ma vie mon ingratitude. À ces mots, Belle se lève, met sa bague sur la table, et revient se coucher. À peine fut-elle dans son lit, qu’elle s’endormit ; et, quand elle se réveilla le matin, elle vit avec joie qu’elle était dans le palais de la Bête. Elle s’habilla magnifiquement pour lui plaire, et s’ennuya à mourir toute la journée, en attendant neuf heures du soir ; mais l’horloge eut beau sonner, la Bête ne parut point. La Belle alors craignit d’avoir causé sa mort. Elle courut tout le palais, en jetant de grands cris ; elle était au désespoir. Après avoir cherché partout, elle se souvint de son rêve, et courut dans le jardin vers le canal, où elle l’avait vue en dormant. Elle trouva la pauvre Bête étendue sans connaissance, et elle crut qu’elle était morte.
Elle se jeta sur son corps, sans avoir horreur de sa figure ; et, sentant que son cœur battait encore, elle prit de l’eau dans le canal, et lui en jeta sur la tête. La bête ouvrit les yeux, et dit à la Belle : « Vous avez oublié votre promesse ; le chagrin de vous avoir perdue m’a fait résoudre à me laisser mourir de faim ; mais je meurs content, puisque j’ai le plaisir de vous revoir encore une fois. — Non, ma chère Bête, vous ne mourrez point, lui dit la Belle, vous vivrez pour devenir mon époux ; dès ce moment je vous donne ma main, et je jure que je ne serai qu’à vous. Hélas ! je croyais n’avoir que de l’amitié pour vous ; mais la douleur que je sens me fait voir que je ne pourrais vivre sans vous voir. À peine la Belle eut-elle prononcé ces paroles qu’elle vit le château brillant de lumière ; les feux d’artifices, la musique, tout lui annonçait une fête ; mais toutes ces beautés n’arrêtèrent point sa vue : elle se retourna vers sa chère Bête, dont le danger la faisait frémir. Quelle fut sa surprise ! la Bête avait disparu, et elle ne vit plus à ses pieds qu’un prince plus beau que l’Amour, qui la remerciait d’avoir fini son enchantement. Quoique ce prince méritât toute son attention, elle ne put s’empêcher de lui demander où était la Bête. — Vous la voyez à vos pieds, lui dit le prince. Une méchante fée m’avait condamné à rester sous cette figure, jusqu’à ce qu’une belle fille consentit à m’épouser, et elle m’avait défendu de faire paraître mon esprit. Ainsi, il n’y avait que vous dans le monde, assez bonne pour vous laisser toucher à la bonté de mon caractère ; et, en vous offrant ma couronne, je ne puis m’acquitter des obligations que je vous ai. La Belle, agréablement surprise, donna la main à ce beau prince pour se relever. Ils allèrent ensemble au château, et la Belle manqua mourir de joie en trouvant, dans la grande salle, son père et toute sa famille, que la belle dame, qui lui était apparue en songe, avait transportée au château. — Belle, lui dit cette dame qui était une grande fée, venez recevoir la récompense de votre bon choix : vous avez préféré la vertu à la beauté et à l’esprit, vous méritez de trouver toutes ces qualités réunies en une même personne. Vous allez devenir une grande reine : j’espère que le trône ne détruira pas vos vertus. — Pour vous, mesdemoiselles, dit la fée aux deux sœurs de Belle, je connais votre cœur et toute la malice qu’il renferme. Devenez deux statues ; mais conservez toute votre raison sous la pierre qui vous enveloppera. Vous demeurerez à la porte du palais de votre sœur, et je ne vous impose point d’autre peine que d’être témoins de son bonheur. Vous ne pourrez revenir dans votre premier état qu’au moment où vous reconnaîtrez vos fautes ; mais j’ai bien peur que vous ne restiez toujours statues. On se corrige de l’orgueil, de la colère, de la gourmandise et de la paresse : mais c’est une espèce de miracle que la conversion d’un cœur méchant et envieux. Dans le moment, la fée donna un coup de baguette qui transporta tous ceux qui étaient dans cette salle, dans le royaume du prince. Ses sujets le virent avec joie, et il épousa la Belle qui vécut avec lui fort longtemps, et dans un bonheur parfait, parce qu’il était fondé sur la vertu.
Conte du IIème siècle. Version de Jeanne Marie Leprince de Beaumont, Contes moraux pour l’instruction de la jeunesse, Barba, 1806 (p. 1-32). Illustrations de l’édition de 1870, Librairie Hachette & Cie.
Racontée par Sophie de Pas
Le Loup et les Sept Chevreaux

Conte des frères Grimm. Adaptation par contesdefees.com.
Une chèvre avait sept petits qu’elle aimait et qu’elle protégeait soigneusement du loup. Un jour, alors qu’elle devait sortir chercher à manger, elle convoqua tout le monde et dit : « Chers enfants, je dois sortir chercher de la nourriture, protégez-vous du loup et ne le laissez pas entrer. Faites très attention, car il fait souvent semblant d’être gentil mais on le reconnaît à sa voix rauque et à ses pattes noires ; Ne lui ouvrez la porte en aucun cas, car il vous mangerait tous en une bouchée. »
Puis elle s’en alla, mais bientôt le loup arriva à la porte d’entrée et dit d’une voix faussée: « Chers enfants, ouvrez-moi, je suis votre mère et j’ai apporté de belles choses du marché. » Mais les sept chevreaux répondirent : « Tu n’es pas notre mère, elle a une belle et jolie voix, mais ta voix est rauque, tu es le loup, nous ne t’ouvrirons pas! »
Alors le loup alla au magasin et acheta un gros morceau de craie, qu’il mangea pour affiner sa voix. Puis il retourna à la porte des sept biquets et cria d’une voix plus douce: « Chers enfants, laissez-moi entrer, je suis votre mère, je vous rapporte quelque chose à chacun de vous. » Mais il avait mis sa patte sur le bord de la fenêtre, et les chevreaux la virent et dirent : « Tu n’es pas notre mère, elle n’a pas de patte noire comme toi ; tu es le loup, nous ne t’ouvrirons pas. » Le loup furieux alla chez un boulanger et dit : » Boulanger, enduit ma patte de pâte fraîche « , et quand cela fut fait, il alla chez le meunier et dit : « Meunier, enduits ma patte de ta farine blanche. » Le meunier protesta. – » Si tu ne le fais pas, je te mangerai. » Alors le meunier s’exécuta.
Puis le loup retourna à la porte d’entrée des sept Chevreaux et dit : « Chers enfants, laissez-moi entrer, je suis votre mère, je rapporte un cadeau pour chacun d’entre vous. » Les sept Chevreaux voulaient d’abord voir la patte, et comme ils virent qu’elle était blanche comme neige et entendirent le loup parler si doucement, ils crurent cette fois que c’était leur mère pour de bon et ouvrirent la porte, et le loup entra. Lorsqu’ils le reconnurent, ils se cachèrent au plus vite, l’un sous la table, le deuxième dans le lit, le troisième dans le four, le quatrième dans la cuisine, le cinquième dans l’armoire, le sixième sous un grand bol ; le septième dans l’horloge au mur. Mais le loup les trouva et les avala tous, à l’exception du plus jeune qui était dans l’horloge.
Bien rassasié, le Loup s’en alla, et peu après la maman chèvre revint à la maison. Quelle tristesse en voyant que le loup avait mangé ses chers enfants. Elle pensa qu’ils étaient tous morts et pleurait amèrement lorsque soudain, le plus jeune sauta de l’horloge murale et raconta comment tout s’était passé.
Pendant ce temps là, le loup qui avait trop mangé, alla dans un champs, se coucha au soleil et tomba dans un profond sommeil. La maman chèvre, en l’apercevant, se demanda si elle pouvait encore sauver ses enfants, et dit au plus jeune : « Prends du fil, une aiguille et des ciseaux et suis-moi. » Puis elle s’approcha du loup en train de ronfler : « Voilà le grand méchant loup bien endormi, dit-elle en le regardant de tous côtés, passe-moi vite les ciseaux. Le petit lui tendit les ciseaux et elle ouvrit le ventre du loup d’un coup.
Les six petits biquets sortirent indemnes car heureusement le loup les avaient avalé sans les croquer. Leur mère les embrassa en pleurant et leur dit d’aller tout de suite chercher de grosses et lourdes briques, avec lesquelles ils remplirent le ventre du loup, le recousirent et s’enfuirent se cacher derrière une haie.
Quand le loup se réveilla, il avait mal et il dit : «j’ai l’estomac bien lourd ». Il pensa que boire de l’eau lui ferait du bien, et ayant trouvé un puits, il se pencha pour boire.
Mais le poids des pierres était tel, qu’il l’entraîna vers l’avant et le méchant loup tomba au fonds du puits.
Lorsque les sept biquets et leur mère virent cela, il sautèrent de joie et dansèrent autour du puits.
Sinbad le marin

Il y a très longtemps, vivait à Bagdad un jeune homme qui se plaignait de la dureté de son travail de transporteur. Un jour, après avoir terminé sa journée, il s’assit pour se reposer un moment près de la porte de la maison d’un riche marchand. L’homme, qui était à l’intérieur, l’entendit se plaindre.
– Travailler et travailler encore. Est-ce donc ça la vie?
Le marchand eut pitié du garçon et l’invita à un dîner chaud. Le garçon accepta et fut étonné d’entrer dans une maison aussi luxueuse avec des mets si riches sur la table.
« Je ne sais pas quoi dire, monsieur !… Je n’ai jamais vu autant de richesse.
– C’est vrai – répondit poliment l’homme – J’ai beaucoup de chance, mais je veux te dire comment j’ai obtenu tout ce que tu vois. Personne ne m’a rien donné et j’aimerais que tu comprennes que c’est le fruit de beaucoup d’efforts.
Le marchand, qui s’appelait Sinbad, raconta son histoire au garçon intrigué.
– En mourant, commença t-il, mon père me laissa une bonne fortune, mais je la gaspillais jusqu’à ce qu’il ne me reste plus rien. Je décidais donc de me faire marin.
– Marin! Quelle merveille!
– Oui, mais ce ne fut pas si facile. Lors du premier voyage, je tombais à l’eau et nageais jusqu’à une île qui s’avéra être le dos d’une baleine. Heureusement, je réussis à m’échapper, accroché à un baril flottant dans l’eau, jusqu’à ce que le courant me dépose sur les rives d’une ville inconnue. J’errais pendant des jours, jusqu’à ce que je sois embauché sur un nouveau bateau qui me ramena finalement à Bagdad. Ce furent des jours très durs !
Il finit de parler et donna au garçon cent pièces d’or en échange de revenir le lendemain écouter ses histoires. Le jeune homme, les poches pleines, sautait de joie. La première chose qu’il fit fut d’acheter un bon morceau de viande pour inviter ses amis.
Le lendemain, il retourna chez Sinbad, comme convenu. Après le dîner, l’homme ferma les yeux et se souvint d’une autre partie de sa vie.
– Mon deuxième voyage fut très étrange… J’aperçus une île et échouais le bateau sur le bord de la plage. Je commençais à chercher de la nourriture, et j’apperçu un œuf géant.
Aors que j’allais m’en emparer, un oiseau géant se posa sur mes épaules, m’attrapa avec ses puissantes griffes, et me souleva vers le ciel. Je volais comme un aigle et bien qu’effrayé au possible, je m’extasiais de voir la terre de si haut.
D’abord, Je pensais qu’il me jetterait au-dessus de la mer, mais il changea de direction, et me lâcha au dessus d’une vallée pleine de diamants. En tombant je me blessais grièvement, mais malgré cela je saisis l’occasion et ramassais autant de pierres précieuses que possible avant de retrouver mon équipage et le navire sur la plage.
Quand il eut fini de se remémorer son deuxième voyage, Sinbad donna cent autres pièces d’or au jeune homme, l’invitant à revenir le lendemain. Le garçon commençait à apprécier le récit des aventures du vieux Sinbad et il était toujours ponctuel à leur rendez-vous. Cette fois encore, l’homme se perdit dans les méandres de ses souvenirs enflammés.
– Cela te paraîtra étrange, dit-il. Grâce aux diamants, j’étais maintenant un homme riche et vivait comme un prince. Mais malgré cela, l’appel de la mer et du large étaient plus forts et je préparais donc un nouveau voyage. Cette fois encore, j’eu de nombreuses aventures passionnantes. Nous débarquâmes sur une île où vivaient des centaines de pygmées sauvages qui détruisirent notre bateau. Ils nous ligotèrent et nous amenèrent chez leur chef, qui était un grand géant borgne à l’air hideux.
– Un géant borgne? Quelle horreur!
« Oui, c’était terrifiant ! » Il mangeait tous mes marins, mais comme j’étais très maigre et qu’il était déjà bien rassasié, il me laissa sur le côté. Il s’endormit et j’en profitais pour attraper le tisonnier du feu, qui était brûlant, et le plantais dans son œil unique. Il entra dans une colère immense et criait à en faire trembler la montagne, mais il ne pouvait plus me voir et j’en profitait pour m’enfuir.
Ayant échappé au géant et à ses pygmées, je rencontrais un marchand qui me prit sur son bateau. Je l’aidais si bien à vendre ses toiles rares de port en port, qu’il m’associa à son entreprise et nous fîmes à nouveau fortune.
Le jeune homme s’exaltait en écoutant les histoires de l’intrépide marin. Que d’aventures cet homme avait vécues!…
Pendant sept nuits, Sinbad raconta sept nouvelles histoires, sept voyages, sept aventures toutes plus époustouflantes les unes que les autres. Et chaque soir, après l’histoire, il lui donnait encore cent pièces.
À leur dernière rencontre, ils se dirent au revoir avec amitié. Avant que le jeune homme ne s’en aille, Sinbad voulut lui dire quelque chose d’important :
– Maintenant tu sais que, pour obtenir une chose, il y a toujours un prix à payer. Et aussi que le destin est quelque chose pour lequel il faut se battre et que chacun doit se forger. Personne dans cette vie ne donne quoi que ce soit gratuitement! Et si cela arrive, il faut savoir en faire bon usage. J’espère que l’argent que je t’ai donné t’aidera à démarrer de nouveaux projets et que mes histoires te serviront.
Le jeune homme comprit que le vieux Sinbad avait accomplis ses rêves, grâce à son courage, son intelligence et ses décisions. Maintenant, il avait sept cents pièces d’or, il était riche, mais il avait appris à ne pas s’endormir sur ses lauriers. Et quelques temps après, que croyez-vous qu’il fit avec son argent?
Adaptation courte du conte classique des Mille et une nuits. Illustration tiré de l’adaptation de Larousse par Mlle Latappy sauf la première (Roland Beaussant)
Le cadeau du brochet
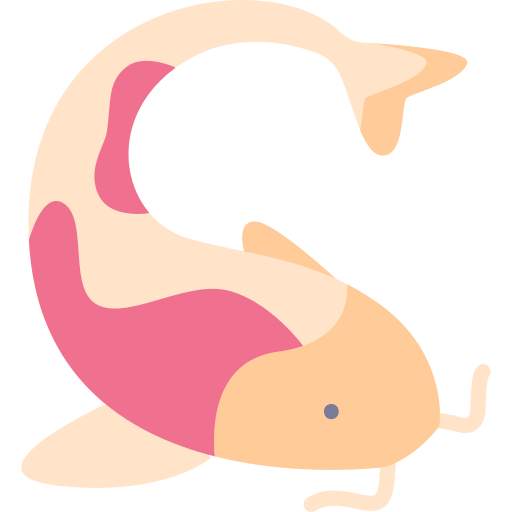
Tiré du recueil de conte de Alexander Afanasyev
Émilien vivait dans un village au bord de la Volga avec ses deux frères et leurs femmes. Il était belle homme, mais il était aussi très paresseux et méprisait le travail. Il passait ses journées assis sur le fourneau dans la cuisine. Ses frères dirigeaient une affaire que leur avait laissée leur père décédé. Un jour il partirent en voyage pour vendre leurs marchandises le long de la rivière, laissant Émilien avec les femmes, promettant de revenir avec un caftan, des bottes rouges et un chapeau rouge pour leur frère.
Pendant les jours et les semaines où les frères furent partis, les épouses essayèrent en vain de faire travailler Émilien, jusqu’à ce qu’un jour, elles ne lui laissent que ce choix : Aller chercher de l’eau à la rivière gelée, ou bien il n’y aurait pas de dîner, pas de caftan, de bottes rouges et de chapeau.
Prenant cette cette menace très au sérieux, Émilien se mit rapidement en chemin, et atteignit la rivière, en grognant et se plaignant de ses problèmes tout en coupant la glace épaisse. Alors qu’il mettait de l’eau dans les seaux, il remarqua qu’il avait attrapé un poisson : un gros brochet. Émilien allait le ramener à la maison pour le dîner, mais le brochet le supplia, lui promettant que si Émilien lui laissait la vie sauve, il n’aurait plus jamais besoin de travailler, ce qui était une offre tentante pour le paresseux. Tout ce qu’il aurait besoin de dire, c’était : « Par ordre du brochet, et selon mon désir, je veux… » et tu ajouteras ton souhait et ta volonté serait faite. Émilien accepta, et à sa grande surprise, le sortilège fonctionna et ses vœux furent tous réalisés.
Émilien ne cachait pas son nouveau talent, et bientôt le tsar en entendit parler et ordonna à ce « magicien » de comparaître devant lui dans son palais au bord de la mer Caspienne. Émilien, toujours aussi paresseux, ordonna au fourneau de la cuisine, et sur lequel il était couché, de le transporter jusqu’au tsar en volant, en utilisant l’ordre du brochet. Il arriva aussitôt au palais devant le tsar, toujours allongé sur sa cheminée, où il regardait de haut le tsar et ne se comportait pas vraiment comme devrait le faire un sujet envers son monarque. Le tsar aurait ordonné qu’on lui coupe la tête s’il n’avait pas ardemment voulu découvrir le secret du pouvoir du garçon. Mais comme le garçon ne révélait pas son secret, il décida d’utiliser sa fille, la princesse, pour obtenir le secret. Après trois jours passés à partager des jeux, la princesse avait seulement appris qu’Émilien était beau, amusant et charmant. Elle voulait l’épouser. Le tsar fut d’abord en colère, puis décida qu’Émilien livrerait peut-être son secret à sa femme, s’il se mariait. Alors il organisa le mariage.
Au début, Émilien était horrifiée à cette idée, persuadé qu’une femme lui amènerait plus de problèmes que cela n’en valait la peine. Il accepta, cependant, et le festin de mariage eu lieu peu de temps après, ce qui fit même descendre Émilien de son poêle. Pendant le festin, Émilien avait de si terribles manières à table, et se tenait si mal, que le Tsar changea d’avis et décida de se débarrasser de lui. Une potion de sommeil fut ajoutée au vin du marié, qui fut ensuite enfermé tout endormi dans un tonneau et jeté à la mer. Son épouse fut bannie sur une île en face du palais royal. En flottant dans les vagues, Émilien rencontra son ami le brochet, qui lui permit de souhaiter à nouveau tout ce que son cœur désirait, puisqu’il n’avait pas abusé de son pouvoir.
Émilien souhaita d’obtenir la sagesse, et quand le brochet le poussa sur l’île, Émilien retrouva sa femme et tomba enfin amoureux d’elle à son tour. Il fit transformer la cabane de l’île en un magnifique palais, avec un pont de cristal reliant le continent, afin que sa femme puisse rendre visite à son père, le tsar, à qui elle avait pardonné sa méchanceté. Avec sa nouvelle sagesse, il fit amende honorable avec tout le monde, et vécu heureux.
La Princesse au petit pois


Il était une fois un prince qui voulait épouser une princesse, une princesse authentique. Pour la trouver, il parcourut le monde entier. Il rencontra beaucoup de princesses, mais il n’en trouvait aucune qui fut vraiment authentique ; à chaque fois, il manquait quelque chose, il y avait un je-ne-sais-quoi de suspect. Il finit donc par rentrer chez lui très triste, car il était vraiment déterminé à n’épouser qu’une princesse véritable.
Une après-midi, un terrible orage éclata ; la foudre et le tonnerre s’alternaient sans interruption, et il pleuvait fort; un vrai temps de chien. Au beau milieu de cette tempête, quelqu’un frappa à la porte du château, et le vieux roi vint ouvrir.
Derrière la porte il trouva une princesse ; Quelle surprise, mais bougre, comme la pluie et le mauvais temps l’avaient arrangée! L’eau dégoulinait sur ses cheveux et ses vêtements aplatis, et coulait de sa taille jusqu’à ses chaussures et ressortait par les talons ; Elle faisait piètre figure, mais cependant, elle se présenta en prétendant être une vraie princesse.
« Nous en aurons bientôt le cœur net », dit la vieille reine après que le roi lui eut amené la princesse. Et, sans dire un mot, elle entra dans la chambre de l’invitée, souleva le lit et posa un petit pois sur le sommier; puis elle empila vingt matelas par-dessus, et encore au-dessus, autant de couettes.
Tout le monde se coucha et la princesse monta sur sa montagne d’édredons pour dormir.
Le lendemain matin toute la famille lui demanda comment elle avait dormi.
« Horriblement mal ! » Répondit-elle. « Je n’ai pas dormi de la nuit! Je ne sais pas ce qu’a ce lit qui me fait si mal! Je suis couverte de bleus! »
Alors ils comprirent qu’elle était vraiment une princesse pour de vrai, puisque, malgré les vingt matelas et vingt couettes, elle avait senti le petit pois. Seul une vraie princesse pouvait être aussi sensible.
Satisfait et fidèle à son dessein, le prince la prit pour femme et le pois fut exposé au musée, où il peut encore être vu, si personne ne l’a dérobé.
Et voilà une vraie histoire authentique!
Jack et le haricot magique

Il était une fois une pauvre femme veuve qui vivait avec son fils Jack. Un jour, elle dit à son fils d’aller au marché pour y vendre la seule vache qu’ils avaient afin qu’ils puissent acheter de la nourriture pour passer le long hiver.
Jack partit avec sa vache au marché mais, en chemin, il rencontra un vieil homme qui lui proposa de lui échanger sa vache :
– Que me donnerez vous en échange de ma vache ? demanda Jack.
– Je te donnerai cinq haricots magiques, répondit le vieil homme.
Jack, qui aimait les histoires de magie, accepta et il rentra chez lui tout fier avec ses haricots.
Sa mère se mit en colère en voyant les haricots et pensa que son fils s’était fait berner par le vieil homme.
– Qu’allons-nous devenir maintenant, sans vache et sans argent et avec ces stupides haricots qui ne valent rien ! Et en colère, elle jeta les haricots par la fenêtre.
Jack était très triste et honteux et alla se coucher sans dîner.
Le lendemain, lorsqu’il se réveilla et regarda par la fenêtre, il vit qu’une énorme plante avait poussé là où sa mère avait lancé les haricots magiques, et s’élevait jusqu’aux nuages. Il grimpa sur la tige en s’accrochant aux branches et commença à monter vers le ciel. Il grimpa et grimpa jusqu’à ce qu’il atteigne les nuages et là, au loin, il aperçut un magnifique château.
Il marcha jusqu’au château et découvrit que c’était la maison d’un couple de géants, car les portes et les meubles était gigantesques. Dans la cuisine, il trouva la femme géante et lui demanda:
– Pouvez-vous me donner quelque chose à manger madame? Je n’ai pas mangé de la journée et j’ai très faim.
La femme, très gentille, lui donna du pain et du lait. Elle lui recommanda de partir dès qu’il aurait fini car son mari, le géant, avait très mauvais caractère et mangeait même les enfants.
Juste à ce moment-là, ils entendirent un grand claquement de porte: c’était le géant qui rentrait chez lui. Jack avait très peur mais il eut heureusement le temps de se cacher.
– Ça sent la chair fraîche d’enfant ici… Où est-il? Je le mangerai pour le dîner, j’ai très faim!
– Il n’y a pas d’enfant ici, mon chéri, juste moi. Dit la femme. Allez, tu dois être fatigué, mange le repas que je t’ai préparé et va faire une sieste.
Le géant, soupçonneux mais obéissant, prit son dîner et se rendit dans sa chambre. C’est là que Jack s’était caché, et depuis sa cachette, il vit le géant ouvrir une petite cage et en sortir une poule à laquelle il se mit à parler.
– Ponds donc un œuf, ma petite poule, dit le géant. Et sur ces mots, la poule pondit un œuf en or.
Alors le géant prit sa harpe et ordonna :
– Harpe, joue pour moi !
Alors la harpe commença à jouer de la musique, et des diamants et des pierres précieuses en sortirent.
Satisfait et repu, le géant s’endormit pour sa sieste.
Jack profita de ce moment pour attraper la poule et la harpe et sortit en courant de la pièce. Mais dans sa fuite, il toucha les cordes de la harpe et la mélodie réveilla la géant. Il vit Jack qui était déjà dehors et courut après lui.
– Je le savais! Te voici petit garnement! Je vais t’attraper, petit canaille ! Tu seras mon repas de ce soir !
Le géant criait en poursuivant Jack qui courait jusqu’au haricot.
Jack descendait aussi vite qu’il pouvait, sautant de branche en branche, sans s’arrêter une seconde. Il entendait le géant au dessus de lui qui criait et soufflait et arrachait les branches.
Il arriva au sol avant que le géant ne l’ait rattrapé et courut jusque chez lui devant sa mère éberluée. Il prit une hache et retourna au haricot géant qu’il se mit à couper aussi vite qu’il pouvait. La plante était fragile, et quand elle fut complètement coupée, elle tomba, entraînant dans sa chute le géant, qui mourut sur le coup.
Depuis ce jour, Jack et sa mère n’eurent plus jamais à se soucier de la nourriture et devinrent même riches grâce à la poule et à la harpe.
Un conte de Noël
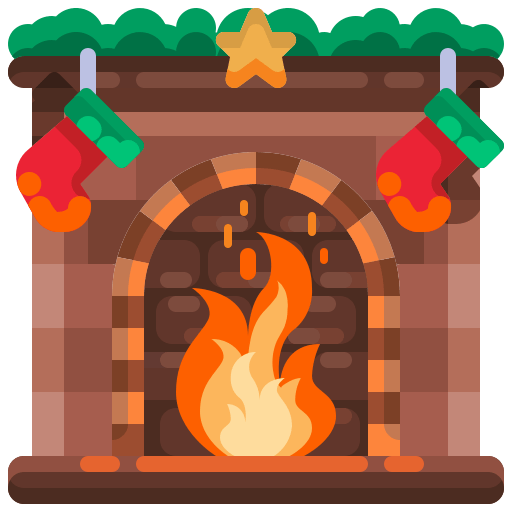
D’après l’œuvre de Charles Dickens, A Christmas Carol (Un chant de Noël). Illustrations d’Arthur Rackham
Il y avait une fois, dans la grande ville de Londres, un vieux banquier qui s’appelait Ebenezer Scrooge. Il était très riche, mais il était surtout très avare, égoïste et grognon.
Scrooge était méchant et méprisant avec tout le monde et n’aidait jamais personne. Son seul employé, Bob Cratchit, devait travailler dans le froid toute la journée car Scrooge ne voulait pas payer le chauffage.
C’était la veille de Noël et une fois de plus, il avait refusé l’invitation de son neveu Fred à venir passer le réveillon dans sa famille, car il détestait les fêtes. « Les fêtes sont pour les paresseux! » Disait-il. Il reprocha même à Bob Cratchit de lui demander une avance sur son salaire pour acheter la dinde du réveillon, en disant qu’il exagérait déjà trop de ne pas venir travailler le jour de Noël.
Il ne savait que travailler : Comptant, calculant et amassant son immense fortune toute la journée, gardant tout pour lui, ne partageant ni son argent, ni son temps avec personne, et encore moins depuis que son associé Jacob Marley était mort il y a sept ans.
Après avoir fermé la boutique, il rentra dans son vieil appartement délabré et sale. Il cru d’abord apercevoir la tête de son ancien associé mort Jacob Marley à la place du pommeau de la porte d’entrée et il entra vite en essayant de l’oublier.
Il s’apprêtait à manger son maigre dîner auprès du faible et unique feu de cheminée qui lui servait de chauffage, avant d’aller se coucher comme tous les soirs, lorsque lui apparut le fantôme – cette fois pour de bon – qui le fit presque mourir de peur. C’était le spectre de son ancien associé Jacob Marley, qui se mit à lui parler ainsi avec une voix d’outre-tombe:
– Ebenezer! Regarde donc ce que tu es devenu, un vieux crouton rance qui ne pense plus qu’en Livres Sterling ! Tu étais plus drôle et gentil quand nous ouvrîmes notre première affaire il y a cinquante ans. Si tu continues comme cela, tu seras condamné à traîner tes livres de comptes, tes dossiers, tes coffres et tes clés pour le restant de tes jours et probablement au delà de la mort! Change ta vie! Redevient un homme meilleur! Soit bon et généreux avec les autres, rit et amuse-toi avec eux! »
Le vieux Scrooge était si effrayé de revoir son ancien associé qu’il resta sans rien dire avec la bouche ouverte.
– Écoute-moi bien, reprit le fantôme. Cette nuit tu recevras la visite de trois esprits, les trois esprits de Noël, celui du Noël passé, celui du Noël présent, et celui du Noël futur. Ce sera ta dernière chance de te sauver. Alors prête leur bien attention et agit en conséquence !
Et sur ces mots il disparut.
Il se mit au lit en tremblant, et peu après, le fantôme du Noël passé lui apparut. Il emmena Ebenezer Scrooge dans un voyage vers sa jeunesse dorée. Le vieil homme se reconnu en train de fêter Noël gaiement avec ses parents et ses amis: Il avait l’air si heureux. Puis il vit d’autres Noëls plus récents et beaucoup plus tristes et les terribles méchancetés qu’il avait commis alors.
Puis vint le fantôme du Noël présent qui lui montra une pauvre pièce joliment décorée avec du houx, du lierre et du gui. Il y avait là une table avec des saucisses, des pommes de terres, quelques poires, des pommes, des oranges et des gâteaux. C’était le logis de son employé Bob Cratchit et sa famille. Bob, sa femme et ses deux enfants étaient assis à la table. C’était là un bien maigre repas de fête, mais ils se réjouissaient tous et disaient que c’était le dîner de Noël le plus merveilleux qu’ils aient jamais vu.
Bien que pauvres, ils étaient heureux et s’aimaient tendrement. Ils l’aperçurent et l’invitèrent à s’assoir et à dîner avec eux. Mais Scrooge avait trop honte car, en plus, il avait aperçu le petit Tim, leur fils, qui était bien malade car les parents n’avaient pas assez d’argent pour payer le docteur. « Regarde! » Dit le fantôme « le petit garçon mourra bientôt si ils ne trouvent pas l’argent nécessaire pour payer le docteur. »
– Emmène-moi ailleurs; s’il te plaît, je n’en peux plus ! Supplia le vieil avare.
Le troisième fantôme était celui du Noël futur.
Il emmena Ebenezer Scrooge dans un cimetière où il lui montra une tombe abandonnée. Il y avait son nom inscrit sur la pierre.
– Oh monsieur le fantôme ! Dit le vieillard apeuré. « Je vais changer de vie, je vous le promet! Je serai aimable et généreux à partir de maintenant! »
Alors le fantôme disparut.
Quand Scrooge se réveilla le lendemain, il se rappela des trois fantômes et ce qu’ils lui avaient montré. C’était le matin de Noël et il pensa: « Quelle merveilleuse matinée ! »
Il sauta du lit et sourit pour la première fois depuis fort longtemps. Il s’habilla vite, sortit dans la rue, et alors qu’il marchait, il lançait des pièces à chaque mendiant qu’il voyait en leur souhaitant un joyeux Noël!
Il acheta toute sorte de plats et desserts délicieux et de nombreux cadeaux et se dirigea vers le pauvre logis de son employé Bob Cratchit. Il leur offrit tout ce qu’il avait acheté sur la route et leur donna l’argent pour que le médecin guérisse leur fils. Il ne s’était jamais senti aussi heureux de toute sa vie!
Alors, il reprit son chemin jusqu’à la maison de son neveu Fred pour célébrer Noël avec lui et sa famille.
Les fantômes de Noël et de son vieil associé avait réussit l’impossible: Changer la vie d’Ebenezer Scrooge qui fut désormais généreux et heureux jusqu’au dernier de ses jours.
Ali-Baba et les quarante voleurs



et les Quarante Voleurs─────*─────
Il y avait une fois, dans une ville de Perse, deux frères nommés Kassim et Ali-Baba. Kassim était riche tandis qu’Ali-Baba était pauvre. Pour gagner sa vie et celle de ses enfants, il allait couper du bois dans la forêt voisine, et le ramenait à la ville, pour le vendre, chargé sur trois ânes qui constituaient toute sa fortune.
Un jour Ali-Baba achevait de couper sa charge de bois lorsqu’il distingua une troupe de cavaliers qui s’avançaient dans sa direction. Craignant d’avoir affaire à des voleurs, il abandonna ses ânes et monta sur un gros arbre touffu.
Les cavaliers mirent pied à terre, ils étaient quarante. Le chef de la bande se dirigea vers un rocher situé près du gros arbre où Ali-Baba s’était réfugié, écarta les broussailles et prononça :
« Sésame, ouvre-toi ! » Aussitôt, une porte s’ouvrit, les brigands s’y engouffrèrent, le chef entra le dernier et la porte se referma sur lui.
Après un bon moment, la porte se rouvrit, livrant passage aux quarante voleurs. Quand ils eurent tous défilé, le chef dit solennellement : « Sésame, referme-toi ! » Et la porte se referma.
Sur ce, chacun enfourcha son cheval, et la bande disparut. Aussitôt Ali-Baba quitta sa cachette, écarta les broussailles et découvrit une porte. Il se rappelait la phrase magique :
« Sésame, ouvre-toi ! » prononça-t-il.
Instantanément, la porte s’ouvrit et Ali-Baba aperçut une immense grotte, emplie de marchandises et surtout de pièces d’or et d’argent empilées dans de grands sacs de cuir. Sans perdre de temps, il réunit autant de sacs d’or que pouvaient en porter ses trois ânes. Quand ils furent chargés, il prononça la formule magique :
« Sésame, referme-toi ! « Et la porte obéit.
Content de son aubaine, Ali-Baba revint chez lui et, devant sa femme, vida le contenu des sacs, qui fit un gros tas d’or. Celle-ci désireuse d’évaluer ce trésor, alla demander à la femme de Kassim de lui prêter une mesure ; mais cette dernière désireuse de savoir quelle sorte de grain la femme d’Ali-Baba entendait mesurer, enduisit le dessous de la mesure d’une légère couche de suif.
En rentrant chez elle, la femme d’Ali-Baba posa la mesure sur le tas d’or, qu’elle se mit en devoir d’évaluer, puis, reporta celle-ci à sa belle-sœur. Le premier soin de la femme de Kassim fut de regarder le dessous de la mesure ; et quelle ne fut pas sa surprise en voyant une pièce d’or attachée à la couche de suif. Son mari ne fut pas plus tôt auprès d’elle qu’elle le mit au courant de sa découverte. Aussitôt Kassim alla trouver son frère qui, cédant à son bon naturel, l’instruisit des paroles indispensables pour pénétrer dans la grotte et pour en sortir.
Le lendemain, de bon matin, Kassim quitta sa maison avec toute une troupe de mulets chargés de grands coffres pour s’emparer du trésor. « Sésame, ouvre-toi ! » prononça-t-il quand il eut trouvé la porte. Elle s’ouvrit, puis se referma dès qu’il fut entré.
Kassim tomba dans une profonde admiration, en face des richesses accumulées en ce lieu. Puis s’emparant d’autant de sacs d’or monnayé qu’il put en porter, il se dirigea vers la porte pour sortir, mais il ne se souvint plus de la phrase exacte et dit : « Orge, ouvre-toi ! »
La porte ne s’ouvrit pas. Kassim en conçut un tel effroi qu’il lui fut impossible de retrouver le mot magique. Soudain, il perçut le bruit d’un galop de chevaux. Il s’avança tout près de la porte et, dès qu’elle s’ouvrit, sortit si brusquement qu’il renversa le chef des voleurs ; mais les brigands se jetèrent sur lui, et l’exterminèrent sans pitié. Ils pénétrèrent ensuite dans leur repaire et remirent en place les sacs abandonnés par Kassim, sans s’apercevoir qu’il en manquait d’autres. Puis, ils coupèrent en quatre le cadavre et retournèrent à leurs exploits.

Cependant, à la nuit close, la femme de Kassim, ne voyant pas revenir son mari, s’alarma et alla chez Ali-Baba qui partit immédiatement avec ses trois ânes. En arrivant près du rocher, il aperçut une large tache de sang devant la porte. Il prononça les paroles miraculeuses, la porte s’ouvrit et il vit le corps de son frère affreusement dépecé. Il réunit ses restes en deux paquets, qu’il chargea sur un de ses ânes, en les dissimulant avec du bois. Sur les deux autres bêtes, il mit des sacs pleins d’or, et reprit le chemin de la ville.
Il laissa à sa femme le soin de décharger les deux ânes qui portaient l’or et conduisit le troisième chez sa belle-sœur. Il fut reçu par Morgiane, une
esclave adroite et ingénieuse.

— Morgiane, lui dit-il, ces deux paquets renferment le corps de ton maître, et cependant il faut que nous le fassions enterrer comme s’il était mort de sa belle mort.
L’esclave alla aussitôt chez un apothicaire, pour chercher une certaine tablette au pouvoir souverain dans les maladies les plus dangereuses.
— Qui donc est souffrant chez votre maître ? demanda l’apothicaire.
— Hélas, répondit-elle, en soupirant profondément, c’est mon bon maître, Kassim lui-même, il ne parle plus, ne mange plus, et personne ne comprend rien à sa maladie !
Le lendemain, Morgiane revint chez ce même apothicaire et demanda un remède qu’on ne donne qu’aux mourants. D’autre part, on vit Ali-Baba et sa femme aller et venir de leur maison à la maison de Kassim, et leur attitude décelait une grande affliction. On ne fut donc pas surpris outre mesure, vers le soir, en entendant les cris lamentables de la femme de Kassim et surtout de Morgiane, qui faisaient connaître ainsi la mort de leur maître.
À l’aube du jour suivant, l’esclave alla trouver un vieux savetier, Baba-Mustafa, dont la boutique était toujours ouverte avant toutes les autres, et le conduisit chez Kassim, après lui avoir bandé les yeux à mi-chemin. Elle ne retira le mouchoir que dans la chambre où gisait la dépouille de
son maître.

— Baba-Mustafa, dit-elle alors, je vous ai amené ici pour coudre les quatre pièces que voilà. Dépêchez-vous, quand vous aurez terminé, je vous donnerai trois pièces d’or.
Quand le travail fut achevé, elle recommanda à Baba-Mustafa de garder le secret, lui rebanda les yeux et l’accompagna jusqu’à l’endroit où elle lui avait mis le mouchoir en l’amenant. Là, elle ôta le bandeau et laissa aller le vieillard.
Le corps de Kassim fut enseveli avec le cérémonial habituel et, quelques jours plus tard, Ali-Baba s’installa dans la maison de son frère.

Quand les quarante voleurs revinrent à leur repaire, ils furent désagréablement surpris en s’apercevant que le corps de Kassim avait disparu et que le nombre de leurs sacs avait sensiblement diminué.
— Le voleur que nous avons châtié n’était pas le seul à connaître notre secret, dit le chef des brigands. Il faut donc qu’après avoir exécuté l’un nous exécutions l’autre. La mort étrange de celui que nous avons exterminé n’a pas dû passer inaperçue dans la ville, il faudrait donc recueillir les bruits qui circulent à ce sujet, savoir le nom de notre victime et connaître sa demeure. Celui de vous qui se chargera de cette tâche délicate devra se soumettre à la peine de mort, dans le cas où il commettrait une erreur capable de causer notre ruine à tous.
Aussitôt l’un des brigands s’avança et se déclara prêt à entreprendre cette enquête. Il se déguisa et gagna la ville, où il entra au petit jour. Une seule boutique était ouverte, celle de Baba-Mustafa ; il s’y présenta à tout hasard.
— Brave homme, dit-il après lui avoir souhaité le bonjour, vous vous mettez au travail de bien bonne heure… Cependant vos yeux ne doivent plus être assez bons pour que vous puissiez coudre !
— Il n’y a pas bien longtemps, répondit le savetier, j’ai cousu un mort en un endroit où il ne faisait pas beaucoup plus clair qu’en ce moment-ci !
Persuadé qu’il était en bonne voie, le voleur tira une pièce d’or de sa poche et, la remettant à Baba-Mustafa, le pria de lui indiquer dans quelle maison il avait cousu le mort.
— Cela m’est impossible, dit Baba-Mustafa, pour la bonne raison qu’on m’a bandé les yeux, à un certain endroit du chemin ; de là on m’a conduit dans la maison, et l’on m’en a ramené de la même manière.

— Écoutez, reprit le voleur ; venez avec moi jusqu’à l’endroit où l’on vous a bandé les yeux. Je vous les banderai à mon tour, et sans nul doute, vous vous souviendrez alors des tours et des détours qu’on vous fit prendre. Voici d’ores et déjà une autre pièce d’or.

Baba-Mustafa ne put résister à la tentation et conduisit le voleur devant la maison de Kassim, qui appartenait maintenant à Ali-Baba. Le brigand traça hâtivement une marque à la craie sur la porte, puis, retirant le mouchoir qui bandait les yeux du savetier :
— Sais-tu qui habite en cette maison ?
— Je ne suis pas du quartier, répondit Baba-Mustafa, et ne puis par conséquent vous renseigner…
Le voleur remercia le vieillard et ils se séparèrent. Presque aussitôt, Morgiane sortit de la demeure d’Ali-Baba. Elle aperçut la marque tracée sur la porte.
— Qu’est-ce que cela signifie ? pensa-t-elle. Dans quel but a-t-on fait cette marque ? En tout cas on ne saurait prendre trop de précautions.
Toujours avisée, elle marqua de la même façon et au même endroit, avec de la craie, les deux ou trois portes qui précédaient et suivaient celle de la maison d’Ali-Baba, et qui étaient absolument semblables. Elle n’en parla ni à son maître, ni à sa maîtresse.
Pendant ce temps, le voleur avait rejoint sa troupe dans la forêt et sans

perdre de temps ils entrèrent dans la ville. Le chef des voleurs, guidé par celui qui avait dirigé l’enquête, arriva devant la première porte marquée par Morgiane.
— C’est ici ! dit-il à son maître.
Mais comme ils continuaient à chevaucher, afin de ne pas attirer l’attention sur eux, le chef fit remarquer à son sous-ordre que les quatre ou cinq portes suivantes portaient la même marque.

— Pourtant, capitaine, je n’en ai marqué qu’une seule ! Malheureusement, il m’est impossible de la distinguer des autres.
L’entreprise ayant avorté, les quarante voleurs revinrent dans la forêt ; séance tenante, le conducteur de l’enquête eut la tête tranchée. Aussitôt l’un d’eux proposa de reprendre la tâche de celui qui venait de périr, et il s’en fut à la ville.
Tout se passa de la même manière que la première fois : il corrompit Baba-Mustafa, qui le conduisit à la demeure d’Ali-Baba. Comme son prédécesseur, il fit une marque à la porte mais, au lieu d’employer de la craie, il la traça au crayon rouge et dans un endroit moins apparent.
Comme la veille, Morgiane sortit de la maison quelques instants après et, quand elle y rentra, la marque rouge frappa sa vue. Elle s’empressa d’aller marquer les portes voisines.
La tentative des brigands échoua de nouveau, et ils se retirèrent dans la forêt où le voleur qui avait commis la méprise subit le même châtiment que son camarade.
Le chef de la bande résolut alors de conduire lui-même l’enquête. Quand Baba-Mustafa l’eut amené devant la maison d’Ali-Baba, il l’examina si minutieusement qu’il fut bien sûr de la reconnaître.
Ses hommes l’attendaient dans la grotte. Il les chargea d’acheter dix-neuf mulets et trente-huit outres dont une seule remplie d’huile. Dans chacune des trente-sept outres vides frottées d’huile à l’extérieur, afin que personne ne doutât qu’elles ne fussent pleines, le chef fit entrer un des voleurs et conduisit le convoi tout droit à la maison d’Ali-Baba. Justement celui-ci prenait le frais à sa porte, après le dîner.
— Seigneur, lui dit-il, j’arrive de bien loin avec ce chargement d’huile que j’irai vendre demain au marché. Il est tard, je ne sais où me loger et je vous serais très obligé, si cela ne vous dérange pas trop, de vouloir bien me recevoir chez vous !

— Entrez ! répondit Ali-Baba sans hésitation, soyez le bienvenu.
Il commanda à un de ses esclaves de mettre les mulets à l’abri. Ensuite, il pria Morgiane de préparer à souper pour son hôte, et lui tint même compagnie tout le long du repas. Le dîner terminé, Ali-Baba alla à la cuisine et dit à Morgiane :
— Demain j’irai au bain avant le jour, fais-moi donc un bon bouillon, que je prendrai à mon retour !
Pendant ce temps, le chef des brigands s’était glissé dans la cour.
— Lorsque je jetterai des petites pierres de la chambre où je suis logé, dit-il tout bas à chacun, vous fendrez l’outre du haut en bas avec le couteau dont vous êtes armés. Vous en sortirez aussitôt…
Quant à Morgiane, elle mit le pot-au-feu pour faire le bouillon. Elle était en train de l’écumer, quand la lampe s’éteignit ; elle s’aperçut que sa provision d’huile était épuisée, ainsi que la chandelle. Elle résolut de prendre un peu d’huile dans l’une des outres de l’hôte de son maître.
Elle alla dans la cour et s’approcha du premier récipient ; mais elle demeura stupéfaite en entendant une voix étouffée qui demandait :
« Est-ce le moment ? »
Morgiane s’aperçut que cette question partait de l’intérieur de l’outre ; et, sans perdre sa présence d’esprit, elle répondit tout bas : « Non, pas encore… mais bientôt ! » À chaque outre elle reçut la même question et fit la même réponse. Quand elle fut à la dernière — la seule qui fût pleine d’huile — elle en emplit son vase et revint à la cuisine, persuadée que son maître avait donné asile à trente-huit voleurs.
Elle ralluma sa lampe, prit une grande chaudière et retourna dans la cour pour l’emplir d’huile à son tour. Puis elle la mit sur un grand feu, afin que le liquide bouillît rapidement et, dans chacune des outres contenant un voleur, elle versa l’huile toute bouillante, leur enlevant ainsi la vie sans qu’ils eussent le temps de se défendre.
Elle accomplit cela sans faire le moindre bruit, après quoi elle éteignit sa lampe et se posta à la fenêtre de la cuisine, pour observer ce qui allait se passer. Elle n’était pas là depuis un quart d’heure que le chef des voleurs donna le signal convenu en jetant des petites pierres. Ne percevant aucun bruit, il se précipita dans la cour, et, approchant des outres, une odeur d’huile chaude et de brûlé lui saisit les narines. Il comprit que son entreprise venait d’échouer une fois encore et qu’il n’avait plus qu’à fuir.
Au retour du bain, Ali-Baba ne manqua pas de se trouver surpris en voyant les outres d’huile dans la cour. Morgiane raconta alors à son maître ce qu’elle avait fait pendant la nuit, et le mit au courant des marques tracées sur la porte.
— Tout ceci, dit-elle en terminant, est l’œuvre des brigands de la forêt… Ce que je ne m’explique pas, c’est qu’il en manquait deux… Il faut donc vous méfier encore…
— Morgiane, répartit Ali-Baba, je n’oublierai jamais que je te dois la vie… Et, en attendant, je t’affranchis de l’esclavage !

Aidé par Morgiane, Ali-Baba creusa au bout de son jardin une fosse immense, dans laquelle il enterra les corps des trente-sept voleurs, afin de ne pas éveiller l’attention de ses voisins ; puis il cacha les outres et les armes et fit vendre les mulets sur divers marchés.

Cependant le chef des voleurs ne se tint pas pour battu, et, de retour à la grotte, songea aux nouveaux moyens qu’il allait employer pour se débarrasser d’Ali-Baba. Dès le lendemain, il revint à la ville et se logea dans un khan (bazar), où il transporta de riches étoffes et des toiles fines qu’il trouva dans son repaire de la forêt. Puis il loua une boutique vis-à-vis de celle occupée naguère par Kassim et actuellement par le fils d’Ali-Baba.
Le chef des voleurs qui se faisait appeler Khodjah Houssain, ne tarda pas à se lier avec le jeune homme. Il poussa l’amabilité jusqu’à lui faire des cadeaux et des invitations. Le fils d’Ali-Baba se crut naturellement obligé de lui rendre ses politesses. Il consulta son père, qui lui dit de s’arranger pour faire le lendemain une promenade avec Khodjah Houssain et, au retour, de l’inviter à prendre place à sa table, ce qu’il fit, mais Houssain refusa de rester à souper, prétextant qu’il ne mangeait aucun mets salé.
— Qu’à cela ne tienne, reprit Ali-Baba, je vais donner les ordres nécessaires. Et il s’esquiva pour donner de nouveaux ordres à Morgiane.
Celle-ci ne cacha pas son mécontentement et se promit bien de connaître cet homme qui ne mangeait pas de sel. Dans ce but, elle aida Abdallah, l’esclave d’Ali-Baba, à porter les plats sur la table et elle reconnut tout de suite, malgré son déguisement, le chef des quarante voleurs, qui dissimulait un poignard sous son habit.

Je m’explique, maintenant, pourquoi le misérable ne veut pas manger de sel avec mon maître [1], il médite quelque mauvais coup… Heureusement, je suis là pour l’empêcher d’accomplir son dessein ! se dit Morgiane.
Elle se vêtit d’un costume de danseuse, et noua autour de sa taille une ceinture d’argent doré, où elle passa un poignard et, accompagnée d’Abdallah avec son tambour basque, pénétra dans la salle et exécuta plusieurs danses. Pour terminer, elle tira le poignard de sa ceinture et imagina des figures d’une diversité surprenante, feignant tour à tour de vouloir frapper un invisible spectateur.
Enfin, elle prit de la main gauche le tambour de basque des mains d’Abdallah, et le présenta à Khodjah tandis que, dans sa main droite, elle tenait le poignard. Khodjah Houssain avait déjà tiré sa bourse et se préparait à l’ouvrir quand Morgiane, en possession de tout son courage lui enfonça le poignard dans le cœur, si profondément que la mort fut instantanée.

Dégrafant l’habit de Khodjah Houssain, elle montra à Ali-Baba le poignard dont il était armé.
— Comprenez-vous, maintenant, pourquoi votre hôte refusa de manger du sel avec vous ? Et ne reconnaissez-vous pas en lui le faux marchand d’huile, le chef des quarante voleurs ?
— Morgiane, répliqua Ali-Baba, je t’ai promis une récompense digne de tes bienfaits : je te choisis pour belle-fille !
Le fils d’Ali-Baba consentit volontiers à épouser Morgiane, et leurs noces furent célébrées quelques jours après.
Le faux Khodjah Houssain fut enterré secrètement dans la fosse qui contenait les corps de ses trente-sept complices.
Ali-Baba, ignorant toujours ce qu’étaient devenus les deux voleurs qui complétaient la bande, se garda de retourner à la grotte enchantée. Cependant, au bout d’un an, il entreprit le voyage en s’entourant de mille précautions. Il se présenta devant la porte et prononça le : « Sésame, ouvre-toi » ; aussitôt la porte s’ouvrit et un coup d’œil lui suffit pour se rendre compte que personne n’était entré depuis la mort du chef des brigands.
Et c’est ainsi que, de père en fils, dans la famille d’Ali-Baba, on se transmit le secret de ce fabuleux trésor, grâce auquel lui et ses descendants vécurent dans le luxe et la splendeur.

- ↑ En effet, il est une tradition chez les Arabes et les Musulmans qui veut qu’on ne mange pas de sel avec ses ennemis.
Les deux frères – Chapitre I
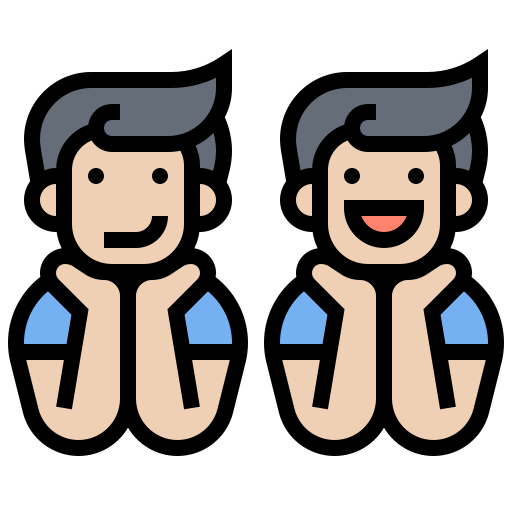
Un conte des frères Grimm développé par Alexandre Dumas. Illustration de Stanisław Wyspiański (1896)
Il y avait une fois deux frères, l’un riche et l’autre pauvre.
Celui qui était riche était orfèvre et avait le cœur aussi dur que la pierre sur laquelle il touchait son or.
Celui qui était pauvre gagnait sa vie à faire des balais ; celui là était bon et honnête.
Le pauvre avait deux enfants, deux fils ; le riche n’en avait pas.
Ces deux fils étaient jumeaux et se ressemblaient au point que, dans leur enfance, leurs parents avaient dû adopter un signe pour les reconnaître.
Ils allaient et venaient souvent dans la maison du riche, et ils attrapaient parfois quelques miettes de sa table.
Or, il arriva que le pauvre, allant un jour au bois pour chercher de la bruyère, vit un oiseau d’or si beau, que jamais il n’en avait vu de semblable.
Il ramassa une pierre, la lui jeta, et atteignit l’oiseau. Mais, comme il l’avait atteint au bout de l’aile, et au moment où l’oiseau étendait cette aile pour s’envoler, il n’en tomba qu’une plume. Seulement, cette plaine était d’or.
Le pauvre faiseur de balais la ramassa et la porta chez son frère, qui l’examina, la toucha à la pierre d’épreuve, et dit :
— Elle est d’or pur, sans aucun alliage !
Et il lui donna beaucoup d’argent pour sa plume.
Le lendemain, le pauvre grimpa sur un bouleau pour en couper quelques brandies. Mais voilà que le meme oiseau qu’il avait vu la veille s’envola une seconde fois.
Alors il chercha soigneusement dans l’arbre et trouva son nid, lequel contenait un œuf qui était d’or, comme l’oiseau.
Il emporta cet œuf à la maison et le montra à son frère, qui lui dit encore :
— C’est de l’or pur et sans aucun alliage !
Et il lui en donna scrupuleusement la valeur ; seulement, il lui dit :
— Je voudrais bien avoir l’oiseau lui- même ; je t’en donnerais un bon prix.
Le pauvre retourna le lendemain au bois et vit l’oiseau d’or perché sur un arbre.
Il prit une pierre, le visa de son mieux, l’atteignit, et, cette fois, le tua roide.
L’oiseau tomba à terre. Le pauvre faiseur de balais le ramassa et le porta à son frère.
— Tiens, lui dit-il, voilà l’oiseau que tu m’as demandé.
L’orfévre lui en donna vingt pièces d’or.
Le pauvre marchand de balais rentra tout joyeux à la maison ; il avait de quoi vivre pendant un an ; aussi ne fit-il pas un seul balai de toute l’année.
L’orfévre était instruit et rusé ; il connaissait la légende de l’oiseau d’or.
Il appela sa femme et lui dit :
— Fais-moi rôtir l’oiseau d’or et aie soin que rien ne s’en perde. J’ai grande envie de le manger tout entier et à moi tout seul.
L’oiseau , comme vous vous en doutez bien, mes chers enfants, n’était pas un oiseau ordinaire, et celui qui mangeait son foie et son cœur était sûr de trouver, chaque matin en s’éveillant, deux pièces d’or sous son oreiller.
La femme arrangea l’oiseau convenablement, l’embrocha et le fit rôtir.
Or, il arriva que, tandis que l’oiseau rôtissait, la femme ayant été obligée de sortir pour une course nécessaire, les deux enfants du pauvre faiseur de balais vinrent chez leur oncle, entrèrent dans la cuisine et, craignant que l’oiseau de leur oncle ne brûlât, lui firent faire quelques tours de broche.
Et, comme il tomba, pendant un des tours qu’opérait le rôti, deux morceaux de l’oiseau dans la lèchefrite :
— Bon! dit le plus âgé au plus jeune; tout ce qui tombe dans le fossé est pour le soldat.
Alors chacun des deux enfants prit un morceau et le mangea.
Sur ces entrefaites, la femme rentra, et leur vit mâcher quelque chose.
— Qu’avez-vous mangé? leur demanda- t-elle.
— Deux morceaux qui sont tombés de l’intérieur de l’oiseau, lui répondirent-ils.
— C’est le cœur et le foie ! s’écria la femme fort effrayée.
Et, pour que son mari ne devinât rien, elle tua vite un pigeon, et en enferma le cœur et le foie dans l’oiseau d’or.
Dès que l’oiseau fut cuit, elle le porta à l’orfévre, qui le mangea tout entier, sans en rien laisser ; mais, le lendemain matin, lorsqu’il visita son oreiller pour y trouver les deux pièces d’or, à son grand étonnement, il n’y trouva rien de plus que de coutume.
Quant aux deux enfants, ils ignoraient quel bonheur leur était échu en partage. Mais, le lendemain matin du jour où ils avaient mangé, l’un le foie, l’autre le cœur de l’oiseau d’or, ils firent, en se levant, tomber à terre quelque chose qui sonna.
Ils ramassèrent ce qui était tombé, et il se trouva que c’étaient deux pièces d’or. Ils les apportèrent à leur père, qui s’en étonna et dit :
— Comment cela s’est-il fait? Mais quand, le lendemain, ils trouvèrent encore deux autres pièces d’or, puis le lendemain, puis le surlendemain, et ainsi de suite chaque matin, le marchand de balais alla trouver son frère l’orfévre et lui raconta cette étrange histoire.
L’orfévre devina à l’instant même comment la chose avait eu lieu, et que les enfants avaient mangé, l’un le cœur, l’autre le foie de l’oiseau d’or.
Et, pour se venger et parce qu’il était jaloux et cruel, il dit au père :
— Tes enfants sont en rapport avec le démon ; cet or te porterait malheur ; ne les garde donc pas plus longtemps chez toi : après s’être attaqué à eux, Satan s’attaquerait à toi.
— Mais que veux-tu que je fasse de ces deux pauvres innocents, frère ? dit-il à l’orfévre.
— Perds-les dans la forêt. Si le diable n’a rien à faire dans ce qui leur arrive, Dieu saura bien les protéger ; si, au contraire, ils appartiennent à Satan, eh bien, ils débrouilleront leur affaire avec lui.
Quoique ce fût une grande douleur pour lui, le pauvre marchand de balais suivit le conseil de l’orfévre.
Il conduisit ses enfants dans le bois et les abandonna à l’endroit où le fourré était le plus épais.
Bientôt, les deux enfants s’aperçurent que leur père n’était plus là, et, essayant de regagner la maison, reconnurent qu’ils étaient perdus.
Plus ils marchèrent, plus ils s’enfoncèrent dans la forêt.
Ils marchèrent toute la nuit, appelant et criant ; mais la seule réponse qu’ils obtinrent furent les hurlements des loups, le glapissement des renards et les cris des chats-huants.
Le matin, enfin, ils rencontrèrent un chasseur, qui leur demanda :
— A qui appartenez-vous, mes enfants?
— Hélas ! monsieur, répondirent-ils, nous sommes les fils d’un pauvre faiseur de balais, qui n’a pas voulu nous garder dans sa maison parce que, chaque matin, nous trouvions, mon frère et moi, une pièce d’or sous notre oreiller.
— Bon! dit le chasseur, il me semble cependant qu’il n’y a pas grand mal à cela, si toutefois vous restez honnêtes, et que cette pièce d’or ne soit pas cause que chacun de vous couche dans la peau d’un paresseux.
— Monsieur, dirent les deux enfants, nous sommes honnêtes et ne demandons pas mieux que de travailler.
— Eh bien, venez avec moi, dit le brave homme, je serai votre père et vous élèverai.
Et, comme il n’avait pas d’enfants, il les recueillit chez lui et tint la promesse qu’il leur avait faite.
Alors ils apprirent à chasser et devinrent les meilleurs tireurs de tout le canton.
En outre, comme tous les matins chacun des deux jeunes gens trouvait une pièce d’or sous son oreiller, le chasseur mettait soigneusement cette pièce d’or de côté, afin qu’un jour, et au besoin, chacun retrouvât son petit trésor.
Quand ils furent grands, et que leur réputation de chasseurs fut faite, leur père nourricier les emmena un jour avec lui au bois.
— Aujourd’hui, dit-il, chacun de vous va tirer son coup d’honneur, afin que je puisse vous reconnaître chasseurs et vous donner votre liberté.
Et ils allèrent ensemble à l’affût.
Mais ils attendirent longtemps ; le gibier ne se montra point.
Le vieux chasseur regarda en l’air et aperçut toute une longue bande d’oies sauvages volant sous la forme d’un triangle.
— Allons, dit-il à l’aîné, qui se nommait Wilfrid, abats l’oie qui vole à chaque extrémité.
Wilfrid mit en joue, fit feu, et abattit les deux oies indiquées par le père nourricier.
Ainsi il avait fait son coup d’honneur.
Un instant après, une autre bande d’oies se montra : elle volait sur une seule ligne.
— A ton tour, dit le père nourricier en s’adressant au cadet, qui se nommait Gottlieb, abats-moi la première et la dernière de ces oies. Et Gottlieb fît deux fois feu, et à chaque fois abattit l’oie désignée.
Lui aussi avait fait son coup d’honneur.
Le père nourricier dit aux deux frères :
— Vous avez terminé votre apprentissage de chasseurs, vous êtes libres.
Les deux jeunes gens alors s’écartèrent de leur père nourricier et échangèrent quelques mots à voix basse.
Puis ils revinrent avec lui à la maison.
Mais, quand le soir fut venu, et qu’on les appela pour souper, Wilfrid, prenant la parole en son nom et en celui de son frère, dit au vieux chasseur :
— Père, nous ne toucherons à aucun aliment avant que vous nous avez accordé une demande.
— Et quelle est cette demande? fit le vieux chasseur.
Wilfrid répondit :
— Voilà que, de votre aveu, nous avons fait notre apprentissage de chasseurs. Nous voulons maintenant voir le monde ; permettez-nous donc, à mon frère et à moi, de partir et de voyager.
Le vieillard eut à peine entendu ces paroles, qu’il s’écria joyeusement :
— Vous parlez comme de vrais chasseurs, et ce que vous désirez a été mon propre souhait. Partez donc, et je vous prédis qu’il vous arrivera bonheur.
Alors ils burent et mangèrent joyeusement. Quand le jour désigné pour le départ fut arrivé, le vieux chasseur donna à chacun de ses fils adoptifs un bon fusil à deux coups, et lui dit de prendre dans le trésor commun autant de pièces d’or qu’il voudrait.
Puis il les accompagna un bout de chemin; mais, arrivé à l’endroit où il était décidé à les quitter, il leur donna, avant de prendre congé d’eux, un beau couteau dont la lame était brillante et sans aucune tache, et leur dit :
— Si vous devez vous séparer un jour, mes chers enfants, enfoncez ce couteau dans un arbre, à l’endroit où les routes se sépareront, et, quand l’un de vous reviendra par ce chemin, il pourra voir comment les choses auront été pour son frère, car, si l’un des deux est mort, le côté de la lame tourné vers la route que celui-là aura suivie sera tout rouillé, tandis qu’au contraire, tant que vous vivrez tous deux, la lame restera pure et brillante.
Wilfrid prit le couteau ; puis tous deux embrassèrent leur père nourricier et continuèrent leur route.
Le soir, ils arrivèrent à une forêt si grande, qu’ils n’eurent pas même l’idée de chercher à la traverser le même jour. Ils s’assirent donc au pied d’un arbre, mangèrent ce qu’ils avaient apporté dans leur carnier et dormirent à la belle étoile.
Le lendemain, ils se remirent en marche; mais ils eurent beau ne point s’arrêter de la journée, le soir, vers cinqheures, ils n’étaient pas encore arrivés à l’extrémité de la forêt.
Ce jour-là, comme les carniers étaient vides, l’un dit à l’autre :
— Il faut nous décider à tuer un animal quelconque pour nous nourrir, ou nous allons passer une mauvaise nuit.
Il chargea alors son fusil, et, battant les broussailles du pied , il en fit sortir un lièvre.
Il mit le lièvre en joue et allait tirer, quand le lièvre lui cria :
— Mon bon chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai deux levrauts.
C’était un peu lâcher la réalité pour l’ombre; mais enfin le jeune homme se fia à la parole du lièvre, qui rentra dans le bois, et, un instant après, lui ramena, en effet, deux jeunes lièvres.
Mais ils étaient si gentils et jouaient si gracieusement ensemble, que les chasseurs ne purent se décider à les tuer ; ils les gardèrent donc près d’eux, et les levrauts reconnaissants, les suivirent, marchant sur leurs talons, comme deux chiens.
Cependant il fallait manger, et, quoique les deux jeunes gens eussent un peu calmé leur faim avec quelques glands doux, l’un d’eux, ayant fait lever un renard, le mit en joue.
Mais le renard lui cria :
— Oh ! mon bon chasseur, laisse-moi la vie et je te donnerai deux renardeaux.
Le chasseur pensa que deux renardeaux seraient meilleurs à manger qu’un vieux renard. Il lui fit signe, en abaissant son fusil, qu’il consentait à l’échange, et, un instant après, le renard lui amena deux petits.
Mais, au moment de les tuer, le cœur manqua aux jeunes chasseurs, et ils les donnèrent pour compagnons aux deux levrauts, se contentant pour leur souper de quelques châtaignes, qu’ils abattirent d’un arbre.
D’ailleurs, ils étaient bien décidés à tuer le premier animal qu’ils rencontreraient.
Ce premier animal fut un loup.
Un des deux jeunes gens allait le tuer, en effet, quand le loup lui cria :
— Oh ! mon bon chasseur, laisse-moi la vie, et je te donnerai deux louveteaux.
Les jeunes gens acceptèrent l’échange, et les deux louveteaux furent adjoints aux deux levrauts et aux deux renardeaux qui les suivaient déjà.
Vint ensuite un ours, qui, se voyant menacé, cria en toute hâte, comme les autres :
— Oh ! mon bon chasseur, laisse-moi la vie, et je te donnerai deux oursons.
Les deux oursons furent amenés et mis avec les autres animaux ; et, comme non-seulement ils étaient les plus forts, mais encore qu’ils avaient l’air grand et raisonnable, ils furent chargés par les jeunes gens de veiller sur les autres.
A peine venaient-ils de leur faire cette recommandation et entraient-ils en fonctions, qu’un lion s’avança vers eux en rugissant et en secouant sa crinière; mais, sans se laisser effrayer par ces menaces, les deux chasseurs le mirent en joue, et leurs deux coups allaient n’en faire qu’un, lorsque le lion, voyant à qui il avait affaire, leur cria :
— Mes bons chasseurs, laissez-moi la vie, et je vous donnerai deux lionceaux.
Et il alla chercher ses lionceaux, de sorte que les chasseurs avaient deux lions, deux ours, deux loups, deux renards et deux lièvres, qui les suivaient et qui les servaient. Seulement, ne trouvant que très-peu de chose à manger dans cette forêt, et ayant de plus en plus faim, ils dirent aux deux renards :
— Voyons, vous autres qui êtes des rusés, pouvez-vous nous donner quelque chose à manger ?
Les renards se consultèrent, et, après s’être consultés :
— Tout près d’ici, dirent-ils, il y a un village d’où notre père et notre mère nous apportaient des poules ; nous allons vous en montrer le chemin.
Les renards montrèrent donc le chemin du village aux deux frères ; ceux-ci y achetèrent de quoi manger, et firent aussi donner la pitance à leurs bêtes, puis ils se remirent en route.
Les renards connaissaient, aux environs, une foule de bons poulaillers, et pouvaient les indiquer aux jeunes chasseurs, qui, de ce moment, grâce aux renards, n’eurent plus à souffrir de la faim.
Ils voyagèrent ainsi pendant quelque temps, offrant leurs services aux grands seigneurs dont les châteaux se trouvaient sur leur chemin ; mais partout on leur disait :
— Nous avons besoin d’un chasseur, mais non pas de deux.
Ils résolurent donc de se séparer.
Ils se partagèrent les animaux de manière que chacun eût un lion, un ours, un loup, un renard et un lièvre ; après quoi, ils se dirent adieu, se jurant une amitié fraternelle jusqu’à la mort.
Mais, avant de se séparer, ils plantèrent dans un arbre le couteau que leur avait donné leur père nourricier, et Wilfrid prit vers l’orient et Gottlieb vers l’occident. Suivons Gottlieb, le plus jeune des deux, et dont le nom, mes chers enfants, veut dire aimé de Dieu.
Les deux frères – Chapitre II
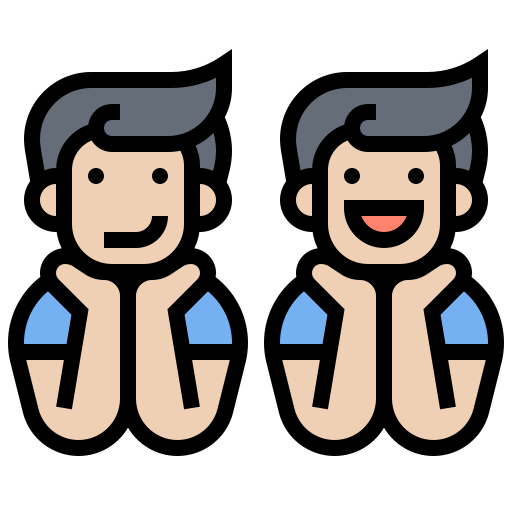
Si vous n’avez pas lu le chapitre I, cliquez ici
Gottlieb arriva bientôt, avec son lion, son ours, son loup, son renard et son levraut, dans une grande ville qui était toute tendue de noir. Il demanda au premier venu de lui indiquer une auberge, et le premier venu lui indiqua l’auberge de la Corne-du-Cerf, ce qui était une bien mauvaise désignation, mes chers enfants, attendu qu’on ne dit pas la corne d’un cerf, mais le bois d’un cerf. Il alla donc à la Corne-du-Cerf, prit une chambre pour lui et une écurie pour ses bêtes, qui avaient l’habitude de vivre en bonne amitié les unes avec les autres, et couchaient d’habitude sur la même paille, comme si elles eussent toutes été de la même espèce.
L’aubergiste lui donna une bonne chambre pour lui, mais il ne lui restait pour ses animaux qu’une écurie qui avait un trou pratiqué dans le mur. Le lièvre y passa le premier. Comme il avait les jambes les plus agiles, c’était lui que, d’habitude, on envoyait en éclaireur. Il est vrai que, comme il était d’un caractère fort timide, il lui prenait souvent des peurs paniques, et qu’il rapportait les nouvelles les plus absurdes. Dans ce cas, on envoyait le renard, qui était plein de ruse et de finesse, et il était rare, quand celui-ci revenait, que l’on ne sût point au juste ce qu’il y avait réellement à craindre ou à espérer.
Cette fois, le lièvre allait tout simplement aux provisions, et rapporta un chou. Le renard y passa à son tour, et rapporta une poule. Le loup, en se faisant petit, suivit le renard et rapporta un agneau. Mais l’ours et le lion ne purent passer, et l’aubergiste leur donna une vieille vache avec laquelle ils purent se rassasier pendant trois jours.
Lorsque Gottlieb eut pourvu à l’entretien de ses bêtes, ce qui était toujours son premier soin, il demanda à l’aubergiste pourquoi la ville était tendue de noir.
— Parce que demain, répondit l’aubergiste, la fille de notre roi doit mourir.
— Est-ce qu’elle est malade à ce point? demanda le jeune homme.
— Non, répondit l’aubergiste; tout au contraire, elle est jeune , fraîche et bien portante ; elle doit mourir, et d’une mort bien cruelle. Et l’aubergiste poussa un gros soupir.
— Comment donc, alors, cela se fait-il ? demanda Gottlieb.
— Là-haut, sur la montagne, répondit l’aubergiste, il y a un dragon à sept têtes, qui, tous les ans, dévore une jeune vierge ; sans quoi, il dévasterait le pays. Et, maintenant, il a mangé toutes les vierges; il ne reste plus que la fille du roi, et, comme il n’y a pas de grâce à attendre du dragon, demain la fille du roi sera exposée, et, après- demain, elle sera morte.
— Mais, demanda le chasseur, pourquoi ne tue-t-on pas le dragon?
— Hélas! dit l’aubergiste, déjà beaucoup de chevaliers l’ont tenté, et ils ont payé cette tentative de leur vie.
— C’est bien, dit Gottlieb, laissez-moi réfléchir un instant à ce que vous venez de me dire. Gottlieb descendit dans l’écurie, assembla son conseil de bêtes, et s’assit, comme président, sur un escabeau.
Lorsqu’il eut exposé la situation, le lion rugit, l’ours grogna, le loup hurla, le renard réfléchit, le lièvre trembla.
Le lion dit :
— Il faut l’attaquer et le mettre en pièces.
L’ours dit :
— Il faut l’attaquer et l’étouffer.
Le loup dit :
— Ce que feront les autres, je le ferai.
Le renard dit :
— Il doit cependant y avoir un moyen de le vaincre sans risquer sa peau.
Le lièvre dit :
— Mon avis est qu’il faut fuir et que le plus tôt sera le mieux. Le chasseur dit au renard :
— Je suis de ton avis ; sors et informe-toi.
Le renard sortit; deux heures après, il rentra. Il avait conféré de l’événement avec le plus vieux renard des environs.
Le vieux renard lui avait dit :
— Je ne saurais indiquer à ton maître un moyen de vaincre le dragon; mais il y a, à mi-chemin de la montagne, une petite chapelle dédiée à saint Hubert, patron des chasseurs. Que ton maître aille y faire sa prière ce soir et y passer la nuit ; peut-être saint Hubert, lui voyant cette dévotion, lui inspirera-t-il quelque bonne idée. Gottlieb remercia le renard et se décida à suivre le conseil de son vieil ami. Le soir venu, sans rien dire de ses intentions, il fit sortir ses animaux de l’écurie et s’achemina avec eux vers la chapelle. Une fois arrivé là, il se mit à genoux et fit sa prière au saint, tandis que les animaux se tenaient respectueusement sur leurs pattes de derrière. Sa prière faite, il se coucha dans un coin et s’endormit.
Alors saint Hubert lui apparut. Il était tout resplendissant de lumière.
— Demain, en t’éveillant, lui dit le saint, tu trouveras sur mon autel trois coupes de cristal: l’une remplie d’un vin rouge comme du rubis, l’autre de vin jaune comme de la topaze, la troisième, enfin, de vin blanc limpide comme du diamant. Quiconque videra ces trois coupes deviendra l’homme le plus fort de la terre, et pourra alors lever la pierre qui est sous le porche de la chapelle, et y prendre le glaive de Goliath, qui y est enfoui. A ce glaive seul est réservé de couper les sept têtes du dragon. Au point du jour, Gottlieb se réveilla. Son rêve était si présent à sa pensée, qu’en ouvrant les yeux il tourna la tête du côté de l’autel. Sur l’autel, où la veille il n’avait rien vu, il vit les trois coupes. Il s’approcha de l’autel , prit les trois coupes l’une après l’autre et les vida. Alors, et au fur et à mesure qu’il vidait les coupes, il lui sembla que la force de tous les hommes de la création entrait en lui, que, comme Hercule, il pourrait lutter avec le lion de Némée, et que, comme Samson, il tuerait mille Philistins avec une mâchoire d’âne.
Aussitôt il s’en alla sous le porche, et reconnut la pierre sous laquelle était enfoui le glaive. Il appela l’ours et le lion.
— Levez donc cette pierre, leur dit-il.
L’ours et le lion se mirent à l’œuvre ; mais ils ne purent même parvenir à l’ébranler.
Alors Gottlieb dit :
— A mon tour.
Et, passant les doigts sous la pierre, il la souleva. Sous cette pierre était un sabre de quatre coudées de long sans compter la poignée, et qui pesait plus de cinq cents livres. Gottlieb le prit et fit avec lui le moulinet aussi facilement qu’il eût fait avec une batte d’arlequin. Dès lors, il ne douta plus qu’il ne remportât la victoire, puisqu’il avait pour lui saint Hubert, le patron des chasseurs, et il monta hardiment au sommet de la montagne.
Cependant, l’heure était venue de livrer la princesse; le roi l’accompagna, avec le maréchal et les courtisans, jusqu’au pied de la montagne. La princesse continua sa route avec le maréchal jusqu’à la chapelle ; là, le maréchal devait rester pour assister au sacrifice, et venir rendre compte au roi. La princesse continua sa route jusqu’au sommet, allant bien à contre-cœur et pleurant à chaudes larmes. En arrivant au haut de la montagne, elle eut grand’peur, car elle crut que le chasseur et ses cinq animaux n’étaient rien autre chose que le dragon qui devait la dévorer. Mais le chasseur, au contraire, s’avançant respectueusement au-devant d’elle, suivi de son lion, de son ours, de son loup, de son renard et de son lièvre, à qui il avait recommandé de faire la plus agréable mine possible.
Il la salua et lui dit :
— Belle princesse, ne craignez rien ni de moi ni des animaux qui me suivent; bien loin de vouloir vous faire du mal, nous sommes venus pour combattre le dragon et vous délivrer.
— Beau chasseur, lui dit la princesse, Dieu vous soit en aide, mais je n’ai pas grand espoir; beaucoup ont déjà essayé ce que vous allez tenter, et tous y ont perdu la vie.
— Eh bien, dit le jeune chasseur encore encouragé par la merveilleuse beauté de la princesse, ou je vous délivrerai, ou je perdrai la vie comme eux ; ce qui fait que je n’aurai pas la douleur de voir périr la plus belle princesse de la terre.
En ce moment, on entendit dans l’air comme une tempête : c’était le battement des ailes du dragon; puis le jour s’obscurcit sous un nuage de fumée, qui n’était rien autre chose que l’haleine du monstre.
— Mettez-vous sous ce chêne, princesse, dit Gottlieb, et, de là, priez Dieu pour votre dévoué serviteur.
La princesse, toute tremblante, alla se mettre sous le chêne : le lièvre la suivit. Les quatre autres animaux, c’est-à-dire le lion, l’ours, le loup et le renard, restèrent près de leur maître. Pendant ce temps, le dragon à sept têtes s’était abaissé peu à peu, et n’était plus qu’à vingt-cinq ou trente coudées de terre. Le chasseur l’attendait, le glaive de Goliath à la main.
Quand le dragon vit Gottlieb, il lui dit :
— Que viens-tu faire sur cette montagne? Je ne te veux point de mal ; va-t’en !
Mais Gottlieb lui répondit :
— Si tu ne me veux point de mal, moi, j’ai juré ta mort, et je viens te combattre ; défends-toi donc.
— Je ne me défends jamais, dit le dragon : j’attaque.
Et, à ces mots, il s’éleva jusque dans les nues, au point qu’il ne paraissait pas plus gros qu’une hirondelle, et, en jetant des flammes par ses sept gueules, il se laissa tomber, rapide comme l’éclair, sur le chasseur, croyant le prendre dans ses griffes et l’enlever en l’air comme un milan enlève un passereau. Mais Gottlieb se jeta de côté, et, du revers de son glaive, il lui abattit une patte. Le dragon jeta un cri de douleur, remonta dans l’air, s’abattit de nouveau, mais sans plus de succès : de son second coup, Gottlieb lui abattit la seconde patte. Trois fois encore, le dragon essaya de la même manœuvre, et, chaque fois, il perdit deux têtes. Enfin, il s’affaiblit à ce point, que, ne pouvant plus s’envoler, il rampa; mais, privé de l’aide de ses pattes, il ne put se garantir de l’attaque de Gottlieb, qui, de deux coups de son glaive, lui coupa encore et la queue et la tête qui lui restaient, Puis, il cria à l’hallali, et livra le cadavre du dragon à ses bêtes pour en faire curée. Elles mirent le dragon en pièces, à l’exception du lièvre, qui n’osait pas plus s’approcher de l’animal mort que de l’animal vivant.
Le combat terminé, le chasseur alla à la belle princesse, qu’il trouva étendue sans connaissance sous le chêne. Elle s’était évanouie de terreur. Le lièvre était près d’elle, les yeux fermés, et, sans le tremblement convulsif qui agitait tout son corps, on eût pu croire qu’il était trépassé. Gottlieb alla à un ruisseau qui coulait près de là, prit de l’eau dans une large feuille de nymphlea, et revint la jeter sur le visage de la princesse. La fraîcheur de l’aspersion fit revenir la princesse à elle.
Le chasseur lui montra le dragon mort et lui dit :
— Vous n’avez plus rien à craindre, princesse, vous êtes délivrée.
La princesse commença par remercier Dieu, qui avait donné à son libérateur la force et le courage ; puis, revenant à Gottlieb, elle lui dit :
— Maintenant, beau chasseur, tu vas être mon époux bien-aimé ; car mon père m’a promise pour femme à celui qui tuerait le dragon. Et, pour récompenser les animaux, elle défit son collier d’émeraudes, qu’elle agrafa autour du cou du lion, ses boucles d’oreilles de diamants qu’elle mit aux oreilles de l’ours, son bracelet de perles qu’elle passa à la patte du loup, et deux bagues d’un grand prix, l’une de saphir, l’autre de rubis, qu’elle donna au renard et au lièvre. Quant au chasseur, elle lui donna son mouchoir de poche encore tout trempé de ses larmes, et aux quatre coins duquel était son chiffre brodé en or. Le chasseur coupa les sept langues du dragon, et les mit dans le mouchoir. Cette opération terminée, comme il était fatigué du combat, il dit à la jeune princesse, non moins brisée par la crainte que lui ne l’était par la fatigue :
— Princesse , nous sommes tellement épuisés tous deux, que nous devrions, pour prendre la force de redescendre jusqu’à la ville, dormir quelques instants.
Elle répondit :
— Oui, mon cher chasseur. Et tous deux s’étendirent à terre côte à côte.
Seulement, avant de s’endormir, le chasseur dit au lion :
— Lion, tu vas veiller à ce que personne ne nous attaque pendant notre sommeil. Entends-tu ?
— Oui, répondit le lion.
La princesse dormait déjà. Le chasseur s’endormit à son tour. Le lion se coucha près d’eux; mais, comme lui-même était très-fatigué, il dit à l’ours :
— Ours, fais-moi le plaisir de veiller à ma place. Je suis si fatigué, que j’ai besoin de dormir un peu. Seulement, au moindre danger, éveille-moi. L’ours se coucha près du lion. Mais il était, de son côté, tellement épuisé par le combat, qu’il appela le loup et lui dit :
— Loup, tu vois que je n’ai pas la force de tenir les yeux ouverts ; si quelque événement survient, réveille-moi. Le loup se coucha près de l’ours, mais ses yeux se fermaient malgré lui ; il fit donc signe au renard de s’approcher.
— Renard, lui dit-il, je meurs de sommeil ; fais bonne garde à ma place, et réveille-moi au moindre bruit. Mais le renard sentit bien qu’il ne pourrait pas faire cette bonne garde qui lui était recommandée, tant sa fatigue était grande. Il appela donc le lièvre et lui dit :
— Lièvre, toi qui ne dors jamais que d’un œil, veille à ma place, je te prie, et, si tu vois quelque chose qui t’inquiète, éveille- moi. Mais le pauvre lièvre avait éprouvé de telles angoisses, qu’il était en réalité le plus fatigué de tous. Aussi la recommandation ne lui eut pas été plus tôt faite qu’il dormait aussi profondément que tous les autres. Ainsi donc le chasseur, la fille du roi, le lion, l’ours, le loup, le renard et le lièvre, étaient profondément endormis, sans personne qui veillât sur eux. Si bien que le maréchal, qui était resté dans la chapelle pour observer, ne voyant pas le dragon enlever la fille du roi dans les airs, et remarquant que tout était tranquille sur la montagne, prit courage et s’avança pas à pas, l’œil au guet, dressant l’oreille et prêt à fuir au moindre danger.
La première chose qu’il aperçut en arrivant au sommet fut le dragon mis en pièces. Alors son regard se porta plus loin. Il vit la fille du roi, le chasseur et ses animaux, tous plongés dans le plus profond sommeil, et, comme le maréchal était un homme plein d’envie et d’ambition, il lui vint à l’instant même dans l’esprit de se faire passer pour le vainqueur du dragon et d’épouser la fille du roi.
Mais, pour en arriver là, il fallait d’abord se débarrasser du véritable vainqueur. Il tira donc son sabre, s’approcha si doucement de Gottlieb, qu’il n’éveilla aucun des animaux, pas même le lièvre, et que, tirant son sabre, il trancha d’un seul coup la tête à Gottlieb.
Puis il réveilla la princesse, qui fut fort effrayée ; mais le maréchal lui dit :
— Tu es dans mes mains, et je vais te couper la tête comme j’ai fait au chasseur, si tu ne me jures pas que tu diras que c’est moi qui ai tué le dragon.
— Je ne puis commettre un si gros mensonge, dit la princesse, car c’est en réalité le chasseur qui a tué le monstre, et ses animaux qui l’ont achevé.
— Tu feras cependant à ma volonté, dit le maréchal en faisant tourner autour de la tête de la princesse son sabre tout sanglant, ou je te coupe en morceaux, et je dis que c’est le dragon qui t’a arrangée ainsi.
La princesse eut si grand’peur, qu’elle jura tout ce que voulait le maréchal.
Ayant donc obtenu ce serment, il la conduisit au roi, qui pensa mourir de joie en revoyant sa chère fille, qu’il tenait pour perdue. Le maréchal dit au roi.
— C’est moi qui ai tué le dragon et délivré non – seulement la princesse, mais l’empire ; je demande donc qu’elle soit ma femme, ainsi que la promesse a été faite sur votre parole sacrée. Le roi se tourna vers sa fille, et, comme le maréchal ne passait point pour un homme courageux :
— Est-ce vrai, ce que raconte le maréchal? lui demanda-t-il.
— Hélas! oui. répondit-elle, il faut bien que cela soit vrai ; seulement, je tiens à ce que le mariage n’ait lieu que dans un an et un jour. Le maréchal insistait pour que le mariage eût lieu tout de suite ; mais la princesse demeura ferme dans son désir, et, comme le maréchal craignait qu’en la brutalisant il ne la poussât à dire tout dans un moment de désespoir, il lui fallut bien passer par ce délai. Quant à la princesse, quoiqu’elle eût vu la tête de son beau chasseur séparée du corps, elle espérait que Dieu, qui avait déjà fait un miracle pour elle, daignerait peut- être en faire un second.
Les deux frères – Chapitre III
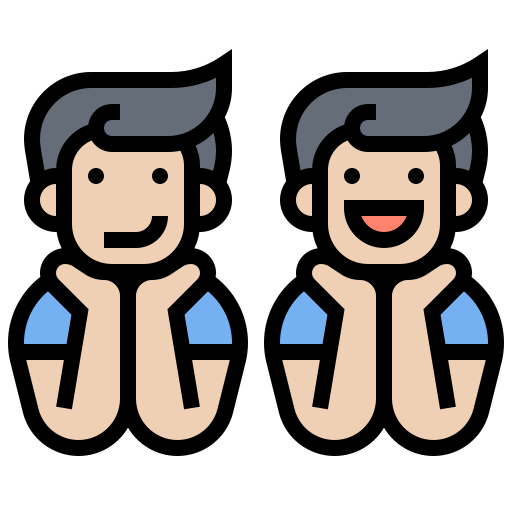
Lire le Chapitre I ou le chapitre II
Cependant, les animaux dormaient toujours sur la montagne du Dragon, autour de leur maître, qui dormait, lui, du sommeil de la mort.
Mais voilà qu’une heure environ après que le maréchal eut commis le crime et emmené la princesse, un gros bourdon vint se poser sur le museau du lièvre. Le lièvre, tout en dormant, passa sa patte sur son museau et chassa l’importun. Mais le bourdon vint une seconde fois se poser à la même place. Lelièvre, avec sa patte, toujours dormant, le chassa une seconde fois. Alors le bourdon revint une troisième fois, et, cette troisième fois, ne se contenta point de le chatouiller avec ses pattes, mais le piqua de son aiguillon. — Ouïff ! fit le lièvre en se réveillant. Une fois réveillé, le lièvre réveilla le renard, le renard réveilla le loup, le loup réveilla l’ours, et l’ours réveilla le lion. Mais, quand le lion vit que la princesse était partie et que son maître avait la tête séparée du corps, il se mit à rugir d’une terrible façon en criant :
— Ours, qui a fait cela? et pourquoi ne m’as-tu pas réveillé ?
— Loup, qui a fait cela? demanda l’ours, et pourquoi ne m’as-tu pas réveillé?
— Renard, qui a fait cela? demanda le loup, et pourquoi ne m’as tu pas réveillé?
— Lièvre, qui a fait cela ? demanda le renard, et pourquoi ne m’as-tu pas réveillé ?
Et, comme le lièvre n’avait personne à interroger, ce fut sur lui que tomba la colère des quatre autres animaux. Tous voulaient le tuer, mais lui prit une posture suppliante et leur dit :
— Ne me tuez pas. Je connais un petit bois, au haut d’une petite colline, dans lequel pousse la racine de vie. Celui à qui l’on met cette racine dans la bouche est guéri de toute maladie et même de toute blessure, et son corps eût-il été séparé en deux tronçons, rien qu’en lui mettant cette racine dans la bouche et en rapprochant les deux tronçons, ils se rejoindraient.
— Où est ce bois? demanda le lion.
— A deux cents lieues d’ici, répondit le lièvre.
— Je te donne vingt-quatre heures pour aller et revenir, dit le lion ; va donc, et rapporte un bon morceau de racine. Le lièvre se mit à courir de toutes ses forces, et, au bout de vingt-quatre heures, il était de retour avec une racine de la longueur et de la forme d’une betrave. Le lion dit à l’ours :
— Toi qui es adroit, rajuste la tête de notre maître, tandis que je le maintiendrai debout, et le lièvre, monté sur les épaules du loup, lui introduira la racine dans la bouche. Les quatre animaux se mirent à l’œuvre avec une grande émotion, car ils aimaient leur maître de tout leur cœur ; aussi furent- ils bien joyeux lorsque, le lièvre ayant introduit la racine de vie dans la bouche de Gottlieb, la tête et le corps se rejoignirent, que le cœur battit et que la vie fut revenue.
Seulement, une dernière crainte leur restait, c’est que la tête n’eût pas bien repris. Le renard chatouilla le nez de Gottlieb avec sa queue, Gottlieb éternua: la tête ne bougea point. L’opération avait donc réussi.
Alors le chasseur demanda à ses animaux ce qu’était devenue la princesse et quel événement était arrivé qui les tenait tous si préoccupés. Les animaux lui racontèrent tout, sans cacher leur faute, que leur dévouement, du reste, venait de racheter. Tout à coup, le lièvre poussa un cri de terreur.
— Maladroit! dit-il à l’ours, qu’as-tu fait ?
L’ours regarda Gottlieb et faillit tomber à la renverse. Il lui avait recollé la tête, mais, dans son émotion, la lui avait recollée à l’envers, de sorte que le pauvre chasseur avait la bouche dans le dos, et la nuque du côté de la poitrine.
Par bonheur, le lion avait recommandé au lièvre de rapporter un bon bout de racine, et le lièvre, comme nous l’avons vu, avait suivi la recommandation. L’ours plaça le sabre de Goliath, qui coupait comme un rasoir, le tranchant en l’air. Le renard, qui était adroit comme un singe, ajusta sur la lame le cou juste à l’endroit où il avait déjà été coupé. Le lion appuya sur la tête, qui se détacha presque sans douleur, et, cette fois, avec plus de précautions que la première, la tête fut rajustée, mais à l’endroit, et, grâce à la racine de vie, se recolla immédiatement.
Mais Gottlieb était triste, et souvent il disait au lion en soupirant :
— Pourquoi n’as-tu pas laissé ma tête et mon corps séparés l’un de l’autre?
Et, en effet, il croyait que c’était la princesse qui, pour ne pas l’épouser, lui avait fait couper le cou pendant son sommeil. Il se mit donc à parcourir le monde, montrant ses animaux, et chacun accourait voir ce lion qui avait un collier d’émeraudes, cet ours qui avait des boucles d’oreilles de diamants, ce loup qui avait un bracelet de perles, et ce renard et ce lièvre qui avaient, l’un une bague de rubis, l’autre une bague de saphir.
Une année passa tout juste, et il était maintenant de retour dans la même ville où il avait délivré la fille du roi du dragon à sept têtes. Seulement, cette fois, toute la ville était tendue d’écarlate.
Il demanda alors à son hôtelier :
— Que signifie cela? Il y a un an, votre ville était tendue de noir, et aujourd’hui elle l’est de rouge. L’aubergiste répondit :
— Vous rappelez-vous qu’il y a un an la fille du roi devait être livrée au dragon?
— Parfaitement, dit Gottlieb.
— Eh bien, le maréchal a combattu et vaincu le monstre, et, demain, on va célébrer son mariage avec la fille du roi ; voilà pourquoi il y a un an la ville était en deuil ; voilà pourquoi aujourd’hui elle est en fête.
Le lendemain, jour de la noce, le chasseur dit à l’aubergiste :
— Voulez-vous parier, mon hôte, qu’aujourd’hui je mangerai du pain de la table du roi?
— Je parie cent pièces d’or que cela ne sera point, répondit l’aubergiste.
Le chasseur tint le pari et déposa un sac contenant la somme pariée; puis il appela le lièvre et lui dit :
— Mon bon petit coureur, va vite me chercher du pain dont le roi mange.
Comme le lièvre était le plus petit et le moins important de la troupe, il ne put charger aucun autre de la commission, et force lui fut de la faire lui-même.
— Aïe, aïe! pensa-t-il, quand je vais courir tout seul par les rues de la ville, tous les chiens des quartiers par lesquels je passerai vont se mettre à mes trousses.
Ce qu’il avait prévu arriva; au bout de cinq minutes de course, il eut à sa queue une véritable meute de chiens de toute espèce, dont l’intention bien visible était de lui entamer la peau. Mais lui courut et sauta si bien, que c’était à peine si on le voyait passer; enfin, poussé à bout, il finit par se glisser dans une guérite si adroitement, que le factionnaire ne s’aperçut pas qu’il n’était plus seul. Les chiens voulurent l’y poursuivre. Mais le factionnaire, ne sachant pas à qui toute cette meute en avait, et croyant que c’était à lui, distribua aux chiens force coups de crosse et même quelques coups de baïonnette. Les chiens se dispersèrent en hurlant.
Dès que le lièvre vit que le passage était redevenu libre, il s’élança hors de la guérite, au grand étonnement du soldat, et, d’un seul saut arrivant au palais, alla droit à la princesse, et, se glissant sous sa chaise, il lui gratta doucement le pied. La princesse crut que c’était son chien favori; mais, comme elle était dans une de ces dispositions d’esprit où tout vous importune :
— Allez-vous-en. Phoenix ! dit-elle, allez- vous-en !
Mais le lièvre gratta de nouveau, et la princesse lui dit encore :
— Veux-tu t’en aller, Phoenix ! Le lièvre continua de gratter. Alors la princesse se pencha et regarda. Le lièvre alors lui montra la patte où était sa bague. La princesse reconnut le rubis qu’elle avait donné au lièvre de son libérateur. Elle prit le lièvre contre sa poitrine et l’emporta dans sa chambre.
— Cher petit lièvre, lui demanda-t-elle, que me veux-tu ?
— Mon maître, qui a tué le dragon, est ici, lui dit-il, et il m’envoie pour chercher un des pains que le roi mange. Toute joyeuse, la princesse fit venir le boulanger, et lui commanda de faire apporter un des pains de la table du roi.
— Mais il faut aussi, dit le lièvre, que le boulanger me rapporte chez mon maître, afin que les chiens ne mangent pas mon pain, et moi avec. Le boulanger prit le lièvre et un des pains du roi dans son tablier et les porta jusqu’à la porte de l’auberge. A la porte de l’auberge, le lièvre prit le pain entre ses pattes de devant, se dressa sur ses pattes de derrière, et porta en sautillant le pain à son maître.
— Voyez, mon hôte, dit le chasseur, les cent pièces d’or sont à moi. Voici le pain que le roi mange, et la preuve, c’est qu’il est à ses armes. L’hôtelier resta tout étonné : mais son étonnement redoubla lorsqu’il entendit le chasseur ajouter :
— J’ai le pain du roi, voilà qui est bien, mais maintenant je veux avoir du rôti du roi.
— Ah! je voudrais bien voir cela ! dit l’aubergiste ; seulement, je ne parie plus. Gottlieb appela son renard et lui dit :
— Mon petit renard chéri, va vite me chercher un peu du rôti dont le roi mange. Maître renard était bien autrement fin que son ami le lièvre ; il s’élança dans une ruelle, prit des chemins détournés, et fit si bien, que pas un chien ne le vit. Il pénétra comme le lièvre dans le palais, comme le lièvre se plaça sous la chaise de la fille du roi, et lui gratta le pied. Elle se pencha et vit le renard entre les bâtons de la chaise, et sa patte où était la bague de saphir que la princesse lui avait donnée. Aussitôt, la princesse l’emmena dans sa chambre, où, à peine entrée, elle lui demanda :
— Mon cher renard, que me veux-tu?
— Mon maître, répondit le renard, celui qui a tué le dragon, est ici, et m’envoie pour vous prier de me donner du rôti que mange le roi.
Elle fit venir le cuisinier, et lui ordonna de mettre dans un panier le renard et un morceau de rôti du roi, et de porter l’un et l’autre jusqu’à la porte de l’auberge, ce qui fut ponctuellement exécuté. Là, le renard prit le plat des mains du cuisinier, en chassa les mouches avec sa queue et l’apporta à Gottlieb.
— Tenez, mon hôte, dit le chasseur, voici déjà le pain et le rôti; maintenant, je vais envoyer chercher des légumes de la table du roi. Appelant alors le loup, il lui dit :
— Mon bon petit loup, va vite au palais, et rapporte-moi des légumes dont le roi mange. Le loup courut tout droit au palais, car lui n’avait pas peur d’etre attaqué. Il entra jusque dans la chambre de la princesse, et, la tirant par sa robe, il la força de se retourner. Elle le reconnut à son bracelet de perles, le caressa, et, comme elle était seule, elle lui dit :
— Mon cher petit loup, que veux-tu?
— Mon maître, répondit le loup, celui qui a tué le dragon, vous fait demander quelques légumes dont mange le roi. Elle fit de nouveau appeler le cuisinier, lui commanda de porter des légumes dont mange le roi jusqu’à la porte de l’auberge. Le cuisinier se mit en route, suivi du loup comme d’un chien. A la porte de l’hôtellerie, il remit le plat au loup, qui le porta à son maître.
— voyez, mon cher hôte, dit Gottlieb, voilà déjà du pain de la table du roi, du rôti de la table du roi, des légumes de la table du roi ; mais mon dîner restera incomplet si je n’ai pas des friandises dont mange le roi. Et, appelant son ours :
— Mon petit ours, lui dit-il, toi qui te connais si bien en miel, en bonbons et en gâteaux, va au palais et apporte-moi quelque bonne friandise de la table du roi. L’ours partit au petit trot, se cachant encore moins que le loup; car, bien loin d’être inquiété par qui que ce fût, il faisait fuir tout le monde sur son passage. Arrivé à la porte du palais, la sentinelle croisa la baïonnette devant lui, refusant de le laisser entrer dans le palais ; et, comme l’ours insistait en grognant, la sentinelle appela le poste. Mais l’ours se dressa sur ses pattes de derrière et distribua tant et de si vigoureux soufflets à droite et à gauclie, que les soldats du poste roulèrent pêle-mêle à terre ; après quoi, l’ours entra tranquillement, vit la princesse, se plaça derrière elle et grogna d’une façon tout à fait gentille. La princesse se retourna à ce grognement, qu’elle se souvenait avoir déjà entendu quelque part, et reconnut l’ours à ses boucles d’oreilles en diamant. Elle le conduisit alors dans sa chambre et lui dit :
— Mon gentil petit ours, que me veux-tu?
— Mon maître, dit l’ours, celui qui a tué le dragon, m’envoie ici, et vous prie de lui donner des sucreries dont mange le roi. La princesse fit venir le confiseur, et lui ordonna de porter jusqu’à la porte de l’hôtel un plateau couvert de sucreries de la table du roi. Arrivé là, l’ours commença de ramasser du bout de la langue tous les bonbons qui étaient tombés à terre, puis, se dressant debout, prit le plateau et le porta à son maître.
— Ali ! ali ! monsieur l’aubergiste , dit Glottlieb, voici nos friandises qui arrivent. J’ai donc maintenant du pain, du rôti, des légumes et du dessert de la table du roi ; maintenant, il me faudrait du vin dont le roi boit; car je ne saurais manger toutes ces bonnes choses sans boire. Il appela donc son lion et lui dit :
— Mon bon petit lion, va au palais et apporte-moi du vin dont le roi boit à sa table. Le lion se mit aussitôt en route pour aller au palais; à sa vue, chacun commença de se sauver à toutes jambes, les boutiquiers fermèrent leurs boutiques et toutes les portes furent closes. Lorsque le lion parut devant le palais, tout le poste prit les armes et voulut l’empêcher d’entrer ; mais le lion poussa un seul rugissement, et tout le poste prit la fuite. Il entra donc au palais sans empêchement, arriva à la porte de la tille du roi, et frappa avec sa queue ; la princesse vint ouvrir et fut d’abord si effrayée, à la vue du lion, qu’elle recula ; mais elle le reconnut bientôt au collier d’émeraudes qu’il portait au cou et qui venait d’elle ; elle le fit entrer et lui dit :
— Mon cher lion, que veux-tu ?
— Mon maître, répondit le lion, celui qui a tué le dragon, m’envoie à vous pour vous prier de lui envoyer du vin dont boit le roi. La princesse fit aussitôt venir le sommelier, et lui dit d’aller à la cave tirer du vin du roi, et de le porter jusqu’à l’auberge. Le sommelier descendit à la cave ; mais le lion dit :
— Un instant, ami sommelier, je connais les gens de ton espèce, et je descends à la cave avec toi, afin de voir ce que tu vas me donner. Il suivit donc le sommelier à la cave, et comme, arrivé là, le sommelier, croyant le tromper facilement, voulait lui tirer du vin que les domestiques buvaient à l’office, le lion lui dit :
— Hâlte-là, camarade! il faut que je me montre digne de la confiance que mon maître a eue en moi, et que je déguste le vin avant de le lui porter. Il en tira donc un demi-broc et l’avala d’un trait; mais, secouant la tête :
— Ah ! ah ! dit-il, c’est comme cela que tu voulais m’en donner à garder, drôle? D’autre vin, et lestement ! Celui-là est bon pour les domestiques, tout au plus. Le sommelier regarda le lion de travers, mais n’osa rien dire; il le conduisit donc à une autre tonne réservée au maréchal du roi. Mais le lion lui dit :
— Halte-là ! il faut que je déguste. Et il en tira un autre demi-broc, l’avala d’un trait, fit clapper sa langue, et, un peu plus satisfait, dit :
— Il est meilleur que l’autre, mais ce n’est pas encore le vrai.
Là-dessus, le sommelier se fâcha, et dit :
— Que peut comprendre au vin un animal aussi stupide que toi ?
Mais il n’avait pas achevé cette phrase, que le lion lui avait envoyé un coup de queue et l’avait fait rouler à l’autre extrémité du caveau.
Le sommelier se releva, et, sans souffler mot, le conduisit à un petit caveau où était le vin réservé à Sa Majesté, et dont jamais aucune autre personne n’avait bu. Le lion, après avoir bu un demi-broc de vin pour le déguster, hocha la tête de haut en bas, en signe de satisfaction, et dit :
— Oui, en effet, celui-là doit être bon. Il en fit donc remplir six bouteilles; après quoi, il remonta, suivi du sommelier ; mais, quand il fut dans la cour, le grand air agit sur lui, et il commença d’aller tellement de travers, que le sommelier fut obligé de porter le panier jusqu’à l’auberge, dans la crainte que le lion ne cassât les bouteilles ou ne se les laissât voler. Là, le sommelier lui mit le panier dans la gueule, et le lion le porta à son maître. Alors le chasseur dit :
— Voyez, monsieur l’aubergiste, j’ai là du pain, du vin, du rôti, des légumes, du dessert de la table du roi.
Je vais donc dîner comme un roi avec mes bêtes. Et, ce disant, il se mit à table, donnant au lion, à l’ours, au loup, au renard et au lièvre chacun sa part du dîner, et il mangea bien, but bien, étant de joyeuse humeur, car il avait pu reconnaître, à la promptitude qu’elle avait mise à remplir ses souhaits, que la princesse l’aimait toujours. Le repas terminé, il dit à l’aubergiste :
— Monsieur l’aubergiste, maintenant que j’ai mangé et bu de ce que le roi mange et boit, je veux aller au palais et épouser la fille du roi.
— Comment cela se pourrait-il? demanda l’aubergiste. La princesse est déjà fiancée, et, aujourd’hui meme, le mariage doit se célébrer. Alors le chasseur tira de sa poche le mouchoir de la princesse, qui contenait les sept langues des sept têtes du dragon.
— Ce que j’ai là dedans, dit-il à l’aubergiste, m’aidera dans mon projet, si fou qu’il vous paraisse. L’aubergiste ouvrit de grands yeux et dit :
— Je crois volontiers à tout ce que l’on me raconte ; mais, quant à épouser la fille du roi, je parierais bien ma maison et mon jardin que vous ne l’épouserez pas.
Le chasseur prit un sac contenant mille pièces d’or et dit :
— Voici mon enjeu contre votre propriété.
Pendant que ce que nous venons de raconter se passait à l’auberge, le roi, étant à table, dit à sa fille :
— Que te voulaient donc toutes ces bêtes qui sont venues vers toi, sont entrées dans mon palais et en sont sorties?
— Je ne puis le dire, répliqua la princesse; mais envoyez chercher leur maître, vous ferez bien. Le roi envoya aussitôt un de ses domestiques dire au chasseur de venir au palais. Le domestique arriva à l’auberge juste au moment où le chasseur venait de conclure le pari avec l’aubergiste. Alors le chasseur dit à l’aubergiste :
— Tenez, mon cher hôte, voici déjà le roi qui m’envoie un de ses serviteurs pour m’inviter à l’aller voir; mais je ne vais pas voir le roi si facilement. El, se tournant vers le messager :
— Retourne et dis au roi, répondit-il, qu’il veuille bien m’envoyer des habits de gala, une voiture attelée de six chevaux, et une escorte pour me faire honneur. Lorsque cette réponse fut transmise au roi par le messager, le roi demanda à sa fille :
— Que dois-je faire?
— Faites ce qu’il vous demande, répondit- elle, et vous ferez bien. Alors le roi envoya au chasseur des habits de gala, une voiture attelée de six chevaux et une escorte. Lorsque Gottlieb aperçut la voiture royale :
— Tenez, mon hôte, dit-il, voici que l’on vient me chercher comme je le désirais. Et il endossa les habits de gala, monta dans la voiture et se rendit au palais. Lorsque le roi le vit venir, il dit à sa fille :
— Comment dois-je le recevoir?
— Allez au-devant de lui, mon père, dit la princesse; vous ferez bien. Le roi alla donc au-devant du chasseur et l’introduisit dans le palais, lui et ses bêtes. Comme on était en grande assemblée, le roi le fit placer entre lui et sa fille, en face du maréchal ; mais celui-ci ne le reconnut pas, bien qu’il lui eût coupé la tête. Ce fut alors que l’on exposa aux regards des convives les sept têtes du dragon. Le roi dit :
— Ces sept têtes sont celles du dragon que le maréchal a tué; c’est pourquoi, aujourd’hui, je lui donne ma fille en mariage. Alors le chasseur se leva, ouvrit les sept gueules, et dit :
— Voilà bien les sept têtes du dragon, mais où sont les sept langues ?
Le maréchal, qui n’avait pas remarqué l’absence des langues, parce que jamais il n’avait osé ouvrir les gueules du dragon, pâlit, et répondit en balbutiant :
— Les dragons n’ont pas de langue.
Le chasseur regarda fixement le maréchal, et dit :
— Ce sont les menteurs qui n’en devraient pas avoir ; mais les dragons en ont, et ce sont les sept langues du dragon qui sont le témoignage du triomphe du vainqueur.
Et, dénouant le mouchoir que lui avait donné la princesse, il montra les sept langues ; puis, les prenant les unes après les autres. il plaça chacune d’elles dans la gueule à laquelle elle appartenait, et toutes ces langues s’ajustèrent parfaitement. Puis, secouant le mouchoir, il demanda à la princesse si elle se rappelait l’avoir donné à quelqu’un.
— Je l’ai donné à celui qui a tué le dragon, répondit la princesse. Alors le chasseur appela le lion, et lui ôta son collier d’émeraude ; l’ours, et lui ôta ses boucles d’oreilles de diamant; le loup, et lui ôta son bracelet de perles ; le renard et le lièvre, et leur ôta leurs bagues. Puis, montrant tous ces bijoux à la princesse :
— Connaissez-vous ces bijoux? lui demanda-t-il.
— Certainement, répondit la princesse, puisque c’est moi qui les ai partagés entre les animaux qui ont aidé dans sa lutte celui qui a tué le dragon.
— Et quel est celui qui a tué le dragon? demanda enfin Gottlieb.
— C’est vous, répondit la princesse.
— Mais comment cela s’est il fait, que vous ne vous soyez points vanté de la victoire, et que vous n’ayez pas réclamé la main de ma fille? demanda le roi.
— Comme j’étais fatigué, je me suis couché et endormi, répondit Gottlieb, et alors le maréchal est venu et m’a coupé la tête. Puis il a entraîné la princesse et s’est fait passer pour le vainqueur du dragon. Mais le véritable vainqueur, c’est moi, et je le prouve par les langues, le mouchoir et les bijoux.
Puis, comme quelques incrédules s’étonnaient qu’ayant eu la tête coupée par le maréchal, il se portât si bien, il raconta de quelle façon ses animaux l’avaient ressuscité, comment il avait couru le monde pendant un an avec eux, et comment enfin il était revenu dans la capitale du royaume, où il avait appris de son hôte la fourberie du maréchal. Alors le roi demanda à sa fille :
— Est-il vrai que ce soit ce jeune homme qui ait tué le dragon?
— Oui, c’est vrai, répondit celle-ci. J’avais juré, j’ai donc dû me taire ; mais, aujourd’hui que, sans ma participation, l’infamie du maréchal est connue, je puis parler. Oui, ajouta-t-elle en montrant Gottlieb, oui, voilà le vainqueur du dragon, et c’est bien à lui que j’ai donné mon mouchoir, et c’est bien à ses animaux que j’ai donné mes bijoux.
Voilà pourquoi j’avais demandé un an et un jour avant d’épouser le maréchal, espérant que, dans l’espace d’un an et un jour, la lumière se ferait.
Alors le roi assembla un conseil composé de douze conseillers, pour juger le maréchal, lequel fut condamné à être écartelé par quatre boeufs. Le jugement fut exécuté, à la grande satisfaction des sujets du roi, qui détestaient le maréchal. Le roi donna sa fille en mariage au chasseur, et le nomma gouverneur général de tout le royaume. Les noces furent célébrées avec une grande magnificence, et le jeune gouverneur fit venir près de lui son père et son père adoptif.
Il n’oublia pas non plus l’hôtelier , et, l’ayant appelé à la cour, il lui dit :
— Eh bien, mon hôte, voici que j’ai épousé la fille du roi et que, par conséquent, votre jardin et votre maison m’appartiennent.
— Oui, dit l’hôtelier, c’est selon la justice.
— Non, dit le jeune gouverneur, cela sera selon la clémence. Garde ta maison et ton jardin, et, par-dessus le marché, prends encore les mille pièces d’or.
Peut être croyez-vous, mes chers petits enfants, que mon histoire finit ainsi ; détrompez-vous. Plus tard, vous apprendrez une vérité bien triste : c’est que, quand on croit toucher au suprême bonheur, on est souvent près de tomber dans la plus cruelle infortune.
La petite souris grise
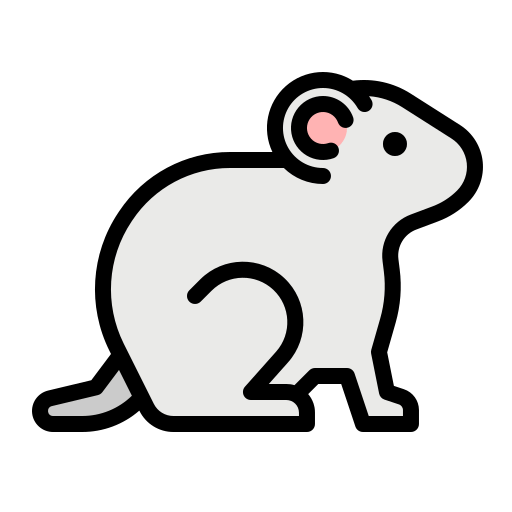
I
LA MAISONNETTE
Il y avait un homme veuf qui s’appelait Prudent et qui vivait avec sa fille. Sa femme était morte peu de temps après la naissance de cette fille, qui s’appelait Rosalie.
Le père de Rosalie avait de la fortune ; il vivait dans une grande maison qui était à lui : la maison était entourée d’un vaste jardin où Rosalie allait se promener tant qu’elle voulait.
Elle était élevée avec tendresse et douceur, mais son père l’avait habituée à une obéissance sans réplique. Il lui défendait d’adresser des questions inutiles et d’insister pour savoir ce qu’il ne voulait pas lui dire. Il était parvenu, à force de soin et de surveillance, à presque déraciner en elle un défaut malheureusement trop commun, la curiosité.
Rosalie ne sortait jamais du parc, qui était entouré de murs élevés. Jamais elle ne voyait personne que son père ; il n’y avait aucun domestique dans la maison ; tout semblait s’y faire de soi-même ; Rosalie avait toujours ce qu’il lui fallait, soit en vêtements, soit en livres, soit en ouvrages ou en joujoux. Son père l’élevait lui-même, et Rosalie, quoiqu’elle eût près de quinze ans, ne s’ennuyait pas et ne songeait pas qu’elle pouvait vivre autrement et entourée de monde.
Il y avait au fond du parc une maisonnette sans fenêtres et qui n’avait qu’une seule porte, toujours fermée. Le père de Rosalie y entrait tous les jours, et en portait toujours sur lui la clef ; Rosalie croyait que c’était une cabane pour enfermer les outils du jardin ; elle n’avait jamais songé à en parler. Un jour qu’elle cherchait un arrosoir pour ses fleurs, elle dit à son père :
« Mon père, donnez-moi, je vous prie, la clef de la maisonnette du jardin.
— Que veux-tu faire de cette clef, Rosalie ?
— J’ai besoin d’un arrosoir ; je pense que j’en trouverai un dans cette maisonnette.
— Non, Rosalie, il n’y a pas d’arrosoir là-dedans. »
La voix de Prudent était si altérée en prononçant ces mots, que Rosalie le regarda et vit avec surprise qu’il était pâle et que la sueur inondait son front.
« Qu’avez-vous, mon père ? dit Rosalie effrayée.
— Rien, ma fille, rien.
— C’est la demande de cette clef qui vous a bouleversé, mon père ; qu’y a-t-il donc dans cette maison qui vous cause une telle frayeur ?
— Rosalie, tu ne sais ce que tu dis ; va chercher ton arrosoir dans la serre.
— Mais, mon père, qu’y a-t-il dans cette maisonnette ?
— Rien qui puisse t’intéresser, Rosalie.
— Mais pourquoi y allez-vous tous les jours sans jamais me permettre de vous accompagner ?
— Rosalie, tu sais que je n’aime pas les questions, et que la curiosité est un vilain défaut. »
Rosalie ne dit plus rien, mais elle resta pensive. Cette maisonnette, à laquelle elle n’avait jamais songé, lui trottait dans la tête.
« Que peut-il y avoir là-dedans ? se disait-elle. Comme mon père a pâli quand j’ai demandé d’y entrer !… Il pensait donc que je courais quelque danger en y allant !… Mais pourquoi lui-même y va-t-il tous les jours ?… C’est sans doute pour porter à manger à la bête féroce qui s’y trouve enfermée… Mais s’il y avait une bête féroce, je l’entendrais rugir ou s’agiter dans sa prison ; jamais on n’entend aucun bruit dans cette cabane ; ce n’est donc pas une bête ! D’ailleurs elle dévorerait mon père quand il y va… à moins qu’elle ne soit attachée… Mais si elle est attachée, il n’y a pas de danger pour moi non plus. Qu’est-ce que cela peut être ?… Un prisonnier !… Mais mon père est bon ; il ne voudrait pas priver d’air et de liberté un malheureux innocent !… Il faudra absolument que je découvre ce mystère… Comment faire ?… Si je pouvais soustraire à mon père cette clef, seulement pour une demi-heure ! Peut-être l’oubliera-t-il un jour… »
Elle fut tirée de ses réflexions par son père, qui l’appelait d’une voix altérée.
« Me voici, mon père ; je rentre. »
Elle rentra en effet et examina son père, dont le visage pâle et défait indiquait une vive agitation. Plus intriguée encore, elle résolut de feindre la gaieté et l’insouciance pour donner de la sécurité à son père, et arriver ainsi à s’emparer de la clef, à laquelle il ne penserait peut-être pas toujours si Rosalie avait l’air de n’y plus songer elle-même.
Ils se mirent à table ; Prudent mangea peu, et fut silencieux et triste, malgré ses efforts pour paraître gai. Rosalie montra une telle gaieté, une telle insouciance, que son père finit par retrouver sa tranquillité accoutumée.
Rosalie devait avoir quinze ans dans trois semaines ; son père lui avait promis pour sa fête une agréable surprise. Quelques jours se passèrent ; il n’y en avait plus que quinze à attendre.
Un matin Prudent dit à Rosalie :
« Ma chère enfant, je suis obligé de m’absenter pour une heure. C’est pour tes quinze ans que je dois sortir. Attends-moi dans la maison, et, crois-moi, ma Rosalie, ne te laisse pas aller à la curiosité. Dans quinze jours tu sauras ce que tu désires tant savoir, car je lis dans ta pensée ; je sais ce qui t’occupe. Adieu, ma fille, garde-toi de la curiosité. »
Prudent embrassa tendrement sa fille et s’éloigna comme s’il avait de la répugnance à la quitter. Quand il fut parti, Rosalie courut à la chambre de son père, et quelle fut sa joie en voyant la clef oubliée sur la table ! Elle la saisit et courut bien vite au bout du parc ; arrivée à la maisonnette, elle se souvint des paroles de son père :
Garde-toi de la curiosité ; elle hésita et fut sur le point de reporter la clef sans avoir regardé dans la maisonnette, lorsqu’elle entendit sortir un léger gémissement ; elle colla son oreille contre la porte et entendit une toute petite voix qui chantait doucement :

Je suis prisonnière,
Et seule sur la terre.
Bientôt je dois mourir,
D’ici jamais sortir.
« Plus de doute, se dit-elle ; c’est une malheureuse créature que mon père tient enfermée. »
Et frappant doucement à la porte, elle dit :
« Qui êtes-vous et que puis-je faire pour vous ?
— Ouvrez-moi, Rosalie ; de grâce, ouvrez-moi.
— Mais pourquoi êtes-vous prisonnière ? N’avez-vous pas commis quelque crime ?
— Hélas ! non, Rosalie ; c’est un enchanteur qui me retient ici. Sauvez-moi, et je vous témoignerai ma reconnaissance en vous racontant ce que je suis. »
Rosalie n’hésita plus, sa curiosité l’emporta sur son obéissance ; elle mit la clef dans la serrure, mais sa main tremblait et elle ne pouvait ouvrir ; elle allait y renoncer, lorsque la petite voix continua :
« Rosalie, ce que j’ai à vous dire vous instruira de bien des choses qui vous intéressent ; votre père n’est pas ce qu’il paraît être. »
À ces mots, Rosalie fit un dernier effort ; la clef tourna et la porte s’ouvrit.
II
LA FÉE DÉTESTABLE
Rosalie regarda avidement ; la maisonnette était sombre ; elle ne voyait rien ; elle entendit la petite voix qui dit :
« Merci, Rosalie, c’est à toi que je dois ma délivrance. »
La voix semblait venir de terre ; elle regarda, et aperçut dans un coin deux petits yeux brillants qui la regardaient avec malice.
« Ma ruse a réussi, Rosalie, pour te faire céder à ta curiosité. Si je n’avais chanté et parlé, tu t’en serais retournée et j’étais perdue. Maintenant que tu m’as délivrée, toi et ton père vous êtes en mon pouvoir. »
Rosalie, sans bien comprendre encore l’étendue du malheur qu’elle avait causé par sa désobéissance, devina pourtant que c’était une ennemie dangereuse que son père retenait captive, et elle voulut se retirer et fermer la porte.
« Halte-là, Rosalie, il n’est plus en ton pouvoir de me retenir dans cette odieuse prison, d’où je ne serais jamais sortie si tu avais attendu tes quinze ans. »
Au même moment la maisonnette disparut ; la clef seule resta dans les mains de Rosalie consternée. Elle vit alors près d’elle une petite Souris grise qui la regardait avec ses petits yeux étincelants et qui se mit à rire d’une petite voix discordante.
« Hi ! hi ! hi ! quel air effaré tu as, Rosalie ! En vérité, tu m’amuses énormément. Que tu es donc gentille d’avoir été si curieuse ! Voilà près de quinze ans que je suis enfermée dans cette affreuse prison, ne pouvant faire du mal à ton père, que je hais, et à toi que je déteste parce que tu es sa fille.
— Et qui êtes-vous donc, méchante Souris ?
— Je suis l’ennemie de ta famille, ma mie ! Je m’appelle la fée Détestable, et je porte bien mon nom, je t’assure ; tout le monde me déteste et je déteste tout le monde. Je te suivrai partout, Rosalie.
— Laissez-moi, misérable ! Une Souris n’est pas bien à craindre, et je trouverai bien moyen de me débarrasser de vous.
— C’est ce que nous verrons, ma mie ; je m’attache à vos pas partout où vous irez. »
Rosalie courut du côté de la maison ; chaque fois qu’elle se retournait, elle voyait la Souris qui galopait après elle en riant d’un air moqueur. Arrivée dans la maison, elle voulut écraser la Souris dans la porte, mais la porte resta ouverte malgré les efforts de Rosalie tandis que la Souris restait sur le seuil.
« Attends, méchante bête ! » s’écria Rosalie, hors d’elle de colère et d’effroi. Elle saisit un balai et allait en donner un coup violent sur la Souris, lorsque le balai devint flamboyant et lui brûla les mains ; elle le jeta vite à terre et le poussa du pied dans la cheminée pour que le plancher ne prît pas feu. Alors, saisissant un chaudron qui bouillait au feu, elle le jeta sur la Souris ; mais l’eau bouillante était devenue du bon lait frais ; la Souris se mit à boire en disant :
« Que tu es aimable, Rosalie ! Non contente de m’avoir délivrée, tu me donnes un excellent déjeuner ! »
La pauvre Rosalie se mit à pleurer amèrement ; elle ne savait que devenir, lorsqu’elle entendit son père qui rentrait.
« Mon père ! dit-elle, mon père ! Oh Souris, par pitié, va-t’en ! que mon père ne te voie pas !
— Je ne m’en irai pas, mais je veux bien me cacher derrière tes talons, jusqu’à ce que ton père apprenne ta désobéissance. »
À peine la Souris était-elle blottie derrière Rosalie, que Prudent entra ; il regarda Rosalie, dont l’air embarrassé et la pâleur trahissaient l’effroi.
« Rosalie, dit Prudent d’une voix tremblante, j’ai oublié la clef de la maisonnette ; l’as-tu trouvée ?
— La voici, mon père, dit Rosalie en la lui présentant et devenant très rouge.
— Qu’est-ce donc que cette crème renversée ?
— Mon père, c’est le chat.
— Comment, le chat ? Le chat a apporté au milieu de la chambre une chaudronnée de lait pour le répandre ?
— Non, mon père, c’est moi qui, en le portant, l’ai renversé. »
Rosalie parlait bien bas et n’osait pas regarder son père.
« Prends le balai, Rosalie, pour enlever cette crème.
— Il n’y a plus de balai, mon père.
— Plus de balai ! Il y en avait un quand je suis sorti.
— Je l’ai brûlé, mon père, par mégarde, en… en… »
Elle s’arrêta. Son père la regarda fixement, jeta un coup d’œil inquiet autour de la chambre, soupira et se dirigea lentement vers la maisonnette du parc.
Rosalie tomba sur une chaise en sanglotant ; la Souris ne bougeait pas. Peu d’instants après, Prudent rentra précipitamment, le visage bouleversé d’effroi.
« Rosalie, malheureuse enfant, qu’as-tu fait ? Tu as cédé à ta fatale curiosité, et tu as délivré notre plus cruelle ennemie.
— Mon père, pardonnez-moi, pardonnez-moi, s’écria Rosalie en se jetant à ses pieds ; j’ignorais le mal que je faisais.
— C’est ce qui arrive toujours quand on désobéit, Rosalie : on croit ne faire qu’un petit mal, et on en fait un très grand à soi et aux autres.
— Mais, mon père, qu’est-ce donc que cette Souris qui vous cause une si grande frayeur ? Comment, si elle a tant de pouvoir, la reteniez-vous prisonnière, et pourquoi ne pouvez-vous pas la renfermer de nouveau ?
— Cette Souris, ma fille, est une fée méchante et puissante ; moi-même je suis le génie Prudent, et puisque tu as délivré mon ennemie, je puis te révéler ce que je devais te cacher jusqu’à l’âge de quinze ans.
« Je suis donc, comme je te le disais, le génie Prudent ; ta mère n’était qu’une simple mortelle ; mais ses vertus et sa beauté touchèrent la reine des fées aussi bien que le roi des génies, et ils me permirent de l’épouser.
« Je donnai de grandes fêtes pour mon mariage ; malheureusement j’oubliai d’y convoquer la fée Détestable, qui, déjà irritée de me voir épouser une princesse, après mon refus d’épouser une de ses filles, me jura une haine implacable ainsi qu’à ma femme et à mes enfants.
« Je ne m’effrayai pas de ses menaces, parce que j’avais moi-même une puissance presque égale à la sienne, et que j’étais fort aimé de la reine des fées. Plusieurs fois j’empêchai par mes enchantements l’effet de la haine de Détestable.
Mais, peu d’heures après ta naissance, ta mère ressentit des douleurs très vives, que je ne pus calmer ; je m’absentai un instant pour invoquer le secours de la reine des fées.
Quand je revins, ta mère n’existait plus : la méchante fée avait profité de mon absence pour la faire mourir, et elle allait te douer de tous les vices et de tous les maux possibles ; heureusement que mon retour paralysa sa méchanceté.
Je l’arrêtai au moment où elle venait de te douer d’une curiosité qui devait faire ton malheur et te mettre à quinze ans sous son entière dépendance.
Par mon pouvoir uni à celui de la reine des fées, je contrebalançai cette fatale influence, et nous décidâmes que tu ne tomberais à quinze ans en son pouvoir que si tu succombais trois fois à ta curiosité dans des circonstances graves.
En même temps, la reine des fées, pour punir Détestable, la changea en souris, l’enferma dans la maisonnette que tu as vue, et déclara qu’elle ne pourrait pas en sortir, Rosalie, à moins que tu ne lui en ouvrisses volontairement la porte ; qu’elle ne pourrait reprendre sa première forme de fée que si tu succombais trois fois à ta curiosité avant l’âge de quinze ans ; enfin, que si tu résistais au moins une fois à ce funeste penchant, tu serais à jamais affranchie, ainsi que moi, du pouvoir de Détestable.
Je n’obtins toutes ces faveurs qu’à grand-peine, Rosalie, et en promettant que je partagerais ton sort et que je deviendrais comme toi l’esclave de Détestable si tu te laissais aller trois fois à ta curiosité.
Je me promis de t’élever de manière à détruire en toi ce fatal défaut, qui pouvait causer tant de malheurs.
« C’est pour cela que je t’enfermai dans cette enceinte ; que je ne te permis jamais de voir aucun de tes semblables, pas même de domestiques.
Je te procurais par mon pouvoir tout ce que tu pouvais désirer, et déjà je m’applaudissais d’avoir si bien réussi ; dans trois semaines tu devais avoir quinze ans, et te trouver à jamais délivrée du joug odieux de Détestable, lorsque tu me demandas cette clef à laquelle tu semblais n’avoir jamais pensé.
Je ne pus te cacher l’impression douloureuse que fit sur moi cette demande ; mon trouble excita ta curiosité ; malgré ta gaieté, ton insouciance factice, je pénétrai dans ta pensée, et juge de ma douleur quand la reine des fées m’ordonna de te rendre la tentation possible et la résistance méritoire, en laissant ma clef à ta portée au moins une fois !
Je dus la laisser, cette clef fatale, et te faciliter, par mon absence, les moyens de succomber ; imagine, Rosalie, ce que je souffris pendant l’heure que je dus te laisser seule, et quand je vis à mon retour ton embarras et ta rougeur, qui ne m’indiquaient que trop que tu n’avais pas eu le courage de résister. Je devais tout te cacher et ne t’instruire de ta naissance et des dangers que tu avais courus le jour où tu aurais quinze ans, sous peine de te voir tomber au pouvoir de Détestable.
« Et maintenant, Rosalie, tout n’est pas perdu ; tu peux encore racheter ta faute en résistant pendant quinze jours à ton funeste penchant. Tu devais être unie à quinze ans à un charmant prince de nos parents, le prince Gracieux ; cette union est encore possible.
« Ah ! Rosalie, ma chère enfant ; par pitié pour toi, si ce n’est pas pour moi, aie du courage et résiste. »
Rosalie était restée aux genoux de son père, le visage caché dans ses mains et pleurant amèrement ; à ces dernières paroles, elle reprit un peu de courage, et, l’embrassant tendrement, elle lui dit :
« Oui, mon père, je vous le jure, je réparerai ma faute ; ne me quittez pas, mon père, et je chercherai près de vous le courage qui pourrait me manquer si j’étais privée de votre sage et paternelle surveillance.
— Ah ! Rosalie, il n’est plus en mon pouvoir de rester près de toi ; je suis sous la puissance de mon ennemie ; elle ne me permettra sans doute pas de rester pour te prémunir contre les pièges que te tendra sa méchanceté. Je m’étonne de ne l’avoir pas encore vue, car le spectacle de mon affliction doit avoir pour elle de la douceur.
— J’étais près de toi aux pieds de ta fille, dit la Souris grise de sa petite voix aigre, en se montrant au malheureux génie. Je me suis amusée au récit de ce que je t’ai déjà fait souffrir, et c’est ce qui fait que je ne me suis pas montrée plus tôt. Dis adieu à ta chère Rosalie ; je l’emmène avec moi, et je te défends de la suivre.»
En disant ces mots, elle saisit, avec ses petites dents aiguës, le bas de la robe de Rosalie, pour l’entraîner après elle.
Rosalie poussa des cris perçants en se cramponnant à son père ; une force irrésistible l’entraînait. L’infortuné génie saisit un bâton et le leva sur la Souris ; mais, avant qu’il eût le temps de l’abaisser, la Souris posa sa petite patte sur le pied du génie, qui resta immobile et semblable à une statue.
Rosalie tenait embrassés les genoux de son père et criait grâce à la Souris ; mais celle-ci, riant de son petit rire aigu et diabolique, lui dit :
« Venez, venez, ma mie, ce n’est pas ici que vous trouveriez de quoi succomber deux autres fois à votre gentil défaut ; nous allons courir le monde ensemble, et je vous ferai voir du pays en quinze jours. »
La Souris tirait toujours Rosalie, dont les bras, enlacés autour de son père, résistaient à la force extraordinaire qu’employait son ennemie.
Alors la Souris poussa un petit cri discordant, et subitement toute la maison fut en flammes.
Rosalie eut assez de présence d’esprit pour réfléchir qu’en se laissant brûler elle perdait tout moyen de sauver son père qui resterait éternellement sous le pouvoir de Détestable, tandis qu’en conservant sa propre vie, elle conservait aussi les chances de le sauver.
« Adieu, mon père ! s’écria-t-elle ; au revoir dans quinze jours ! Votre Rosalie vous sauvera après vous avoir perdu. »
Et elle s’échappa pour ne pas être dévorée par les flammes.
Elle courut quelque temps, ne sachant où elle allait ; elle marcha ainsi plusieurs heures ; enfin, accablée de fatigue, demi-morte de faim, elle se hasarda à aborder une bonne femme qui était assise à sa porte.
« Madame, dit-elle, veuillez me donner asile ; je meurs de faim et de fatigue ; permettez-moi d’entrer et de passer la nuit chez vous.
— Comment une si belle fille se trouve-t-elle sur les grandes routes, et qu’est-ce que cette bête qui vous accompagne et qui a la mine d’un petit démon ? »
Rosalie, se retournant, vit la Souris grise qui la regardait d’un air moqueur.
Elle voulut la chasser, mais la Souris refusait obstinément de s’en aller. La bonne femme, voyant cette lutte, hocha la tête et dit :
« Passez votre chemin, la belle : je ne loge pas chez moi le diable et ses protégés. »
Rosalie continua sa route en pleurant, et partout où elle se présenta, on refusa de la recevoir avec sa Souris qui ne la quittait pas. Elle entra dans une forêt où elle trouva heureusement un ruisseau pour étancher sa soif, des fruits et des noisettes en abondance ; elle but, mangea, et s’assit près d’un arbre, pensant avec inquiétude à son père et à ce qu’elle deviendrait pendant quinze jours. Tout en réfléchissant, Rosalie, pour ne pas voir la maudite Souris grise, ferma les yeux ; la fatigue et l’obscurité amenèrent le sommeil : elle s’endormit profondément.
III
LE PRINCE GRACIEUX
Pendant que Rosalie dormait, le prince Gracieux faisait une chasse aux flambeaux dans la forêt ; le cerf, vivement poursuivi par les chiens, vint se blottir effaré près du buisson où dormait Rosalie. La meute et les chasseurs s’élancèrent après le cerf ; mais tout d’un coup les chiens cessèrent d’aboyer et se groupèrent silencieux autour de Rosalie.
Le prince descendit de cheval pour remettre les chiens en chasse. Quelle ne fut pas sa surprise en apercevant une belle jeune fille qui dormait paisiblement dans cette forêt ! Il regarda autour d’elle et ne vit personne ; elle était seule, abandonnée.
En l’examinant de plus près, il vit la trace de larmes qu’elle avait répandues et qui s’échappaient encore de ses yeux fermés. Rosalie était vêtue simplement, mais d’une étoffe de soie qui dénotait plus que de l’aisance ; ses jolies mains blanches, ses ongles roses, ses beaux cheveux châtains, soigneusement relevés par un peigne d’or, sa chaussure élégante, un collier de perles fines, indiquaient un rang élevé.
Elle ne s’éveillait pas, malgré le piétinement des chevaux, les aboiements des chiens, le tumulte d’une nombreuse réunion d’hommes. Le prince, stupéfait, ne se lassait pas de regarder Rosalie ; aucune des personnes de la cour ne la connaissait. Inquiet de ce sommeil obstiné, Gracieux lui prit doucement la main : Rosalie dormait toujours ; le prince secoua légèrement cette main, mais sans pouvoir l’éveiller.
« Je ne puis, dit-il à ses officiers, abandonner ainsi cette malheureuse enfant, qui aura peut-être été égarée à dessein, victime de quelque odieuse méchanceté. Mais comment l’emporter endormie ?
— Prince, lui dit son grand veneur Hubert, ne pourrions-nous faire un brancard de branchages et la porter ainsi dans quelque hôtellerie voisine, pendant que Votre Altesse continuera la chasse ?
— Votre idée est bonne, Hubert ; faites faire un brancard sur lequel nous la déposerons ; mais ce n’est pas à une hôtellerie que vous la porterez, c’est dans mon propre palais. Cette jeune personne doit être de haute naissance, elle est belle comme un ange ; je veux veiller moi-même à ce qu’elle reçoive les soins auxquels elle a droit. »
Hubert et les officiers eurent bientôt arrangé un brancard sur lequel le prince étendit son propre manteau ; puis, s’approchant de Rosalie toujours endormie, il l’enleva doucement dans ses bras et la posa sur le manteau. À ce moment, Rosalie sembla rêver ; elle sourit, et murmura à mi-voix :
« Mon père, mon père !… sauvé, à jamais !… la reine des fées,… le prince Gracieux… je le vois… qu’il est beau ! »
Le prince, surpris d’entendre prononcer son nom, ne douta plus que Rosalie ne fût une princesse sous le joug de quelque enchantement. Il fit marcher bien doucement les porteurs du brancard, afin que le mouvement n’éveillât pas Rosalie ; il se tint tout le temps à ses côtés.
On arriva au palais de Gracieux ; il donna des ordres pour qu’on préparât l’appartement de la reine, et, ne voulant pas souffrir que personne touchât à Rosalie, il la porta lui-même jusqu’à sa chambre, où il la déposa sur un lit, en recommandant aux femmes qui devaient la servir de le prévenir aussitôt qu’elle serait réveillée.
Rosalie dormit jusqu’au lendemain ; il faisait grand jour quand elle s’éveilla ; elle regarda autour d’elle avec surprise : La méchante Souris n’était pas près d’elle ; elle avait disparu.
« Serais-je délivrée de cette méchante fée Détestable ? dit Rosalie avec joie ; suis-je chez quelque fée plus puissante qu’elle ? »
Elle alla à la fenêtre ; elle vit des hommes d’armes, des officiers parés de brillants uniformes. De plus en plus surprise, elle allait appeler un de ces hommes qu’elle croyait être autant de génies et d’enchanteurs, lorsqu’elle entendit marcher ; elle se retourna et vit le prince Gracieux, qui, revêtu d’un élégant et riche costume de chasse, était devant elle, la regardant avec admiration. Rosalie reconnut immédiatement le prince de son rêve, et s’écria involontairement :
« Le prince Gracieux ! »
— Vous me connaissez, Madame ? dit le prince étonné. Comment, si vous m’avez reconnu, ai-je pu, moi, oublier votre nom et vos traits ?
— Je ne vous ai vu qu’en rêve, prince, répondit Rosalie en rougissant ; quant à mon nom, vous ne pouvez le connaître, puisque moi-même je ne connais que depuis hier celui de mon père.
— Et quel est-il, Madame, ce nom qui vous a été caché si longtemps ? »
Rosalie lui raconta alors tout ce qu’elle avait appris de son père ; elle lui avoua naïvement sa coupable curiosité et les fatales conséquences qui s’en étaient suivies.
« Jugez de ma douleur, prince, quand je dus quitter mon père pour me soustraire aux flammes que la méchante fée avait allumées, quand, repoussée de partout à cause de la Souris grise, je me trouvai exposée à mourir de froid et de faim ! Mais, bientôt, un sommeil lourd et plein de rêves s’empara de moi ; j’ignore comment je suis ici et si c’est chez vous que je me trouve. »
Gracieux lui raconta comment il l’avait trouvée endormie dans la forêt, les paroles de son rêve qu’il avait entendues, et il ajouta :
« Ce que votre père ne vous a pas dit, Rosalie, c’est que la reine des fées, notre parente, avait décidé que vous seriez ma femme lorsque vous auriez quinze ans ; c’est elle sans doute qui m’a inspiré le désir d’aller chasser aux flambeaux, afin que je pusse vous trouver dans cette forêt où vous étiez perdue.
Puisque vous aurez quinze ans dans peu de jours, Rosalie, daignez considérer mon palais comme le vôtre ; veuillez d’avance y commander en reine. Bientôt votre père vous sera rendu, et nous pourrons aller faire célébrer notre mariage.»
Rosalie remercia vivement son jeune et beau cousin ; elle passa dans sa chambre de toilette, où elle trouva des femmes qui l’attendaient avec un grand choix de robes et de coiffures.
Rosalie, qui ne s’était jamais occupée de sa toilette, mit la première robe qu’on lui présenta, qui était en gaze rose garnie de dentelles, et une coiffure en dentelles avec des roses moussues ; ses beaux cheveux châtains furent relevés en tresse formant une couronne. Quand elle fut prête, le prince vint la chercher pour la mener déjeuner.
Rosalie mangea comme une personne qui n’a pas dîné la veille ; après le repas, le prince la mena dans le jardin ; il lui fit voir les serres, qui étaient magnifiques ; au bout d’une des serres, il y avait une petite rotonde garnie de fleurs choisies ; au milieu était une caisse qui semblait contenir un arbre, mais une toile cousue l’enveloppait entièrement ; on voyait seulement, à travers la toile, quelques points briller d’un éclat extraordinaire.
IV
L’ARBRE DE LA ROTONDE
Rosalie admira beaucoup toutes les fleurs ; elle croyait que le prince allait soulever ou déchirer la toile de cet arbre mystérieux, mais il se disposa à quitter la serre sans en avoir parlé à Rosalie.
« Qu’est-ce donc que cet arbre si bien enveloppé, prince ? demanda Rosalie.
— Ceci est le cadeau de noces que je vous destine ; mais vous ne devez pas le voir avant vos quinze ans, dit le prince gaiement.
— Mais qu’y a-t-il de si brillant sous la toile ? Insista Rosalie.
— Vous le saurez dans peu de jours, Rosalie, et je me flatte que mon présent ne sera pas un présent ordinaire.
— Et ne puis-je le voir avant ?
— Non, Rosalie ; la reine des fées m’a défendu de vous le montrer avant que vous soyez ma femme, sous peine de grands malheurs. J’ose espérer que vous m’aimerez assez pour contenir pendant quelques jours votre curiosité. »
Ces derniers mots firent trembler Rosalie, en lui rappelant la Souris grise et les malheurs qui la menaçaient ainsi que son père si elle se laissait aller à la tentation qui lui était sans doute envoyée par son ennemie, la fée Détestable.
Elle ne parla donc plus de cette toile mystérieuse, et elle continua sa promenade avec le prince ; toute la journée se passa agréablement.
Le prince lui présenta les dames de sa cour, et leur dit à toutes qu’elles eussent à respecter dans la princesse Rosalie l’épouse que lui avait choisie la reine des fées.
Rosalie fut très aimable pour tout le monde, et chacun se réjouit de l’idée d’avoir une si charmante reine.
Le lendemain et les jours suivants se passèrent en fêtes, en chasses, en promenades, le prince et Rosalie voyaient approcher avec bonheur le jour de la naissance de Rosalie, qui devait être aussi celui de leur mariage ; le prince, parce qu’il aimait tendrement sa cousine, et Rosalie, parce qu’elle aimait le prince, parce qu’elle désirait vivement revoir son père, et aussi parce qu’elle souhaitait ardemment voir ce que contenait la caisse de la rotonde.
Elle y pensait sans cesse ; la nuit elle y rêvait, et, dans les moments où elle était seule, elle avait une peine extrême à ne pas aller dans les serres, pour tâcher de découvrir le mystère. Enfin arriva le dernier jour d’attente : le lendemain Rosalie devait avoir quinze ans.
Le prince était très occupé des préparatifs de son mariage, auquel devaient assister toutes les bonnes fées de sa connaissance et la reine des fées.
Rosalie se trouva seule dans la matinée ; elle alla se promener, et, tout en réfléchissant au bonheur du lendemain, elle se dirigea machinalement vers la rotonde ; elle y entra pensive et souriante, et se trouva en face de la toile qui recouvrait le trésor.
« C’est demain, dit-elle, que je dois enfin savoir ce que referme cette toile… Si je voulais, je pourrais bien le savoir dès aujourd’hui, car j’aperçois quelques petites ouvertures dans lesquelles j’introduirais facilement les doigts… et en tirant un peu dessus… Au fait, qui est-ce qui le saurait ? Je rapprocherais la toile après y avoir un peu regardé… Puisque ce doit être à moi demain, je puis bien y jeter un coup d’œil aujourd’hui. »
Elle regarda autour d’elle, ne vit personne, et, oubliant entièrement, dans son désir extrême de satisfaire sa curiosité, la bonté du prince et les dangers qui les menaçaient si elle cédait à la tentation, elle passa ses doigts dans une des ouvertures, tira légèrement : la toile se déchira du haut en bas avec un bruit semblable au tonnerre, et offrit aux yeux étonnés de Rosalie un arbre dont la tige était en corail et les feuilles en émeraudes ; les fruits qui couvraient l’arbre étaient des pierres précieuses de toutes couleurs, diamants, perles, rubis, saphirs, opales, topazes, etc., aussi gros que les fruits qu’ils représentaient, et d’un tel éclat que Rosalie en fut éblouie.
Mais à peine avait-elle envisagé cet arbre sans pareil, qu’un bruit plus fort que le premier la tira de son extase : elle se sentit enlever et transporter dans une plaine, d’où elle aperçut le palais du prince s’écroulant ; des cris effroyables sortaient des ruines du palais, et bientôt Rosalie vit le prince lui-même sortir des décombres, ensanglanté, couvert de haillons. Il s’avança vers elle et lui dit tristement :
« Rosalie, ingrate Rosalie, vois à quel état tu m’as réduit, moi et toute ma cour. Après ce que tu viens de faire, je ne doute pas que tu ne cèdes une troisième fois à ta curiosité, que tu consommes mon malheur, celui de ton père et le tien. Adieu, Rosalie, adieu ! Puisse le repentir expier ton ingratitude envers un malheureux prince qui t’aimait et qui ne voulait que ton bonheur ! »
En disant ces mots, il s’éloigna lentement. Rosalie s’était jetée à genoux ; inondée de larmes, elle l’appelait, mais il disparut à ses yeux, sans même se retourner pour contempler son désespoir. Elle était prête à s’évanouir, lorsqu’elle entendit le petit rire discordant de la Souris grise, qui était devant elle.
« Remercie-moi donc, Rosalie, de t’avoir si bien aidée. C’est moi qui t’envoyais la nuit ces beaux rêves de la toile mystérieuse ; c’est moi qui ai rongé la toile pour te faciliter les moyens d’y regarder ; sans cette dernière ruse, je crois bien que tu étais perdue pour moi, ainsi que ton père et ton prince Gracieux. Mais encore une petite peccadille, ma mie, et vous serez à moi pour toujours. »
Et la Souris, dans sa joie infernale, se mit à danser autour de Rosalie ; ces paroles, toutes méchantes qu’elles étaient, n’excitèrent pas la colère de Rosalie.
« C’est ma faute, se dit-elle ; sans ma fatale curiosité, sans ma coupable ingratitude, la Souris grise n’aurait pas réussi à me faire commettre une si indigne action.
Je dois l’expier par ma douleur, par ma patience et par la ferme volonté de résister à la troisième épreuve, quelque difficile qu’elle soit.
D’ailleurs, je n’ai que quelques heures d’attente, et de moi dépendent, comme le disait mon cher prince, son bonheur, celui de mon père et le mien. »
Rosalie ne bougea donc pas ; la Souris grise avait beau employer tous les moyens possibles pour la faire marcher, Rosalie persista à rester en face des ruines du palais.
V
LA CASSETTE
Toute la journée se passa ainsi ; Rosalie souffrait cruellement de la soif.
« Ne dois-je pas souffrir bien plus encore, se disait-elle, pour me punir de ce que j’ai fait souffrir à mon père et à mon cousin ? J’attendrai ici mes quinze ans. »
La nuit commençait à tomber, quand une vieille femme qui passait s’approcha d’elle et lui dit :
« Ma belle enfant, voudriez-vous me rendre le service de me garder cette cassette qui est bien lourde à porter, pendant que je vais aller près d’ici voir une parente ?
— Volontiers, Madame », dit Rosalie, qui était très complaisante.
La vieille lui remit la cassette en disant :
« Merci, la belle enfant ; je ne serai pas longtemps absente. Ne regardez pas ce qu’il y a dans cette cassette, car elle contient des choses…, des choses comme vous n’en avez jamais vu… et comme vous n’en reverrez jamais.
Ne la posez pas trop rudement, car elle est en écorce fragile, et un choc un peu rude pourrait la rompre… Et alors vous verriez ce qu’elle contient… Et personne ne doit voir ce qui s’y trouve enfermé. »
Elle partit en disant ces mots. Rosalie posa doucement la cassette près d’elle, et réfléchit à tous les événements qui s’étaient passés. La nuit vint tout à fait ; la vieille ne revenait pas. Rosalie jeta les yeux sur la cassette, et vit avec surprise qu’elle éclairait la terre autour d’elle.
« Qu’est-ce, dit-elle, qui brille dans cette cassette ? »
Elle la retourna, la regarda de tous côtés, mais rien ne put lui expliquer cette lueur extraordinaire ; elle la posa de nouveau à terre, et dit :
« Que m’importe ce que contient cette cassette ? Elle n’est pas à moi, mais à la bonne vieille qui me l’a confiée. Je ne veux plus y penser, de crainte d’être tentée de l’ouvrir. »
En effet, elle ne la regarda plus et tâcha de n’y plus penser ; elle ferma les yeux, résolue d’attendre ainsi le retour du jour.
« Alors j’aurai quinze ans, je reverrai mon père et Gracieux, et je n’aurai plus rien à craindre de la méchante fée.
— Rosalie, Rosalie, dit précipitamment la petite voix de la Souris, me voici près de toi ; je ne suis plus ton ennemie, et pour te le prouver, je vais, si tu veux, te faire voir ce que contient la cassette. »
Rosalie ne répondit pas.
« Rosalie, tu n’entends donc pas ce que je te propose ? Je suis ton amie, crois-moi, de grâce. »
Pas de réponse.
Alors la Souris grise, qui n’avait pas de temps à perdre, s’élança sur la cassette et se mit en devoir d’en ronger le couvercle.
« Monstre, s’écria Rosalie en saisissant la cassette et la serrant contre sa poitrine, si tu as le malheur de toucher à cette cassette, je te tords le cou à l’instant ! »
La Souris lança à Rosalie un coup d’œil diabolique, mais elle n’osa pas braver sa colère.
Pendant qu’elle combinait un moyen d’exciter la curiosité de Rosalie, une horloge sonna minuit. Au même moment, la Souris poussa un cri lugubre et dit à Rosalie :
« Rosalie, voici l’heure de ta naissance qui a sonné ; tu as quinze ans ; tu n’as plus rien à craindre de moi ; tu es désormais hors de mon atteinte, ainsi que ton odieux père et ton affreux prince. Et moi je suis condamnée à garder mon ignoble forme de souris, jusqu’à ce que je parvienne à faire tomber dans mes pièges une jeune fille belle et bien née comme toi. Adieu, Rosalie ; tu peux maintenant ouvrir ta cassette. »
Et, en achevant ces mots, la Souris grise disparut.
Rosalie, se méfiant des paroles de son ennemie, ne voulut pas suivre son dernier conseil, et se résolut à garder la cassette intacte jusqu’au jour.
À peine eut-elle pris cette résolution, qu’un Hibou qui volait au-dessus de Rosalie laissa tomber une pierre sur la cassette qui se brisa en mille morceaux.
Rosalie poussa un cri de terreur ; au même moment elle vit devant elle la reine des fées, qui lui dit :
« Venez, Rosalie ; vous avez enfin triomphé de la cruelle ennemie de votre famille ; je vais vous rendre à votre père ; mais auparavant, buvez et mangez. »
Et la fée lui présenta un fruit dont une seule bouchée rassasia et désaltéra Rosalie. Aussitôt, un char attelé de deux dragons se trouva près de la fée qui y monta et y fit monter Rosalie.
Rosalie, revenue de sa surprise, remercia vivement la fée de sa protection, et lui demanda si elle n’allait pas revoir son père et le prince Gracieux.
« Votre père vous attend dans le palais du prince.
— Mais, Madame, je croyais le palais du prince détruit, et lui-même blessé et réduit à la misère.
— Ce n’était qu’une illusion pour vous donner plus d’horreur de votre curiosité, Rosalie, et pour vous empêcher d’y succomber une troisième fois. Vous allez retrouver le palais du prince tel qu’il était avant que vous ayez déchiré la toile qui recouvrait l’arbre précieux qu’il vous destine. »
Comme la fée achevait ces mots, le char s’arrêta près du perron du palais. Le père de Rosalie et le prince l’attendaient avec toute la cour. Rosalie se jeta dans les bras de son père et dans ceux du prince, qui n’eut pas l’air de se souvenir de sa faute de la veille.
Tout était prêt pour la cérémonie du mariage qu’on célébra immédiatement ; toutes les fées assistèrent aux fêtes qui durèrent plusieurs jours.
Le père de Rosalie vécut près de ses enfants. Rosalie fut à jamais guérie de sa curiosité ; elle fut tendrement aimée du prince Gracieux, qu’elle aima toute sa vie ; ils eurent de beaux enfants, et ils leur donnèrent pour marraines des fées puissantes, afin de les protéger contre les mauvaises fées et les mauvais génies.
Illsutrations de Gustave Doré et Jules Didier
Les deux frères IV
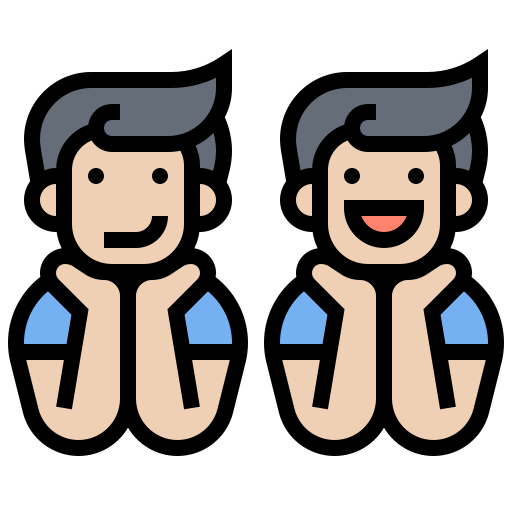
Chapître IV
Cliquez pour lire le chapitre I, chapitre II, chapitre III
Le jeune prince et son épouse vivaient fort heureux, et, comme Gottlieb, tout prince qu’il était, n’avait point oublié son ancien métier, il allait souvent à la chasse, et prenait toujours à cet exercice un extrême plaisir. Il va sans dire que, chaque fois qu’il allait à la chasse, ses hôtes l’y accompagnaient. Seulement, il y avait, à quelques lieues de la ville, une forêt qui passait pour giboyeuse, et qui en même temps jouissait du plus mauvais renom ; on y avait vu entrer beaucoup de chasseurs, jamais on n’en avait vu sortir un seul; ce qu’ils étaient devenus, personne ne le pouvait dire. Cependant, chaque fois que le jeune prince passait en vue de cette forêt, il s’arrêtait, secouant la tête et disant :
— Je ne serai pas content que je n’aie pénétré dans cette forêt, et que je ne sache par moi-même ce qui s’y passe.
Cette envie devint si grande, que Gottlieb ne laissa aucun repos au vieux roi que celui-ci ne lui eût accordé la permission qu’il sollicitait.
Un matin, il partit donc à cheval accompagné d’une nombreuse escorte; arrivé à la lisière du bois, il y aperçut une biche blanche comme la neige.
— Attendez-moi ici, dit-il à son escorte, je veux chasser cette magnifique bête.
Et il entra dans le bois, suivi seulement de ses fidèles animaux. Ses gens l’attendirent jusqu’au soir; mais, ne le voyant point revenir, ils retournèrent au palais, et racontèrent à la jeune reine ce qui s’était passé.
La pauvre princesse, qui adorait son Gottlieb, tomba dans une effroyable tristesse. Le jeune prince cependant avait poursuivi la biche blanche, ne la perdant pas de vue, mais ne pouvant l’atteindre. Depuis cinq heures déjà, cette poursuite durait, quand, tout à coup, l’animal s’évanouit comme une fumée. Alors seulement il s’aperçut qu’il était bien avant dans la forêt. Il prit son cor, en sonna de toutes ses forces ; mais il eut beau écouter, il n’entendit que l’écho qui lui répondait. Dans cette situation, et comme la nuit tombait, il résolut de demeurer dans la forêt jusqu’au lendemain matin, pensant qu’il lui serait impossible de retrouver sa route.
Il descendit donc de cheval, alluma du feu au pied d’un arbre et s’apprêta à bivuaquer. Il s’était déjà étendu près de son feu, ainsi que ses bêtes, et il ne voyait plus que dans le rayon de lumière projeté par ce feu, lorsqu’il crut entendre comme une voix humaine qui se plaignait. Il jeta les yeux tout autour de lui, mais n’aperçut âme qui vive. Un second gémissement se fit entendre : celui-là venait assurément d’en haut. Gottlieb leva la tête, regarda en l’air et vit une vieille femme perchée au haut d’un arbre.
— Hou ! hou ! hou ! disait la vieille ; hou ! hou ! hou ! que j’ai froid ! Le jeune prince la regarda avec étonnement, et, quoiqu’elle eût plutôt l’air d’un hibou que d’une femme, il en eut pitié.
— Si vous avez si froid que cela, la mère, lui dit-il, descendez et venez vous chauffer.
— Non, répondit la vieille, vos bêtes me mordraient. Puis elle répéta :
— Hou ! hou ! hou ! Je gèle ici.
— Mes bêtes ne font de mal à personne, répondit Gottlieb ; ne les craignez donc aucunement, et venez vous asseoir près de mon feu. Mais la vieille, qui était une sorcière, lui dit :
— Non, j’ai trop peur, je ne descendrai pas, à moins cependant que vous ne vouliez déjà toucher le dos de vos animaux avec la branche que je vais vous jeter, auquel cas je descendrai. Gottlieb se mit à rire, et, comme il ne voyait aucun inconvénient à faire ce que lui demandait la vieille, qu’il prenait pour une folle :
— Cassez votre branche, envoyez la-moi, et j’en toucherai le dos de mes animaux, lui répondit-il.
Il n’avait pas achevé ces paroles, que la branche tombait à ses pieds. Il la ramassa sans défiance et en toucha ses animaux, qui, à ce contact, demeurèrent complètement immobiles ; ils étaient changés en pierre.
Pendant que Gottlieb regardait avec stupéfaction le prodige qui venait de s’opérer, la vieille se laissa glisser le long du tronc de l’arbre, et vint par derrière toucher de sa baguette le jeune prince, qui fut à l’instant même pétrifié comme ses animaux. Puis elle le traîna, lui et ses cinq animaux, dans une caverne, où se trouvaient déjà beaucoup d’autres personnes changées en pierre par ses maléfices.
Plusieurs jours s’écoulèrent, et la jeune princesse, ne voyant pas revenir son mari, devenait de plus en plus triste. Ceci se passait, par bonheur, juste au moment où le frère du prince, celui qui avait pris vers l’Orient, rentrait dans le royaume. Il avait cherché du service, et, n’en ayant pas trouvé, il avait promené ses bêtes en les faisant danser dans les marchés et les foires. Mais enfin, un jour, comme par une inspiration du ciel, il lui prit envie d’aller consulter le couteau qu’ils avaient planté dans un arbre, et, quand il arriva à cet arbre, il vit que la lame du couteau était luisante du côté où il arrivait et rouillée du côté par lequel avait pris son frère. Seulement, elle n’était rouillée qu’à moitié. Il fut effrayé et se dit :
— Il faut qu’il soit arrivé un grand malheur à mon frère; mais peut-être puis-je encore le sauver, puisque la moitié de la lame est restée blanche.
Il prit donc aussitôt, sans perdre une minute, la route de l’occident, et, lorsqu’il arriva à la porte de la capitale, l’officier de garde à cette porte lui demanda s’il désirait que l’on fît prévenir sa femme de son arrivée, la princesse étant depuis quelques jours dans une inquiétude mortelle, persuadée qu’elle était qu’il avait péri dans la forêt enchantée. L’officier, en effet, croyait avoir affaire au jeune prince lui-même, tant la ressemblance était grande entre les deux frères. Ajoutez à cela que, comme le jeune prince, il était suivi d’un lion, d’un ours, d’un loup, d’un renard et d’un lièvre.
Le nouveau venu comprit qu’il était, selon toute probabilité, question de son frère ; il pensa que mieux valait se faire passer pour lui, et que cette erreur contribuerait probablement à sauver Gottlieb. Il se fit donc accompagner et conduire au palais, où il fut reçu avec une grande joie. La jeune princesse, de son côté, crut fermement que c’était son mari et lui demanda pourquoi il était resté si longtemps absent.
— Je m’étais égaré dans la foret, lui répondit-il, et j’ai été jusqu’aujourd’hui sans pouvoir retrouver mon chemin.
Le soir, on le conduisit à la chambre à coucher de son frère, et on l’invita à se coucher dans le lit royal ; mais, en s’y couchant, il mit entre lui et la jeune princesse une épée à double tranchant ; elle ne savait point ce que cela voulait dire, et n’osa pas le demander. Pendant deux jours, Wilfrid s’enquit de tout ce que l’on racontait du bois enchanté, et, le troisième, il dit :
— Décidément, il faut que je retourne chasser dans la forêt.
Le vieux roi et la jeune princesse firent tout ce qu’ils purent pour l’en dissuader ; mais il persista, et, le lendemain, il partit, suivi de la meme escorte qui avait accompagné son frère. Pendant toute la route, il causa adroitement avec l’officier qui la commandait, de sorte que, quoique l’officier crût parler au jeune prince, il avait dit à Wilfrid tout ce que celui-ci voulait savoir. Arrivé au bois, il vit la biche blanche qu’avait vue son frère, et, comme son frère, il dit à son escorte :
— Restez là, je veux chasser seul ce bel animal.
Et il entra dans la foret, suivi de ses bêtes seulement, poursuivit la biche sans pouvoir l’atteindre, la vit s’évanouir au moment où il croyait la forcer, et, la nuit venant, il se trouva forcé, comme son frère, de bivaquer dans le bois. Ayant, comme son frère, allumé du feu, comme lui il entendit, au-dessus de sa tête, des gémissements.
— Aïe ! aïe ! aïe ! disait une voix, qu’il fait froid ici !
Il leva la tête, et vit la vieille sorcière aux yeux de hibou.
— Si tu as froid là-haut, bonne mère, lui dit-il, descends et viens te chauffer.
— Je n’ai garde, répondit la sorcière, tes bêtes me mangeraient,
— Mes bêtes ne sont pas méchantes, elles ne te feront rien ; descends.
— Je vais te jeter une baguette, dit-elle ; et, en effet, si tu les frappes avec cette baguette, elles ne me feront rien.
En entendant ces paroles, le chasseur témoigna quelque surprise et dit:
— Quand je te réponds de mes bêtes, cela doit te suffire ; descends, ou sinon je vais aller te chercher.
— Bah ! dit la vieille, venir me chercher; quand tu le voudrais, tu ne le pourrais pas.
— C’est ce que nous allons voir, dit le chasseur; et, pour commencer, je vais t’envoyer une balle.
— Je me moque de tes balles, dit la sorcière ; essaye, et tu verras. Le chasseur la coucha en joue et lui envoya une balle.
Mais, comme sorcière, elle était à l’épreuve des balles de plomb !
— Tu n’es guère adroit ! dit la sorcière en ricanant.
Et elle lui rejeta sa balle de plomb.
En voyant cet échec, le chasseur, qui manquait si rarement son coup, n’eut plus de doute sur celle à qui il avait affaire. Mais il essaya d’un autre moyen, et, rechargeant son fusil, il glissa dans le canon un des boutons d’argent de son habit, et, comme la sorcière n’était pas à l’épreuve des balles d’argent, il lui cassa la cuisse, si bien que la sorcière dégringola du haut en bas de l’arbre.
Le chasseur lui mit le pied sur la poitrine et lui dit :
— Vieille coquine, si tu ne me dis pas à l’instant ce que tu as fait de mon frère, je te prends de mes mains et je te jette au feu.
Elle eut peur et demanda grâce.
— Où est mon frère? demanda plus impérativement encore que la première fois le chasseur.
— Ton frère est dans une caverne, répondit-elle; il est changé en pierre, lui, et ses bêtes.
Il força la sorcière de le conduire à la caverne, ce qu’elle fit en sautillant sur sa jambe ; et, lorsqu’ils y furent arrivés :
— Maintenant, vieille sorcière, dit-il, tu vas non-seulement rappeler à la vie mon frères et ses bêtes, mais encore toutes les personnes qui sont ici pétrifiées.
La sorcière, voyant qu’il fallait obéir, prit une baguette et en toucha chaque pierre, et le jeune prince et ses bêtes se levèrent, ainsi qu’une foule de personnes, voyageurs, marchands, artisans, soldats, qui remercièrent chaudement leur libérateur, et s’en allèrent chacun chez soi.
Quand les deux jumeaux se reconnurent, ils se jetèrent dans les bras l’un de l’autre, se réjouissant de tout leur cœur de s’étre si miraculeusement retrouvés. Puis ils saisirent la sorcière, et, pour qu’elle ne fît plus à d’autres ce qu’elle leur avait fait, ils la jetèrent dans le feu, où elle fut brûlée comme une mauvaise magicienne qu’elle était.
À peine eut-elle rendu le dernier soupir, que la forêt enchantée disparut comme une vapeur, et que, de l’endroit où ils étaient, les deux frères purent voir non-seulement la ville, mais encore le palais du roi. Ils prirent à l’instant même le chemin du château, et, tout en marchant, se racontèrent leurs aventures. Gottlieb raconta à son frère comment il était devenu gendre du roi et gouverneur général de tout le royaume.
Lorsqu’il eut fini son récit, son frère prit la parole à son tour :
— Je m’en suis bien aperçu, dit-il en souriant ; car, lorsque je suis entré dans la ville tout le monde m’a pris pour toi, et m’a rendu les honneurs royaux; il n’y a point jusqu’à ta femme qui ne s’y soit trompée, de sorte que j’ai dû me mettre à table à ses côtés et dormir dans son lit.
Quand le jeune prince entendit cela, la jalousie s’empara de lui, et l’aveugla à un tel point, qu’il tira son sabre et, d’un coup, abattit la tête de son frère.
Mais à peine ce meurtre eut-il été commis, qu’il se jeta sur le corps décapité, s’arrachant les cheveux et donnant les marques du plus profond désespoir. Alors, l’ours, qui, dans les circonstances les plus graves, ne perdait point sa présence d’esprit, s’approcha de lui et lui dit :
— Ne te désole pas, maître, tout peut se réparer ; la tête est très-proprement coupée et peut reprendre. Le lièvre connaît la racine de vie avec laquelle nous t’avons recollé la tienne, et il ne demandera certes pas mieux que de te rendre le service de te l’aller chercher.
— Oh ! mon petit lièvre ! dit Gottlieb en joignant les mains.
Mais le lièvre était déjà loin ; il courait si vite, qu’à peine le pouvait-on suivre des yeux. Au bout de vingt heures, il revint, tant il avait fait diligence. Le corps fut mis debout, la tête replacée sur le cou, la racine de vie placée entre les dents, et la tête reprit si complètement, que le frère aîné ignora toujours ce qui s’était passé et crut être tombé dans un sommeil qu’il attribua à la grande fatigue qu’il avait prise.
Mais, comme il était parfaitement frais et dispos, il se remit à l’instant même en route, et, deux heures après, ils arrivèrent aux environs de la ville. Alors Gottlieb dit à son frère :
— Tu me ressembles à s’y méprendre; tu as comme moi des habits royaux, comme moi tes bêtes te suivent. Entrons dans la ville chacun par une porte opposée, et arrivons en même temps au château royal. Cette proposition sourit à l’aîné ; ils se séparèrent donc. Arrivés à la ville, chacun se présenta, comme il était convenu, à la porte opposée. Aussitôt l’officier de garde se mit en route, et, comme il y en avait un à la porte où se montrait le jeune prince , et un autre à celle où se montrait son frère, tous deux se présentèrent au palais en même temps, annonçant chacun l’arrivée du jeune prince avec ses bêtes.
— Oh! pour cela, ce n’est point possible, dit le vieux roi. Comment mon gendre peut- il être à la fois à la porte du Nord et à la porte du Midi ? Les deux portes sont à une lieue l’une de l’autre.
En ce moment, et des deux côtés opposés, arrivèrent les deux frères. Ils descendirent de cheval dans la cour, chacun d’un côté du perron, et montèrent ensemble à la salle de réception.
— Ma foi, ma fille, dit le vieux roi à la princesse , vois lequel des deux est ton mari ; quant à moi, je m’y perds.
La jeune princesse demeurait dans une grande perplexité, quand, tout à coup, elle pensa aux cadeaux qu’elle avait faits aux bêtes. Derrière Gottlieb étaient le lion avec son collier d’émeraudes, l’ours avec ses boucles d’oreilles de diamants, le loup avec son bracelet de perles, le renard et le lièvre avec leurs bagues, l’une de saphir, l’autre de rubis. Elle étendit la main vers Gottlieb et dit :
— Voilà mon mari.
— C’est vrai, dit le jeune prince en riant.
Et tout le monde se mit à table. Le repas fut joyeux, et, lorsque le soir vint, et que Gottlieb accompagna sa femme dans la chambre à coucher :
— Pourquoi donc, lui demanda la jeune princesse, as-tu mis entre nous, pendant la dernière nuit,un glaive à double tranchant? J’ai eu grand’peur d’abord, croyant que tu me voulais tuer.
Alors le jeune prince reconnut combien son frère lui avait été fidèle.
La Belle aux cheveux d’or

Il y avait une fois la fille d’un roi qui était si belle, qu’il n’y avait personne de si beau au monde; pour cela on l’appelait la Belle aux Cheveux d’Or : car ses cheveux étaient plus fins que de l’or, d’un blonds merveilleux, tout frisés, et lui tombaient jusque sur aux pieds.
Elle allait toujours couverte de ses cheveux bouclés, avec une couronne de fleurs sur la tête et des habits brochés de diamants et de perles ; on ne pouvait la voir sans l’aimer.
Il y avait un jeune roi de ses voisins qui n’était pas marié, et qui était beau et riche.
Quand il eut appris tout ce qu’on disait de la belle aux Cheveux d’Or, bien qu’il ne l’eût jamais vue, il se prit à l’aimer si fort, qu’il en perdit la faim et la soif, et il se résolut à lui envoyer un ambassadeur pour la demander en mariage. Il fit faire un carrosse magnifique à son ambassadeur; il lui donna plus de cent chevaux et cent laquais, et l’ambassadeur parti chercher la princesse.
Quand il eut pris congé du roi et qu’il fut parti, toute la cour ne parlait d’autre chose; et le roi, qui ne doutait pas que la Belle aux Cheveux d’Or accepta sa demande, lui faisait déjà faire de belles robes et de jolies meubles.
Pendant ce temps, l’ambassadeur arriva chez la Belle aux Cheveux d’Or, et lui remit son message; mais, soit qu’elle ne fût pas ce jour-là de bonne humeur, où que le compliment ne lui semblât pas à son gré, elle répondit à l’ambassadeur qu’elle remerciait le roi, mais qu’elle n’avait pas envie de se marier.
L’ambassadeur repartit, bien triste de ne pas l’amener avec lui; il rapporta tous les présents qu’il lui avait portés de la part du roi : car elle était fort sage, et savait bien qu’il ne faut pas accepter de cadeau si on veut rester libre. Elle garda seulement un quarteron d’épingles d’Angleterre.
Quand l’ambassadeur arriva à la grande ville du roi, où il était attendu si impatiemment, chacun s’affligea de ce qu’il n’amenait pas la Belle aux Cheveux d’Or, et le roi se mit à pleurer comme un enfant : on le consolait sans en pouvoir venir à bout.
Il y avait un jeune garçon à la cour qui était beau comme le soleil, et le mieux fait de tout le royaume: à cause de sa bonne grâce et de son esprit, on le nommait Avenant. Tout le monde l’aimait, hors les envieux, qui étaient jaloux que le roi l’apprécie et qu’il lui confie ses affaires.
Avenant entendit parler du retour de l’ambassadeur, et qu’il n’avait pas eu de succès dans son voyage; Alors il dit, d’un air innocent : « Si le roi m’avait envoyé chercher la Belle aux Cheveux d’Or, je suis certain qu’elle serait venue avec moi. » Tout aussitôt les médisants allèrent dire au roi: « Sire, savez-vous ce que dit Avenant? Que, si vous l’aviez envoyé chercher la Belle aux Cheveux d’Or, il l’aurait ramenée. Considérez bien sa malice, il prétend être plus beau que vous, et qu’elle l’aurait tant aimé, qu’elle l’aurait suivi partout. »
Voilà le roi qui se met en colère, en colère tant et tant, qu’il était hors de lui.
« Ha! ha! dit-il, ce joli mignon se moque de mon malheur, et il se croit plus beau que moi; allons, qu’on le mette dans ma grosse tour, et qu’il y meure de faim! Les gardes du roi allèrent chez Avenant, qui ne pensait plus à ce qu’il avait dit; ils le traînèrent en prison et lui le maltraitèrent. Ce pauvre garçon n’avait qu’un peu de paille pour se coucher; et il serait mort sans une petite fontaine qui coulait dans le pied de la tour, dont il buvait un peu pour se rafraîchir : car la faim lui avait bien séché la bouche.
Un jour qu’il n’en pouvait plus, il dit en soupirant: « De quoi se plaint le roi? Il n’a point de sujet qui lui soit plus fidèle que moi, je ne l’ai jamais offensé. » Le roi, par hasard, passait proche de la tour : et, quand il entendit la voix de celui qu’il avait tant aimé, il s’arrêta pour l’écouter, malgré ceux qui étaient avec lui, qui haïssaient Avenant et qui disaient au roi : « A quoi vous amusez-vous, sire? ne savez-vous pas que c’est un fripon? » Le roi répondit : « Laissez-moi là, je veux l’écouter. » Ayant ouï ses plaintes, les larmes lui en vinrent aux yeux ; il ouvrit la porte de la tour et l’appela.
Avenant vint tout triste se mettre à genoux devant lui, et baisa ses pieds : « Que vous ai-je fait, sire, lui dit-il, pour me traiter si durement?
— Tu t’es moqué de moi et de mon ambassadeur, dit le roi. Tu as dit que, si je t’avais envoyé chez la Belle aux Cheveux d’Or, tu l’aurais bien amenée.
— Il est vrai, sire, répondit Avenant, que je lui aurais si bien venté vos grandes qualités, que je suis persuadé qu’elle n’aurait pu résister ; mais je ne comprends pas pourquoi cela vous a fâché. »
Le roi trouva qu’effectivement il n’y avait pas de mal à cela ; il regarda de travers ceux qui lui avaient dit du mal de son favori, et il l’emmena avec lui, se repentant bien de la peine qu’il lui avait faite.
Après l’avoir fait souper à merveille, il l’appela dans son cabinet, et lui dit : « Avenant, j’aime toujours la Belle aux Cheveux d’Or, ses refus ne m’ont point rebuté ; mais je ne sais comment m’y prendre pour qu’elle veuille m’épouser : je te demande d’y aller pour voir si tu peux la convaincre. » Avenant répliqua qu’il était disposé à lui obéir en toutes choses , qu’il partirait dès le lendemain.
« Bien! dit le roi, je vais te donner un grand équipage.
— Cela n’est pas nécessaire, répondit Avenant; il ne me faut qu’un bon cheval, et une lettre de votre part. »
Le roi l’embrassa , car il était ravi de le voir sitôt prêt.
Le lendemain matin il prit congé du roi et de ses amis, et s’en allant tout seul, sans pompe et sans bruit. Il réflechissait au moyen de convaincre la Belle aux Cheveux d’Or d’épouser le roi. Il avait une carnet dans sa poche, et, quand il lui venait quelque bonne idée, il descendait de cheval et s’asseyait sous un arbre pour écrire, afin de ne rien oublier.
Un matin qu’il était parti à l’aube, en passant dans une grande prairie, il lui vint une très bonne idée; il mit pied à terre, et se plaça contre un saule près d’une petite rivière qui coulait au bord d’un pré. Après qu’il eut écrit, il regarda autour de lui, charmé de se trouver en un si bel endroit. Il aperçut sur l’herbe une grosse carpe dorée qui bâillait et était en train de mourir, car elle avait voulu attraper de petits moucherons, elle avait sauté hors de l’eau.
Avenant en eut pitié; et, quoiqu’il eût pu l’emporter pour en faire son dîner, il décida de la remettre doucement dans la rivière. Dès que la carpe sentit la fraîcheur de l’eau, elle se réjouit, et se laissa couler jusqu’au fond; puis revenant toute contente au bord de la rivière, elle se mit à parler:
« Avenant, dit-elle, je vous remercie de m’avoir sauvé la vie; je vous le revaudrai. » Et ayant dit cela, elle s’enfonça dans l’eau ; et Avenant demeura bien surpris de l’esprit et de la grande civilité de la carpe.
Un autre jour qu’il continuait son voyage, il vit un corbeau bien embarrassé : ce pauvre oiseau était poursuivi par un gros aigle (grand mangeur de corbeaux) : Celui-ci était près de l’attraper, et il l’aurait avalé comme en une bouchée, si Avenant n’eût eu pitié du malheureux oiseau. « Quelle tristesse, dit-il, que les plus forts oppriment toujours les plus faibles : quelle raison a l’aigle de manger le corbeau?»
Il pris son arc qu’il portait toujours dans son dos, ainsi qu’une flèche; puis, visant bien l’aigle, croc! il lui décoche la flèche dans le corps et le perce de part en Part; L’aigle tombe raide mort, et le corbeau, ravi, vint se Percher sur un arbre à côté. « Avenant, lui dit-il, vous êtes bien généreux de m’avoir secouru, moi qui ne suis qu’un misérable corbeau; mais je ne demeurerai point ingrat, je vous le revaudrai. »
Avenant admira le bon esprit du corbeau et continua son chemin. En entrant dans un grand bois, si tôt qu’il ne voyait presque rien, il entendit un hibou qui criait désespéré. « Oulà! dit-il, voilà un hibou bien affligé; il pourrait s’être laissé prendre dans quelque piège.» Il chercha de tous côtés, et enfin il trouva un de ces grands filets que des oiseleurs tandaient la nuit pour attraper les oisillons. « Quelle pitié! dit-il; les hommes ne sont faits que pour se faire la guerre, ou pour persécuter de pauvres animaux qui ne leur font ni tort ni dommage. »
Il tira son couteau et coupa les cordelettes. Le hibou prit son envol; mais, revenant à tire d’aile, il lui dit : « Avenant, dit-il, il n’est pas nécessaire que je vous fasse une longue harangue pour vous faire comprendre combien je vous dois : les chasseurs allaient venir, j’étais pris, j’étais mort sans votre secours; j’ai le cœur reconnaissant, je vous le revaudrai. »
Voilà les trois plus notables aventures qui arrivèrent à Avenant pendant son voyage. Il arriva enfin au palais de la Belle aux Cheveux d’Or. Tout y était admirable ; on y voyait les diamants entassés comme des pierres ; les beaux habits, le bonbon, l’argent; ils n’y avaient que des choses merveilleuses; et il pensait en lui-même que, si elle laissait tout cela pour venir chez le roi son maître, il faudrait qu’il ait beaucoup de chance. Il prit un habit de brocart, des plumes rouges et blanches ; il se peigna, se poudra, se lava le visage; il mit une riche écharpe toute brodée à son cou, avec un petit panier, et dedans un beau petit chien, qu’il avait acheté en passant à Bologne. Avenant était si bien fait, si aimable, il faisait toute chose avec tant de grâce, que lorsqu’il se présenta à la porte du palais, tous les gardes lui firent une grande révérence; et l’on courut dire à la Belle au Cheveux d’Or qu’Avenant, ambassadeur du roi son voisin, demandait à la voir.
Sur ce nom d’Avenant, la princesse dit : « Avec un tel nom, je gagerais qu’il est joli et qu’il plaît à tout le monde.
— Vraiment oui, madame, lui dirent toutes ses filles d honneur : nous l’avons vu depuis le grenier où nous accommodions votre filasse, et tant qu’il est demeuré sous les fenêtres nous sommes restées là la bouche grande ouverte sans pouvoir rien faire d’autre que l’admirer.
— Voilà qui est beau, se moqua la Belle aux Cheveux d’Or, de vous amuser à regarder les garçons ! Qu’on me donne ma grande robe de satin bleu brodée, et que l’on éparpille bien mes cheveux blonds; que l’on me fasse des guirlandes de fleurs nouvelles ; que l’on me donne mes souliers à talons et mon éventail ; que l’on balaye ma chambre et mon trône : car je veux qu’il dise partout que je suis vraiment la Belle aux Cheveux d’Or. »
Voilà toutes ses femmes qui s’empressaient de la parer comme une reine ; elles étaient si pressées qu’elles s’entre-cognaient et n’avançaient guère.
Enfin la princesse passa dans sa galerie aux grands miroirs, pour voir si rien ne lui manquait; et puis elle monta sur son trône d’or, d’ivoire et d’ébène, qui sentait comme un baume , et elle commanda à ses filles de prendre des instruments et de chanter tout doucement.
On conduisit Avenant dans la salle d’audience: il demeura si transporté d’admiration qu’il ne pouvait presque plus parler; néanmoins il prit courage et transmit son message dignement, en vantant les mérites de son roi.
« Gentil Avenant, lui dit-elle, toutes les raisons que vous venez de me conter son fort bonnes, et je vous assure que je serais bien aise de vous favoriser plus qu’un autre. Mais il faut que vous sachiez qu’il y a un mois, alors que je me promenais près de la rivière avec toutes mes dames, en ôtant mon gant pour boire, je tirai de mon doigt une bague qui tomba par malheur dans la rivière : je la chérissais plus que mon royaume. Je vous laisse à juger quelle fut ma tristesse. J’ai jurer depuis de n’accepter aucune proposition de mariage, à moins que l’ambassadeur qui me proposera un époux ne me rapporte ma bague. »
Avenant fut bien étonné de cette réponse ; il lui fit une profonde révérence et la pria de recevoir le petit chien, le panier et l’écharpe ; mais elle lui répondit qu’elle ne voulait point de présents, et qu’il songeât à ce qu’elle venait de lui dire.
Quand il fut retourné chez lui, il se coucha sans souper; et son petit chien, qui s’appelait Cabriole, ne voulut pas souper non plus : il vint se mettre auprès de lui. Tant que la nuit fut longue, Avenant ne cessait de soupirer. « Où puis-je prendre une bague tombée depuis un mois dans une grande rivière ? disait-il : c’est impossible. La princesse a dit cela car elle veut être sûre de ne pas se marier. »
Il soupirait et s’attrista très-fort. Cabriole, qui l’écoutait, lui dit : «Mon cher maître, je vous prie, ne désespérez point de votre bonne fortune : vous êtes trop aimable pour n’être pas heureux. Allons, dès qu’il fera jour, au bord de la rivière. »
Avenant lui donna deux petits carresses et ne répondit rien; mais, tout accablé de tristesse, il s’endormit.
Cabriole, voyant le jour, cabriola tant qu’il l’éveilla, et lui dit : « Mon maître, habillez-vous, et sortons.» Avenant se leva, s’habilla, et descendit dans le jardin, jusqu’au bord de la rivière, où il se promena son chapeau sur les yeux et les bras croisés l’un sur l’autre, ne pensant qu’à son départ, quand tout d’un coup il entendit qu’on l’appelait : « Avenant! Avenant! » Il regarde de tous côtés et ne vit personne; il crut rêver. Il continua sa promenade; mais on l’appela à nouveau: « Avenant! Avenant !
— Qui m’appelle?» dit-il.
Cabriole, qui était fort petit, et qui regardait vers l’eau, lui répliqua : « Vous ne me croirez pas, si je vous dit que c’est une carpe dorée qui parle. »
Aussitôt la grosse carpe s’approcha, et lui dit: « Vous m’avez sauvé la vie dans le pré des Aliziers, où je serais restée à me désécher sans vous; je vous ai promis de vous récompenser. Tenez, cher Avenant. Voici la bague de la Belle aux Cheveux d’Or.»
Avant se baissa et prit la bague dans la gueule de son amie la carpe, qu’il remercia mille fois.
Au lieu de retourner dans sa chambre, il s’en fut droit au palais avec le petit Cabriole, qui était bien aise d’avoir fait venir son maître au bord de l’eau. On alla dire à la princesse qu’il demandait à la voir. « Hélas! dit-elle, le pauvre garçon, il vient prendre congé de moi; il a compris que ce que je veux est impossible, et il va le dire à son maître. »
On fit entrer Avenant, qui lui présenta sa bague et lui dit : « Madame la princesse, voilà votre souhait réalisé; pourrez-vous maintenant prendre le roi mon maître pour époux? »
Quand elle vit sa bague, La Belle aux Cheveux d’Or resta si étonnée, si surprise, qu’elle croyait rèver. « Vraiment, dit-elle, beau Avenant, il faut que vous soyez aimé de quelque fée ; car cela n’est pas possible sans l’aide d’un pouvoir surnaturel.
— Madame, dit-il, je n’en connais pas, mais j’avais très envie de vous obéir.
— Puisque vous avez si bonne volonté, continua-t-elle, il faut que vous me rendiez un autre service, sans lequel je ne me marierai jamais. Il y a, non loin d’ici, un prince appelé Galifron, qui s’est également mis en tête de m’épouser. Il m’a déclarer ses intentions en y joignant d’épouvantables menaces, et que si je le refusais il détruirait mon royaume. Mais jugez par vous-même si je pouvais l’ accepter: c’est un géant qui est plus haut qu’une haute tour; il mange des hommes comme un singe mange une banane. Quand il va en guerre, il porte dans ses poches des canons, dont il se sert comme des pistolets; et, lorsqu’il parle bien fort, ceux qui sont près de lui en deviennent sourds.
Je lui fit répondre que je ne voulais point me marier, et qu’il m’excusât ; cependant il n’a de cesse de me persécuter; il tue tous mes sujets. Avant de pouvoir me demander d’épouser qui que ce soit, il faudra se battre contre lui et m’apporter sa tête. »
Avenant demeura un peu étourdi par cette nouvelle demande ; il réfléchit quelque instants, puis il dit:
«Eh bien, madame, je combattrai Galifron. Je crois que je serai vaincu; mais je mourrai en brave homme. »
La princesse fut surprise de sa réponse : elle le pria mille fois de renoncer à cette entreprise. Mais cela ne servit de rien : il se retira pour aller chercher des armes et tout ce qu’il lui fallait. Quand il fut prêt, il remit le petit Cabriole dans son panier, il monta sur son beau cheval, et s’en fut vers le pays de Galifron. Quand il demandait son chemin à ceux qu’il rencontrait, on lui disait que c’était un vrai démon dont personne n’osait s’approcher : plus il entendait cela, plus il avait peur. Cabriole le rassurait, en lui disant: « Mon cher maître, pendant que vous vous battrez, j’irai lui mordre les jambes; il baissera la tête pour me chasser, et vous le tuerez.» Avenant admirait l’intelligence de son petit chien, mais il savait que son aide ne suffirait pas.
Enfin, il arriva près du château de Galifron. Là, tous les chemins étaient couverts d’os et de carcasses d’hommes qu’il avait mangés ou mis en pièces. À peine s’étai-il remis de son choc, qu’il vit venir Galifron à travers bois. Sa tête dépassait les plus grands arbres, et il chantait d’une voix épouvantable :
Où sont les petits enfants, Que je les croque à belles dents?
Il m’en faut tant, tant, et tant, Que le monde n’est pas suffisant.
Assitôt Avenant se mit à chanter sur le même air :
Approche Galifron, voici Avenant, qui t’arrachera les dents.
Bien qu’il ne soit pas des plus grands, pour te battre il est suffisant.
Les rimes n’étaient pas bien régulières ; mais il fit la chanson fort vite, et c’est même un miracle qu’il ne la fît pas plus mal, car il avait horriblement peur. Quand Galifron entendit ces paroles, il regarda de tous côtés, et il aperçut Avenant l’épée à la main, qui lui dit deux ou trois injures pour l’irriter. Il n’en fallut pas tant : il se mit dans une colère effroyable, et prenant une massue toute de fer, il aurait assommé du premier coup le gentil Avenant, si un corbeau n’était venu se mettre sur le haut de sa tête, et lui piquant les yeux avec son bec, jusqu’à les crever.
Son sang coulait sur son visage ; il était devenu fou, frappant de tous côtés. Avenant l’évitait et lui portait de grands coups d’épée qu’il enfonçait jusqu’à la garde, et qui lui faisaient mille blessures, par où il perdait tant de sang qu’il finit par tomber. Alors Avenant lui coupa la tête, bien content d’avoir été si chanceux. Le corbeau, qui s’était perché sur un arbre, lui dit : « Je n’ai pas oublié le service que vous me rendîtes en tuant l’aigle qui me poursuivait; je vous avait promis de m’en acquitter : je crois l’avoir fait aujourd’hui.
— C’est moi qui vous doit tout, maître Corbeau, répliqua Avenant; je demeure votre serviteur. »
Il monta aussitôt à cheval, chargé de l’épouvantable tête de Galifron.
Quand il arriva dans la ville, tout le monde le suivait et criait : « Voici le brave Avenant qui vient de tuer le monstre; » de sorte que la princesse, qui entendit bien du bruit et qui tremblait qu’on ne lui vînt apprendre la mort d’Avenant, n’osait demander ce qui lui était arrivé; mais elle vit entrer Avenant avec la tête du géant, qui lui faisait encore peur, bien qu’il n’y eût plus rien à craindre.
« Madame, lui dit-il, votre ennemi est mort ; j’espère que vous ne refuserez plus le roi mon maître à présent?
— Ah ! si fait, dit la Belle aux Cheveux d’Or, je le refuserai si vous ne trouvez moyen de m’apporter de l’eau de la grotte ténébreuse. Il y a proche d’ici une grotte profonde qui a bien six lieues de profondeur; on trouve deux dragons qui en garde l’entrée; ils ont du feu dans la gueule et dans les yeux; et, lorsqu’on est dans la grotte, on trouve un grand couloir souterrain par lequel il faut descendre : il est plein de crapauds, de couleuvres et de serpents. Au fond de ce trou, il y a une petite cave où coule la fontaine de beauté et de santé : c’est de cette eau que je veux absolument. Tout ce qu’on en mouille devient merveilleux : si l’on est belle, on demeure toujours belle; si l’on est laide, on devient belle; si l’on est jeune, on reste jeune; si l’on est vieille, on devient jeune. Vous jugez bien, Avenant, que je ne quitterai pas mon royaume sans en emporter un flâcon.
— Madame, lui dit-il, vous êtes si belle que Cette eau vous est bien inutile; mais je suis un malheureux ambassadeur dont vous voulez la mort : je vais vous aller chercher ce que vous désirez ; avec la certitude de n’en pouvoir revenir. » La Belle aux Cheveux d’Or ne changea point de dessein, et Avenant partit avec le petit chien Cabriole, pour aller à la grotte ténébreuse chercher de l’eau de beauté. Tous ceux qu’il rencontrait Sur le chemin disaient : « Quel dommage de voir un garçon si gentil aller mourrir ainsi; il va tout seul à la grotte, et quand bien même ils seraient cent, ils n’en pourraient venir à bout. Pourquoi la Princesse ne veut-elle que des choses impossibles ? » Il continuait de marcher, et ne disait pas un mot; mais il était bien triste.
Il arriva vers le haut d’une montagne où il s’assit pour se reposer un peu, et il laissa paître son cheval et Cabriole courir après des mouches.
Il savait que la grotte ténébreuse n’était pas loin de là, il regardait s’il ne la verrait point ; en effet il aperçut un vilain rocher noir comme de l’encre, d’où sortait une grosse fumée, et au bout d’un moment, il vit sortir un des dragons, qui jetait du feu par les yeux et par la gueule : il avait le corps jaune et vert, des griffes et une longue queue qui faisait plus de cent tours. En voyant cela, Cabriole ne savait où se cacher, tant il avait peur.
Avenant, tout résolu de mourir, tira son épée, descendit avec une fiole que la Belle aux Cheveux d’Or lui avait donnée pour la remplir de l’eau de beauté. Il dit à son petit chien Cabriole : « C’en est fait de moi! je ne pourrai jamais avoir de cette eau qui est gardée par des dragons; quand je serai mort, remplis la fiole de mon sang, et porte-la à la princesse, pour qu’elle voie ce qu’elle me coûte; et puis va trouver le roi mon maître et conte-lui mon malheur. »
Comme il parlait ainsi, il entendit qu’on l’appelait : « Avenant ! Avenant! »
Il dit : « Qui m’appelle? » et il vit un hibou dans le trou d’un vieux arbre, qui lui dit : « Vous m’avez retiré du filet des chasseurs où j’étais pris, et vous me sauvâtes la vie; je vous ai promis que je vous le revaudrais : voici venu le moment. Donnez-moi votre fiole : je sais tous les chemins de la grotte ténébreuse ; je vais vous chercher de l’eau de beauté. »
Juste ciel! qui fut bien aise? je vous le laisse à penser. Avenant lui donna vite sa fiole, et le hibou entra sans nul empêchement dans la grotte.
En moins d’un quart d’heure, il revint rapporter la bouteille bien remplie. Avenant fut ravi ; il le remercia de tout son cœur, et, remontant la montagne, il prit le chemin de la ville bien joyeux.
Il alla droit au palais ; il présenta la fiole à la Belle aux Cheveux d’Or, qui n’eut plus rien à dire : elle remercia Avenant, et donna ordre à tout ce qu’il lui fallait pour partir; puis elle se mit en voyage avec lui. Elle le trouvait bien aimable, et elle lui disait quelquefois : « Si vous aviez voulu, je vous aurais fait roi ; nous ne serions rester dans mon royaume. » Mais il répondit : « Je ne voudrais pas jouer un si mauvais tour à mon maître pour tous les royaumes de la terre, quoique je vous trouve plus belle que le soleil. »
Enfin ils arrivèrent à la grande ville du roi, qui sachant que la Belle aux Cheveux d’Or venait, alla au-devant d’elle et lui fit les plus beaux présents du monde. Il l’épousa avec tant de réjouissances, que l’on ne parlait d’autre chose ; mais la Belle aux Cheveux d’Or, qui aimait Avenant dans le fond de son cœur, n’était bien aise que quand elle le voyait, et elle le louait toujours. « Je ne serais point Venue sans Avenant, dit-elle au roi; il a dû faire des choses impossibles pour que je vienne : vous devez lui être reconnaissant; il m’a donné de l’eau de beauté, je ne vieillirai jamais, je serai toujours belle. »
Les envieux qui écoutaient la reine dirent au roi : « Vous n’êtes pas jaloux, bien que vous ayez des raisons de l’être. La reine aime si fort Avenant qu’elle en perd la faim et la soif ; elle ne fait que parler de lui et des obligations que vous avez envers lui, comme si personne n’en eût fait autant à sa place. »
Le roi dit : « C’est bien vrai, qu’on l’enferme dans la tour avec les fers aux pieds et aux mains. » On enferma Avenant, qui avait si bien servi le roi. Il ne voyait personne que le geôlier, qui lui jetait un morceau de pain noir par un trou, et de l’eau dans une écuelle de terre. Pourtant son petit chien Cabriole ne le quittait point; il le consolait et venait lui donner toutes les nouvelles.
Quand la Belle aux Cheveux d’Or sut sa disgrâce, elle se jeta aux pieds du roi, et, tout en pleurs, elle le pria de faire sortir Avenant de prison. Mais plus elle le priait, plus il se fâchait, songeant : « C’est qu’elle l’aime; » et il n’en voulut rien faire. Elle n’en parla plus : elle était bien triste.
Le roi s’avisa qu’elle ne le trouvait peut-être pas assez beau ; il eut envie de se frotter le visage avec de l’eau de beauté, afin que la reine l’aimât plus qu’elle ne faisait. Cette eau était dans une fiole sur le bord de la cheminée de la chambre de la reine, elle l’avait mise là pour la regarder plus souvent ; mais une de ses femmes de chambre, voulant tuer une araignée avec un balai, jeta par malheur la fiole par terre, qui se cassa, et toute l’eau fut perdue. Elle balaya rapidement, et, ne sachant que faire, elle se souvint qu’elle avait vu dans le cabinet du roi une fiole toute semblable pleîne d’eau claire comme l’était l’eau de beauté ; elle s’en empara sans rien dire, et la porta sur la cheminée de la reine, à la place de l’eau de beauté.
Mais l’eau qui était dans le cabinet du roi servait à faire mourir les princes et les grands seigneurs quand ils étaient criminels ; au lieu de leur couper la tête ou de les pendre, on leur frottait le visage de cette eau : ils s’endormaient, et ne se réveillaient plus. Un soir donc, le roi prit la fiole et se frotta bien le visage, puis il s’endormit et mourut.
Le petit chien Cabriole l’apprit des premiers et ne manqua pas de l’aller dire à Avenant, qui lui dit d’aller trouver la Belle aux Cheveux d’Or et de la faire souvenir du pauvre prisonnier.
Cabriole se glissa doucement dans la foule; car il y avait grand bruit à la cour à cause de la mort du roi. Il dit à la reine : « Madame, Avenant est enfermé dans la tour.» La reine fut bien aise d’entendre cette nouvelle. Elle sortit sans parler à personne, et s’en fut droit à la tour, où elle ôta elle-même les fers des pieds et des mains d’Avenant; et, lui mettant une couronne d’or sur la tête et le manteau royal sur les épaules, elle lui dit : « Venez, aimable Avenant, je vous fais roi et vous prends pour époux. »
Il se jeta à ses pieds et la remercia. Chacun fut ravi de l’avoir pour maître. Il se fit la plus belle noce du monde, et la Belle aux Cheveux d’Or vécut longtemps avec le bel Avenant, tous deux heureux et satisfaits.
MORALITÉ.
Si par hasard un malheureux te demande ton assistance, ne lui refuse point un secours généreux : Un bienfait tôt ou tard reçoit sa récompense.
Boucles d’or et les trois ours
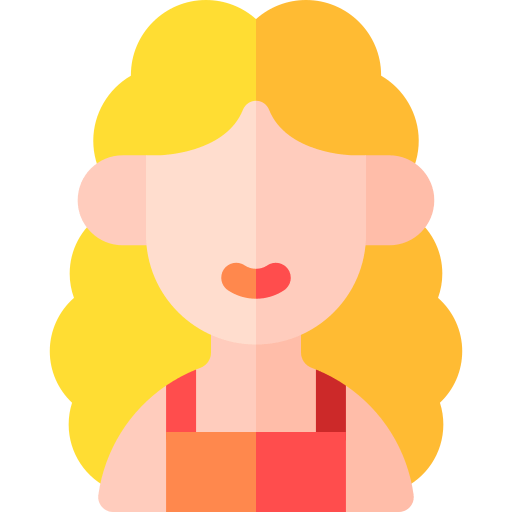
Il était une fois une famille de trois ours, le père, la mère et leur fils, qui vivaient dans une petite maison au milieu de la forêt.
Un jour que la soupe était prête mais trop chaude, maman ours proposa d’aller faire une promenade en attendant qu’elle refroidisse. Ils partirent tous les trois en laissant la fenêtre ouverte pour laisser la maison s’aérer.
Pendant ce temps, arriva une petite fille qui était perdue dans la forêt. Elle s’appelait Boucles d’or, car ses cheveux étaient frisés et blonds. Elle arriva près de la maison et, voulant demander de l’aide, frappa à la porte. Mais personne ne répondit. Alors elle fit le tour de la maison et, voyant la porte ouverte, elle se glissa à l’intérieur.
Elle découvrit une jolie pièce dans laquelle il y avait trois chaises et une table. Puis elle sentit une bonne odeur de soupe et vit trois bols de soupe sur la table. Un grand, un moyen et un petit. Affamée, elle goûta d’abord le grand bol, mais il était trop chaud. Alors elle goûta le moyen bol, mais la soupe était trop froide. Enfin, elle goûta le petit bol, et celui-ci était parfait, alors elle finit toute la soupe.
Fatiguée, elle voulut s’assoir sur la grande chaise, mais elle était trop grandse Elle essaya alors la deuxième chaise, mais elle était encore trop grande. Alors elle essaya la petite chaise et celle-ci lui allait parfaitement, mais tout à coup elle se cassa et Boucles d’or tomba.
Encore fatiguée, elle poursuivit sa visite de la maison et arriva dans la chambre où elle découvrit trois lits. Un grand, un moyen et un petit. Elle essaya le grand lit mais il était trop mou. Elle essaya le deuxième lit, mais il était trop dur. Puis elle essaya le plus petit lit et celui-ci lui allait tellement bien qu’elle s’endormit profondément.
Peu de temps après, la famille ours revint de sa promenade et Papa Ours dit:
– Quelqu’un a goûté ma soupe et l’a laissé
Maman Ours dit à son tour:
– Quelqu’un a touché à ma soupe et l’a laissé
Et petit Ours dit alors en pleurant:
– Quelqu’un a goûté à ma soupe et l’a mangé !
Alors Papa Ours dit:
– Quelqu’un s’est assis sur ma chaise
Maman Ours dit:
– Quelqu’un s’est aussi assis sur ma chaise
Et Petit Ours se mis à pleurer en disant:
– Quelqu’un s’est assis sur ma chaise et l’a cassé !
Alors ils allèrent à la chambre et là, Papa Ours dit:
– Quelqu’un s’est couché sur mon lit.
Maman Ours dit aussi:
– Quelqu’un s’est couché sur mon lit.
Et Petit Ours se remit à pleurer en disant:
– Quelqu’un s’est couché dans mon lit et y dort encore !
Alors Boucles d’Or se réveilla, et voyant les trois ours penchés au-dessus d’elle, elle sauta hors du lit et courut jusqu’à la fenêtre. Elle sauta et s’enfuit dans la forêt.
Les trois Ours ne surent jamais qui elle était. Papa Ours répara le fauteuil et Maman Ours refit une soupe car Petit Ours était bien triste.
Boucle d’Or retrouva son chemin et ne rentra plus jamais chez des inconnus.
Illustrations d’Arthur Rackham, Leonard Leslie Brooke et John Batten
Avec la participation vocale de Jojo, Appo et Thomas Blachère. Jingle de Blandine Beaussant.
L’intrépide soldat de plomb

Il était une fois vingt-cinq soldats de plomb, tous frères, car ils étaient nés d’une vieille cuiller de plomb. L’arme au bras, l’oeil fixe, l’uniforme rouge et bleu, quelle fière mine ils avaient tous !
La première chose qu’ils entendirent en ce monde, quand fut enlevé le couvercle de la boîte qui les renfermait, ce fut ce cri : « Des soldats de plomb ! » que poussait un petit garçon en battant des mains. On les lui avait donnés en cadeau pour sa fête, et il s’amusait à les ranger sur la table. Tous les soldats se ressemblaient parfaitement, à l’exception d’un seul, qui n’avait qu’une jambe : on l’avait jeté dans le moule le dernier, et il ne restait pas assez de plomb. Cependant il se tenait aussi ferme sur cette jambe que les autres sur deux, et c’est lui précisément qu’il nous importe de connaître.
Sur la table où étaient rangés nos soldats, il se trouvait beaucoup d’autres jouets ; mais ce qu’il y avait de plus curieux, c’était un charmant château de papier. À travers les petites fenêtres, on pouvait voir jusque dans les salons.
Au dehors se dressaient de petits arbres autour d’un petit miroir imitant un petit lac ; des cygnes en cire y nageaient et s’y reflétaient. Tout cela était bien joli; mais ce qu’il y avait de bien plus joli encore, c’était une petite demoiselle debout à la porte ouverte du château.
Elle aussi était de papier ; mais elle portait un jupon de linon transparent et très léger, et au-dessus de l’épaule, en guise d’écharpe, un petit ruban bleu, étroit, au milieu duquel étincelait une paillette aussi grande que sa figure. La petite demoiselle tenait ses deux bras étendus, car c’était une danseuse, et elle levait une jambe si haut dans l’air, que le petit soldat de plomb ne put la découvrir, et s’imagina que la demoiselle n’avait comme lui qu’une jambe.
« Voilà une femme qui me conviendrait, pensa-t-il, mais elle est trop grande dame. Elle habite un château, moi une boîte, en compagnie de vingt-quatre camarades, et je n’y trouverais pas même une place pour elle. Cependant il faut que je fasse sa connaissance. »
Et, ce disant, il s’étendit derrière une tabatière. Là, il pouvait à son aise regarder l’élégante petite dame, qui toujours se tenait sur une jambe, sans perdre l’équilibre.
Le soir, tous les autres soldats furent remis dans leur boîte, et les gens de la maison allèrent se coucher. Aussitôt les jouets commencèrent à s’amuser tout seuls : d’abord ils jouèrent à colin-maillard, puis ils se firent la guerre, enfin ils donnèrent un bal.
Les soldats de plomb s’agitaient dans leur boîte, car ils auraient bien voulu en être ; mais comment soulever le
couvercle ? Le casse-noisette fit des culbutes, et le crayon traça mille folies sur son ardoise. Le bruit devint si fort que le serin se réveilla et se mit à chanter. Les seuls qui ne bougeassent pas étaient le soldat de plomb et
la petite danseuse. Elle se tenait toujours sur la pointe du pied, les bras étendus ; lui intrépidement sur son unique jambe, et sans cesser de l’épier.
Minuit sonna, et crac ! voilà le couvercle de la tabatière qui saute ; mais, au lieu de tabac, il y avait un petit sorcier noir. C’était un jouet à surprise.
« Soldat de plomb, dit le sorcier, tâche de porter ailleurs tes regards ! »
Mais le soldat fit semblant de ne pas entendre.
« Attends jusqu’à demain, et tu verras ! » reprit le sorcier.
Le lendemain, lorsque les enfants furent levés, ils placèrent le soldat de plomb sur la fenêtre ; mais tout à coup, enlevé par le sorcier ou par le vent, il s’envola du troisième étage, et tomba la tête la première sur le
pavé. Quelle terrible chute ! Il se trouva la jambe en l’air, tout son corps portant sur son shako, et la baïonnette enfoncée entre deux pavés.
La servante et le petit garçon descendirent pour le chercher, mais ils faillirent l’écraser sans le voir. Si le soldat eût crié : « Prenez garde ! » ils l’auraient bien trouvé ; mais il jugea que ce serait déshonorer l’uniforme.
La pluie commença à tomber, les gouttes se suivirent bientôt sans intervalle; ce fut alors un vrai déluge.
Après l’orage, deux gamins vinrent à passer :
« Ohé ! dit l’un, par ici ! Voilà un soldat de plomb, faisons-le naviguer.»
Ils construisirent un bateau avec un vieux journal, mirent dedans le soldat de plomb, et lui firent descendre le ruisseau. Les deux gamins couraient à côté et battaient des mains. Quels flots, grand Dieu ! dans ce ruisseau ! que le courant y était fort ! Mais aussi il avait plu à verse. Le bateau de papier était étrangement balloté, mais, malgré tout ce fracas, le soldat de plomb restait impassible, le regard fixe et l’arme au bras.
Tout à coup le bateau fut poussé dans un petit canal où il faisait aussi noir que dans la boîte aux soldats.
« Où vais-je maintenant ? pensa-t-il. Oui, oui, c’est le sorcier qui me fait tout ce mal. Cependant si la petite demoiselle était dans le bateau avec moi, l’obscurité fût-elle deux fois plus profonde, cela ne me ferait rien. »
Bientôt un gros rat d’eau se présenta ; c’était un habitant du canal :
« Voyons ton passeport, ton passeport ! »
Mais le soldat de plomb garda le silence et serra son fusil. La barque continua sa route, et le rat la poursuivit. Ouf ! il grinçait des dents, et criait aux pailles et aux petits bâtons : « Arrêtez-le, arrêtez-le ! il n’a pas payé son droit de passage, il n’a pas montré son passeport. »
Mais le courant devenait plus fort, toujours plus fort ; déjà le soldat apercevait le jour, mais il entendait en même temps un murmure capable d’effrayer l’homme le plus intrépide. Il y avait au bout du canal une chute d’eau, aussi dangereuse pour lui que l’est pour nous une cascade. Il en était déjà si près qu’il ne pouvait plus s’arrêter. La barque s’y lança : le pauvre soldat s’y tenait aussi roide que possible, et personne n’eût osé dire qu’il clignait seulement des yeux. La barque, après avoir tournoyé plusieurs fois sur elle-même, s’était remplie d’eau ; elle allait s’engloutir.
L’eau montait jusqu’au cou du soldat, la barque s’enfonçait de plus en plus. Le papier se déplia, et l’eau se referma tout à coup sur la tête de notre homme. Alors il pensa à la gentille petite danseuse qu’il ne reverrait
jamais, et crut entendre une voix qui chantait :
– Soldat, le péril est grand ;
– Voici la mort qui t’atend !
Le papier se déchira, et le soldat passa au travers. Au même instant il fut dévoré par un grand poisson.
C’est alors qu’il faisait noir pour le malheureux ! C’était pis encore que dans le canal. Et puis comme il y était serré ! Mais toujours intrépide, le soldat de plomb s’étendit de tout son long, l’arme au bras.
Le poisson s’agitait en tous sens et faisait d’affreux mouvements ; enfin il s’arrêta, et un éclair parut le transpercer. Le jour se laissa voir, et quelqu’un s’écria : « Un soldat de plomb ! » Le poisson avait été pris, exposé au marché, vendu, porté dans la cuisine, et la cuisinière l’avait ouvert avec un grand couteau.
Elle prit avec deux doigts le soldat de plomb par le milieu du corps, et l’apporta dans la chambre, où tout le monde voulut contempler cet homme remarquable qui avait voyagé dans le ventre d’un poisson. Cependant le soldat n’en était pas fier. On le plaça sur la
table, et là – comme il arrive parfois des choses bizarres dans le monde ! – il se trouva dans la même chambre d’où il était tombé par la fenêtre.
Il reconnut les enfants et les jouets qui étaient sur la table, le charmant château avec la gentille petite danseuse ; elle tenait toujours une jambe en l’air, elle aussi était intrépide. Le soldat de plomb fut tellement touché qu’il aurait voulu pleurer du plomb, mais cela n’était pas convenable. Il la regarda, elle le regarda aussi, mais ils ne se dirent pas un mot.
Tout à coup un petit garçon le prit, et le jeta au feu sans la moindre raison ; c’était sans doute le sorcier de la tabatière qui en était la cause. Le soldat de plomb était là debout, éclairé d’une vive lumière, éprouvant
une chaleur horrible. Toutes ses couleurs avaient disparu ; personne ne pouvait dire si c’étaient les suites du voyage ou le chagrin. Il regardait toujours la petite demoiselle, et elle aussi le regardait. Il se sentait fondre ; mais, toujours intrépide, il tenait l’arme au bras.
Soudain s’ouvrit une porte, le vent enleva la danseuse, et, pareille à une sylphide, elle vola sur le feu près du soldat, et disparut en flammes. Le soldat de plomb était devenu une petite masse.
Le lendemain, lorsque la servante vint enlever les cendres, elle trouva un objet qui avait la forme d’un petit coeur de plomb ; tout ce qui était resté de la danseuse, c’était une paillette, que le feu avait rendue toute noire.
L’enfance du roi Arthur

Il y a fort longtemps, régnait sur la Grande-Bretagne le roi Uther Pendragon. Selon la légende, le roi Pendragon était depuis des années en guerre contre le duc de Tintagel, jusqu’à ce qu’ils fassent la paix en organisant une grande fête de réconciliation des grands seigneurs du pays. Le duc de Tintagel vint accompagné de son épouse, la duchesse Igraine.

Uther Pandragon par Arthur Pyle
Mais lorsque Uther Pendragon et la duchesse Igraine croisèrent leurs regards, le roi tomba éperdument amoureux d’elle. Il était tellement fou amoureux qu’il demanda au magicien de la cour, Merlin l’enchanteur, de lancer un sort. Ce sort consistait à faire croire à Igraine qu’Uther était son véritable mari. Et cela fonctionna tellement bien qu’ils s’unirent et de leur union naquit un fils nommé Arthur.
Mais comme cela ne pouvait se savoir dans le royaume et qu’Igraine mourut peu de temps après la naissance, Arthur fut confié à Merlin l’enchanteur, qui l’emmena dans un lieu secret et s’occupa de lui et de son éducation jusqu’à ce qu’il ait seize ans.
À son adolescence, Arthur fut envoyé auprès d’un chevalier nommé Sir Hector pour apprendre à combattre et diriger les hommes. Il devint l’écuyer de Keu, le fils d’Hector, qui le traitait rudement et se moquait de ce qu’Arthur n’avait pas de parents.
Après toutes ces années, le roi Uther mourut sans laisser de descendant officiel pour diriger le pays. Alors Merlin l’enchanteur, convaincu par un groupe de chevaliers, organisa un événement pour désigner un nouveau roi. Le défi serait de libérer une épée magique, appelée Excalibur, en la retirant de l’enclume de fer dans laquelle elle était emprisonnée, comme soudée.
Nombreux furent ceux qui essayèrent de l’enlever, mais aucun ne put y arriver. Keu, le chevalier d’Arthur n’y arriva pas non plus et il dit à Arthur de tenter da chance, pour pouvoir se moquer de lui.
À la grande surprise de tous, Arthur, retira l’épée sans effort.

Marshall, H. E. (Henrietta Elizabeth), 1867-1941
Cependant, la plupart des chevaliers n’acceptèrent pas la nomination d’Arthur en tant que nouveau roi, et Merlin dût prendre sa défense en avouant qu’il était en fait le seul descendant légitime du roi Uther. Beaucoup de chevaliers, dont Keu, changèrent alors d’avis et s’agenouillèrent en signe de reconnaissance.
Pour s’assurer qu’Arthur ne soit plus jamais inquiété par les chevaliers qui n’acceptaient pas sa nomination, Merlin décida de créer la célèbre table ronde, composée de chevaliers fidèles au nouveau roi. Et grâce à cela, pendant longtemps, le royaume connu la paix et la prospérité.
Et les chevaliers de la table ronde eurent de nombreuses aventures passionnantes que nous relaterons ici très bientôt.


The romance of King Arthur and his knights of the Round Table. Abridged from Malory’s Morte d’Arthur by Alfred W. Pollard. Illustrated by Arthur Rackham. Published 1920 by Macmillan in New York.
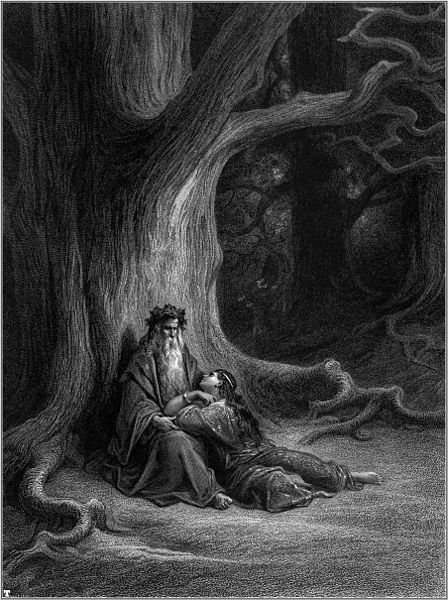
Les aventures de Marie et Roland
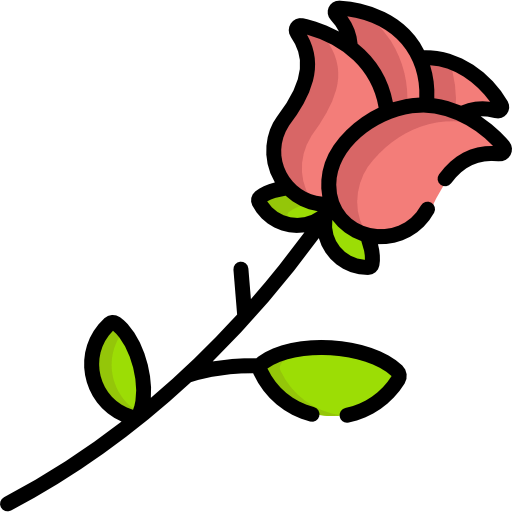
Il était une fois une femme qui était une vraie sorcière et qui avait deux filles, une méchante et laide, qu’elle aimait parce qu’elle était sa vraie fille, et une autre belle et bonne, qu’elle détestait, parce que c’était la fille de la première femme de son mari. La belle-fille avait un beau tablier, que l’autre aimait beaucoup, de telle sorte qu’elle en eut envie et demanda le tablier à sa mère.
– Tu l’auras sans nul doute. Ta sœur a bien mérité la mort, et ce soir pendant qu’elle dort, j’irai lui couper la tête. Veille seulement à t’allonger au fonds du lit et à la pousser devant.
La pauvre belle-fille, qui s’appelait Marie, serait morte si elle n’avait pas été caché derrière la porte et n’avait pas tout entendu. Quand vint l’heure de dormir, elle attendit que sa sœur dorme et la poussa à l’avant du lit.
Plus tard dans la nuit, la sorcière vint dans le noir, une hache à la main, et coupa la tête de sa propre fille puis repartit se coucher.
Marie se leva d’un coup et alla voir son amant, qui s’appelait Roland, et frappa à sa porte. Quand il sortit, elle lui dit:
– Cher Roland, nous devons fuir rapidement. Ma belle-mère voulait me tuer, mais elle a assassiné sa propre fille. Quand le matin viendra et qu’elle verra ce qu’elle a fait, nous serons perdus.
– Bien, lui dit Rolando, mais je te conseille de lui prendre d’abord sa baguette magique ; sinon, nous ne pourrons pas nous sauver quand elle nous poursuivra.
La jeune fille retourna à la maison et prit la baguette magique et s’enfuit avec son bien-aimé Roland. Quand la sorcière se leva le lendemain matin, elle appela sa fille pour lui donner le tablier, mais celle-ci ne répondit pas. Elle alla dans la chambre et vit sa propre fille, qui nageait dans son sang et à qui elle avait elle-même coupé la tête.
La sorcière se mit dans une colère folle et elle regarda par la fenêtre. Comme elle pouvait voir très loin avec ses pouvoirs, elle vit Marie qui courait avec Roland.
– Tu peux courir ! Ça ne te servira à rien ! cria t-elle.
Elle mit ses bottes de sept lieues, avec lesquelles elle parcourait sept lieues à chaque pas, et elle ne tarda pas à les rattraper.
Alors, la jeune Marie prit la baguette magique et se transforma en buisson de roses. Puis elle changea son amoureux en violoniste.
Roland se mit à jouer du violon qui produisait des mélodies enchantées, obligeant la sorcière à danser, et danser tant et tant qu’elle se piquait su rosier, perdant son sang et ses forces, jusqu’à mourir d’épuisement.

Heureux d’être délivrés, les amoureux voulurent se marier immédiatement et Roland dit:
– Je vais aller voir mon père pour préparer le mariage.
– Je t’attendrais ici, dit la fille.
Roland partit et la fille se changea en pierre rouge, en attendant son amant. Quand Roland arriva dans son village, il rencontra une autre jeune fille et se laissa séduire, jusqu’à en oublié la pauvre Marie. Celle-ci resta longtemps à attendre, mais finalement, voyant qu’il ne revenait pas, elle devint très triste, se transforma en fleur et pensa : « Quelqu’un qui me marchera sûrement dessus en passant par ici et je mourrait en paix.
Hors, un berger qui gardait ses moutons dans les champs vit la fleur et, comme elle était très belle, il la coupa, la prit et la mis dans un placard. A partir de ce moment, des choses merveilleuses ont commencèrent à se produire dans sa maison.
Quand il se levait le matin, tout le ménage était fait ; la chambre balayée, la table et les bancs dépoussiérés, le feu allumé dans l’âtre et l’eau remplie dans la cruche. À midi, quand il rentrait chez lui, la table était mise et un bon repas était servi. Il était content d’avoir le ménage fait, mais il commençait à avoir peur. Il slla donc voir une fée pour lui demander conseil.
La fée dit : C’est de la magie. Demain matin, si quelque chose bouge dans la pièce et que vous voyez quelque chose, quoi que ce soit, jetez un chiffon blanc dessus et la magie s’arrêtera. Le berger fit ce qu’elle lui avait dit, et le lendemain matin, alors qu’il faisait jour, il vit le tiroir s’ouvrir et la fleur en sortir. Il lui sauta dessus et jeta un chiffon blanc sur elle.
Immédiatement, une belle fille apparut devant lui, et lui explica son histoire et comment elle avait pris soin de sa maison.
Alors le berger lui proposa de l’épouser; mais elle refusa, car elle voulait rester fidèle à son bien-aimé Roland, même s’il l’avait abandonnée. Cependant elle promis qu’elle ne partirait pas et qu’elle continuerait à s’occuper de la maison.
Puis le jour approcha où le mariage de Roland devait avoir lieu. Suivant une vieille coutume du pays, il fut rendu public que toutes les filles devaient se réunir et chanter en l’honneur des fiancés. La fidèle Marie, quand elle entendit cela, fut si triste qu’elle pensa que son cœur allait éclater de douleur, et elle ne voulut pas y assister. Mais les autres filles vinrent la chercher et elle n’eut d’autre choix que de chanter.
En l’entendant, Roland sursauta et cria : Je connais cette voix ! C’est ma vraie fiancée Marie !
Alors Roland et Marie se marièrent et vécurent heureux presque tous les jours de leur vie.
Adapté de Roland le bien-aimé, des frères Grimm
Les enfants de la mer
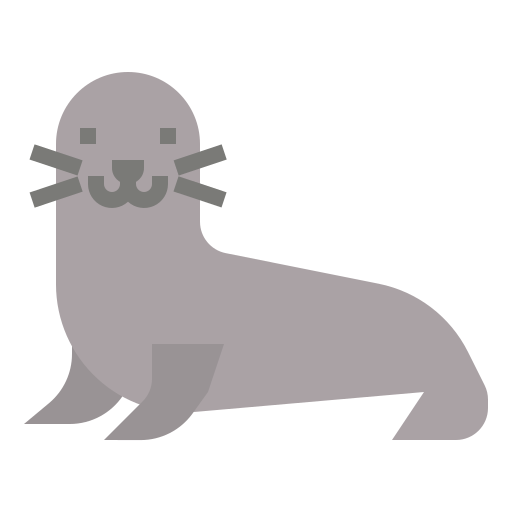
Avant que les premiers marins ne lancent leurs proues sur l’océan à la découverte de nouvelles contrées, le roi et la reine de la mer vivaient sous les vagues en paix et en harmonie. Ils avaient de nombreux enfants, aux yeux couleur miel et aux longues jambes, qui passaient leurs journées à jouer gaiement avec les hippocampes et à nager à travers les bosquets d’anémones de mer qui dansaient au fond des eaux. Ces merveilleuses créatures marines aimaient la musique, et partout où ils allaient on pouvait entendre leurs chants qui étaient comme le rire des vagues. On les appelait les enfants de la mer.
Mais un jour, un grand malheur survint car la reine tomba malade et mourut. Le roi et ses enfants, très tristes, pleurèrent longtemps après qu’elle fut enterrée aux milieux des grottes de corail du royaume. Et après cela, il n’y eut plus personne pour s’occuper des enfants de la mer, pour peigner leurs magnifiques cheveux et les bercer avec de douces mélodies de la mer. Le Roi voyait leurs cheveux décoiffés flottant comme de vulgaires algues, et les entendait tousser la nuit quand ils n’arrivaient pas à dormir; et il se dit en lui-même, qu’il devrait chercher une nouvelle femme pour s’occuper de ses enfants.
Dans la sombre forêt de la mer vivait une étrange sorcière de la mer, et c’est à elle que le roi demanda d’être sa nouvelle femme, bien qu’il ne sente pas d’amour pour elle, puisque son coeur était resté prisonnier dans les grottes de corail où sa reine reposait. La sorcière de la mer accepta sans hésiter en se disant qu’elle serait bien aise de devenir la reine de la mer et de régner sur un si vaste royaume. Elle accepta donc de se marier avec le roi, et devint la belle-mère des enfants de la mer. Mais elle n’était pas une bonne belle-mère, car quand elle vit leurs yeux couleur miel et leurs belles jambes, elle devint maladivement jalouse de leur beauté, ne supportant pas qu’il existe des êtres plus beaux qu’elle dans la mer.
Un jour, elle retourna dans sa sombre forêt de la mer et elle y cueillit les fruits jaunes du raisin de la mer qui poussaient là. Elle en fit une potion magique et y conjura un mauvais sort contre les enfants de la mer. Elle jura qu’ils perdraient leurs longues jambes et seraient changés en phoques, et seraient condamnés à nager dans les mers pour toujours, sauf un jour chaque année, durant lequel ils reprendraient leur forme originale.
Ce mauvais sort surprit les enfants de la mer alors qu’ils jouaient avec les hippocampes et serpentaient entre les anémones violettes du fonds de la mer. Leurs corps s’épaissirent et perdirent leur formes; leurs bras agiles se transformèrent en palmes maladroites et leur jambe en nageoir; et leurs peaux claires furent recouvertes de poils de soie gris, noirs et bruns dorés. Mais ils gardèrent leurs yeux doux et purent continuer à chanter comme ils le faisaient auparavant.
Quand leur père découvrit ce qui s’était passé, sa colère envers la méchante sorcière de la mer fut immense, et il la chassa et la condamna à vivre prisonnière dans sa sombre forêt de la mer pour toujours. Mais il ne put défaire le sortilège qu’elle avait lancé. Et les phoques, qui avaient été les beaux enfants de la mer, chantèrent en se lamentant de ne plus pouvoir vivre avec leur père, et d’avoir perdu à jamais le royaume de leur enfance heureuse. Tristement, le roi les regarda s’éloigner en nageant.
Pendant longtemps, les phoques voyagèrent très loin de mer en mer. Une fois par an, au coucher du soleil jusqu’au jour suivant, ils venaient s’échouer sur un bout de terre loin du regard des humains, et là, ils enlevaient leurs peaux de soie aux reflets gris, noir et brun doré et, se dressaient dans leur ancienne et gracieuse forme humaine. Mais leur jeux sur la page ne duraient jamais très longtemps, car au coucher de soleil suivant, ils devaient remettre leurs peaux de phoque et replonger dans la mer.
Les hommes racontent que les phoques arrivèrent d’abord aux îles de l’ouest en tant qu’émissaires des rois nordiques de Lochlan. Quelle que soit la vérité, il est certain qu’ils se mirent à aimer cette terre brumeuse de l’ouest, et qu’aujourd’hui encore, on peut les y apercevoir s’échouer autour de l’île de Lewis; Ou a Rona, également appelé l’île aux phoques; Ou encore dans le détroit de Harris. Les gens des Hébrides connaissent la légende des enfants de la mer, et disent qu’une fois par an, quelqu’un passant par là pourrait les surprendre en train de jouer et s’ébattre sur le sable avant le coucher du soleil.
C’est ce qui arriva un jour à un pêcheur nommé Roderic MacCodrum, du Clan Donald. Il vivait seul sur l’île de Bernerary.
Un jour qu’il marchait le long de la plage où il avait laissé sa barque de pêche, il entendit des bruits de chants venant d’un tas de rochers proches. Il s’en approcha sans faire de bruit et regarda derrière les pierres. Là, devant lui, il vit un groupe d’enfants de la mer qui s’amusaient et dansaient avant que le soleil ne se couche. Leurs longs cheveux flottaient derrière eux et leurs yeux étaient remplis de joie alors qu’ils jouaient sur la plage.
Il ne regarda pas longtemps, car il avait entendu dire que ces créatures étaient timides et ne supportaient pas le regard des mortels. Mais comme il allait s’en aller, il aperçu un tas de peaux de phoques soyeuses – Gris et noir et brun doré – posées sur un rocher à côté de lui, là où les enfants de la mer s’en étaient défait. Il ramassa celle qui lui semblait la plus brillante des peaux, en se disant que ce serait un fameux trophée à ramener chez lui. Et en arrivant chez lui, il cacha la peau au-dessus du linteau de sa porte.
Plus tard ce jour-là, après le coucher du soleil, alors que Roderic réparait son filet de pêche devant la cheminée, il entendit un étrange bruit de plainte au dehors. Il sortit et se trouva nez à nez avec la plus belle femme qu’il eut jamais vu. Elle avait de longues jambes et ses yeux étaient de couleur marron miel aux doux reflets. Elle ne portait aucun vêtement sur sa peau blanche, mais sa longue et abondante chevelure brune aux reflets dorés recouvrait sa beauté.
Oh, aidez-moi, aidez-moi, homme mortel, supplia- t-elle. Je suis une enfant de la mer, j’ai perdu ma peau de phoque en soie et, sans elle, je ne retrouverai jamais mes frères et sœurs.
Roderic prit l’air surpris et l’invita à passer à l’intérieur et à se couvrir avec son écharpe. Mais au fonds, il savait parfaitement que cette belle enfant de la mer n’était autre que la propriétaire de la peau de phoque qu’il avait dérobée plus tôt ce jour-là. Il aurait juste eu à lever le bras au dessus de la porte pour lui rendre sa peau de soie et sa liberté d’aller rejoindre ses frères et sœurs dans la mer. Mais Roderic la regarda s’assoir auprès de la cheminée et il pensa qu’il serait bien heureux de garder cette jolie femme exotique pour lui, pour égayer sa sollitude et apporter de la joie à son coeur.
Il est trop tard pour retrouver votre peau de phoque, dit-il. Quelqu’un a dû vous la voler et doit être déjà loin. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici et devenir ma femme. Je prendrai soin de vous, vous respecterai et vous aimerai toute ma vie.
La fille du roi de la mer leva ses grands yeux de miel pleins de chagrin vers le pêcheur.
Si ma peau de phoque a été volée et qu’il n’y a plus de chance de la retrouver, je n’ai donc pas d’autre choix que de rester avec vous et devenir votre femme, dit-elle. Je ne pourrai espérer trouver quelqu’un de plus aimable que vous dans ce monde que je ne connais pas.
Et elle soupira en pensant à sa vie de la mer qu’elle pensait ne plus jamais connaître.
J’aimerai tellement être avec mes frères et sœurs de la mer, qui doivent m’attendre et m’appeler sans cesse.
Le coeur du pêcheur trésaillit face au désarroi de la jeune femme, mais il était si étourdi par sa beauté et sa douceur qu’il sut qu’il ne la laisserai jamais partir.
Durant de longues années, Roderic MacCodrum et sa merveilleuse épouse de la mer vécurent dans la maisonnette près de la plage, et ils eurent beaucoup d’enfants : Des enfants aux yeux bruns couleur de miel et de belles voix pour chanter. Les gens des environs avaient surnommé Roderic “MacCodrum des phoques”, car il avait épousé une femme phoque; et les enfants furent surnommés les “enfants de MacCodrum des phoques”. Malgré le temps qui passait, la fille du roi de la mer se remémorait souvent son grand chagrin. Elle allait marcher seule sur la plage, écoutant le ceol-mara, nom donné en gaëlique, à la musique de la mer et le gait na mara, le rire des vagues. Et parfois, elle apercevait au loin ses frères et sœurs nageant près du rivage, appelant encore et encore du nom de leur sœur perdue depuis longtemps. Elle espérait pouvoir les rejoindre un jour, du plus profond de son cœur.
Un jour, comme à son habitude, Rodric sortit pêcher après avoir embrassé sa femme et ses enfants. Mais en chemin il croisa un lièvre, ce qui est toujours un mauvais présage. Roderic était partagé entre revenir à la maison ou poursuivre son chemin, mais il regarda le ciel et se dit:
C’est seulement un peu de vent qui se présage. J’ai déjà traversé et surmonté de nombreuses tempêtes dans ma barque.
Et il continua son chemin.
En effet, un peu plus tard, le vent forcit autour de sa maison où il avait sa femme et ses enfants. Le plus jeune était en train d’écouter le vent et le bruit de la mer dans un coquillage, le posant contre son oreille comme il aimait faire souvent. Sa mère l’appela pour rentrer. Alors qu’il passait le seuil en obéissant à sa mère, un coup de vent plus fort rabattit la porte, qui claqua fort et fit trembler les murs. La pierre au-dessus du linteau de la porte se descella, laissant tomber la peau de phoque que Rederic avait caché là des années auparavant.
La fille du roi de la mer prit la peau dans ses mains. Elle ne dit rien contre son mari qui l’avait gardé contre sa volonté pendant tellement d’années. Mais elle enleva ses habits humains et serra la peau de phoque contre elle. Puis elle dit adieu à ses enfants et descendit jusqu’à la mer. Là, elle revêtit sa peau de phoque et entra dans l’eau. Elle regarda une dernière fois vers la maison du pêcheur où elle avait malgré tout vécu quelques moments de bonheur. Ses enfants étaient alignés le long de la plage et pleuraient. Mais l’appel de la mer était plus fort que tout au monde; et elle nagea au loin, très loin, pleine de joie à nouveau.
Quand Roderic MacCodrum revint de sa journée de pêche, il trouva la porte ouverte et le feu éteint. En voyant le trou au-dessus de la porte, il comprit ce qui s’était passé. Sa belle épouse était retournée à jamais dans les profondeurs de la mer. Il fut bien triste quand ses enfants lui racontèrent la manière dont elle leur avait fait ses adieux.
Jour funeste qui me fit croiser un lièvre en chemin vers ma barque! Dit-il. Le vent soufflait fort, la pêche était mauvaise, et maintenant ce grand malheur qui m’accable!
Il n’oublia jamais sa merveilleuse femme-phoque et la pleura tous les jours de sa vie restante. Depuis ce temps, Roderic MacCodrum, ses enfants et leurs descendants, se rappelant de leur épouse et mère, firent bien attention de ne jamais déranger ou blesser un phoque, s’ ils venaient à en rencontrer. Et on les appela le Clan MacCodrum des phoques dans tout le Uist du nord et les Hébrides.
Traduit de MacCodrum of the Seals, Fairy Tales from Scotland, contes recueillis para Barbara Ker Wilson
Pinocchio
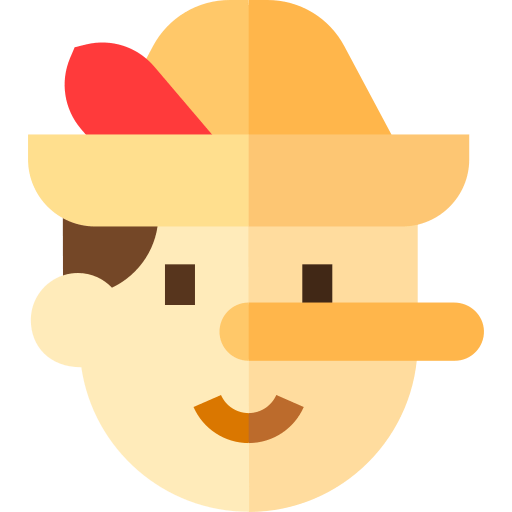
Il était une fois un vieux menuisier qui s’appelait Gepetto. Il vivait et travaillait seul dans son atelier. Toutes les nuits il sculptait une marionnette de bois. Il avait mis tant d’efforts dans ce travail que le résultat était vraiment extraordinaire. Il ne manquait aucun détail : Les jambes, les bras, le corps et un joli petit nez pointu. Ce pantin était magnifique.
– Tu es prêt. Mais je devrais te donner un nom… Je sais ! Puisque tu es taillé en bois de pin, je t’appellerai Pinocchio. – dit le vieux charpentier. Dommage que tu ne sois qu’un pantin et que tu ne puisses pas être mon fils, j’aimerais tant que tu sois un vrai petit garçon.
Cette nuit là, une fée, la Fée Bleue, entendit le vœu du vieil homme et décida de le réaliser. Pendant que Gepetto dormait, elle apparut dans l’atelier avec sa baguette magique, se dirigea vers le pantin et lui dit :
– Réveille-toi Pinocchio. Maintenant, tu peux parler et bouger comme tout le monde. Mais tu devras être très bon et obéissant si tu veux devenir un jour un vrai petit garçon.
Et ayant dit cela, la fée disparut.
Pinocchio commença à explorer l’atelier et derrière d’autres jouets inachevés, il découvrit un grillon qu’on nomme aussi criquet.
– Salut, qui es-tu? Demanda-t-il. Moi, je m’appelle Pinocchio. Tu peux venir jouer avec moi si tu veux.
Le criquet avait un peu peur, mais il finit par s’approcher. Ils devinrent rapidement amis et commencèrent à jouer et à rire. Finalement ils firent un tel vacarme qu’ils réveillèrent Gepetto.
Quand il vit que son rêve était devenu réalité et que Pinocchio était devenu vivant, le vieil homme le serra dans ses bras de toutes ses forces et se mit à rire.
– Quel joie de te voir vivant Pinocchio ! Je ferai de toi un enfant bon et studieux. Dès demain, tu iras à l »école comme tous les enfants. Attends-moi ici, je vais t’acheter un livre.
Le vieil homme quitta la maison et revint très tard. Comme il était très pauvre, il avait dû vendre son manteau pour acheter un livre de classe au petit pantin. Mais il s’en moquait car il voulait le meilleur pour celui qui considérait désormais comme son fils.
Le lendemain, Pinocchio se rendait pour la première fois à l’école, lorsqu’il tomba sur un garçon que tout le monde appelait Asperge parce qu’il était très maigre.
Celui-ci dit à Pinocchio :
– Tu vas à l’école ? C’est ennuyeux l’école ! Viens avec moi voir le théâtre de marionnettes. Tu verras comme c’est amusant.
Pinocchio n’hésita pas et suivit son nouvel ami.
– Mais Pinocchio, qu’est-ce que tu fais ? dit le grillon parlant, qui était caché dans la poche de sa veste et avait tout entendu. C’est ton devoir d’aller à l’école ! Et c’est aussi le souhait de ton père !
Mais Pinocchio ignora les conseils de son ami et suivit Asperge au théâtre.
Pinocchio apprécia tellement le spectacle qu’il finit par monter sur scène avec le reste des marionnettes. Les gens applaudirent et rirent avec enthousiasme et Gulter, le propriétaire du théâtre, se rendit tout de suite compte que Pinocchio pouvait lui rapporter beaucoup d’argent.
– Je ne peux pas rester, monsieur – répondit Pinocchio à Gulter.
Mais avant qu’il ait pu finir sa phrase, Gulter l’avait pris par le bras, et enfermé dans une cage.

Durant la nuit, le pauvre pantin se mit à pleurer, à tel point que la Fée Bleue l’entendit et vint à son aide pour le libérer.
De retour chez lui, Pinocchio trouva Gepetto très inquiet.
– Où étais-tu Pinocchio ?
– A l’école Papa… Mais ensuite le professeur m’a demandé d’aller faire une course…
À ce mensonge, le nez de Pinocchio se mit à pousser et à pousser sans que le pauvre ne puisse rien faire. Et plus il mentait, plus son nez s’allongeait comme une branche d’arbre.
– Tu dois dire la vérité ! Lui dit son ami le criquet parlant.
Pinocchio avoua alors la vérité à son père et promit de ne plus mentir ni de manquer à l’école.
La fée envoya des piverts qui picorèrent le nez jusqu’à ce qu’il reprenne sa taille normale.
Le lendemain, il reprit le chemin de l’école avec son ami le grillon. Mais il trouva à nouveau son compère Asperge debout au coin d’une ruelle.
– Qu’est-ce que tu fais ici Asperge ?
– J’attends la calèche qui va au Pays des jouets. C’est un endroit incroyable, c’est plein de friandises et de bonbons et il n’y a pas d’école et personne pour te dire quoi faire. Tu peux même passer toute la journée à jouer si tu le veux ! Pourquoi ne viens-tu pas avec moi?
Pinocchio céda rapidement et une fois de plus désobéit à son père et oublia ses belles promesses. Son ami le criquet tenta de l’avertir, mais Pinocchio ne voulut rien entendre.
– Non, Pinocchio !. Ce n’est pas une bonne idée d’y aller, crois-moi. Souviens-toi de la promesse faite à ton père.
Au Pays des jouets, tout commença pour le mieux. Il y avait des manèges partout, les enfants couraient et riaient, ils pouvaient manger de la barbe à papa et du chocolat… Pinocchio n’aurait pas pu imaginer un meilleur endroit où vivre. Les semaines passèrent, jusqu’au jour où il passa devant un miroir et eut une grosse frayeur.
– Mais comment?!! – dit-il en se touchant la tête – J’ai des oreilles d’âne !
Il courut le dire à l’Asperge et ne le trouva pas. A sa place il y avait un petit âne ! Tous les enfants avaient été transformés en ânes ! Il avait tellement peur qu’il voulut appeler à l’aide mais tout ce qu’il put faire, c’est brailler comme un âne !
Heureusement, son fidèle ami le grillon parlant indiqua à Pinocchio comment sortir de cet endroit.
Pinocchio et le grillon marchèrent pendant des jours pour rentrer chez eux et les oreilles d’âne disparurent finalement. Mais lorsqu’ils arrivèrent à la maison de Gepetto, ils la trouvèrent vide.
– Il n’est pas là! Mon père n’est pas là ! – dit Pinocchio en larmes
Une colombe qui passait par là entendit Pinocchio.
– Excusez-moi, mais est-ce que votre père s’appelle Gepetto ?
– Oui oui. Comment le sais-tu?
– Car je l’ai vu en mer. Il était dans un bateau et une énorme baleine l’a avalé.
– Une baleine? Vite criquet, il faut partir à sa recherche ! Merci colombe.
Pinocchio et le grillon atteignirent la plage et montèrent dans un petit bateau en bois. Ils dérivèrent pendant des jours dans l’immense océan. Un jour, ils crurent voir la terre au loin, mais lorsqu’ils se rapprochèrent, ils se rendirent compte que ce n’était pas la terre qu’ils voyaient mais la baleine qu’ils cherchaient.
Pinocchio laissa la baleine les avaler et ils furent plongés dans l’obscurité la plus totale. Pinocchio appela son père mais personne ne répondit. Dans l’estomac de la baleine, ce n’était que silence. Après un long moment, Pinocchio aperçu une petite lumière au plus profonds de la grotte et il crut entendre une voix familière.
– Pinocchio ? C’est toi, Pinocchio ? – cria la voix
– C’est mon père ! Papa ici, c’est moi. Je suis ici!
Père et fils purent enfin se serrer dans les bras après si longtemps. Ils étaient si heureux qu’ils oublièrent un instant qu’ils devaient trouver un moyen de sortir de là.
– Je sais – dit Pinocchio – nous ferons un feu en brûlant l’un des bateaux et ainsi la baleine éternuera et nous pourrons partir.
Le plan fonctionna, la baleine éternua si fort que Gepetto, Pinocchio et le criquet parlant se s’envolèrent. Ils étaient sur le point d’atteindre la plage lorsque Pinocchio vit à quel point son vieux père n’avait pas la force de continuer.
– Accroche-toi à moi. Je te porterai.
Pinocchio le porta sur son dos mais lui aussi commençait à être de plus en plus fatigué. Quand ils atteignirent le rivage, son corps en bois abandonna et se coucha face contre terre dans l’eau.
– Pinochio ! Non s’il te plaît! Ne pars pas, ne me laisse pas ici ! – cria Gepetto tristement en prenant Pinocchio dans ses bras.
A ce moment la Fée Bleue apparut.
– Geppetto, ne pleurez pas. Pinocchio a montré que même s’il a été désobéissant, il a un bon cœur et vous aime beaucoup. Il mérite donc de devenir un vrai petit garçon.
Alors la fée agita sa baguette et les yeux de Pinocchio s’écarquillèrent à nouveau. Il était devenu un vrai petit garçon.
Pinocchio, Gepetto et le cricquet rentrèrent chez eux et vécurent heureux pendant de nombreuses années.
Les valeurs du conte
L’histoire de Pinocchio est principalement une histoire de désobéissance et de mensonges par laquelle l’auteur prétend enseigner aux plus petits l’importance de valeurs opposées : l’obéissance et l’honnêteté. L’histoire est pleine de complications tant que Pinocchio n’arrête pas de désobéir et mentir, mais change radicalement lorsqu’il change de comportement et se décide à sauver son père qu’il aime. De cette manière, il montre aux enfants comment en étant bon et honnête, les choses tournent toujours mieux.
De la relation que Pinocchio entretient avec Gepetto, nous pouvons également extraire l’importance de l’amour, capable de donner au pantin la force d’affronter toutes sortes de dangers tels que la baleine ou l’effort de porter son père quand il n’en peut plus. En ce sens on peut aussi parler de sacrifice, puisque Pinocchio finit par donner sa vie pour sauver celle de son père.
Contes avec des valeurs similaires:
Blanche Neige
La petite Sirène
le laitier gourman
Chaperon rouge
Raiponce
La belle et la Bête
L’écureuil qui ne voulait pas apprendre à balayer

Il était une fois, dans une belle futaie de hêtres, onze petits frères écureuils, qui habitaient tous les onze ensemble. Ils avaient établi leur maison sur un ancien nid de pie, à une haute enfourchure. Ils jouaient du matin au soir parmi les branches ensoleillées à cache-cache, à l’écureuil perché, à saute-écureuil, ou bien ils dansaient des rondes dans la clairière.
Et leur vieille petite mère-grand, qui n’était plus très alerte, les surveillait du pas de la porte, toujours tricotant pour leur faire des cache-nez et toussant d’une jolie toux claire, en manière d’avertissement, lorsqu’un de ses onze petits-fils commençait quelque sottise.
Le plus petit s’appelait Guerlinguet. Il était un peu paresseux et surtout très obstiné, mais si drôlet, si vif et preste, avec une si jolie mine futée qu’il fallait l’aimer malgré tout.
Chaque soir, aussitôt le dîner fini, un écureuil rangeait la vaisselle en coquilles de noix et pliait les serviettes de feuilles jaunies. Et un autre écureuil balayait la cabane avec sa queue. Guerlinguet enlevait le couvert d’assez bonne grâce, mais il n’aimait pas à balayer. Quand il ne pouvait esquiver la corvée, il tournait trois tours de chambrette et donnait trois chiquenaudes sur le tapis de mousse. Pas une miette n’était seulement déplacée, et ses grands frères se voyaient forcés de refaire sa besogne, ce qui les fâchait beaucoup.
Et sa bonne mère-grand lui disait : Je sais, Guerlinguet, je sais pourquoi tu ne veux pas apprendre à balayer. Tu as peur de gâter ta belle queue rousse vernie, comme l’alisier d’automne, touffue et longue à ravir. Mais cela ne la gâterait pas, mon garçon. Lorsqu’une queue s’est empoussiérée, on la lave à la rosée du matin, en la passant dans les feuilles vertes, on l’essuie sur la fine écorce du hêtre, puis on se pavane au soleil pour la finir de sécher. Cela donne de la force au poil. Il pousse plus brillant et plus dru. Mais Guerlinguet secouait la tête, et n’en balayait pas plus.
Un jour que, laissé devant l’ouvrage, il était allé se construire une escarpolette, sans faire même semblant d’épousseter, ses aînés perdirent patience, et sa mère-grand finit par dire :
Écoute, Guerlinguet, cela ne peut plus durer. Puisque tu ne veux pas apprendre à balayer, nous allons te chasser du logis. Il te faudra diner par cœur (voir définition); tu coucheras à la belle étoile; si tu souhaites te divertir, tu valseras tout seul avec ta queue, et peut- être, par malchance, tu te feras croquer par le loup.
Et le petit Guerlinguet, qui était très entêté, répondit à sa mère-grand :
– Je veux bien diner par cœur, je veux bien coucher à la belle étoile, je veux bien être croqué par le loup, mais je ne veux pas apprendre à balayer.
– Entendu, dit la mère-grand : tu peux prendre ton baluchọn et chercher gîte où tu voudras.
Guerlinguet prit son baluchon et s’éloigna sans se retourner, se sentait le cœur lourd, mais il ne voulait pas le montrer. II suivit son chemin droit devant lui, bondissant de rameaux en ramilles et répétant de plus en plus haut :
– Je veux bien diner par ceur, je veux bien coucher à la belle étoile, je veux bien être croqué par le loup, mais je ne veux pas apprendre à balayer.
Comme il raisonnait et sautait, sans prendre garde à ses pattes, il manqua tout à coup sa branche et pouf! il tomba sur le dos du loup qui dormait. Le loup, réveillé en sursaut, se dressa, terrible, et ouvrit sa grande gueule pour le croquer. Mais Guerlinguet, tout à sa pensée, s’assit sur sa queue devant lui, et dit de son filet de voix têtu :
– Je veux bien être croqué, Monsieur le Loup, mais je ne veux pas apprendre à balayer.
Le loup fut si étonné qu’il en referma sa grande gueule. Il examina l’écureuil et se mit à se gratter l’oreille.
– C’est trop compliqué pour moi, dit-il enfin. Tu vas venir t’expliquer avec mon cousin le renard.
Haoup!… il enleva Guerlinguet par la peau du dos, brinque-balli-brinqueballant, tête de-ci et queue de-là, et il l’emporta dans sa gueule en le balançant. Le cousin Renard se polissait les ongles à l’ombre d’un cornouiller. Quand il entendit quelqu’un venir, il se leva pour s’étirer.
– Regarde un peu, mon cousin, dit le loup en lui posant Guerlinguet sous le museau. Voilà un écureuil qui ne veut pas apprendre à balayer.
– Et qu’est-ce que ça peut te faire? dit le renard. Tu n’as pas besoin de ça pour le croquer.
– Je ne vais certainement pas le croquer, dit le loup. Je suis le loup le plus important du pays. Chacun sait que j’ai l’habitude d’une nourriture choisie. De quoi aurais-je l’air si je mangeais un écureuil qui ne sait rien?
– Je n’y pensais pas, dit le renard; il nous faut remédier à cela. Et pourquoi s’entête-t-il, ce petit?
– Monsieur le Renard, dit Guerlinguet bien poliment, Monsieur le Loup ne va peut-être pas me croquer, mais ma mère-grand m’a mis dehors. Il faudra que je dîne par cœur; je ne sèmerai pas de miettes sur la mousse : je n’ai pas besoin d’apprendre à balayer.
– Il a raison, dit le renard qui riait sous cape. Si tu veux l’instruire, compère Loup, il faut que tu lui donnes à manger.
– J’ai compris, dit le loup, garde-le moi. Et houp! et houp! Le loup prend sa course à travers le fourré; il court, il trotte jusqu’à sa tanière; il tire de sa réserve un grand quartier de chair saignante et revient le jeter devant l’écureuil.
– Avale, dit-il à Guerlinguet, voilà ton déjeuner. Guerlinguet regarda la viande, la tête un peu de côté:
– Ah! non, dit Guerlinguet, la viande, je ne mange pas ça
– Ça va bien, dit le loup; je sais ce qu’il te faut.
Et houp! et houp! le loup reprend sa course à travers le fourré; il court, il trotte jusqu’à un champ de pommes de terre. Il gratte et creuse, emplit un sac et s’en revient toujours courant.
– Là! dit le compère Loup en vidant son sac devant Guerlinguet, avale voilà ton déjeuner.
Guerlinguet poussa un peu, du bout de la patte, les pommes de terre crues toutes terreuses.
– Ah non, dit-il, les pommes de terre, je ne mange pas ça.
– Tu n’y connais rien, compère, dit le renard, qui s’amusait beaucoup; les écureuils mangent des fruits. Je vais te donner un de mes renardeaux pour te guider.
Et houp! et houp! compère le Loup, un peu essoufflé, reprend sa course derrière le renardeau. Le renardeau l’emmène aux noisettes, à la récolte des faînes et des pommes de pin. Puis, dans le jardin d’un bûcheron, il lui fait voler des noix, des pommes, des poires, et quelques grappes de raisin. Le loup n’avait pas l’habitude de ces cueillettes, il suait et soufflait à plaisir. Enfin il vit son panier plein, et il le rapporta à Guerlinguet qui l’attendait bien tranquillement, assis à l’ombre de sa queue, dans la mousse, sous la garde du cousin Renard. Guerlinguet cassa, puis grignota les noix et les noisettes; il éplucha les faînes à loisir; il fit craquer les amandes de pin sous ses dents fines. Jamais il n’avait savouré une si friande collation. Il se pourléchait à chaque bouchée. Il ouvrit les pommes et les poires pour se régaler des pépins. Il suça le jus frais des raisins. Enfin il lustra ses moustaches; il épousseta son gilet blanc et gonfla sa queue rouge en panache.
II
– Eh bien! lui dit le cousin Renard, tu n’as pas dîné par cœur. Je pense que te voilà content?
– Oui, dit Guerlinguet, mais je ne veux pas apprendre à balayer.
Quand le renard entendit cela, et vit l’air déconfit du loup, il se reprit à rire jusqu’à s’en tenir les côtes.
– Il est trop malin, ton bonhomme, dit-il à compère le Loup. Il va venir conter son affaire devant mon ami le blaireau qui a le terrier le plus propre du bois et sait certainement tout ce qui concerne le balayage et les balais. Celui-là nous conseillera.
Haoup! Le cousin Renard enleva délicatement Guerlinguet par la peau du dos, brinqueballi-brinqueballant, tête de-ci et queue de-là, et l’emporta dans sa gueule en le balançant.
L’ami Blaireau rêvait au soleil à l’entrée de son terrier. Il est toujours d’humeur triste et grogne ou geint entre ses dents. Quand il vit approcher le renard et le loup, et Guerlinguet qui se laissait sagement porter, il se leva tout soupirant.
– Regarde un peu, l’ami Blaireau, dit le renard en lui posant son prisonnier entre les pattes. Voilà un écureuil qui ne veut pas apprendre à balayer.
– Hélas! de quoi vous inquiétez-vous là? dit le blaireau; le prenez-vous pour valet de chambre? Vaudrait-il pas mieux nous le partager?
– C’est mon avis, reprit le renard, mais voilà mon compère Loup qui ne veut plus manger que des écureuils savants. Nous requérons ton aide à ce propos.
– C’est autre chose, dit le blaireau. Et qu’est-ce qui empêche votre nigaud d’étudier une science aussi simple? Le lui avez vous demandé?
– Monsieur le Blaireau, dit Guerlinguet paisiblement, Monsieur le Loup ne m’a pas croqué et je n’ai pas dîné par cœur, mais ma grand’mère et mes frères m’ont mis à la porte. Je dois coucher à la belle étoile. Puisque je n’ai plus de maison, je n’ai pas besoin d’apprendre à balayer.
– Cet écureuil est le bon sens même, dit le blaireau. Si vous voulez qu’il balaie, il faut lui bâtir une maison.
– J’ai compris, dit compère Loup; gardez-le-moi.
Et houp! et houp! le loup prend sa course. Il revient roulant une grosse pierre, puis il en amène deux, puis trois; il traîne quelques lourdes branches mortes, un fagot d’épines et une motte de boue. Il empile le tout à grands coups de nez pour construire une espèce de grotte basse, qui rappelait en petit son repaire.
– Entre là, dit-il à Guerlinguet, te voilà logé. – C’est ouvert à tous les vents, dit Guerlinguet. Je n’habite pas ces maisons-là.
– Je sais ce qui lui convient, dit le blaireau. Je vais t’aider, compère Loup. Nous lui creuserons un terrier.
Et groum! et groum! le loup et le blaireau s’enfoncent dans le sable côte à côte, fouissent du museau et des griffes, rejettent les cailloux derrière eux.
Le pauvre loup éternuait et s’époumonait; le gravier lui piquait les yeux; il se cassa même un ongle. Enfin le terrier fut achevé.
– Entre là, dit le blaireau à Guerlinguet, te voilà logé.
– Il y fait noir comme chez une taupe, dit Guerlinguet; je n’habite pas les maisons sous terre.
– Vous n’y connaissez rien, mes amis, dit le renard; les écureuils nichent sur les arbres. Je vais vous donner un de mes renardeaux qui vous montrera ce qu’il faut m’apporter. Je m’institue maître du chantier.
Mais l’ami Blaireau n’y voulut pas aller. Et houp! et houp! le loup tout seul reprit donc sa course derrière le renardeau. Dans les taillis bas et les brandes, il récolta de la bruyère, du genêt, de la mousse, puis conseillé par le renard, il dut les disposer dans le tronc creux d’un, vieux chêne. Ses pattes maladroites s’agaçaient à tresser les murs et à aplanir le sol tandis que le blaireau gâchait des boulettes de glaise pour tout consolider. Enfin le toit en cône fut posé, et le loup put réveiller Guerlinguet qui faisait un petit somme, roulé en boule dans l’herbe fine, le nez entre les pattes et la queue au soleil, toujours gardé par le renard.
Guerlinguet considéra la jolie logette fraîche et bien close, qui sentait bon le genêt et la bruyère. Il essaya les matelas de mousse, il éprouva les murs de la patte. Enfin il s’assit sur le seuil, d’un air satisfait de propriétaire.
– Eh bien, lui dit l’ami Blaireau, tu ne coucheras pas à la belle étoile! Il me semble que tout est arrangé?
– Non, dit Guerlinguet, je ne veux pas apprendre à balayer.
Lorsque le blaireau l’entendit, il se trouva fort penaud, d’autant que le loup montrait les dents et que le renard s’esclaffait.
– Il faut le mener à Madame Chouette, dit-il enfin, l’air désolé. Elle est voisine des écureuils et connaît tout ce qui les concerne.
– Peut-être nous tirera-t-elle d’embarras.
Haoup! le blaireau saisit Guerlinguet par la peau du dos, brinqueballi-brinqueballant, tête de-ci et queue de-là, et l’emporta dans sa gueule mi-le traînant, mi-le balançant. Le cousin Renard trottait auprès, et le loup suivait sur trois pattes.
Madame Chouette est une compatissante personne. Elle loge dans un rocher creux, tout près du hêtre où la grand’mère écureuil et ses petits-enfants ont établi leur maison. Elle connaissait bien Guerlinguet et elle eût souhaité le délivrer.
– Regarde un peu, Madame Chouette, lui dit le blaireau en posant Guerlinguet sur la mousse. Voilà un écureuil qui ne veut pas apprendre à balayer.
– Et de quoi vous venez-vous mêler? dit la chouette. C’est l’affaire de sa famille. Laissez-le rentrer chez lui.
– Moi, cela me serait égal, reprit le blaireau. Mais, pour notre compère Loup, c’est une question de dignité. Il ne trouve pas séant de le manger avant que son éducation soit parfaite.
– Je vais donc m’en occuper, dit la chouette. Voyons, Guerlinguet, pourquoi fais-tu le paresseux?
– Madame la Chouette, dit Guerlinguet en levant son petit nez hardi, Monsieur le Loup ne m’a pas croqué, je n’ai pas dîné par cœur, je ne coucherai pas à la belle étoile, mais ma grand’mère m’a chassé et mes petits frères ne veulent plus jouer avec moi. Si je souhaite me divertir, je devrai valser tout seul avec ma queue. Je n’ai pas le cœur d’apprendre à balayer.
– Qui est-ce qui pourrait te blâmer? s’écria la chouette. C’est trop évident, mes compères. Il est mélancolique, ce mignon. Avant de songer à l’éduquer, il faut que vous dansiez avec lui.
– Ça me va, dit le cousin Renard: en place pour la contredanse.
– Ça ne me va pas du tout, dit le loup; je comprends bien qu’il faut danser, mais j’ai tant couru, tant creusé, tant bâti, que mes pauvres pattes sont raides comme bois!…
Mais personne ne l’écoutait. Un merle, sur une branche, siffla l’air de la bourrée et les danseurs choisirent leurs places. Et quand revint la ritournelle, voilà le malheureux loup, épuisé mais prêt à tout faire en conscience, qui prend son élan comme les autres. Et houp!… et houp!… il suivait de son mieux la mesure, bondissant et se trémoussant, avec carrements et révérences, avec des entrechats et des jetté-battus et jusqu’à des cabrioles. Le renard, en face de lui, exécutait une petite gigue, les pattes de devant sur les hanches, sans perdre de l’œil Guerlinguet. Le bon gros blaireau se dandinait d’un flanc sur l’autre, trop lourd pour mieux s’évertuer et la chouette, son vis-à-vis, les ailes demi-soulevées, pirouettait avec beaucoup de grâce.
Jamais on n’a vu telle bourrée. Guerlinguet, qui était fou de danse, faisait le plus beau cavalier seul. Il valsait, virait, voltait, en faisant panache de sa queue, s’amusait comme cent écureuils, frivolait et tourbillonnait.
Ses dix petits frères et petites sœurs, attirés par le tapage, vinrent se ranger sur une branche et ils regardaient, bien étonnés, toute cette brillante assemblée qui donnait le bal à Guerlinguet.
Après la bourrée ce fut un branle, après le branle un rigodon. Quand Guerlinguet fut las de sauter, il s’assit sur un champignon et regarda tourner les autres, en s’éventant du bout de sa queue.
Enfin le rigodon s’acheva. Le loup, rendu, se laissa rouler sur l’herbe, et tout le monde reprit haleine.
– Eh bien! Guerlinguet, dit la chouette en clignant son grand œil vert, nous t’avons tenu tête aux danses, tu n’as pas valsé tout seul avec ta queue. Je pense que te voilà satisfait?
– Ça ne fait rien, dit Guerlinguet. Je ne veux pas apprendre à balayer.
Quand le loup l’entendit, il perdit courage, leva la tête, ouvrit la gueule, et se mit à hurler comme un désespéré. Et hou… hou… hou… tout le bois en retentissait. Les fouines et les jeunes belettes montraient le nez aux trous des vieux troncs; les lézards verts risquaient un regard entre deux touffes de colchique; les petits oiseaux se rassemblaient à tire-d’aile pour savoir les ennuis du loup.
Il aurait hurlé jusqu’au soir sans une petite toux claire, très haut dans l’arbre au-dessus de sa tête, qui le fit soudain s’arrêter.
C’était la grand’mère écureuil qui se penchait un peu entre les feuilles, assise au seuil de sa maison.
Elle avait grand’peur en voyant son petit-fils prisonnier de tant de bêtes dangereuses, mais elle n’en laissait rien paraître, et tricotait d’un air tranquille.
– Pourquoi nous assourdis-tu, compère Loup? dit-elle. Est-ce mon mutin de Guerlinguet qui te tourmente?
– Oui! Oui! Oui!… c’est ton Guerlinguet : il ne veut pas apprendre à balayer! hurla le loup exaspéré.
– Je le sais bien, dit la mère-grand; j’ai un peu de rhumatisme aux pattes, et je ne peux pas l’aller morigéner, mais il suffit de me l’envoyer. Je lui allongerai les oreilles, et je te réponds qu’il balaiera.
– Je ne te conseille pas ça, mon compère, souffla le renard; quand un écureuil est lâché, il faut des ailes pour le rattraper.
– Ça va bien, gronda le loup. Il ira et je ne le lâcherai pas; mes dents sauront lui tenir la queue. Allons, l’écureuil, grimpe là-haut, que ta grand’mère t’allonge les oreilles.
Haoup! Compère Loup saisit la queue de Guerlinguet dans sa gueule, et le pousse pour qu’il grimpe au hêtre.
Mais Guerlinguet eut beau aller jusqu’au bout de sa longue queue tandis que le loup se levait sur les pattes de derrière, il ne put atteindre bien haut.
– Vous êtes loin de compte, dit le renard; perche-toi sur mes épaules, mon compère, et surtout ne lâche pas la queue.
Le loup monta sur les épaules du renard qui se dressa tout debout contre l’arbre, mais Guerlinguet touchait à peine aux premières feuilles.
– Nous n’y sommes pas, dit le renard, viens là, l’ami Blaireau, que tu me prêtes tes épaules.
Le blaireau prêta ses épaules et se fit aussi grand qu’il put, portant le renard, qui portait le loup, qui tenait Guerlinguet par la queue.
– Nous y sommes presque, dit le blaireau. Viens ça, Madame Chouette, que tu me prêtes tes épaules.
– Tu n’y penses pas, notre ami, dit la chouette : vous êtes trop lourds pour que je vous porte. Je vais pincer les poils de ta nuque dans mon bec et tirer en battant des ailes; ainsi je t’aiderai à te hisser sur cette racine.
La chouette tira le blaireau par les poils, le blaireau se hissa sur la racine, soulevant le renard, qui souleva le loup, qui tenait Guerlinguet par la queue, et le petit écureuil arriva jusqu’à sa grand’mère.
– Nous y voilà, dit la maligne grand’mère. Je vais lui tirer les oreilles. Tu tiens bien sa queue, compère Loup? tu n’as pas peur de lâcher?
– Non, non, dit le loup, ouvrant la gueule pour répondre, tu peux tirer, je le tiens ferme.
Mais dès qu’il desserra les dents, Guerlinguet, sentant sa queue libre, fit un bond pour se dégager, en décochant deux bonnes ruades griffues sur le museau du loup.
Le loup perdit l’équilibre; il s’abattit à la renverse sur le renard, qui tomba sur la tête du blaireau, qui dégringola de sa racine en entraînant la chouette.
La chouette s’envola vers son gîte, bien aise et chantant victoire.
Le blaireau plongea dans ses souterrains.
Le renard déguerpit en s’étouffant de rire, et le pauvre loup demeura tout seul, assis sur son derrière, le nez en l’air, la gueule ouverte, avec deux longs poils rouges encore accrochés aux dents.

 Tous les écureuils, sur leur arbre, se gaussaient de sa mine ahurie: ils lui jetaient des coques de faînes, des bouts d’écorce, des brindilles, tant qu’il ne put rassembler ses esprits et s’enfuit sans y rien comprendre, furieux, honteux et moulu.
Tous les écureuils, sur leur arbre, se gaussaient de sa mine ahurie: ils lui jetaient des coques de faînes, des bouts d’écorce, des brindilles, tant qu’il ne put rassembler ses esprits et s’enfuit sans y rien comprendre, furieux, honteux et moulu.
Les petits écureuils, bien joyeux de retrouver leur frère, sautaient tous dix autour de lui.
– Tu vois, Guerlinguet, disaient-ils, tu vois ce qui t’est arrivé. Voilà ce que c’est que d’être entêté.
– Et qu’est-ce qui m’est arrivé? répondait Guerlinguet, en se balançant au bout d’une branche; et qu’est-ce qui m’est arrivé? Le loup ne m’a pas croqué; je n’ai pas dîné par cœur; je n’ai pas couché à la belle étoile; je n’ai pas valsé tout seul avec ma queue et je n’ai pas appris à balayer.
Mais, comme c’était au fond un gentil petit écureuil et qu’il voulait faire plaisir à sa grand’mère, après cette aventure, il a tout de même appris à balayer.
Premier chapitre des Contes du Ver Luisant, écrit par Jeanne Roche-Mazon (1885-1953), illustrés par O’Klein (1893-1985 – Avec l’autorisation des héritiers).
Lire aussi:
La moitié de Jau
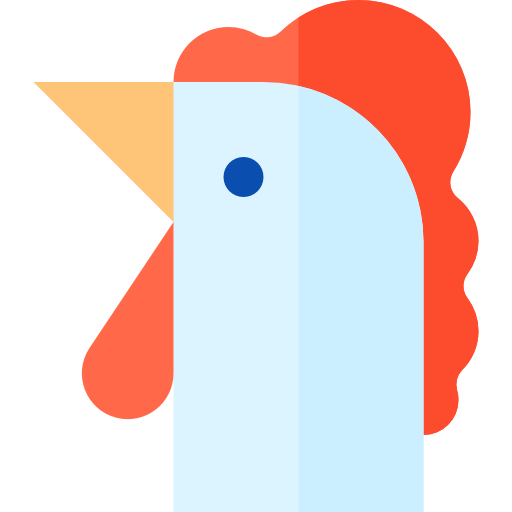
UN ancien soldat s’était retiré au village après avoir longtemps servi le roi. Se voyant assez près de sa fin, il fit commandement à ses deux fils de n’appeler bailli ni procureur pour disposer de son héritage.
– Ces chats-fourrés vous grugeraient, leur dit-il. Mieux vaut s’arranger entre frères. Cela est facile, puisque chacun de vous a droit à la moitié de toute chose. Sosthène, qui est le plus âgé, composera les lots : il a l’esprit propre à bien évaluer. Vous vous mettrez d’accord pour le choix, et je vous supplie, mes enfants, par l’affection que je vous porte, de ne vous quereller en rien à propos de ces pauvres biens. Mieux vaut que l’un cède à l’autre une bagatelle que de rendre les voisins témoins d’une désunion entre frères, et de recourir à la justice.
Lorsque le bonhomme fut mort et que ses fils durent songer au partage, Sosthène vint dire à son frère :
– Je m’en vais faire les lots, comme l’a ordonné notre père. Mais il me semble juste que ce soit moi qui choisisse ensuite le premier, puisque je suis ton aîné de cinq ans.
– C’est la justice même, dit Stéphane, qui avait un cœur confiant. Fais les lots et choisis le premier.
Là-dessus, Sosthène sembla réfléchir profondément. Notre père, dit-il, possédait deux maisons : celle du village et celle des bois. Je prends la maison du village avec son mobilier et la terre qui l’entoure, et tu prendras de même la maison des bois.
– Stéphane demeura saisi de surprise. Ce que le soldat appelait en plaisantant sa maison des bois n’était qu’une hutte à piper les oiseaux, au milieu d’un carré de taillis clairsemé qui ne rapportait pas trente-cinq sols en dix ans. De meubles, elle n’en contenait point, sinon une botte de fougère pour s’étendre, un banc boiteux et une marmite mise au rebut.
– L’étable loge deux bêtes à cornes, continua Sosthène. Je choisis la vache et je te donne la chèvre. Sur six poules, tu en auras trois, et je pense que te voilà satisfait.
– Mais notre père possédait de l’argent, dit le pauvre Stéphane timidement. Est-ce que je n’y ai pas droit aussi?
– L’aîné n’osa pas dire non, et sa figure s’allongea quand il fit tomber d’un bas de laine rouge cent beaux écus d’or reluisants. Mais il se trouvait un papier au fond du bas. Et c’était une reconnaissance du Roi, pour cent écus d’or justement, dus à l’ancien soldat sur sa paie.
Il était connu dans le pays que le Roi ne payait jamais ses dettes, mais faisait bâtonner ou pendre ceux qui osaient les réclamer. Pourtant Sosthène remit le papier à son cadet, et il garda les écus sans vergogne, en déclarant le partage fini.
Stéphane avait les larmes aux yeux à se voir ainsi dépouillé, et surtout à découvrir le mauvais cœur de son frère qu’il aimait tendrement jusque-là. Il aurait pu se plaindre et réclamer, mais il se souvenait des dernières paroles de son père et ne voulait pas lui désobéir.
Il mit donc ses hardes dans un sac et ses trois poules dans un panier, et il franchissait le seuil lorsque le coq du logis vola soudain à travers la cour et vint se percher sur son épaule.
– Nous avions oublié le Jau, dit Sosthène (car on appelle ainsi les coqs au village). Comme il n’y en a qu’un seul, il faut le couper par la moitié.
– Aurais-tu le cœur de tuer cette gentille bête, s’écria Sté phane, qui nous suit partout comme un chien et vient manger au bout de nos doigts? Tu peux bien me l’offrir en sus de ma part : cela ne t’appauvrira pas tant.
– Et pourquoi te faire ce présent? dit l’avare.
– Alors, garde-le tout entier, reprit Stéphane. Ce Jau était aimé de mon père qui le trouvait drôle en ses façons et lui croyait assez de malice pour en remontrer à un sorcier. Il ne sera pas dit que je l’aurai fait dépecer par convoitise.
Cet arrangement plaisait à Sosthène, mais soudain il se ravisa et saisit le coq par les pattes.
– Je vois ta ruse, dit-il à son frère. En sortant d’ici tu irais te plaindre de moi, prétendant que tu n’as pas reçu ta part d’héritage au complet. Il s’arma d’un grand couteau et fendit le coq en deux, depuis la crête et le bec jusqu’à la pointe du croupion, si adroitement qu’il n’y avait pas une plume de différence entre les deux moitiés.
Il en jeta une à son frère, le poussa par les épaules et lui ferma la porte derrière le dos.
Puis, rentré dans sa maison bien meublée, il se fit un ragoût avec son demi-coq et le mangea tout au souper.
Le pauvre Stéphane, confondu de tristesse, gagna sa hutte au fond des bois. En y arrivant, comme il examinait sa moitié de Jau, il reconnut qu’elle n’était pas tout à fait morte, bien qu’il s’en fallut d’assez peu. Et comme il avait l’âme pitoyable, il oublia ses chagrins à soigner la misérable bestiole. De longues nuits se passèrent en veilles, de longs jours en pansements difficiles. Le jeune homme vendit ses meilleures hardes pour payer des pots d’onguents, de l’Elixir mystérique et du Baume Samaritain, mais il s’acharna si bien qu’il guérit la Moitié de Jau.
Dès que la Moitié de Jau fut guéri, il devint une grande compagnie pour Stéphane. Il sautait sur son unique patte aussi vite que couraient les trois poules, il battait de son unique aile et chantait avec sa moitié de bec et sa moitié de gosier plus haut et plus clair qu’il n’avait fait de sa vie. Il s’était mis aussi à parler, le couteau de Sosthène lui ayant tranché le filet, sans – doute, ou taillé la langue plus déliée, et c’est alors que se dé ploya son esprit. On le vit raisonner comme un maître d’école, argumentant à tout propos et ne laissant le dernier mot à personne.
Un jour, en grattant la poussière, il découvrit quatre sous neufs. Cette trouvaille le fit réfléchir. Puis il s’en alla vers son maître qui rêvait tristement dans sa hutte, et il se percha près de lui sur la marmite fêlée.
– Mon maître, lui dit-il, quand vous m’avez sauvé la vie, vous n’obligiez pas un ingrat. Allons ensemble chez le roi et réclamons vos cent écus.
– Hélas, ma pauvre Moitié de Jau, dit Stéphane, pour entrer dans la ville du Roi, il faut payer en passant le pont.
– Bah, fit le coq, n’est-ce que cela? J’ai quatre sous, je paierai pour vous. Mais, pour tenir mon rang là-bas, je veux un habit bleu à la française, culotte courte et chapeau tricorne.
Le tailleur du village était un ami de mon père, dit Stéphane. Peut-être te fera-t-il crédit.
La Moitié de Jau sut parler au tailleur et se fit habiller à crédit. Mais le plumassier ne voulut rien entendre, ni le passementier, ni la lingère. Si bien que le plumet manqua au chapeau, les rubans en floquet à la jarretière, et le mouchoir dans la pochette, ce qui vexait le coq cruellement.
– Partons, dit-il à son maître. Je ne sais comment je m’y prendrai, mais que je devienne un quart de Jau si je me présente ainsi devant le Roi.
La Moitié de Jau et son maître partirent ensemble de grand matin.
Stéphane dit adieu à la chèvre, la Moitié de Jau à ses trois poules. Ils les recommandèrent aux voisines et prirent à travers prés pour gagner la ville du Roi. Bientôt sur leur chemin, ils trouvèrent une petite rivière : elle reflétait le ciel bleu et les herbes vertes; elle était charmante à voir, mais elle leur barrait le passage. La Moitié de Jau ne se déconcerta pas. Il ôta son chapeau tricorne et fit signe à Stéphane de se découvrir aussi.
– Le bonjour, Madame Rivière, dit-il avec politesse. Je vais saluer le Roi. Veux-tu venir avec moi?
– Le bonjour à vous, gens honnêtes, répliqua la rivière flattée. J’irais volontiers chez le Roi, mais les gardes ne me laisseront pas entrer sans argent.
– Bah, fit le coq, n’est-ce que cela? Roule ton ruban comme un floquet galant et viens te nouer à ma jarretière. J’ai quatre sous : je paierai pour tous.
La rivière enchantée ne se le laissa pas dire deux fois, et quand la Moitié de Jau reprit sa route, modeste et tendant la patte, un floc de ruban vert et bleu lui tombait jusqu’à l’ergot.
Un peu plus loin, les voyageurs s’engagèrent dans un pays boisé, mais, comme ils voulaient traverser une lande de bruyère, ils virent que des paysans l’avaient allumée pour la défricher. Le feu venait à leur rencontre et les empêchait de passer.
La Moitié de Jau tira bien vite sa coiffure, tandis que son maître l’imitait.
– Le bonjour, Monsieur Feu, dit-il. Je vais saluer le Roi.
– Veux-tu venir avec moi? Le bonjour à vous, gens honnêtes, répondit aussitôt le feu. Je ferais bien visite au Roi, mais ses soldats gardent la porte.
—Bah! dit le coq, n’est-ce que cela? Ébouriffe ta flamme en plumet et viens te planter à mon chapeau. J’ai quatre sous: : je paierai pour tous. Le feu ne se fit pas prier, et la Moitié de Jau repartit fièrement. Il sautillait à côté de son maître et relevait haut la tête pour faire admirer son panache.
Bientôt ils aperçurent les tours blanches et les toits dorés de la ville. Mais un grand vent s’était levé qui soufflait juste en face d’eux, si fort qu’ils ne pouvaient avancer.
Stéphane retira son bonnet. La Moitié de Jau leva son chapeau tricorne et il dit aimablement:
— Le bonjour, Monsieur Vent. Je vais saluer le Roi. Veux-tu venir avec moi?
— Le bonjour à vous, gens honnêtes, siffla le vent. J’aimerais rendre hommage au Roi, mais les gardes du palais me ferment portes et fenêtres au nez.
— Bah, dit le coq, n’est-ce que cela ? Plie-toi en quatre seulement, comme un mouchoir élégant, et niche-toi dans ma pochette.
— Je t’introduirai jusqu’aux pieds du trône. Lorsque le vent bien plié se fut glissé dans la pochette, la Moitié de Jau se prit à marcher trois pas devant son maître, tendant le jarret, levant le bec et se rengorgeant. Jamais on n’avait vu plus chatoyant floquet qu’à sa jarretière, plus flamboyant plumet qu’à son chapeau bleu, ni mouchoir d’un plus fin tissu que celui qui sortait de sa pochette.
En passant le pont-levis pour entrer dans la capitale, il jeta fièrement ses quatre sous aux gardes, puis il mena son maître au palais.
— Mais le portier du roi savait recevoir les créanciers. Il n’eut pas plus tôt vu la reconnaissance de dette qu’il croisa la halle barde en riant, et menaça de lâcher les chiens.
– Nous n’arriverons à rien de la sorte, dit la Moitié de Jau.
— Allez à l’auberge, mon maître, et laissez-moi mener vos affaires.
Resté seul, le vaillant coq fit le tour du château royal en sautant sur sa patte unique. Il arriva ainsi aux basses-cours et vit qu’une simple palissade les enfermait. Entre les pieux, les fentes n’étaient pas assez larges pour laisser passer la plus mince poulette. Mais un demi-Jau tout plat trouvait l’entrée suffisante.
Il se faufila donc dans la basse-cour du palais et par chance il y rencontra le Roi.
Ce prince aimait tant les oeufs frais qu’il daignait les dénicher lui-même. Il en rapportait six, ce jour-là, dans un pli de son manteau d’hermine, et il paraissait joyeux. Mais il devint blanc de colère quand la Moitié de Jau se planta sur sa route pour réclamer les cents écus.
Allongeant le bras tout d’un coup, il enleva le pauvre coq par l’aile.
— Je vais te mettre aux épinettes, cria-t-il tout furibond, et je te mangerai dimanche. Qu’en diras-tu, mon camarade?
— Rien du tout, fit la Moitié de Jau, mais j’ôterai le plumet de mon chapeau et que la Coquelure me coquefague si tu ne te repens pas bientôt.
Le Roi le jeta à la volée entre les mains du basse-courier. Fourre-moi ce morceau de poulet aux épinettes, dit-il, et gave-le pour qu’il engraisse. Je veux le goûter en fricassée.
Sitôt que la Moitié de Jau se vit enfermé, il se prit à crier bien haut :
— Feu! Feu! quitte mon chapeau bleu, ou je suis un petit poussin perdu!
Le feu quitta le chapeau en faisant claquer ses flammes. En un moment il eut brûlé la porte des épinettes, par où sortit la Moitié de Jau, puis il brûla les poulaillers, la vacherie, la por cherie, la bergerie, dont tout le bétail dut fuir en hâte. Il léchait les murs du palais quand cent valets accourus réussirent enfin à l’éteindre.
Le coq rejoignit Stéphane à l’auberge : il partagea son souper de bon appétit et passa la nuit sur le pied de son lit. Le lendemain, à midi sonnant, il se glissait de nouveau dans la basse-cour du palais. Comme il n’y trouva personne, il monta l’escalier de service et pénétra dans la salle à manger.
Le Roi était à table, sur son fauteuil à dorseret, un gros pâté dans son assiette.
Quand le demi-coq vola devant lui, au milieu des plats, il pensa s’étouffer de colère et le saisit à la gorge aussitôt.
— Tu viens chercher l’argent de ton maître, insolent oiseau, lui dit-il. Que feras-tu si je te jette dans ce feu pour t’y flamber, t’y griller, t’y réduire en carbonade?
— Presque rien, dit la Moitié de Jau. Je dénouerai le floquet de ma jarretière, et que la Coquefague me coquefredouille si tu ne te repens pas soudain.
— J’en suis curieux, dit le Roi. Et il le lança dans la cheminée où brûlaient plus de dix fagots, avec des flammes à faire frémir.
Mais la Moitié de Jau criait à tue-tête : Rivière, Rivière! quitte ma jarretière, ou je suis un petit poussin perdu! Et la rivière, aussitôt, déroula ses ondes, qui éteignirent le feu, d’abord, et emplirent en bouillonnant la salle à manger.
Tout le monde monta sur les chaises, puis sur la table, et le flot s’élevait toujours. Le roi était grimpé au dorseret de son fauteuil, mais il sentait ses jambes dans l’eau, et voyant la Moitié de Jau perché sur la corniche, qui contemplait de haut tout ce tu multe, il le supplia de renouer sa jarretière.
— Je la renouerai, dit le coq. Mais je veux nos cent écus, ou ta fille en mariage pour mon maître.
— Vous aurez vos cent écus, dit le Roi. Venez demain, ton maître et toi. Mon trésorier vous remboursera. Alors la rivière s’écoula dans les corridors, et le Jau descendit fièrement par le grand escalier d’honneur, entre tous les chambellans faisant la haie.
Stéphane n’en crut pas ses oreilles en apprenant qu’il recevrait son dû. Il fit toilette le lendemain. La moitié de Jau défripa son habit et épousseta son chapeau tricorne, et tous deux se rendirent au palais.
On les attendait, et les portes s’ouvrirent grandes pour eux. On les conduisit sur une terrasse où le roi trônait en cérémonie avec sa fille à ses côtés et toute sa cour bien rangée, dessinant un parfait demi-cercle. Mais la Moitié de Jau s’inquiéta parce que la Princesse pleurait. En tournant la tête, il découvrit deux potences préparées : une grande potence à pendre un homme, et une petite auprès, de très bonne taille pour un coq.
— Te voilà dans mes mains, pauvre fragment de volaille, dit le Roi, et ton niais de maître avec toi. Tu vas voir comment je paie mes dettes. Quand on vous aura tous deux suspendus par le col, que trouveras-tu encore pour te défendre?
— Peu de chose, dit la Moitié de Jau. Je déplierai le mouchoir de ma pochette et que la Coquefredouille me coquelure, si tu ne vois pas ce que tu verras.
— Voyons-le donc! dit le Roi.
La Princesse, qui avait l’âme honnête et trouvait bonne mine à Stéphane, s’était jetée à genoux devant son père pour le supplier.
Il l’écarta du bout de son sceptre et fit signe aux bourreaux d’avancer; mais la Moitié de Jau criait :
— Vent! Monsieur Vent! déplie-toi vitement, ou sans ça j’sommes tretous perdus.
Le vent se déploya d’un seul coup, enleva les deux potences et les bourreaux en tourbillon, fit envoler par les airs les major domes, les huissiers, les soldats, les grands seigneurs, et il allait saisir le Roi quand celui-ci se mit à clamer:
– Replie ton mouchoir, Moitié de Jau, mon trésorier va vous payer.
Le vent n’avait pas enlevé le trésorier. Ce pauvre homme s’approcha tout frissonnant avec un gros sac d’écus. Il commençait à les compter, mais le Roi n’eut pas le courage de le laisser faire.
— Jamais je n’ai payé mes dettes, dit-il. Je ne peux pas commencer à mon âge. J’aime mieux donner la main de ma fille.
Le vent n’avait pas enlevé la fille du Roi, et Stéphane put voir qu’elle était jolie comme une rose. Il consulta de l’œil la moitié de Jau qui, de tout son demi-cœur, hochait sa demi-crête en signe de consentement, et il accepta sans se faire prier. La Princesse et lui furent mariés à l’heure même et ils vécurent toujours heureux.
Le méchant Roi fut bientôt chassé par ses peuples, et le fils du soldat monta sur le trône. Il ne fut pas ingrat envers la Moitié de Jau: il en fit son ministre, son conseiller intime, et, pour l’honorer plus encore, il donna ordre en son royaume de placer l’image du brave coq, bien ciselée, bien plate et dorée, sur la pointe des plus hautes tours.
C’est depuis ce temps qu’on met des coqs aux clochers.
Réédition des Contes du Ver Luisant, écrit par Jeanne Roche-Mazon (1885-1953), illustrés par O’Klein (1893-1985 – Avec l’autorisation des héritiers)
Lire aussi :
L’oiseau bleu

Il était une fois un roi qui avait une fille belle comme le jour, intelligente et aimable, et qui s’appelait Florine. Ayant perdu son épouse, après quelques années il se remaria avec une femme à l’honnêteté douteuse, qui installa au château sa fille du même âge, qu’on appelait Truitonne, car sa laideur et sa bétise lui faisaient ressembler à une truite.
Quand vint le moment de marier les princesses, le prince Charmant appelé à la cour tomba fou amoureux de Florine.
Mais sa belle-mère la reine voulait le prince pour sa fille Truitonne et elle fit enfermer Florine dans une tour pendant le reste de la visite du prince. Celui-ci, désespéré, crut avoir trouvé un moment pour parler seul à seul avec sa bien aimée, mais il fut trompé par la reine, et donna son anneau de fiançailles à Truitonne, qui avait pris la place de Florine en maintenant son visage caché.
Le lendemain, croyant toujours avoir affaire à sa belle, il enleva Truitonne dans un char volant, tiré par deux grenouilles ailées et lui jura de l’épouser.
Il arrivèrent chez la marraine de Truitonne, la fée Soussio qui voulut les marier sur place. Mais le prince, réalisant qu’il avait été berné, et avait enlevé Truitonne au lieu de Florine, refusa catégoriquement le mariage. Alors la fée le changea en oiseau bleu pour les sept années suivantes.
Truitonne revint au château et sa mère fit croire à la princesse que le mariage avait vraiment eu lieu en montrant la bague que le prince avait donnée à Truitonne par mégarde.
Florine fut si triste qu’elle en pleurait jour et nuit, implorant le ciel par la fenêtre de sa chambre.
Un soir, se posa au balcon un charmant oiseau bleu, qui revint plusieurs jours de suite, portant dans son bec de beaux bijoux qu’il offrait à la princesse.
Mais la reine s’en aperçut et fit poser un piège qui lui coupa les pattes.
L’oiseau bleu fut alors recueilli par un enchanteur qui obtint de la fée Soussio de lui rendre sa forme humaine, à la condition qu’il épouse vraiment Truitonne. Le prince dût se résigner.
Ignorant cela, triste, mais déterminée à retrouver son prince, Florine prit la route et rencontra une fée qui lui donna 4 œufs magiques pour l’aider dans son entreprise.
Elle arriva au château du Prince Charmant et se déguisa en marchande pour s’introduire au palais. Grâce aux œufs magiques, elle obtint l’attention des souverains.
Quand le Prince la reconnut, il tomba à genoux et pleura de joie en la serrant dans ses bras.
La bonne fée et l’enchanteur les marièrent sur le champs et Truitonne fut changée en truie.
Conte de Madame d’Aulnoy résumé et modernisé. Illustrations tirées des images d’Épinal.
Ondine

ONDINE
I – L’ARRIVÉE DU CHEVALIER
Il était une fois un vieux pêcheur qui vivait dans une contrée merveilleuse. La pointe de terre, couverte de gazon fleuri, où s’élevait sa chaumière, s’avançait très loin au milieu des eaux d’un grand lac, et les ondes bleues caressaient ce sol ombragé de beaux arbres.
Les hommes ne s’étaient pas encore partagé cet endroit délicieux : le pêcheur et sa famille en étaient les seuls habitants.
Cela tenait sans doute à ce que derrière cette presqu’île de rêve s’étendait une sombre forêt, réputée fort dangereuse, repaire, disait-on, d’esprits malins et pervers, en tout cas si effrayante que personne n’osait s’y aventurer.
Cependant, pour aller vendre les produits de sa pêche à la ville voisine, le vieux pêcheur l’avait bien des fois traversée, et toujours sans accident ; mais il faut dire que le bonhomme avait le cœur pur et que toutes ses pensées allaient à Dieu : encore avait-il soin, afin d’armer son courage, d’entonner des cantiques dès l’instant où il abordait l’ombre épaisse des fourrés.
Or, ce soir-là, tandis qu’il raccommodait tranquillement ses filets au seuil de sa cabane, le bon pêcheur entendit soudain un bruit étrange qui semblait provenir de la forêt : on eût dit la course folle d’un cheval au galop. Il ne put s’empêcher de penser aux visions qu’il avait eues, certaines nuits de tempête : surtout l’image d’une sorte de géant, blanc comme neige, au chef branlant, lui revint en mémoire, et, comme il regardait dans la direction de la forêt, voici qu’il crut apercevoir le fantôme parmi les arbres.
Il frissonna ; seule, l’idée que la verte et riante prairie où il se trouvait le mettait à l’abri des mauvais génies de la forêt parvint à le rassurer. Et puis, une prière lui monta aux lèvres, et bientôt il se mit à rire de ses hallucinations : ce qu’il prenait si volontiers pour un géant de neige, c’était tout simplement un ruisseau qui jaillissait d’un fourré et courait en clairs replis se jeter dans le lac. Et le bruit étrange, qui tout d’abord l’avait inquiété, cessa de l’émouvoir lorsqu’il vit à la lisière de la forêt un cavalier apparaître et piquer droit sur la chaumière.
C’était un chevalier de noble apparence et richement vêtu : un manteau de pourpre couvrait en partie son justaucorps violet brodé d’or ; de belles plumes rouges et bleues rehaussaient l’élégance de sa toque ; à son baudrier d’or pendait une épée ornée de pierreries étincelantes.
L’étalon blanc qui le portait, plus fin et plus léger que les chevaux d’armes, courbait à peine les hautes herbes en passant.
Sans doute, il n’y avait rien à redouter d’une si gracieuse apparition : le vieux pêcheur hésitait cependant. A la fin, il se leva, ôta poliment son bonnet devant ce visiteur de marque, et attendit.
Le chevalier s’enquit auprès du bonhomme d’un asile pour lui et son cheval.
— Votre cheval, mon bon seigneur, répondit le pêcheur, passera une excellente nuit sur cette herbe molle et fraîche.
Quant à vous, je mets à votre disposition mon humble chaumière où vous pourrez souper à peu près bien et dormir ensuite paisiblement.
Le chevalier se déclara satisfait ; il sauta à terre, débrida sa monture et lui donna la liberté. Puis il dit à son hôte : — Vous êtes hospitalier, mais l’eussiez-vous moins été que la force des choses m’aurait, je crois, de toute façon retenu ici ce soir. Je crois que ma route est barrée par ce lac et, quant à rebrousser chemin, Dieu me garde d’affronter les mystères de cette forêt en pleine nuit.
— Ne parlons pas trop de ces mystères, répliqua le pêcheur, et il ouvrit à son hôte la porte de la cabane.
Près de l’âtre où crépitait un maigre feu de bois, la vieille femme du pêcheur était assise dans un grand fauteuil rustique. A la vue du bel étranger, elle se leva, salua avec beaucoup de bonne grâce et reprit place dans son fauteuil.
— Excusez ma bonne femme, dit alors le pêcheur avec un sourire, si elle ne vous offre pas le siège le plus confortable de la maison : la coutume veut, chez les pauvres gens, que les personnes âgées soient en tout les mieux servies.
— Mais, répliqua la femme, notre hôte, bon chrétien comme nous, ne saurait certainement trouver à redire à cette coutume. Asseyez-vous là, continua-t-elle en s’adressant au chevalier, asseyez-vous là, mon jeune seigneur : cet escabeau est encore très bon malgré qu’il soit un peu bancal.
Le chevalier approcha du feu le siège qu’on lui désignait et s’y installa de bon cœur tant il se sentait à l’aise dans ce milieu de braves gens : il lui semblait que ce foyer avait été le sien autrefois et qu’il y revenait après une longue absence ; les objets à l’entour lui étaient familiers.
On bavarda, près des chenêts, comme de vieilles connaissances. Le chevalier tenta à plusieurs reprises de mettre la conversation sur la fameuse forêt, mais le vieux pêcheur, chaque fois, montra la nuit qui descendait et mit un doigt sur ses lèvres. Les deux vieillards parlèrent abondamment de leur maisonnette et de leurs petites affaires ; quant au chevalier, il se contenta de dire qu’il s’appelait le Sire Huldbrand de Ringstetten, qu’il possédait un château sur les bords du Danube, et qu’il avait beaucoup voyagé.
Cependant, l’étranger était fort intrigué depuis quelques instants par un bruit singulier qui semblait venir de la fenêtre, comme si quelqu’un se fût amusé à lancer de l’eau contre les vitres. Le vieux pêcheur s’en était aussi aperçu et il fronçait les sourcils d’un air mécontent. A la fin, l’eau gicla le long de la croisée mal fermée, en une fusée scintillante. Le pêcheur se leva alors, en colère, et cria vers la fenêtre : — Ondine, as-tu fini tes espiègleries ? Nous avons du monde à la maison.
Un petit rire joyeux perla dans le silence du dehors et les jets d’eau cessèrent.
— Il faut excuser cette enfant, mon bon chevalier, dit le pêcheur en regagnant son siège ; elle n’a pas de méchanceté, au fond ; c’est un petit diable, voilà tout. Je veux parler d’Ondine, notre fille adoptive. Elle est encore une gamine bien qu’elle ait tantôt dix-huit ans. Mais, je le répète, son cœur, au fond, est excellent.
— Sans doute, sans doute, répartit la vieille avec un petit mouvement de tête, tu ne vois guère Ondine qu’en revenant de la pêche ou du marché et, comme cela, en passant, ses gamineries t’amusent. Mais moi qui suis obligée de veiller sur elle toute la journée, moi qui n’en peux jamais rien tirer de raisonnable et qui, malgré mes cheveux blancs, ne trouve auprès d’elle aucune aide dans les soins du ménage, j’avoue que j’en juge autrement. Il y a souvent de quoi perdre patience, serait-on une sainte du Paradis.
— Bon ! bon ! fit le bonhomme en riant, nous avons tous nos petites luttes, toi contre Ondine, moi contre mon lac qui abîme trop souvent mes filets. Et cela n’empêche pas que nous aimons, moi mon lac, toi notre Ondine, malgré les soucis qu’elle te cause. N’est-ce pas, ma bonne femme?
— Ah ! le fait est qu’on ne peut lui garder rancune, dit la vieille d’un air attendri et affectueux.
Là-dessus la porte s’ouvrit, et une jeune fille blonde, radieuse de grâce et de fraîcheur, entra dans la chambre.
— Qu’est-ce que vous m’avez raconté, père, dit-elle, il n’y a personne ici.
Mais à ce moment elle aperçut le chevalier, s’arrêta court, et le considéra longuement, avec la plus extrême surprise. Huldbrand, de son côté, ne pouvait détacher ses regards de cette ravissante apparition : de sorte qu’ils restèrent là à s’admirer l’un l’autre plus longtemps que de raison. Enfin, loin de marquer quelque timidité, Ondine s’avança familièrement vers le jeune homme, se mit à genoux devant lui et, jouant avec une médaille d’or suspendue à une chaîne qu’il portait au cou, elle lui dit : — Aimable et beau chevalier, te voilà donc enfin arrivé dans ce pays, dans notre chaumière ! T’a-t-il fallu voyager à travers le monde pour parvenir jusqu’ici ? Viens-tu de la sombre forêt ?
Les réprimandes de la bonne femme arrêtèrent la réponse du chevalier. Ondine était indiscrète et on la priait de se mettre sans mot dire à son ouvrage ; mais Ondine approcha un petit banc du tabouret de Huldbrand et affirma en s’installant : — Je ne travaillerai pas ailleurs qu’ici.
Le vieux pêcheur, plein d’indulgence pour cette enfant gâtée, eut l’air de s’occuper d’autre chose. Mais la jeune fille insista : — J’ai demandé à notre gracieux hôte d’où il venait: j’attends sa réponse.
— Je viens de la forêt, ma jolie, répliqua Huldbrand.
— Alors, raconte-moi comment tu y es entré et ce que tu y as vu, car il court de curieuses histoires sur cette forêt.
Des souvenirs tout proches encore revinrent à l’esprit du chevalier qui frissonna et jeta un regard inquiet dans la direction de la fenêtre ; mais dehors le calme régnait et nulle forme ne s’agitait dans l’ombre de la nuit. Huldbrand allait commencer son récit lorsque le vieux pêcheur le prévint par ces mots :
— Sire chevalier, ne parlez pas de ces choses : c’est la nuit, le moment n’est pas propice.
Alors Ondine, fort en colère, se leva, trépigna, et, les poings sur les hanches, dit à son père adoptif : — Et moi je veux qu’il parle ! il le doit ! je le veux !
Cette arrogance fit sortir le bonhomme de sa patience.
A son tour il se fâcha, semonça vertement la jeune fille et lui fit entendre ses vérités : en quoi il fut naturellement secondé par la vieille femme qui en avait long à dire sur le compte d’Ondine.
A la fin, celle-ci, de plus en plus révoltée, s’écria : — Puisqu’il vous plaît de me chercher querelle et de me contrarier dans mes désirs, je ne passerai pas la nuit avec vous dans votre vilaine chaumière.
Et, là-dessus, elle prit la porte, fila comme une flèche et disparut dans les ténèbres qui s’épaississaient de plus en plus.
II
DE QUELLE MANIÈRE ONDINE ÉTAIT ARRIVÉE CHEZ LE VIEUX PÊCHEUR
Huldbrand et le pêcheur s’étaient, d’un mouvement instinctif, élancés à la poursuite de la jeune fille. Mais, dehors, dans l’obscurité, ils avaient bientôt été contraints de s’arrêter. Huldbrand, d’ailleurs, se demandait s’il n’était pas le jouet d’un rêve, et si la suave apparition d’Ondine, si brusquement suivie de sa disparition, n’était pas une nouvelle aventure merveilleuse comme celles de la forêt. Mais le vieux pêcheur le ramena à la réalité : — Ce n’est pas la première fois qu’Ondine nous joue ce tour, dit-il. Elle va nous laisser maintenant dans une mortelle inquiétude jusqu’à demain matin : pourvu seulement qu’il ne lui arrive pas de mal !
— Essayons encore de la rejoindre, proposa le chevalier.
— Inutile, répliqua le pêcheur. Je ne saurais permettre que vous risquiez votre vie à rechercher cette petite folle, et, pour moi, mes vieilles jambes n’en peuvent plus.
D’ailleurs, comment savoir la direction qu’elle a prise ?
— Du moins appelons-la, supplions-la de revenir.
Et Huldbrand lança aux échos le nom gracieux de la jeune fille. Le vieillard hochait la tête en disant que la petite était bien trop entêtée pour répondre et que tous les moyens du monde ne serviraient de rien ; pourtant, il ne pouvait lui-même s’empêcher de mêler ses appels à ceux du chevalier et de crier : — Ondine ! reviens pour cette fois, je t’en prie !
Cependant, il en arriva comme le pêcheur l’avait dit : Ondine ne répondit pas ni ne parut. Les deux hommes, de guerre lasse, reprirent le chemin de la maisonnette. La bonne mère était aller se coucher, et, dans l’âtre, le feu s’éteignait lentement. Le vieux pêcheur ranima les cendres, ajouta du bois et posa sur la table une cruche de vin : — Vous avez aussi de l’inquiétude au sujet de cette enfant, dit-il au chevalier ; nous ferions donc mieux de passer ici une partie de la nuit à causer et à boire, plutôt que de nous étendre sur nos lits pour n’y point dormir.
Huldbrand acquiesça, et tous deux se mirent à deviser tout en faisant honneur à la cruche. Ondine, naturellement, fit tous les frais de la conversation ; on ne pensait guère qu’à elle. Quand le plus léger bruit se faisait entendre au dehors, le chevalier ou le pêcheur se levait, poussait la porte, interrogeait la nuit d’un regard anxieux. Bientôt, le vieux pêcheur en vint à raconter à la suite de quelles circonstances ils avaient, sa femme et lui, adopté cette étrange enfant. Le chevalier l’écouta avec le plus grand intérêt : Un jour, dit le vieillard, il y a de cela environ quinze ans, j’étais allé comme de coutume à la ville pour vendre mes poissons. Ma femme était restée à la maison pour s’occuper des soins du ménage et veiller sur une petite fille que le ciel nous avait heureusement envoyée peu de temps auparavant. Divers projets s’agitaient alors dans ma tête : j’adorais ce coin de terre où j’avais vécu dans la paix, mais je songeais à le quitter pour aller m’établir à la ville et y préparer l’avenir de notre enfant. Je discutais en moi-même les avantages et les inconvénients d’une telle résolution. Je réfléchissais, enfin. Et j’allais tranquillement mon petit bonhomme de chemin, à travers cette même forêt dont on dit tant de choses et où le bon Dieu, quant à moi, m’a toujours gardé de toute rencontre et de tout mal. Hélas ! le malheur devait cependant tomber sur moi, il n’était pas loin, il ne se dissimulait pas parmi ces ombres mystérieuses, non, il était installé à mon propre foyer. Je reviens de ma tournée, j’arrive, je trouve ma femme en pleurs, seule.
« — Où est notre enfant? m’écriai-je. Qu’as-tu?
Les sanglots de ma femme l’étouffent, elle ne peut répondre que par des mots entrecoupés qui sont autant de blessures affreuses pour mon pauvre cœur. Un accident banal et terrible: l’enfant avec sa mère jouait au bord du lac ; soudain, la petite échappe aux mains qui la tiennent, se penche sur le miroir trompeur des eaux, tombe, disparaît.
Nous avons longuement interrogé les rives du lac, cherché parmi les hautes herbes et jusqu’au fond de l’eau : en pure perte ; il ne nous a même pas été donné de revoir le cher visage de notre pauvre enfant.
Je vous laisse à penser, seigneur chevalier, dans quel état de désolation nous laissa ce cruel événement.
Nous étions, le même soir, assis, ma femme et moi, autour de la table familiale, tristes et sans force, suppliant la mort de ne pas nous épargner après un tel coup. Vivre encore, vivre sans notre cher ange, nous semblait impossible. Mais le ciel veillait ! Nous étions là à pleurer, à gémir, quand, tout à coup, par la porte ouverte entra une jolie petite fille de trois ou quatre ans environ, richement habillée, toute gracieuse et souriante. Nous la regardâmes avec émotion et surprise, sans savoir que penser. Quand elle fut tout près de moi, je vis que ses cheveux et ses vêtements ruisselaient d’eau.
« — Chère, dis-je à ma femme, faisons du moins pour cette enfant ce que nous voudrions tant qu’on fît pour notre pauvre disparue.
Nous déshabillâmes la petite, la mîmes dans un lit bien chaud et lui donnâmes des boissons généreuses et réconfortantes. Cependant, elle ne cessait de nous sourire avec de beaux et bons yeux où se révélait sa petite âme.
Le lendemain, comme elle allait bien, je la questionnai sur ses parents et sur l’aventure qui l’avait amenée chez nous.
Mais elle ne répondit que par des histoires si extravagantes, pleines de châteaux d’or et de palais de cristal, qu’il nous parut pendant longtemps, à nous autres gens simples, qu’elle était tombée tout droit de la lune sur notre presqu’île. Tout ce qu’on pût, à la fin, démêler de son discours, fut qu’elle se promenait avec sa mère en barque, que le bateau avait chaviré, qu’elle s’était trouvée précipitée dans le lac, qu’elle avait perdu connaissance et qu’elle s’était par la suite réveillée, non loin de notre cabane, sous le frais ombrage d’un arbre. Mais quand à rien savoir d’autre, sur son origine, son nom, sa religion même, ses parents, sa demeure, impossible ! Il fallut y renoncer.
Notre chère fille nous manquait affreusement : il nous vint tout naturellement à l’idée de garder auprès de nous, pour la remplacer, cette petite inconnue que le ciel lui-même semblait avoir pris soin de nous envoyer dans notre malheur. Ainsi en fût-il décidé : la place vide autour de la table familiale fut à nouveau occupée et la chaumière connut encore les frais éclats de rire et les jeux innocents.
« Cependant, nous ne savions de quel nom appeler notre nouvelle enfant. Je proposais bien Dorothée, qui signifie Don de Dieu,’ et qui, par cela, me semblait tout indiqué ; mais la petite ne voulait pas entendre parler de Dorothée : elle disait que ses parents l’avait nommée Ondine, qu’Ondine elle s’appelait, qu’Ondine elle voulait être et demeurer. Ondine ? Était-ce là un nom de chrétien ? Je consultai le calendrier : point d’Ondine. J’allai prendre le conseil d’un vieux prêtre, à la ville : Ondine, d’après lui, devait être un nom de païen. Que faire ?
L’enfant avait-elle été baptisée, seulement ? Le vieux prêtre fut d’avis que, dans le doute où nous étions, il valait mieux risquer de la baptiser une seconde fois. On décida d’un jour pour célébrer ce grand acte. Le saint homme vint à notre chaumière, un beau matin : la petite, toute gracieuse dans une ravissante robe blanche, supplia avec tant d’insistance pour qu’on lui laissât son nom d’Ondine, que le prêtre crût pouvoir sans péché la baptiser sous ce nom étrange : l’enfant se conduisit d’ailleurs, pendant toute la cérémonie, comme une vraie petite sainte, et il est bien certain qu’aucune chrétienne du bon Dieu, portant tous les noms du calendrier, ne se fût montrée en cette circonstance plus chrétienne que notre Ondine.
« Je dois à la vérité d’ajouter que, par la suite, ce beau zèle tomba un peu, et que bien des polissonneries…. »
Ici, le chevalier, qui n’avait rien perdu de l’histoire, interrompit le pêcheur pour lui faire remarquer comme un grondement sourd et prolongé venant de la plaine. Les deux hommes sortirent de la cabane pour voir si quelque orage s’annonçait. Mais ce qu’ils virent les inquiéta bien autrement : le ruisseau qui, sorti de la forêt, serpentait dans la plaine et, avant de se jeter dans le lac, passait non loin de l’habitation du pêcheur, avait soudain grossi formidablement et ses eaux débordées couraient de tous côtés dans un bouillonnement de tempête. De gros nuages passaient, rapides, dans le ciel, et le lac, lui aussi, se soulevait sous les rafales terribles du vent.
— Ondine ! Ondine ! crièrent les deux hommes, il va t’arriver malheur ! Pour l’amour de Dieu, reviens !…
Et, comme nulle réponse ne leur parvenait, ils se mirent à courir au hasard, l’un à droite, l’autre à gauche, appelant et cherchant la fugitive.
III
LE CHEVALIER RETROUVE ONDINE
HULDBRAND se demandait de plus en plus sérieusement si Ondine n’était pas un être immatériel dans le genre de ceux qu’il avait rencontrés dans la forêt. Tout, dans cette contrée naguère si paisible, lui paraissait illusion trompeuse ; il en serait venu à douter même de l’existence du vieux pêcheur si l’écho n’avait persisté à lui apporter la voix du brave homme, appelant sa fille adoptive, suppliant le ciel de l’aider dans ses recherches.
Bientôt, le chevalier arriva au bord du ruisseau transformé en torrent et vit que l’onde débordée séparait à présent complètement la pointe de terre de la forêt.
— Ciel, pensa le jeune homme, la pauvre Ondine est donc dans la forêt, seule, parmi les spectres, et ce torrent met entre nous sa barrière infranchissable !
S’armant de courage et de décision, Huldbrand tenta d’entrer dans le ruisseau pour le traverser soit à gué, soit à la nage. Toutes les visions qu’il avait eues dans la forêt l’assaillirent de nouveau : surtout l’image d’un grand vieillard blanc, qui ricanait en agitant avec ironie son énorme tête, lui apparut. Mais au-dessus de tout cela planait le souvenir attirant de la gracieuse Ondine, et Huldbrand ne recula pas.
Il allait, au contraire, bravement, luttant contre le courant rapide qui menaçait à tout instant de l’emporter, avec une forte branche de sapin sur laquelle il s’appuyait.
Il avançait, avançait, quand tout à coup il entendit non loin de lui une voix charmante qui disait : — Attention ! Méfie-toi du vieux torrent : il est plein de malice.
Il reconnut aisément la voix d’Ondine, s’arrêta, chercha d’où elle pouvait venir. Mais, étourdi par le bouillonnement de l’eau, il faillit perdre l’équilibre et tomber. Il se remit à marcher, murmurant : — N’es-tu qu’un rêve, une illusion de beauté et de charme, Ondine ? Si tu ne vis pas réellement, je ne veux plus exister non plus : je veux devenir une ombre telle que toi, Ondine, chère Ondine.
— Fais attention ! Tourne-toi par ici, mon bel étourdi fit entendre de nouveau la voix mystérieuse.
Et Huldbrand, regardant de côté, aperçut soudain, comme la lune se montrait entre deux nuages, Ondine gracieusement couchée sur un lit de verdure, au beau milieu d’un petit îlot ombragé de hauts arbres et que l’inondation avait formé en cet endroit.
Un bond, deux bonds encore parmi les vagues qui s’entre-choquent avec fureur, et le chevalier est auprès de la jeune fille, sur le frais gazon de l’île minuscule.
Ondine enlace de ses bras blancs le cou de Huldbrand, le force à s’asseoir à ses côtés, et, tout de suite, sans prêter plus d’attention à l’orage, à la tempête, à l’inondation, elle dit : — Gentil ami, maintenant que nous voici réunis et seuls tous deux, tu vas me faire le récit que je t’ai demandé.
Parle-moi de la sombre forêt. On est bien ici pour raconter des histoires : notre toit de feuillage vaut bien la pauvre petite chaumière du pêcheur.
— C’est le ciel, dit Huldbrand en pressant la jeune fille sur son cœur.
Cependant, le vieux pêcheur était arrivé au bord du torrent et, comme la lune éclairait bien, il n’eut pas de peine à découvrir la retraite des deux jeunes gens. De loin, il s’écria : — Hé là ! mon hôte ! Que faites-vous seul avec ma fille adoptive ? Je vous ai reçu sous mon toit en toute confiance : est-ce ainsi que vous abusez de mon hospitalité, tandis que, la crainte au cœur, je cherche partout cette enfant ?.
— Calmez-vous, bon vieillard ! répondit Huldbrand, je viens moi-même de trouver Ondine.
— Amenez-la donc, dit le pêcheur.
Mais Ondine ne l’entendait pas ainsi. Elle cria qu’elle préférait s’enfuir dans la forêt avec le bel étranger et ne pas réintégrer la chaumière où l’on ne faisait rien à sa fantaisie et d’où le gracieux chevalier partirait tôt ou tard. Puis, se penchant vers son compagnon dans un mouvement plein de grâce, elle se mit à chanter une jolie romance où l’on voyait un petit ruisseau quitter son vallon obscur, chercher le bonheur vers les larges horizons de la mer et ne plus jamais revenir.
Cette chanson arracha des larmes amères au vieux pêcheur ; mais Ondine ne semblait pas s’en soucier. Elle embrassait son bel ami qui lui dit enfin : — Ondine, es-tu donc insensible ? Si les larmes de ce bon vieillard ne t’émeuvent point, elles me font à moi beaucoup de peine. Retournons chez lui.
— Que ta volonté soit faite ! répondit la jeune fille avec un étonnement qu’elle ne chercha même pas à dissimuler. Tout ce que tu désires, je le désire ; mais je voudrais cependant que ce bon vieux nous fît une promesse : c’est qu’il ne s’opposera plus à ce que tu me racontes tout ce que tu as vu dans la forêt.
Le pêcheur promit, trop heureux d’avoir retrouvé sa chère Ondine ; et celle-ci, escortée du chevalier, regagna la maison familiale où la vieille femme du pêcheur lui fit fête le plus admirablement du monde.
Là-dessus, le temps se remit au beau ; l’orage cessa, la tempête se calma ; des oiseaux dans les arbres célébrèrent par des chants cet apaisement de la nature redevenue harmonieuse.
Et, comme Ondine insistait encore pour entendre l’histoire promise, Huldbrand commença son récit de la manière suivante.
IV
AVENTURES DU CHEVALIER DANS LA FORÊT MAUDITE
« Il y avait environ huit jours que j’étais dans la capitale quand il y fut donné un tournoi. Je pris part à cette fête et n’y épargnai ni mon coursier ni ma lance. Une belle demoiselle daigna me remarquer. On l’appelait Bertalda et elle était la fille adoptive d’un duc. Tout le temps que durèrent les réjouissances, je m’appliquai, comme l’eût fait n’importe quel jeune homme à ma place, à plaire à Bertalda, à briller à ses yeux, à triompher dans toutes les épreuves. »
Ici le chevalier fut interrompu par une douleur soudaine à la main : c’était Ondine qui lui enfonçait ses petites dents pointues dans la chair pour lui marquer, sans doute, sa jalousie. Il continua, ému et souriant :
Cette Bertalda est à la vérité une jeune fille orgueilleuse et singulière. Le deuxième jour, elle me plut déjà moins que le premier ; le troisième, mon affection se mêla d’inquiétude. Mais je demeurai à ses côtés, parce qu’elle me montrait plus de sympathie qu’aux autres chevaliers.
Il arriva, qu’en plaisantant, je lui demandai un de ses gants : Oui, fit-elle, si vous avez le courage d’aller explorer la forêt maudite pour me dire ce qui s’y passe.’ Je ne tenais guère à son gant ; mais mon amour propre se trouva en jeu : il n’est rien qu’un chevalier puisse refuser à une dame. » Ondine interrompit encore pour exprimer son étonnement d’une telle façon d’aimer les gens ; pour elle, jamais l’idée ne lui serait venue de chasser loin de sa présence et vers des dangers inconnus l’objet de son amour.
« Je me mis donc en route hier matin, reprit le chevalier ; le temps était limpide ; la rosée scintillait au soleil sur les herbes, et la forêt, aux beaux ombrages verdoyants, m’apparaissait comme rien moins que terrible. Je m’y engageai, tout confiant, au petit trot de mon cheval.
A un certain moment, comme je ne me rendais plus bien compte de la route que je suivais, j’arrêtai ma monture et levai les yeux au ciel pour interroger la position du soleil. Dans ce mouvement, j’aperçus, entre les branches d’un chêne, une étrange créature noire, assez semblable à un ours. Elle me considérait en ricanant, et me dit : Je suis en train de faire provision de bois pour alimenter le feu sur lequel on te fera rôtir cette nuit, monsieur l’indiscret.’ Et en même temps elle fit un tel vacarme, criant et agitant les grosses branches du chêne, que mon cheval, épouvanté, s’emballa et m’emporta dans une course vertigineuse, avant que j’aie pu faire plus ample connaissance avec ce monstre diabolique.
— Mieux vaut n’en pas savoir plus long sur son compte, dirent ensemble et en se signant les deux vieux pêcheurs.
Et Ondine remarqua, en fixant sur Huldbrand ses beaux yeux clairs : — Le plus charmant de l’histoire, c’est qu’ils ne t’ont pas rôti, mon gracieux chevalier.
Huldbrand reprit : « Mon cheval, dont je ne pouvais plus me rendre maître, manquait à chaque instant de se jeter sur quelque tronc d’arbre ou dans quelque précipice. Tout à coup, il fit un brusque écart et s’arrêta net: je crus voir alors un homme haut et blanc qui s’était placé résolument en travers du chemin pour arrêter dans sa course folle le fougueux animal. Mais, en y regardant de plus près, je n’aperçus en réalité qu’un ruisseau clair et argenté qui coulait là son cours, et qui, barrant le passage à mon cheval, avait obligé la bête à s’arrêter.
— Merci, cher ruisseau ! s’écria Ondine en tapant des mains.
A peine étais-je remis de cette alerte, continua Huldbrand, que j’aperçus à côté de moi un nain difforme, extrêmement laid, au nez démesuré et au teint jaunâtre ; il ricanait, lui aussi, et me faisait mille révérences ridicules.
Impatienté, je tournai bride et songeai à m’éloigner, d’autant que le soleil baissait et que j’avais du chemin à faire pour regagner la ville. Mais ce petit être, en deux ou trois bonds, eût tôt fait de me rejoindre et se trouva de nouveau à la tête de mon cheval : « — Place ! m’écriai-je, ou je te passe sur le corps.
— Hé ! cria-t-il d’une voix rauque, je viens de te sauver la vie, cela vaut bien un pourboire !
« — Tu mens, répondis-je ; c’est le ruisseau qui m’a sauvé la vie. Tu n’y es pour rien ; mais, afin de me délivrer de ta présence et de tes grimaces, je te paierai cependant volontiers.
« Et je lui jetai une pièce d’or qu’il reçut au vol dans un étrange petit bonnet pointu.
Je poursuivai mon chemin au trot ; le nain ne me quitta pas et courut derrière moi en poussant des cris invraisemblables. Je mis mon cheval au galop ; l’affreux petit personnage galopa à côté de moi le plus naturellement du monde. Je le regardai avec colère ; il me montra la pièce de monnaie en glapissant : Mauvais or ! fausse monnaie ! A la fin, je m’arrêtai : Que veux-tu ? lui dis-je. Prends encore cette pièce et laisse-moi.’ Il recommença ses révérences grotesques et répondit : Ceci n’est pas de l’or, ou je me trompe fort. Je possède moi même quelques-unes de ces piécettes et je vais en montrer.

L’affreux petit personnage me montra la pièce de monnaie en glapissant : Mauvais or ! fausse monnaie !
Là-dessus, il me sembla que la terre s’ouvrait tout à coup sous mes yeux. Dans un abîme sans fond, je vis une troupe de nains aussi hideux que mon petit compagnon, occupée à manipuler des métaux précieux, à échafauder des colonnes de pièces d’or qu’ils renversaient ensuite en se jouant. Tous gesticulaient, riaient d’un air sardonique, poussaient des cris sinistres, tendaient vers moi des poings menaçants, ou bien me désignaient de leurs doigts crochus, noircis de fumée. C’était l’enfer même : fuir, fuir, je ne pouvais penser à autre chose, et c’était tout ce que la nature pouvait m’ordonner de faire. Je donnai donc de l’éperon à mon cheval qui repartit dans un galop furieux.
Plus tard, autre aventure. J’avais fini par retrouver le chemin de la ville et je voulais m’y engager. Une étrange figure se dressa alors devant moi et m’empêcha de passer. J’essayai de la contourner ; elle revint se placer juste à la tête de mon cheval. J’allai droit sur elle, déterminé à passer au travers s’il le fallait ; mais une telle trombe d’eau écumante jaillit à ce moment de la mystérieuse figure que j’en fus aveuglé et que je dus rebrousser chemin. Une seule route s’offrait à moi d’autre part; je la pris. C’est celle qui m’a conduit jusqu’à cette prairie verdoyante et jusqu’à cette cabane hospitalière.» Le vieux pêcheur félicita Huldbrand sur l’heureuse façon dont il avait échappé à ses persécuteurs ; puis, il étudia le moyen, pour le chevalier, de regagner la capitale, ce qui fit sourire Ondine.
— Tu te réjouis donc de mon départ ? lui demanda Huldbrand.
— De quel départ veux-tu parler ? fit Ondine. Essaie donc un peu de t’en aller. Tu es bel et bien prisonnier ici, et le lac, pas plus que la forêt, pas plus que le torrent, ne t’aideront dans ton dessein ; ils s’y opposeront au contraire, et si tu veux lutter contre eux, ce sera pour ton malheur.
— Je resterai donc jusqu’à ce que les éléments me soient plus favorables, répondit Huldbrand. En es-tu fâchée, petite Ondine ?
— Ah ! dit la jeune fille avec mauvaise humeur, laissez-moi ! Je songe à tout ce que vous auriez encore raconté sur cette Bertalda, si je ne vous avais mordu la main pour vous faire taire là-dessus.
V
COMMENT HULDBRAND VÉCUT DANS LA PRESQU’ÎLE
Peut-être, cher lecteur, t’est-il arrivé déjà, après avoir longtemps erré, de pays en pays, de t’arrêter dans une contrée, dans une maison, où, enfin, tout te paraissait bon et favorable. L’amour du repos, l’amour du foyer familial, si naturel, si humain, se réveillait au fond de toi, et il te semblait que c’était la patrie elle-même, la patrie ornée de ses fleurs les plus personnelles, que tu venais de retrouver. Rappelle en ton cœur ce sentiment délicieux et tu auras une idée de celui qu’éprouvait le seigneur Huldbrand à vivre dans la petite cabane des pêcheurs.
Il s’assurait souvent et volontiers que le torrent devenait de plus en plus large, tumultueux, impraticable, et que le séjour dans la presqu’île n’était pas près de s’achever.
Il passait ses journées à aller tirer quelques oiseaux, avec une vieille arbalète découverte dans un coin de la chaumière, et ce gibier augmentait fort à propos l’ordinaire de la maison. Ondine grondait bien un peu son ami de se montrer si cruel, de tuer ces aimables petites bêtes ; mais si, d’aventure, il revenait sans rien rapporter de sa chasse, elle le grondait encore plus fort, en disant qu’à cause de sa maladresse il allait falloir se contenter, pour tout mets, de poissons et d’écrevisses. Huldbrand supportait gaiement toutes ces petites attaques, d’autant qu’il les voyait le plus souvent finir par des caresses.
Le pêcheur et sa femme trouvaient naturelles ces familiarités ; ils en étaient venus insensiblement à considérer les deux jeunes gens comme des fiancés. Huldbrand lui-même se considérait comme le fiancé d’Ondine.
Il lui semblait que sa vie s’écoulerait désormais en ce coin de terre perdu, séparé du restant de l’univers par un torrent infranchissable et par la plus redoutable des forêts ; que ce foyer était devenu le sien ; ces bons vieillards, ses parents d’adoption ; cette jeune fille, douce et aimante, sa fiancée.
Quelquefois, son cheval faisait entendre un hennissement particulier, comme pour lui rappeler qu’il avait d’autres exploits à accomplir. Ou bien, il semblait à Huldbrand que son blason brillait avec un éclat inaccoutumé, que son épée sortait à demi de son fourreau, pour lui inspirer les mêmes pensées chevaleresques et lui reprocher son inaction. Il apaisait alors son âme inquiète en se disant qu’Ondine était certainement la fille de quelque haut seigneur de la région, et qu’avoir gagné son amour était déjà un beau fait d’armes.
Huldbrand n’aimait pas entendre la femme du pêcheur gronder Ondine en termes vulgaires et trop familiers ; mais comme Ondine était toujours la première à rire des reproches qui lui étaient ainsi adressés, et comme, d’autre part, l’espiègle enfant les méritait dans une large mesure, le chevalier ne pouvait pas en vouloir beaucoup à la vieille femme, et l’harmonie n’était jamais rompue le moins du monde dans la modeste mais heureuse petite cabane.
Quelque chose vint enfin varier un peu cette existence.
Après le repas du soir, tout en devisant, le pêcheur et son hôte avaient pris l’habitude de vider ensemble un cruchon de vin, tant et si bien qu’un jour la provision s’en trouva épuisée, ce dont les deux hommes se montrèrent fort mécontents. Ondine s’amusa bien de la grimace qu’elle leur vit faire à ce sujet et les plaisanta sans pitié. Vers le soir de ce jour-là, elle sortit sous le prétexte de fuir ces visages maussades ; le temps se gâtait, l’orage menaçait, et les deux hommes, au souvenir des angoisses qu’ils avaient déjà connues en une circonstance semblable, s’apprêtaient à rappeler la jeune fille quand elle revint d’elle-même, l’air joyeux et frappant gaiement des mains.
— Que me donnerez-vous, dit-elle, si je vous procure du vin ?
Les deux hommes se regardèrent, surpris.
— Mais non, je ne vous demande rien, continua-t-elle ; si vous reprenez un visage plus aimable, je me tiendrai pour payée. Suivez-moi ; le torrent a poussé un tonneau sur le rivage et je parie que c’est un tonneau plein de vin.
Huldbrand et le pêcheur suivirent Ondine. Parmi des herbes, dans une petite baie du rivage, ils trouvèrent en effet le tonneau dont avait parlé l’étrange jeune fille. Ils le roulèrent vers la cabane, en toute hâte, car l’orage, à présent, était sur le point d’éclater. Ondine aidait ses compagnons dans la mesure de ses forces. On se dépêchait, on se dépêchait, mais les nuages allaient encore plus vite ; ce que voyant, Ondine montra son petit poing au ciel en criant d’une façon menaçante et à la fois comique : — Toi, là-haut, tâche de ne pas nous mouiller !
Le vieux pêcheur blâma ce qu’il appelait une imprécation, mais Ondine en rit sous cape ; d’ailleurs, il n’arriva de mal à personne pour cette saillie sans gravité ; bien mieux, contre toute prévision, ils arrivèrent tous trois à la chaumière, avec leur butin, sans avoir été mouillés.
On ouvrit le tonneau : un mince filet d’excellent vin en coula, dont on remplit les verres. Alors seulement les nuages se déchirèrent et une pluie torrentielle se mit à tomber. Le lac, en furie, se souleva en lames impétueuses ; le torrent rugit comme la fameuse nuit de l’arrivée du chevalier.

Ondine cria d’une façon menaçante et à la fois comique : Toi, là-haut, tâche de ne pas nous mouiller !
— Mon Dieu ! dit tout à coup le pêcheur, nous sommes là à nous réjouir de notre trouvaille et à la savourer, et le propriétaire de ce bon vin a peut-être bien perdu la vie parmi les rochers du torrent.
— Mais non ! fit Ondine en versant à boire à Huldbrand.
— Sur mon honneur, s’écria ce dernier, si je savais où trouver l’homme dont vous parlez, bon vieillard, je n’hésiterais pas à m’élancer dans la nuit pour lui porter secours.
— Tu dis là une sottise, répliqua Ondine ; si tu te jetais dans pareille aventure, je pleurerais à en perdre mes yeux. Or, tu préfères, je pense, ne pas risquer ta vie et ne pas me faire de la peine, rester auprès de moi et savourer ce bon vin ?.
— Vraiment oui, fit le chevalier.
— Donc, je le répète, tu as dit une sottise, recommença Ondine ; car il faut toujours penser à soi et pas du tout aux autres.
Cette profession de foi eut le don de révolter le pêcheur et sa femme : — Ne dirait-on pas, s’écria le vieil homme, à t’entendre, que tu as été élevée par des païens ! Que Dieu nous pardonne !
— Ah ! tant pis ! répondit la jeune fille. J’ai dit ma façon de penser.
— Silence ! interrompit rudement le pêcheur.
Ondine, toute espiègle qu’elle était, n’était pas dénuée de sensibilité, et elle s’effraya beaucoup du ton dont ce mot avait été prononcé par son père adoptif. Son petit corps tressaillit, et elle vint se réfugier dans les bras du chevalier. Celui-ci, assez mécontent de la soudaine brutalité du vieux pêcheur, ne sut pas trop à qui donner raison. Il caressa sans rien dire les boucles soyeuses de la jeune fille, et, dans le silence qui pesa quelques instants sur la petite assemblée, il y eut, pour la première fois, comme une ombre de gêne et de déplaisir.
VI
UN MARIAGE
Tout à coup, on entendit à la porte un bruit léger, comme si quelqu’un frappait pour se faire ouvrir. Il y eut un moment d’hésitation de la part des habitants de la paisible chaumière où l’on n’était guère habitué à recevoir des visites. Qu’un être humain fût là, derrière cette porte, à cette heure de nuit, cela semblait d’autant plus invraisemblable qu’en raison de l’inondation la pointe de terre où habitait le pêcheur était encore totalement séparée du restant de la terre.
Mais, une seconde fois, le même bruit se fit entendre à la porte, accompagné d’une sorte de gémissement. Huldbrand, courageux, avança, l’épée nue à la main.
— Si c’est ce que je redoute, votre arme ne nous servira pas, lui dit le vieux pêcheur.
Et Ondine, s’approchant de la porte, s’écria d’une voix impérieuse :
— Si vous venez ici pour nous inquiéter, méchants gnomes, vous aurez affaire à Kühleborn !
Ces mots bizarres achevèrent de dérouter les autres personnages qui regardèrent la jeune fille avec stupéfaction. Cependant, une voix, du dehors, répondit : — Je ne suis pas un méchant esprit ; je suis un pauvre être humain. Pour l’amour de Dieu, secourez-moi !
Ondine, à ces mots, ouvrit toute grande la porte et, à la lueur de la lanterne qu’elle tenait d’une main, on aperçut un véritable moine qui recula, tout effrayé lui-même en se trouvant devant une si merveilleuse demoiselle.
Sans doute pensa-t-il qu’il y avait dans le fait qu’une jeune fille d’une beauté incomparable logeait dans une si misérable chaumière quelque artifice satanique, car il se mit à prier avec ferveur, en disant : — Dieu tout-puissant, protège ton serviteur contre les artisans du mal.
— Entrez ! entrez ! vénérable père, dit Ondine ; vous serez ici chez de braves gens. Ne craignez rien, et faites-moi la grâce de me tenir pour une honnête fille du Seigneur.
Le prêtre pénétra dans la chaumière ; l’eau ruisselait sur son vêtement de bure et dégouttait de sa chevelure et de sa barbe qui étaient blanches. Le pêcheur et Huldbrand l’entraînèrent dans une pièce voisine, l’obligèrent doucement à retirer ses vêtements afin qu’on put les faire sécher devant le feu. Il les remercia avec un bon sourire et consentit à s’envelopper, en attendant, dans un vieux pardessus gris qui appartenait au pêcheur. Mais il refusa obstinément le riche manteau brodé que lui tendait le chevalier.
Puis tous trois revinrent dans la première pièce, où la bonne vieille s’empressa de céder à l’homme de Dieu son grand et confortable fauteuil.
— Il vous revient de droit, dit-elle, car vous êtes âgé, accablé de fatigue et de plus prêtre de notre sainte église.
Le chevalier et le pêcheur offrirent alors du vin et quelque nourriture à l’ecclésiastique, et lorsque celui-ci eut repris des forces, il raconta comment il avait quitté la veille son couvent, situé très loin par delà le grand lac, pour se rendre au siège de l’évêché, afin d’annoncer à l’évêque l’état de misère où se trouvaient le couvent et les villages qui avaient à lui payer la dîme. Après avoir fait de grands détours, à cause des inondations qui désolaient la contrée, il s’était vu dans la nécessité de s’adresser à deux bons bateliers pour traverser avec eux le lac grossi par les pluies.
— Mais à peine, continua le moine, notre petite barque avait-elle pris flot qu’une terrible tempête s’éleva. Les ondes, révoltées, se dressèrent en mugissant. Les rames furent arrachées des mains de mes compagnons, et nous-mêmes, dans notre frêle embarcation à la dérive, nous fûmes livrés aux forces aveugles de la nature. Le sort nous conduisit jusqu’en vue de cette rive lointaine où se dresse votre maison ; alors, notre barque, comme prise de vertige, se mit à tournoyer sur elle-même ; j’ignore si elle chavira, j’ignore ce qu’il est advenu de mes malheureux bateliers, et je ne sais pas davantage comment ces vagues ont fini par me jeter sain et sauf, mais épuisé d’angoisse, sous les arbres de votre île. En tout cas, je remercie profondément notre Père Céleste de ce qu’après m’avoir sauvé de la fureur des eaux, il m’a conduit chez des gens honnêtes, bons et pieux. Hélas ! peut-être, après vous, ne verrai-je plus jamais visage humain !
— Et pourquoi cela, mon Dieu ? demande le pêcheur.
— Je suis un vieillard au bord de la tombe, répondit le prêtre, et il est bien probable, à mon âge, où les choses vont vite, que je serai couché sous la terre avant que le cours des eaux débordées n’ait recommencé d’être ce qu’il était autrefois.
« Et puis, il faut bien le prévoir, il se pourrait que les eaux en folie, à force de s’étendre entre vous et la forêt, en vinssent à vous séparer totalement du reste de la terre ; les autres hommes, au milieu de toutes leurs préoccupations personnelles, vous oublieraient vite et ne vous porteraient pas secours.
La bonne vieille, à ces mots, ne put s’empêcher de frémir ; elle fit le signe de la croix et murmura : — Que Dieu nous garde !
Cela fit sourire le pêcheur, qui dit : — Je ne vois pas ce qui peut t’épouvanter là-dedans, ni en quoi cet événement, s’il se produisait, changerait notre vie, ou tout au moins la tienne. Il y a bien longtemps que tu n’as pas marché plus loin que l’orée de cette forêt et vu d’autres visages humains que le mien et celui de notre Ondine. Le chevalier, et surtout ce bon moine, ne font que d’arriver dans notre minuscule royaume ; si l’état des eaux nous interdisait d’en sortir, nous resterions tous les cinq ici, et tes habitudes n’y perdraient rien.
— Sans doute, répliqua la bonne femme, mais on se fait difficilement à l’idée qu’on est sans recours séparé de ses semblables.
— Tu resterais donc avec nous ! murmura Ondine au chevalier d’une voix douce et en se serrant câlinement contre lui.
Mais Huldbrand tomba dans une profonde méditation.
Tout un monde de pensées parut l’envahir ; des images multiples flottèrent devant ses yeux ; tout le pays situé par delà le torrent et la forêt, la ville qu’il avait quittée peu de jours auparavant, son château, ses habitudes, sa vie coutumière, tout cela lui sembla d’un autre temps, d’un passé irréel ; seule, l’île verte et fleurie, baignée par les eaux du lac, se présenta à son esprit dans une réalité charmante, contrée d’amour et de bonheur dont la jolie Ondine était la fleur éternelle. Alors, sans presque se rendre compte de ce qu’il faisait, comme poussé par une volonté mystérieuse, Huldbrand prononça ces paroles : — Vous voyez devant vous, vénérable prêtre, un couple de fiancés. Faites-nous la grâce de nous unir l’un à l’autre ce soir même. C’est Dieu qui nous a envoyé aujourd’hui son représentant.
Le pêcheur et sa femme furent très surpris par ce discours. Depuis longtemps déjà ils considéraient les deux jeunes gens comme des fiancés, mais le chevalier n’ayant jamais encore parlé de ses intentions de mariage, la soudaineté de cette déclaration, la hâte avec laquelle le grand événement s’annonçait ne laissèrent pas de les dérouter quelque peu. Quant à Ondine, elle était devenue tout à coup très sérieuse, et, les yeux baissés, elle paraissait réfléchir à son tour profondément. Le prêtre demanda des explications, des renseignements détaillés et s’informa si les vieillards consentaient à cette union. Après s’être bien entendu sur tous les points, de part et d’autre, on tomba d’accord, et tous furent à la joie. La bonne vieille se mit sans plus tarder en devoir de donner à la chaumière son plus bel air de fête, et elle alla chercher dans sa chambre deux beaux cierges qu’elle avait un jour rapportés de la ville et mis de côté pour cette circonstance solennelle.
Huldbrand, cependant, cherchait à détacher de sa chaîne d’or deux anneaux dont il eut fait l’alliance d’Ondine et la sienne. Mais la jeune fille, le voyant occupé à ce travail, l’arrêta et lui dit : — N’abîme pas cette chaîne, Huldbrand ; mes parents avaient prévu qu’un jour viendrait où je me marierais, et ils ne m’ont pas laissée sur cette terre pauvre comme une mendiante.
Là-dessus, elle sortit de la pièce et revint l’instant d’après avec deux bagues précieuses, dont l’une fut offerte au chevalier. Le vieux pêcheur, en apercevant cela, fut plus étonné que jamais et demanda à Ondine d’où provenaient ces joyaux qu’il ignorait.
— Mes parents, expliqua Ondine, avaient caché ces bijoux dans la doublure des riches vêtements que je portais lorsque j’arrivai pour la première fois chez vous. Je le savais, mais j’étais tenue au secret jusqu’au jour béni où un noble chevalier viendrait demander ma main.
Le prêtre interrompit les exclamations que souleva ce conte de fée, en se disposant à commencer la cérémonie.
Les deux cierges avaient été disposés sur une table recouverte d’un voile blanc. Huldbrand et Ondine s’agenouillèrent côte à côte et le saint homme prononça les paroles sacramentelles qui unissent les fiancés. Le vieux pêcheur et sa femme bénirent les deux jeunes gens et l’épouse, toute émue, appuya pensivement sa jolie tête contre l’épaule de son mari.
Quand tout fut fini, le moine dit : — Je croyais, mes chers hôtes, que vous étiez les seuls habitants de cette île ; vous me l’aviez du moins affirmé. Qu’est-ce donc alors que cet homme de belle apparence, vêtu d’un vaste manteau blanc, qui s’est tenu de l’autre côté de la fenêtre, en face de moi, pendant tout le temps de la cérémonie nuptiale ?
— Dieu nous garde de cette apparition, s’écria la bonne vieille, en tremblant ; et le vieux pêcheur prit un air inquiet. Quant à Huldbrand, il courut à la fenêtre pour voir ce qu’il en était ; mais il ne distingua qu’une ombre vague qui se perdit bientôt derrière un bouquet d’arbres.
VII
LE SOIR DES NOCES
Ondine se départit bientôt, ce soir-là, de la gravité qu’elle avait observée pendant la cérémonie du mariage.
Sa petite nature libre et espiègle eut tôt fait de reprendre le dessus, et les gamineries qui déplaisaient si fort à la vieille femme du pêcheur recommencèrent sous mille formes variées. La présence du prêtre n’arrêta pas cette grande enfant terrible qui ne cessa de harceler de ses agaceries son époux, ses parents nourriciers, et le vénérable moine lui-même. La bonne vieille aurait bien grondé, mais en présence de Huldbrand elle n’osait maintenant plus rien dire à Ondine. Cependant les enfantillages de sa femme étaient loin, cette fois, de plaire au chevalier. S’il montrait, en ridant son front ou bien par un petit geste de colère, que son mécontentement était grand, Ondine, au désespoir, venait l’embrasser et lui demander pardon de la façon la plus câline ; mais, ensuite, elle n’avait rien de plus pressé que de recommencer ses petites farces puériles.
A la fin, le prêtre lui dit avec bienveillance : — Jeune et charmante dame, avez-vous songé, en cette grave circonstance, à mettre votre âme en harmonie avec celle de votre époux ?
— Mon âme ! s’écria Ondine en éclatant de rire ; voilà un joli mot, mais je n’ai pas d’âme.
Le prêtre, saisi, ne sut que penser d’un tel blasphème, et détourna son visage avec toutes les marques de la plus grande tristesse. Immédiatement, Ondine se jeta à ses pieds et le supplia de ne pas avoir de la peine, de lui témoigner de l’indulgence, de l’écouter et de mieux entendre ce qu’elle avait voulu signifier par ces étranges paroles.
On crut alors qu’Ondine allait conter sa véritable histoire et faire de longs aveux ; mais à peine se disposait-elle à parler en effet qu’un tremblement convulsif l’agita, que des sanglots la prirent à la gorge et qu’un flot de larmes lui monta aux yeux.
— Ce doit être quelque chose de bien doux, mais aussi de bien effrayant, murmura-t-elle enfin, que d’avoir une âme. Au nom de Dieu, saint prêtre, instruisez-moi !
Ces paroles achevèrent d’épouvanter les pieux habitants de la chaumière. Tout le monde se recula d’Ondine comme d’un être qui n’a pas été touché par les grâces du Seigneur, un être diabolique. Huldbrand était désolé et ne savait que penser.
— Oui, continua la pauvre Ondine, l’âme doit occuper une bien grande place dans un être ; car voici que de sentir seulement une âme prête à s’éveiller en moi, je me sens en même temps envahie par toutes sortes d’angoisses, moi tout à l’heure si légère, si insouciante !
Et de nouveau elle versa d’abondantes larmes, en se cachant le visage dans ses mains.
Le moine, alors, s’avança gravement vers elle, et au nom du ciel, il l’adjura de se débarrasser de l’esprit du mal si celui-ci habitait son enveloppe humaine. Mais elle tomba à genoux devant le saint homme et, répétant avec lui les paroles sacrées, elle montra les pures dispositions d’une créature de Dieu. Le prêtre finit par dire au chevalier : — Cher seigneur, je vais vous laisser avec celle qui est désormais votre épouse. Il n’y a rien de méchant dans cet être énigmatique, mais je vous recommande d’être prudent et de veiller, afin que les démons, qui guettent tous leur proie, ne soient pas ici les plus forts.
Lorsque le chevalier et sa jeune femme se trouvèrent seuls, Ondine, toujours à genoux, leva vers son mari un visage bouleversé : — Hélas ! dit-elle, ne vas-tu pas me repousser ? Je dois te faire horreur, et pourtant je ne suis qu’une pauvre enfant innocente.
Elle prononça ces paroles avec une telle émotion dans la voix que le jeune époux se sentit pénétré de pitié et qu’il oublia du coup tout le mécontentement qui s’était accumulé en lui. Il s’élança vers sa femme et la releva tendrement. Ondine sourit parmi ses larmes ; un rayon de soleil venait dissiper l’orage.
— Tu ne m’abandonneras pas ? Mon cher chevalier me pardonne, murmura Ondine, redevenue confiante ; et elle passa doucement ses petites mains roses sur les joues de son époux.
Huldbrand, rassuré lui aussi, chassa loin de lui les pensées qui tentaient encore de l’assaillir, et dont la moindre était qu’il venait d’épouser un être malicieux et méchant du monde des esprits. Cependant, une question s’échappa encore de ses lèvres : — Chère petite Ondine, demanda-t-il, explique-moi seulement ce que signifiaient tes menaces aux gnomes et ton invocation à Kühleborn, lorsque le moine frappait à la porte ?
— Bah ! bah ! rien du tout, répondit Ondine en riant ; c’était une plaisanterie, elle s’est retournée contre moi.
VIII
ONDINE PARLE DES ONDINS
Les premiers rayons de soleil réveillèrent les jeunes époux.
Huldbrand avait été, pendant toute la nuit, assailli de rêves étranges où il voyait des fantômes qui ricanaient méchamment et se transformaient tour à tour, à ses yeux, en femmes merveilleuses et en dragons affreux. La vue d’Ondine, qui reposait paisiblement à son côté, lui rendit un peu de confiance et de calme. Il fit part cependant à sa femme des rêves mauvais qu’il avait eus ; mais elle acheva de le tranquilliser par un regard plein d’amour et de sérénité.
Il se leva et alla rejoindre dans la salle commune les autres habitants de la cabane. Il lui sembla qu’ils avaient tous trois l’air inquiet et malheureux ; mais son apparition dérida tous les fronts et chacun s’empressa auprès de lui avec des mots aimables et gais. Quand Ondine parut à son tour, de véritables acclamations l’accueillirent, tant son joli visage montrait de grâce et de pure beauté.
Le prêtre s’avança le premier vers elle pour la bénir.
Elle se mit à genoux devant lui et lui demanda pardon, avec la plus touchante humilité, des paroles un peu folles qu’elle avait prononcées la veille. Puis elle embrassa ses bons parents nourriciers et, pour leur marquer la vraie reconnaissance qu’elle leur gardait au fond de son cœur, elle leur dit : — Chers et bien-aimés parents, je sens bien et profondément que vous avez entouré mon enfance de la plus exquise bonté : je ne l’oublierai jamais.
Elle ne les laissa qu’après les avoir couverts de caresses, et lorsqu’elle vit la bonne vieille se préoccuper du déjeuner, elle courut aussitôt près du feu, mit la table, et se chargea elle-même de tout préparer. C’était toujours Ondine, avec sa mignonne et ravissante figure, mais avec une tout autre nature, une nature également charmante. Tout le jour elle se montra ainsi, gentille, dévouée, pleine d’attentions, pour tout le monde. Personne ne croyait que cela pût durer, mais l’Ondine espiègle, insouciante et légère qui, la veille encore, se livrait aux caprices les plus exubérants, avait bel et bien disparu pour faire place à une nouvelle Ondine, sage et douce comme un ange.
— Messire chevalier, dit le prêtre à Huldbrand vers la fin de cette heureuse journée, c’est un véritable trésor que Dieu vous a donné là par l’entremise de son humble ministre. Conservez-le bien et ce sera la source de toutes vos joies.
Le soir, Ondine, s’appuyant sur le bras de son époux, entraîna celui-ci dehors, du côté où le soleil couchant incendiait de vives lumières le feuillage des grands arbres.
Ils marchèrent côte à côte, sans rien dire, ou du moins sans exprimer autrement leurs pensées que par de longs regards tout chargés d’amour. Peut-être s’ajoutait-il à cela dans les yeux d’Ondine, une vague mélancolie, mais Huldbrand, tout à sa joie d’aimer et d’être aimé, ne s’en aperçut pas. Ils arrivèrent ainsi au torrent débordé, et le chevalier fut tout étonné de voir que les eaux, rentrées dans leur lit habituel, avaient repris leur cours régulier.
— Demain, ce torrent qui mettait obstacle à ton départ sera de nouveau franchissable, dit Ondine avec des larmes dans la voix ; tu pourras donc reprendre ton chemin et quitter ce pauvre coin de terre perdu.
— Mais jamais sans toi, chère petite Ondine, répliqua Huldbrand ; pourquoi pleures-tu ? Quelle injuste pensée traverse encore ton esprit ? Nous sommes l’un à l’autre pour la vie !
— Qui sait ce que demain décidera, ce que tu décideras toi-même tout à l’heure, murmura Ondine avec tristesse.
Allons, il faut que je te dise de graves choses. Porte-moi là-bas, sur cette petite île. Je pourrais aisément traverser ces ondes tranquilles, mais je préfère que tu me portes, afin de reposer une fois encore, la dernière peut-être, dans tes bras, sur ton cœur. Allons !
Huldbrand, ému et troublé par ces paroles inattendues, ne répondit rien et se borna à faire exactement ce qu’Ondine lui demandait. Arrivé sur l’îlot il déposa doucement sur l’herbe son cher fardeau.
— Maintenant, assieds-toi en face de moi, dit Ondine, que je puisse lire dans tes yeux avant même que tes lèvres ne me répondent. Écoute avec une grande attention ce que je vais te dire.
Apprends, ami, qu’il existe dans le monde invisible qui enveloppe le monde où tu évolues, des êtres vivants dont l’existence se manifeste rarement aux hommes. Dans ces flammes se jouent les énigmatiques Salamandres ; des Gnomes malicieux peuplent les profondeurs de la terre ; les Sylvains habitent les forêts; les Sylphes traversent sans cesse les airs ; et dans les mers, les lacs, les torrents, les ruisseaux, vit le peuple innombrable des Ondins. Ceux-ci occupent de vastes palais de cristal d’où ils voient le ciel, le soleil et les lumières de la nuit ; dans leurs jardins s’élèvent des arbres de corail chargés de fruits d’or ; un sable pur tout parsemé de beaux coquillages s’étend sous leurs pas. Les habitants de ces régions que Dieu dérobe aux regards indignes des hommes, sont tous d’un aspect gracieux et beau. Les femmes surtout, ondoyantes comme les vagues parmi lesquelles elles se jouent, surpassent en beauté les êtres les plus privilégiés ; leur visage a la pureté, leurs yeux la clarté du monde marin où elles vivent ; les pêcheurs qui, à l’aube, ont eu la bonne fortune de voir une de ces filles des eaux, au moment où, pour chanter, elle émergeait de la blanche écume, ne perdront jamais le souvenir de cette prodigieuse apparition. On appelle ces femmes les Ondines ; dois-je te dire, après cela, mon bien-aimé, que c’est une de ces Ondines que tu vois en ce moment devant toi ? Tandis qu’il écoutait l’étrange histoire de sa jeune épouse, Huldbrand cherchait à se persuader à lui-même qu’il n’y avait rien de vrai là dedans, que ce n’était là, une fois de plus, qu’une mystification de la part de l’espiègle Ondine ; mais, en même temps, un vague pressentiment le portait à croire qu’Ondine était sincère, et alors, infiniment troublé, il regardait la conteuse sans savoir que répondre.
Nous devrions préférer notre existence à celle des autres humains, reprit Ondine, car notre vie est plus harmonieuse que la vôtre ; mais un abîme nous sépare de vous. Tandis que notre corps a été exalté par le Créateur, nous avons été privés de la plus douce des fortunes : nous n’avons pas d’âme ! L’élément qui nous fait vivre nous est seulement soumis tant que nous vivons ; il disperse jusqu’à nos traces dès que la mort a fait sur nous son œuvre d’anéantissement. Nous n’avons point d’âme ! Alors qu’une vie nouvelle, plus sereine et plus enviable, sonne pour vous à l’heure de la déchéance de votre corps, nous et nos semblables des autres éléments nous sommes tout entiers anéantis par la mort dès l’instant où son aile nous a touchés. Insouciants et heureux de vivre, nous sommes gais cependant comme les oiseaux au clair soleil du printemps.
Mais chacun aspire à plus qu’il ne possède. Mon père, un puissant prince de la Méditerranée, a voulu que sa fille unique acquît une âme, fût-ce au prix des plus cruelles souffrances réservées généralement aux hommes doués de ce sentiment profond. Or, les Ondines ne peuvent atteindre à ce but que grâce à l’amour d’un homme de la terre. Tu m’as aimée, tu m’aimes : j’ai désormais une âme et c’est par toi qu’elle s’est révélée. Je te rends grâce, ô mon bien-aimé, et éternellement je te garderai la même reconnaissance quel que soit l’avenir d’heur ou de malheur qui m’est réservé par toi.
Maintenant que tu sais tout, que je me suis dépouillée à tes yeux de toute enveloppe de mensonge, maintenant aussi que tu connais et l’amour et la gratitude que je te garde, choisis, décide de nos deux destinées. Si tu veux qu’elles se poursuivent côte à côte, tu me verras, aimante et fidèle, près de toi ; si au contraire tu veux m’abandonner, me repousser, par crainte de mes origines étranges, je plongerai dans ce ruisseau, qui est mon oncle, et je retournerai vers mes frères les Ondins. Mon parent le ruisseau est puissant : c’est lui qui m’a conduite, légère et rieuse enfant, chez le vieux pêcheur ; c’est lui qui me ramènera aux miens, femme maintenant, douée d’une âme, connaissant l’amour et prête à connaître la souffrance. »
Huldbrand, sur ces dernières paroles, saisit Ondine avec transport dans ses bras, et lui prodigua toutes les marques de la plus vive affection. Mieux qu’aucune réponse, cet élan de son cœur vers la jeune femme témoignait de sa sincérité. Enfin, il dit qu’il la regarderait toujours comme sa femme adorée et que jamais il ne la délaisserait. Pleine d’une douce confiance, Ondine reprit le bras de son époux, et le monde nouveau qui s’ouvrait devant elle lui parut infiniment plus délicieux que l’autre, celui où des palais de cristal s’élevaient entre des arbres de corail.
IX
LE CHEVALIER PART AVEC SA JEUNE FEMME
Huldbrand fut bien étonné, le lendemain matin, à son réveil, en constatant qu’Ondine n’était plus à ses côtés.
Il se laissait déjà reprendre par cette idée que son mariage et la gracieuse fille des ondes elle-même n’étaient que rêve et illusion, quand Ondine reparut et lui dit : — Je suis sortie de bonne heure pour aller voir mon oncle le ruisseau. Il a tenu parole et ses eaux ont tout à fait repris leur cours paisible d’autrefois. D’ailleurs toute la région a retrouvé son calme des beaux jours ; tu peux donc quand tu voudras reprendre le chemin de ton pays.
Quelques instants après, les deux époux se trouvaient sur le seuil de la chaumière, et, devant le beau paysage qui s’étendait devant eux, Huldbrand, songeant à ce berceau de son amour, ne put s’empêcher de dire : — Pourquoi nous hâter de partir ? Cet endroit est charmant et nous ne connaîtrons peut-être plus, ailleurs, des jours de douce solitude comparables à ceux que nous passons ici. Qu’il nous soit donné au moins de revoir deux ou trois fois le soleil se coucher sur ce paysage ami.
— Que la volonté de mon seigneur et maître soit faite, répondit Ondine souriante. Mais je pense aux deux bons vieillards qui ont été ici mes parents nourriciers. Ils vont avoir beaucoup de peine en apprenant notre départ, et je ne saurais peut-être pas leur cacher suffisamment que mon amour en m’attachant à toi m’a bien détachée d’eux.
J’aime mieux aussi qu’ils ignorent mon âme nouvelle ; le souvenir qu’ils garderont de moi sera plus léger, la séparation entre nous moins cruelle. Telle qu’ils m’ont connue, un oiseau, une fleur me remplaceront exactement.
C’est pour toutes ces raisons que je serais heureuse de voir abréger le moment pénible du départ.
Le chevalier comprit ces raisons. Il alla trouver le vieux pêcheur et sa bonne femme et leur parla avec bonté.
Puis Ondine et lui, accompagnés du moine, prirent congé d’eux. L’adieu fut marqué d’affection et de reconnaissance de la part de chacun. Ondine surtout embrassa ses parents adoptifs avec la plus grande tendresse et leur dit de bonnes paroles d’une voix pleine de larmes. Puis Huldbrand aida son épouse à se placer sur le cheval, dont il saisit la bride, tandis que le prêtre marchait de l’autre côté ; et l’on se mit en route.
Les deux bons vieillards, qui sanglotaient sur le seuil de leur maisonnette vide, répondirent aussi longtemps qu’ils purent aux gestes gracieux de leur Ondine, et puis un silence triste se mit à peser autour d’eux sur la presqu’île qui leur parut toute changée.
Les trois voyageurs arrivèrent bientôt sous les ombrages touffus de la forêt. Ondine était plus ravissante que jamais sur son noble coursier ; le prêtre paraissait grave, dans sa robe austère de moine ; Huldbrand, ceint de son épée, la plume hardiment plantée dans le chapeau, était le chevalier intrépide. Ondine et lui ne cessaient de se regarder, de s’admirer l’un l’autre. Au bout d’un certain temps, ils s’aperçurent avec surprise que le moine était en grande conversation avec un quatrième personnage, venu ils ne savaient d’où et qui s’était joint mystérieusement à eux. Ce personnage portait une longue robe blanche aux plis flottants ; son aspect était imposant quoique étrange. Au moment où les deux jeunes gens les remarquèrent, il disait au prêtre : — Je vis depuis longtemps dans cette forêt, digne seigneur, sans être pourtant un ermite au sens où vous entendez ce mot. Je ne suis pas ici par esprit de pénitence.
J’aime la forêt parce qu’elle me semble tout particulièrement belle et que j’ai plaisir à me promener, dans mes vêtements qui ondoient, sous les arceaux légers qui traversent, telles des flèches d’or, les rayons du soleil. Le soleil est de mes amis ; il joue volontiers parmi les reflets chatoyants de ma robe d’argent.
— Vous êtes un homme tout à fait étrange, répondit le moine.
— Mais vous-même, qui êtes-vous donc ? demanda l’étranger.
— Je suis le Père Heilmann, dit le prêtre, et je viens du couvent de la Salutation, qui est situé de l’autre côté du grand lac.
— Moi, répondit l’homme à la robe flottante, je m’appelle Kühleborn, le sire de Kühleborn, voire même le baron de Kühleborn, car si le mot baron signifie homme libre, il est vraiment fait pour moi, nul n’étant plus libre que moi sur cette terre. A propos, il faut que je dise un mot à cette jeune femme.
Et, brusquement, l’étranger se trouva à côté d’Ondine ; il parut quitter le sol pour atteindre au visage de la jeune femme et lui parler à l’oreille ; mais Ondine se détourna de lui, toute effrayée, en disant : — Je n’ai plus rien de commun avec vous.
— Oh ! oh ! quelle grande dame vous faites, riposta en riant le sire de Kühleborn. Ne connaissez-vous plus vos parents ? Faut-il vous rappeler que c’est l’oncle Kühleborn qui vous a gentiment amenée dans cette contrée ?
— Je vous en prie, insista Ondine, éloignez-vous, mon oncle. Que pensera mon mari en me voyant en si singulière compagnie ?
— Ma chère petite nièce, répondit Kühleborn, vous savez bien que je suis ici pour votre défense ; sans moi, les gnomes malicieux pourraient vous jouer quelque vilain tour. Laissez-moi donc vous accompagner, vous servir de protecteur. Le vieux prêtre que voici m’a accueilli plus aimablement. Il m’a dit que mon visage ne lui était pas inconnu ; et, en effet, j’étais la vague qui l’entraîna dans le lac et le porta ensuite sous les arbres de la presqu’île, près de la chaumière, afin qu’il pût bénir ton mariage.
Mais Ondine dit encore à Kühleborn : — Je vous en prie, mon oncle, n’insistez pas, retirez-vous. Voici que j’aperçois la fin de la forêt : nous n’avons donc plus besoin de vous. Laissez-nous continuer en paix notre chemin.
Ces paroles eurent le don de déplaire à Maître Kühleborn qui ne cacha pas sa mauvaise humeur et lança à sa jeune nièce un coup d’oeil significatif. Ondine, effrayée, poussa un cri et appela son époux à sa défense. Le chevalier s’élança aussitôt, l’épée haute, pour frapper Kühleborn.
Mais l’arme en s’abaissant ne rencontra qu’une trombe d’eau qui s’abattit sur les voyageurs et les inonda de la tête aux pieds. En même temps, d’un rocher voisin une belle cascade se mit à jaillir dont les eaux, en bondissant gaiement sur la pierre, imitaient le bruit de petits rires ironiques.
Le moine, comme s’il sortait d’un rêve, dit alors : — Il y avait un moment déjà que je voyais cette cascade près de nous. J’ai même cru tout d’abord que c’était un homme et que cet homme nous parlait.
Huldbrand allait répondre quand, de la cascade, lui parvinrent très nettement ces paroles : Beau chevalier noble et courageux, tu fais ton devoir et je ne saurais t’en vouloir : Protège toujours ainsi ton épouse, Sois toujours son fidèle chevalier.
Encore quelques pas et les voyageurs se trouvèrent hors de la forêt. La ville leur apparut alors. Ses tours et ses clochers, dressés vers le ciel magnifique, étincelaient dans la lumière du soleil couchant.
X
A LA VILLE
La disparition du jeune chevalier Huldbrand de Ringstetten avait soulevé une grosse émotion par toute la ville.
Tous ceux — et ils étaient nombreux — qui avaient eu l’occasion d’apprécier les fines et nobles qualités du jeune homme regrettaient qu’une folle audace l’eût entraîné dans une aventure pleine de mystère, et ressentaient les plus grandes inquiétudes sur son sort.
Ses serviteurs ne savaient quel parti prendre. Ils n’osaient regagner seuls le château de leur maître et moins encore pénétrer dans la forêt maudite pour y faire des recherches.
Lorsque, bientôt après sa disparition, on apprit quelles tempêtes et quelles inondations avaient dévasté la région où il s’était engagé, il se trouva bon nombre de personnes pour conclure à la mort du pauvre chevalier. Bertalda ne se cacha pas pour le pleurer, et quand ses parents adoptifs, le duc et la duchesse, vinrent la chercher à la ville pour la reconduire chez eux, dans un château lointain, elle les décida à rester avec elle jusqu’à ce qu’on eût reçu des nouvelles certaines de Huldbrand, dont il fallait au moins, disait-elle, qu’on retrouvât le corps. Elle essaya de pousser quelques chevaliers, assidus auprès d’elle, à entreprendre des recherches dans la forêt ; mais elle ne comptait point en retour promettre sa main à aucun d’eux, sans doute parce que tout espoir de revoir Huldbrand vivant n’était pas encore perdu pour elle. Et pour gants et rubans, voire pour un baiser, personne ne consentit à risquer sa vie au service d’un rival si redoutable.
Lors donc que Huldbrand reparut inopinément, ses serviteurs et les habitants de la ville en témoignèrent une grande joie. Bertalda fut peut-être la seule à ne pas se réjouir ; mais le fait est que son visage, triste depuis longtemps, s’assombrit davantage encore. La raison en était que le chevalier ne revenait pas seul, qu’une femme d’une délicieuse beauté l’accompagnait, et qu’un prêtre, témoin de leur mariage, suivait ce couple heureux. Bertalda, prise entre un amour véritable et qu’elle avait déjà ouvertement avoué à tous, et la nécessité de faire face à des circonstances nouvelles, s’acquitta fort habilement de cette tâche délicate. Elle accueillit Ondine de la manière la plus aimable et montra à Huldbrand des sentiments vagues où dominait une indifférence affectée.
Ondine passa bientôt pour une princesse merveilleuse délivrée par Huldbrand de quelque mauvais enchantement dans la forêt maudite. Quand on l’interrogeait elle-même sur son origine, un mot ou deux lui suffisaient à éluder fort adroitement la question. Le chevalier, de son côté, ne disait que ce qu’il voulait bien dire, et, quant au Père Heilmann, il avait presque immédiatement quitté la ville pour regagner son couvent. Si bien que les gens durent se contenter de leurs hypothèses ; Bertalda elle-même en fut réduite à ses imaginations. Ondine l’aimait cependant beaucoup et se sentait attirée vers elle : — Je ne sais pas quel sentiment secret me pousse vers vous, disait-elle parfois à sa nouvelle amie, mais, dès que je vous ai vue, je vous ai aimée. On dirait qu’un lien mystérieux, quelque chose comme un souvenir, nous unit.
Quant à Bertalda, elle constatait avec surprise la sympathie qui l’entraînait vers une femme qu’elle eût dû haïr, puisque cette heureuse rivale lui avait ravi le cœur du chevalier.
Cette amitié réciproque fut cause que le jeune couple prolongea son séjour au château. Ondine invita même Bertalda à venir passer quelques semaines au manoir de Ringstetten qui s’élevait non loin des sources du Danube.
Par une douce soirée d’automne, le chevalier et les deux amies se promenaient sur la grand’place de la ville, à la lueur tranquille des étoiles. Ils causaient gaiement, s’arrêtant parfois pour admirer une antique fontaine qui occupait le milieu de la place ; ils écoutaient le murmure captivant des eaux jaillissantes, que troublaient seuls les pas des autres promeneurs et le rire clair d’une bande d’enfants.
A travers le rideau sombre des grands arbres, ils apercevaient les lumières des maisons voisines. Ils se sentaient comme isolés au milieu de la ville, inondés de la joie sereine et calme que la nuit répandait autour d’eux.
Ils causaient du prochain départ, du voyage qu’ils comptaient bien faire à eux trois. Les objections élevées par les parents adoptifs de Bertalda leur semblaient incompréhensibles.
Au moment où ils allaient fixer le jour du départ, un homme de haute taille, traversant la place, s’avança vers eux et, saluant courtoisement Ondine, lui glissa quelques phrases à l’oreille. Une vive contrariété se peignit sur les traits de la jeune femme, mais, devançant ses compagnons, elle fit quelques pas avec l’étranger. On les entendit causer à voix basse, dans une langue inconnue.
Huldbrand, frappé par un souvenir imprécis, considérait attentivement le nouveau venu. Perdu dans ses pensées, il n’entendit même pas une question que lui adressait Bertalda. Soudain, Ondine se mit à rire, en battant joyeusement des mains, puis revint auprès de son mari, tandis que l’étranger s’éloignait rapidement en hochant la tête d’un air fort mécontent. Arrivé près de la fontaine, il disparut subitement, comme s’il fût entré dedans. Alors seulement, Huldbrand eut la certitude que son souvenir ne l’avait point trompé. Mais déjà Bertalda s’écriait : — Que te disait donc ce maître-fontainier ?
Le visage d’Ondine reflétait la joie la plus vive, quand elle répondit avec un sourire : — Tu sauras cela après-demain, quand nous célébrerons le jour de ta fête, chère Bertalda.
Elle ne voulut pas donner de plus amples explications et termina l’entretien en invitant son amie à prendre part, ainsi que ses parents adoptifs, à un grand festin qu’elle offrait le surlendemain.
— C’était bien Kühleborn ? demanda anxieusement Huldbrand à sa jeune femme, dès qu’ils eurent quitté Bertalda. Ils marchaient lentement dans les rues de la ville où la nuit se faisait plus obscure.
— Oui, dit Ondine, c’était lui. Il me racontait toutes sortes d’histoires absurdes, au milieu desquelles, sans le vouloir, il a laissé échapper un secret qu’il n’avait pas l’intention de me révéler et qui, pourtant, me rend bien heureuse. Si tu veux le connaître à l’instant, mon doux seigneur, tu seras obéi. Mais si tu veux me faire un grand plaisir tu attendras jusqu’à après-demain ; tu verras quelle jolie surprise vous attend tous.
Le chevalier n’eut garde de refuser à sa belle épouse ce qu’elle lui demandait si gentiment. Quelques instants plus tard, Ondine, sur le point de s’endormir, se redisait tout bas, avec un sourire de bonheur : — Comme elle sera heureuse, ma chère Bertalda, quand elle connaîtra la nouvelle apportée par son maître fontainier.
XI
LA FÊTE DE BERTALDA
Au milieu d’une nombreuse assemblée de convives, Bertalda, parée des bijoux qu’on venait de lui offrir, trônait au haut bout de la table, entre Ondine et Huldbrand. On eût dit la déesse du Printemps. Lorsque la fin du repas approcha, on ouvrit toutes grandes les portes de la salle, suivant l’antique coutume du pays, afin que les gens du peuple pussent prendre leur part de la fête. Des serviteurs offrirent aux nouveaux venus des rafraîchissements et des pâtisseries. Huldbrand et Bertalda, impatients de percer enfin le mystère qu’Ondine avait promis de dévoiler, ne quittaient point des yeux la jeune femme qui, émue et souriante, s’efforçait de contenir le secret qu’elle semblait à tout instant sur le point de trahir. Ainsi que les enfants reculent le moment où ils mangeront le gâteau qui excite leur convoitise, ainsi la jeune mariée semblait vouloir jouir plus longtemps d’une attente délicieuse. Huldbrand et Bertalda, pleins d’émotion, ne l’interrogeaient point, tendant que, d’elle-même, elle leur révélât le bonheur qui devait se répandre sur eux comme une rosée céleste.
Enfin, quelques-uns des convives ayant prié Ondine de leur chanter une mélodie du pays, la jeune femme fit apporter sa harpe et se mit à chanter :
Par une claire matinée, les fleurs aux mille couleurs, les herbes enivrantes se balancent sur la rive du lac argenté.
Que vois-je, parmi les fleurs, briller d’un éclat si pur ?
On dirait un beau lis blanc tombé du ciel sur la prairie.
Non, c’est une mignonne fillette qui joue dans l’herbe haute.
Sont-ce les rayons d’or que reflète le lac, O gracieuse enfant, qui t’attirent ainsi ?
Le lac berceur s’empare de toi.
Hélas ! pourquoi maintenant tendre ainsi tes mains vers le rivage ?
Aucune main n’ira vers toi.
Loin du cœur maternel, tu vas perdre ta vie, dans un sourire.
Mais un noble duc chevauche
le long du bord et retient son coursier.
Il te prend dans ses bras, t’emmène en son château et t’élève comme sa fille.
Tu grandis belle et pure, tu brilles entre toutes.
Mais hélas ! le bien le plus précieux, tu l’as laissé au lointain rivage !
Les parents adoptifs de Bertalda ne purent contenir leur émotion. Le duc, se levant, dit alors à Bertalda : — C’est ainsi que les choses se sont passées, pauvre orpheline, quand je te retirai du lac ; mais Ondine a raison, nous ne pouvions te rendre le plus précieux des biens !
— Ecoutez ! écoutez ! reprit Ondine. Voici ce qui est arrivé aux pauvres parents : La mère erre dans les chambres, vide tous les tiroirs, puis les remplit ; elle gémit, elle appelle, et rien ne lui répond.
La maison vide, hélas !
Quelle sombre parole pour celle qui eut un doux enfant qu’elle berçait la nuit, qu’elle suivait le jour!
Pauvre mère, cesse de chercher, ce que tu aimes t’est ravi pour toujours.
Et quand, le soir, souffle le vent et que le père, las, revient à son foyer, il voudrait te sourire, mais ses yeux n’ont que des larmes.
Car le père sait bien qu’en sa triste demeure règne le froid silence que troublent seuls les sanglots d’une femme.
L’enfant ne sourit plus, en lui tendant les bras !
— Ondine, au nom du ciel, dis-moi où sont mes parents, s’écria Bertalda en pleurant. Oui, tu le sais, car tu ne me déchirerais pas le cœur, si tu ne pouvais, en même temps, me consoler. Peut-être sont-ils ici ? Serait-ce ?
Elle embrassa d’un regard la noble assemblée et ses yeux s’arrêtèrent sur une princesse placée à côté de son père adoptif. Alors, Ondine, versant des larmes de bonheur, se tourna vers les serviteurs.
— Faites entrer, dit-elle, les pauvres parents qui se consument dans l’attente.
On vit alors le vieux pêcheur et sa femme, tout tremblants, s’avancer vers Ondine, qui, d’un geste attendri, leur désigna Bertalda. Les deux braves gens se jetèrent en pleurant de joie au cou de la belle jeune fille qu’on disait être leur enfant chérie, mais Bertalda les repoussa, les yeux pleins de colère. C’en était trop pour cette nature orgueilleuse ! Déjà, elle se flattait d’appartenir à une illustre famille, elle se voyait montant les marches d’un trône, et voilà qu’on lui découvrait une origine si humble que son cœur frémissait d’indignation. Persuadée qu’Ondine avait inventé cette histoire ridicule pour l’humilier devant toute l’assemblée, elle se redressa, couvrant d’injures Ondine et les deux vieillards. La pauvre mère ainsi repoussée, ne put que balbutier : — Hélas ! hélas ! comme son cœur est devenu méchant ! Et pourtant, je le sens, c’est mon enfant !
Quant au pêcheur, il s’était jeté à genoux en suppliant le Seigneur que cette fille ne fût pas la sienne. Ondine, pâle et chancelante, considérait en silence cette scène pénible. Son beau rêve était brisé, sa joie faisait place à un immense désespoir. Enfin, elle se dirigea vers son amie en disant : — N’as-tu donc pas d’âme, Bertalda? N’as-tu pas d’âme ?
La pauvre enfant s’imaginait que cette question rendrait Bertalda à elle-même en la tirant de cet accès de fureur qui semblait une crise de folie. Mais la jeune fille, en proie à une rage terrible, l’invectivait de plus belle.
Les convives commençaient à murmurer, les uns prenant son parti, les autres blâmant la dureté de son cœur. Au milieu du tumulte grandissant, la voix d’Ondine se fit entendre. La jeune femme réclama le droit de parler dans les appartements de son mari. Son noble maintien, sa dignité douloureuse en imposèrent aux invités. Un grand silence se fit.
— Vous tous qui assistez à une fête que je voulais si belle, dit Ondine, soyez assurés que mon cœur ne connaissait point les mœurs insensées des hommes et leurs âmes perverses. Jamais, sans doute, je ne pourrai m’y accoutumer. Si mon entreprise échoue, hélas ! pitoyablement, ne vous en prenez pas à moi ; je n’ai voulu que le bonheur d’une amie. Je ne me défendrai donc point ; mais ce que je puis vous affirmer, c’est que je n’ai point menti. Je ne puis, ni ne daigne vous en donner des preuves, ma parole doit vous suffire. Celui qui m’a révélé l’origine de Bertalda est l’homme qui, jadis, l’a ravie à ses parents en l’attirant dans le lac, et qui, ensuite, l’a portée sur le passage du duc.
— Tu n’es qu’une sorcière ! hurla Bertalda. Tu entretiens un mystérieux commerce avec les esprits malfaisants et les démons !
— Non, reprit Ondine avec force, il suffit de me voir et de m’entendre pour me croire innocente !
— Mensonges ! infamie ! Comment osez-vous prétendre que je sois l’enfant de ces misérables gens ? 0 mes chers parents adoptifs, emmenez-moi loin de cette demeure maudite où l’on m’accable de honte !
Le duc, pensif, se taisait ; sa femme dit alors : — Il faut que cette affaire s’éclaircisse ; je jure devant Dieu de ne point sortir d’ici tant que la vérité ne sera pas établie.
— Noble dame, dit la vieille femme en s’avançant, votre bonté et votre justice m’encouragent à vous parler. Si cette méchante demoiselle est ma fille, elle porte sur une épaule un petit signe semblable à une violette, et un autre près de la cheville. Qu’elle consente seulement à me suivre un moment dans la pièce voisine.
— Me déshabiller devant cette paysanne ! Jamais! fit dédaigneusement Bertalda en lui tournant le dos.
— Vous le ferez donc devant moi, reprit gravement la duchesse. Suivez-moi, mon enfant, et vous aussi, ma bonne femme.
Les trois femmes sortirent pour reparaître, un instant après, au milieu d’un silence impressionnant. Bertalda était pâle comme une morte.
— Je déclare ici, dit à voix haute la duchesse, que très haute et puissante dame de Ringstetten a dit la vérité : Bertalda est bien la fille du pêcheur. Nous n’avons rien de plus à vous dire.
L’assemblée se dispersa en commentant l’événement, tandis que le duc et la duchesse, suivis de la jeune fille et de ses parents, regagnaient leur château. Ondine se jeta dans les bras de son époux et pleura longtemps.

Bertalda portait sur une épaule un petit signe semblable à une violette et un autre près de la cheville
XII
COMMENT LES JEUNES ÉPOUX QUITTÈRENT LA VILLE
Le chevalier de Ringstetten était fort contrarié de cet événement imprévu, mais il ne pouvait qu’admirer la bonté de sa belle Ondine. «Il se peut, pensait-il, que je lui aie donné une âme, mais comme cette âme charmante est plus noble que la mienne ! Son plus cher souci fut donc de consoler celle qu’il aimait ; il résolut de l’emmener chez lui sans plus tarder. L’opinion, pourtant, se montrait favorable à Ondine. Tous ceux qui avaient assisté à la scène blâmaient hautement la dureté de Bertalda, mais cela aussi peinait la douce jeune femme.
Le lendemain, un carrosse attendait Ondine devant l’hôtellerie. Au moment où le chevalier parut, tenant par la main sa belle épouse, une jeune pêcheuse s’avança vers eux pour leur offrir sa marchandise : — Nous n’avons besoin de rien, dit Huldbrand en l’écartant doucement, nous quittons à l’instant ce pays.
La jeune fille s’étant mise à pleurer, les voyageurs, surpris, la regardèrent plus attentivement et reconnurent Bertalda. Aussitôt ils rentrèrent avec elle dans leurs appartements et apprirent de sa bouche comment le duc et la duchesse, indignés de sa conduite, l’avaient abandonnée, non sans lui assurer une riche dot.
— Ne sachant que devenir, continua la jeune fille, je cherchai, pour les suivre chez eux, ces vieux pêcheurs que l’on prétend être mes parents.
— Ils le sont véritablement, Bertalda ; je le tiens de celui que tu pris pour un maître-fontainier. Il voulait à toutes forces m’empêcher de t’emmener avec nous et, au milieu de ses exhortations, il m’a involontairement livré son secret.
— Cet homme, ou plutôt mon père puisque vous affirmez qu’il l’est, m’a repoussée en disant : Tant que ton cœur ne sera pas changé, nous ne voulons pas de toi. Pour te donner maintenant notre affection, j’exige de toi l’épreuve suivante : Tu traverseras seule la forêt hantée, vêtue non comme une princesse, mais comme la fille de pauvres pêcheurs. » Je n’ai qu’à m’incliner devant sa volonté, étant désormais seule au monde ; je vivrai humble et solitaire dans la chaumière de mes parents. Ce qui me cause une épouvante sans nom, c’est l’obligation de traverser la forêt redoutable, moi qui tremble au moindre danger. Mais, je ne viens pas à vous pour me plaindre, je suis ici pour implorer votre pardon, noble dame de Ringstetten. Je comprends maintenant que vous ne vouliez que mon bonheur et je regrette les paroles blessantes que, dans ma colère et mon dépit, j’ai proférées contre vous. Pardon ! pardon ! Je suis si malheureuse ! si punie ! Songez à ce que j’étais hier, avant ce fatal repas de fête, et voyez où je suis tombée !
Les sanglots l’interrompirent, mais Ondine la prit tendrement dans ses bras et, mêlant ses larmes à celles de la jeune fille, répondit : — Tu viendras à Ringstetten avec nous ; rien ne doit être changé à ce que nous avions décidé. Je te défends seulement de m’appeler noble dame ; je reste ton amie fidèle. Dès mon enfance, j’ai pris ta place, nos destinées ne se doivent point séparer. Viens avec moi, nous nous aimerons comme deux sœurs.
Bertalda leva timidement ses beaux yeux vers Huldbrand qui, tout ému de compassion, acquiesça au désir de sa femme. Il engagea la jeune fille à les accompagner, en lui promettant de faire savoir aux vieux pêcheurs pourquoi elle ne les avait pas rejoints. Offrant sa main à Bertalda, pour la faire monter dans le carrosse, il l’y installa aux côtés d’Ondine, puis sauta en selle.
Les voyageurs s’éloignèrent rapidement. Peu à peu, la tristesse fit place à une douce joie. Les jeunes voyageuses admiraient les riches contrées qu’elles traversaient.
Au bout de quelques jours, on vit apparaître le château de Ringstetten, où l’on débarqua par une radieuse journée.
Le soir même, Ondine et Bertalda, laissant le chevalier en conversation avec ses intendants, gravirent un petit tertre qui dominait le parc. Elles admiraient le magnifique paysage qu’étalaient sous leurs yeux les riantes vallées de la Souabe, lorsqu’un homme de haute taille, s’approchant d’elles, les salua profondément.
Bertalda tressaillit, croyant reconnaître le maître-fontainier cause de ses malheurs. Elle ne douta plus que ce ne fût bien lui, lorsqu’elle le vit, sur un geste mécontent d’Ondine, s’éloigner à grands pas, en hochant la tête d’un air soucieux, exactement comme l’autre fois.
— Ne crains rien, ma chérie, dit Ondine, désormais il ne pourra pas te faire de mal.
Alors elle se mit à lui raconter sa propre histoire, expliquant comment Bertalda, jadis, avait été ravie à ses parents, et comment elle, Ondine, avait été conduite chez les vieux pêcheurs. Bertalda l’écouta d’abord avec terreur, pensant que son amie venait de perdre soudain la raison, mais, peu à peu, frappée par la coïncidence de tous ces événements, elle se rendit à l’évidence. Un sentiment obscur lui disait que ce récit, pour étrange qu’il fût, était bien la vérité. A la fois fière de vivre au milieu d’aventures fabuleuses, et troublée par le mystère qui entourait Ondine, elle se sentait attirée vers la jeune femme et un peu effrayée de ses révélations étranges. Au dîner, elle s’étonna de voir les attentions dont Huldbrand entourait sa jeune femme, elle se demandait comment il pouvait être aussi épris d’une créature charmante à la vérité, mais qui lui semblait à présent moins une femme qu’un gracieux fantôme.
XIII
COMMENT ON VÉCUT AU CHÂTEAU DE RINGSTETTEN
PASSONS rapidement sur les premières années qui s’écoulèrent au château. Il serait certes plus conforme aux règles de l’art de montrer comment, peu à peu, l’amour d’Huldbrand pour Ondine s’affaiblit pour se reporter sur Bertalda. Nous nous contenterons pourtant d’en arriver au fait et de dire que la passion du chevalier pour la jeune fille fut récompensée d’un amour égal. Tous deux considéraient maintenant la pauvre Ondine comme un être étranger à leur race. Les larmes de l’infortunée leur inspiraient une crainte vague, mais point de pitié. Parfois, le chevalier semblait éprouver un remords, mais l’ancien amour ne se pouvait réveiller. Il frissonnait à la vue de sa femme, s’efforçait de se montrer affectueux, mais il ne trouvait le repos du cœur qu’auprès de Bertalda, comme lui enfant des hommes. L’auteur, qui a traversé des épreuves cruelles, ne veut pas, en vous racontant les tristesses de l’abandon, réveiller ses propres souvenirs mal assoupis. Mais revenons au château de Ringstetten.
Si Ondine vivait dans la douleur, les deux autres n’étaient certes pas plus heureux ; car celui qui cause les tourments est encore plus à plaindre que celui qui les subit. Bertalda s’aigrissait de plus en plus, croyant voir une revanche jalouse de la femme outragée dans la plus légère contradiction d’Ondine. Elle montrait à tous un air impérieux et dur, imposant ses caprices que la jeune femme devait subir parce que le chevalier donnait toujours raison à celle qu’il aimait.
Ce qui jetait le désarroi dans le cœur des deux complices, c’était le nombre des apparitions qu’ils rencontraient dans les sombres couloirs du château. Ils reconnaissaient Kühleborn dans cet homme de haute taille qui leur barrait souvent le chemin d’un air si menaçant que plusieurs fois Bertalda s’était évanouie de terreur. Mais ils se rassuraient en songeant à l’innocence d’un amour que ni l’un ni l’autre n’avait jamais déclaré. D’ailleurs, si la jeune fille quittait le château, où irait-elle ? Le chevalier avait, selon sa promesse, envoyé un messager au père de Bertalda.
La réponse du vieux pêcheur, confuse et difficile à lire, semblait contenir un blâme, un avertissement troublant.
– Me voilà seul désormais, disait-il ; ma chère femme est morte. Bertalda est mieux auprès de vous que dans ma chaumière désolée, mais si jamais elle fait le moindre mal à ma chère Ondine, je la maudis ! La jeune fille n’accorda aucune attention à la menace, ne retenant que la permission tant désirée de se fixer au château de Ringstetten.
Or, un matin, comme Huldbrand venait de sortir à cheval, Ondine appela les serviteurs et leur commanda de boucher avec une énorme pierre un grand puits situé au milieu de la cour du château. Étonnés, les serviteurs lui firent observer respectueusement que ce serait bien incommode de ne plus se servir du puits, car il faudrait chercher l’eau très loin, tout au fond du vallon.
— Mes braves amis, répondit la jeune femme avec un triste sourire, je suis désolée de vous imposer ce surcroît de fatigue, mais il est indispensable de condamner ce puits. Croyez en ma parole : c’est le seul moyen d’éviter un grand malheur.
Touchés de la douceur de leur jeune maîtresse qu’ils adoraient, les serviteurs n’ajoutèrent pas une parole et s’empressèrent d’exécuter ses ordres. Déjà, ils soulevaient un gros quartier de roche pour l’élever jusqu’à la margelle du puits, lorsqu’ils virent accourir Bertalda.
Elle leur ordonna de cesser sur-le-champ leur travail, déclarant que l’eau de ce puits possédait une pureté incomparable, qu’elle s’en servait pour sa toilette, et que, seule, cette eau pouvait conserver la blancheur de son teint.
Mais, cette fois, Ondine ne s’inclina pas devant la volonté de Bertalda. Elle répondit, d’un ton doux quoique ferme, qu’elle était seule maîtresse en sa demeure et ne devait de comptes qu’à son époux et seigneur.
— Voyez ! voyez ! s’écria la jeune fille avec colère, cette eau transparente s’agite, moutonne et s’enfle ! On dirait qu’elle a compris qu’on allait lui dérober les chauds et clairs rayons du soleil et la priver de ce pour quoi elle a été créée : refléter joyeusement les visages humains ! En effet, l’eau grondait et bouillonnait au fond du puits, comme si quelque chose eût voulu en jaillir. Ondine réitéra plus énergiquement son ordre ; mais déjà les serviteurs, heureux de lui être agréables et de désobéir à l’impérieuse Bertalda, avaient soulevé la pierre et la déposaient sur l’orifice du puits. Dès que ce fut fait, Ondine se pencha sur la pierre et y traça, avec son doigt, quelques signes. Lorsqu’elle s’éloigna, les serviteurs s’approchèrent et se demandèrent avec surprise de quel instrument aiguisé elle avait bien pu se servir pour tracer ces signes étranges qui ne se trouvaient pas auparavant sur la pierre.
Le soir, Bertalda attendit le retour du chevalier pour se plaindre en pleurant du procédé d’Ondine. Huldbrand jeta un regard courroucé sur la jeune femme qui baissa tristement la tête.
— Mon cher seigneur ne blâmerait pas le dernier de ses sujets sans avoir entendu sa défense. Voudrait-il faire moins pour sa propre épouse ? dit-elle.
— Eh bien ! parle donc et dis-nous pourquoi tu as agi ainsi.
— Je voudrais te le dire sans témoin.
— Ne peux-tu donc pas parler devant Bertalda ?
— Si tu me l’ordonnes, j’obéirai, mais, je t’en supplie, ne fais pas cela.
Elle prononça ces mots d’un ton si humble, si soumis, que le cœur d’Huldbrand tressaillit de pitié et s’émut au souvenir de l’ancien amour. Il prit tendrement sa femme par la main et l’emmena dans son appartement.
— Tu te rappelles mon oncle Kühleborn, dit alors Ondine ; je crois même que tu t’irrites de le rencontrer parfois dans ce château, et Bertalda elle-même en est souvent effrayée. Tu sais qu’il n’a pas d’âme et qu’il ne comprend pas les choses de la même manière que nous.
Mais il m’aime, il s’obstine, malgré moi, à veiller sur mon bonheur. Il sait que parfois tu me parles avec sévérité ; alors je verse des larmes de douleur, tandis que Bertalda semble satisfaite. Cela lui met dans la tête mille pensées absurdes. Il se croit obligé de se mêler sans cesse à notre existence. J’essaie de lui faire comprendre que les peines et les joies d’amour sont liées les unes aux autres par un charme doux et mystérieux ; mais je parle vainement, il ne me croit pas. Pourtant, à travers les larmes, le sourire peut briller, et quelquefois le sourire amène les larmes.
Elle regarda timidement son mari en souriant et pleurant comme elle le disait, et le chevalier sentit soudain en son cœur l’ivresse des premiers temps d’amour. Ondine le comprit et, se serrant plus fort contre la poitrine d’Huldbrand, reprit : — Comme je ne puis réussir à persuader cet oncle dont je redoute la tendresse, il m’a bien fallu, pour m’en débarrasser, lui enlever le moyen d’entrer ici. Le puits de la cour est le seul endroit par où il peut pénétrer au château, parce qu’un de ses amis qui en est le possesseur le laisse passer, tandis qu’il est brouillé avec tous les autres génies des puits, fontaines et cours d’eau de la région. Ce n’est que beaucoup plus loin, vers le Danube, qu’il retrouve son pouvoir. Voilà pour quelle raison j’ai fait boucher le puits, et tracé sur la pierre des signes magiques qui enlèvent tout pouvoir à cet oncle trop bien intentionné. Ces signes n’ont pas de puissance sur les hommes, tu peux donc satisfaire le désir de Bertalda. Mais elle ne se doute pas de ce qu’elle exige. C’est à elle surtout qu’en veut Kühleborn, mais si ce que mon oncle redoute et prédit arrivait, toi-même, mon bien-aimé, tu serais en danger !
Huldbrand, plein d’admiration pour la noble créature qui se privait volontairement d’un puissant protecteur et n’hésitait pas à encourir les reproches de Bertalda, la serra dans ses bras avec amour.
— La pierre restera où tu l’as fait mettre, dit-il, et tout sera réglé ici selon ta volonté, ma chère femme adorée.
Ravie d’entendre enfin les mots d’amour qu’elle attendait en vain depuis si longtemps, Ondine reprit, après avoir rendu au chevalier ses caresses : — Mon doux seigneur, j’oserai t’adresser une prière, puisque je te retrouve aimant et tendre. Songe, ami, à ce qui se passe parfois, en été : au milieu d’une journée radieuse, on voit soudain le ciel éclatant se couvrir de nuages, comme d’une couronne où brillent les éclairs, où gronde la foudre. C ‘est alors que l’été semble le roi, le dieu de la terre. Il en est de même pour toi. Lorsque je t’ai mécontenté, ta voix gronde et tes yeux lancent des éclairs. Tu me sembles encore plus beau et plus grand, mais ensuite je pleure. Je t’en supplie, évite de te montrer ainsi courroucé contre moi quand nous serons près d’un fleuve, d’une fontaine ou d’un lac. Mes parents reprendraient alors sur moi le droit qu’ils ont perdu, et m’arracheraient à toi, indignés d’entendre offenser une des leurs. Ils m’obligeraient à vivre auprès d’eux, loin de toi, dans leur palais de cristal, et jamais plus on ne me permettrait de te revoir.
Ou bien, si par malheur ils me renvoyaient vers toi, alors, ô mon bien-aimé ! ce serait pour une mission effrayante !
Sois doux et bon pour ta pauvre Ondine. Hélas ! si tu savais ce que causerait la perte de ton amour !
Huldbrand jura tendrement de faire ce que lui demandait sa femme et d’éviter toute occasion de mécontenter ses parents. Les deux époux, remplis de tendresse comme au temps de leur amour, sortaient de leur appartement, lorsqu’ils rencontrèrent Bertalda.
— Eh bien ! dit-elle d’un ton rogue et maussade, il est fini, je pense, votre mystérieux entretien ! Maintenant, je vais donner aux ouvriers que je viens d’appeler l’ordre d’enlever la pierre du puits.
Le chevalier, outré de l’insolence de Bertalda, répondit sèchement : — La pierre restera où elle est.
Les ouvriers se retirèrent, enchantés, en jetant des regards moqueurs sur la jeune fille qui pâlit, serra les lèvres et regagna son appartement.
A l’heure du dîner, on l’attendit en vain. Un valet chargé d’aller la quérir trouva la chambre déserte. Sur une table, un pli était disposé, adressé au sire de Ringstetten. Le serviteur le porta aussitôt à son maître qui, ayant rompu le cachet, lut avec stupeur le message suivant : J’avais oublié que je ne suis qu’une humble fille de pêcheur, pardonnez-moi de m’en être souvenue si tard et vivez heureux auprès de la belle Ondine. Je retourne à la chaumière paternelle. Adieu. Ondine, désolée, pria son mari de courir à la recherche de la fugitive. Hélas ! point n’était besoin de stimuler le zèle du chevalier chez qui venait de se réveiller l’ardent amour qu’il éprouvait pour Bertalda. Il parcourut fiévreusement le château, interrogeant tous les serviteurs, visitant toutes les chambres ; puis, il sauta sur un cheval qu’on lui amenait. Au moment où il allait s’élancer dans la direction de la ville, un écuyer lui cria qu’il venait de rencontrer la jeune demoiselle sur le chemin de la Vallée noire.
— Dans la Vallée noire ! gémit Ondine. N’y va pas, Huldbrand. Oh ! n’y va pas ! ou bien emmène moi !
Ses cris se perdirent dans le vent ; le chevalier avait disparu sans entendre les supplications de sa femme. Ce que voyant, Ondine fit amener son blanc palefroi, bondit légèrement en selle et s’enfonça au galop à la poursuite du chevalier, après avoir défendu aux écuyers de l’accompagner.
La Vallée noire s’étendait fort loin, du côté de la montagne. On la nommait ainsi à cause de l’obscurité qui régnait sous les grands arbres dont elle était entourée. Un ruisseau descendait d’une masse de rochers et promenait au milieu des terres ses eaux assombries par le reflet des hauts sapins de la forêt. A cette heure du crépuscule, le paysage prenait un aspect sauvage et fantastique. Le sire de Ringstetten galopait, partagé entre la crainte de ne pas rejoindre la jeune fille avant la nuit et celle de la dépasser sans l’apercevoir. Il se demandait, tout en suivant le ruisseau, s’il ne se trompait pas de chemin.
Son cœur battait à se rompre à la pensée que Bertalda, si craintive, allait être perdue en pleine nuit. sous un ciel menaçant où grondait par moment la tempête. Soudain, il aperçut une forme blanche, et, transporté de joie à la pensée de retrouver la jeune fille, il éperonna son coursier.
Mais le noble animal se cabra violemment, refusant d’avancer dans la direction où l’engageait son maître, si bien que celui-ci, impatienté, sauta à terre et l’attacha à un arbre. Aussi bien, il lui eût été impossible de traverser à cheval les broussailles enchevêtrées. Les ronces lui déchiraient la figure, le tonnerre grondait de plus en plus fort. Le chevalier jetait des regards inquiets sur le pays étrange qu’il parcourait, tout en se hâtant vers la forme blanche qu’il distinguait de plus en plus nettement, étendue sur le sol. Il arriva tout près d’elle en faisant craquer les branches et résonner ses éperons, il appela : Bertalda ! Bertalda ! » La jeune fille, immobile, ne répondit point. Alors, il se pencha vers elle, cherchant à pénétrer l’obscurité pour reconnaître les traits aimés.
Soudain, un éclair sillonna le ciel, éclairant une hideuse figure grimaçante, et une voix étouffée ricana : — Donne-moi un baiser, mon bel amoureux !
D’un bond, Huldbrand se rejeta en arrière avec un cri d’effroi. Mais la forme blanche se leva et le suivit en murmurant d’un ton menaçant : — Va-t’en, va-t’en chez toi ! Les esprits veillent; si tu vas plus avant, tu seras ma proie !. Et les longs bras blancs se tendaient d’un geste impérieux.
— Ah ! maudit Kühleborn ! c’est donc toi! Je te reconnais ! Tiens ! le voilà ton baiser ! s’écria le sire de Ringstetten en reprenant son sang-froid. Il tira son épée et en porta un coup terrible sur la forme blanche qui disparut en une masse d’eau écumante dont le chevalier se trouva tout inondé.
— Ah ! il veut m’empêcher de rejoindre Bertalda, murmura-t-il, certain maintenant de l’identité de son adversaire. Il s’imagine que la peur me fera reculer en abandonnant cette malheureuse enfant à sa vengeance !
Mais je le vaincrai, cet esprit maudit, il ne sait pas de quoi est capable un homme qui veut une chose de toutes les forces de son cœur !
Huldbrand, plus décidé que jamais, continua sa marche. Cette fois, le succès couronna ses recherches.
A peine arrivé à l’endroit où son cheval était attaché, il entendit un faible sanglot. S’élançant dans la direction d’où venait le bruit, il ne tarda pas à rejoindre Bertalda éperdue qui s’efforçait de gravir la colline pour fuir l’effrayante obscurité de la vallée. La jeune fille avait perdu toute sa fierté et son arrogance. Toute au bonheur de ne plus se sentir seule dans cette nuit terrible, elle n’essaya point d’échapper à celui qui venait la chercher et le suivit sans résistance. Comme elle était épuisée de terreur et de fatigue, le sire de Ringstetten voulut la faire monter sur son cheval, mais l’animal se cabra si furieusement que la jeune fille, tremblante, ne put se tenir en selle.
Huldbrand, tirant son cheval d’une main, soutenant de l’autre Bertalda, tenta de rentrer à pied. Au bout de quelques pas, il y fallut renoncer. La fugitive venait d’éprouver une telle frayeur en apercevant de loin Kühleborn, que ses forces la trahirent. Elle roula sur le sol en murmurant : — Laissez-moi, noble chevalier, je suis punie en cet instant de mes folies, je dois mourir ici.
— Jamais je ne vous abandonnerai, mon amie, s’écria Huldbrand, tout en s’efforçant de maîtriser son cheval qui s’emportait, ruait avec une fureur croissante.
Craignant que l’animal ne blessât Bertalda, il voulut l’éloigner en le tirant par la bride, mais la jeune fille, folle d’angoisse, le rappela d’une voix désespérée en le suppliant de rester auprès d’elle. Le chevalier eût voulu courir auprès de son amie ; mais il n’osait lâcher la bride de son cheval, redoutant de le voir s’élancer sur l’endroit où gisait Bertalda. Dans cet extrême embarras, quelle ne fut pas sa joie d’entendre le bruit d’une voiture qui se dirigeait sur eux. Il la hêla aussitôt, une voix d’homme répondit ; quelques instants plus tard, une grande carriole recouverte d’une toile blanche s’arrêta devant les voyageurs.
Sautant à bas de son siège, le conducteur s’approcha du cheval écumant et dit : — Je sais ce qu’il y a ; la première fois que j’ai traversé cette vallée, pareille chose est arrivé à mes bêtes. C’est un méchant génie, habitant ces contrées, qui s’amuse à l’exciter. Heureusement, je connais le moyen d’apaiser votre cheval, je n’ai qu’à lui glisser un mot à l’oreille. Vous allez voir l’effet.
— C’est bon, c’est bon, dépêchez-vous, ordonna le chevalier.
Le charretier s’approcha de l’oreille de l’animal en furie, lui dit un mot à voix basse, et aussitôt le cheval se calma. Huldbrand ne s’attarda pas à demander des explications, il accepta la proposition du conducteur qui offrait de prendre Bertalda dans sa voiture où on l’étendrait confortablement sur des ballots de coton.
— Montez à côté d’elle, ajouta l’homme, j’aurai bientôt fait de vous ramener à Ringstetten.
Huldbrand attacha sa monture derrière la carriole et prit place à côté de la jeune fille, tandis que le charretier guidait l’attelage. L’orage s’éloignait. Dans le silence d’une nuit apaisée, les deux voyageurs rassurés, causaient avec abandon. Huldbrand reprocha tendrement à Bertalda sa fuite précipitée ; elle, émue, s’excusait humblement et chacune de ses paroles pénétrait au cœur de celui qui l’aimait. Il répondait d’une voix passionnée, lorsque la voix du conducteur résonna dans la nuit : — Holà ! mes chevaux ! levez les pieds ! Encore un effort ! Vous savez ce qui vous reste à faire ! Hardi !
Le sire de Ringstetten, troublé, tressaillit et se penchant vivement hors de la voiture, vit avec terreur que les chevaux s’avançaient péniblement au milieu d’une eau bouillonnante dans laquelle ils semblaient nager ; les roues de la voiture tournaient comme celles d’un moulin ; le charretier s’était installé sur le toit de la carriole.
— Ah ! çà, quel chemin prends-tu ? cria le chevalier. Ne vois-tu donc pas que tu nous conduis au beau milieu de la rivière ?
— Non pas, répondit l’homme en éclatant de rire ; c’est justement le contraire. Voyez vous-même : les eaux marchant sur nous, envahissant tout.
Et, en effet, la vallée tout entière disparaissait sous un flot montant ; les vagues s’agitaient en grondant.
— C’est encore ce misérable Kühleborn qui s’acharne contre nous ; il doit chercher à nous noyer. Mais tu sais probablement une formule contre ses maléfices ?
— Bien sûr que j’en sais une, mais je ne veux pas l’employer avant que vous ne sachiez mon nom.
— Le moment est mal choisi pour nous le faire connaître, ces flots montent sans cesse. Que m’importe ton nom !
— Il t’importe plus que tu ne le crois, chevalier. Je m’appelle Kühleborn.
Comme il achevait ces mots, la voiture soudain disparut, se changeant en un tourbillon d’écume, les chevaux s’évanouirent de même, tandis que le charretier se courbait et se fondait, à son tour, en une vague gigantesque qui s’abattit sur les deux voyageurs. Ceux-ci, d’un effort vigoureux, revinrent à la surface, cherchant à nager, mais de hautes vagues accouraient sur eux. Ils allaient être submergés quand une voix douce domina tout à coup la tempête. A la lueur pâle de la lune, on vit apparaître Ondine sur le faîte de la colline. Elle parlait aux flots déchaînés sur un ton de prière et de menace. Aussitôt, la plus haute des vagues s’enfuit en murmurant ; à sa suite, l’immense nappe d’eau disparut rapidement. Ondine accourut, tendit la main à Huldbrand et à Bertalda et les conduisit dans une prairie où elle leur prodigua les soins les plus tendres. Quand ils eurent repris leurs forces, elle aida la jeune fille à monter sur le cheval et tous trois rentrèrent en silence à Ringstetten.
XIV
LE VOYAGE A VIENNE
Depuis ce jour, la vie s’écoula paisiblement au château. Le chevalier, touché de la générosité de sa femme, lui prodiguait une affection tendre et reconnaissante. Ondine retrouvait le bonheur et la sécurité en retrouvant l’amour et la considération de son époux. Bertalda se montrait humble et douce, presque craintive. Chaque fois que l’on faisait une allusion à l’incident du puits ou de la Vallée noire, elle suppliait qu’on n’en parlât pas devant elle, tant elle rougissait de sa conduite, et tant elle redoutait les terribles souvenirs de sa fuite. Elle ne sut donc jamais rien de précis sur ce qui s’était passé. D’ailleurs, à quoi bon l’en instruire, puisque le bonheur et la paix régnaient pour toujours au château de Ringstetten ?
L’hiver avait passé heureux et tranquille ; le printemps revenait apportant le sourire de son ciel clair et la gaieté de ses feuillages verdissants. Les trois amis admiraient la riante nature, suivaient le vol des cigognes et des hirondelles. Peu à peu, il leur prit fantaisie d’explorer la campagne environnante ; ils organisèrent des excursions. Un jour qu’ils se trouvaient aux sources du Danube, Huldbrand se mit à décrire chaleureusement les beautés du fleuve, de ses fertiles vallées, de Vienne, l’opulente cité traversée par ses flots.
— Comme ce serait amusant d’aller ainsi jusqu’à Vienne, s’écria Bertalda. Puis elle rougit et se tut, honteuse d’être sortie de la réserve qu’elle s’imposait.
Ondine, émue de cette humilité, répondit gentiment : — Mais rien ne nous empêche de faire ce voyage.
Aussitôt, voilà les deux amies bâtissant mille projets, se représentant tous les agréments du voyage, riant, babillant. Huldbrand aquiesça à leur désir, non sans avoir glissé à l’oreille de sa femme : — Et Kühleborn ? Tu sais que par là-bas il retrouve son pouvoir.
— Sois sans crainte, répondit-elle avec un beau sourire confiant ; puisque je suis de la partie, il ne tentera rien contre nous.
On fit joyeusement les préparatifs de l’expédition et, le cœur léger, on se mit en route.
Il ne faut jamais s’étonner que les choses se passent autrement en réalité qu’en imagination. Les puissances ennemies qui nous tendent des pièges endorment nos cœurs par des songes dorés et des illusions merveilleuses. Par contre, notre bon ange nous effraie souvent par des avertissements trop brusques ou trop rudes.
Les premiers jours de navigation furent, pour les trois amis, un enchantement continuel ; tout marchait à souhait. Mais un matin, comme on traversait une belle vallée, de petites taquineries annoncèrent que Kühleborn régnait en maître dans ces parages : les vagues secouaient le navire, le vent contrariait les voiles. Ondine n’avait qu’un mot à dire et tout s’apaisait, mais pour recommencer un peu plus tard. Les esprits commencèrent à s’aigrir, les humeurs à s’altérer. Les bateliers, méfiants et craintifs, causaient à voix basse en regardant d’un air hostile leurs passagers. Les serviteurs, sentant vaguement une influence mystérieuse, murmuraient. Le chevalier méditait parfois avec dépit : Voilà les ennuis que l’on a quand on ne s’unit pas à quelqu’un de sa race. Un homme ne doit pas s’allier à une fille des eaux. Il faut que je supporte sans cesse les caprices de cette extravagante parenté. » Peu à peu, il ne parvint plus à dissimuler son irritation ; il se détournait d’Ondine ou la regardait avec une froideur malveillante dont la pauvre femme ne devinait que trop la raison.
Un soir, fatiguée par la lutte qu’elle avait soutenue tout le jour contre son oncle et par le chagrin que lui causait l’humeur sombre de son époux, elle ferma les yeux et s’endormit. À l’instant même, chacun des passagers et des rameurs aperçut devant lui une monstrueuse tête d’homme qui se dressait, toute droite, à côté du navire, suivant l’embarcation. Tous, en voulant se montrer les uns aux autres cette horrible tête, s’aperçurent que chacun en avait une devant lui, et que le bateau en était environné.
Un cri de terreur s’échappa de leurs poitrines, Ondine se réveilla en sursaut. A peine eut-elle ouvert les yeux, que les apparitions s’évanouirent. Huldbrand, furieux, allait se répandre en imprécations, quand un regard suppliant de sa femme le contint.
— Au nom du ciel, mon doux seigneur, murmura-telle, songe à ta promesse ; ne te mets pas en courroux contre moi quand nous sommes près de l’eau !
Le chevalier se rassit en se mordant les lèvres.
— Ne vaudrait-il pas mieux, mon cher époux, renoncer à ce voyage et rentrer au château où nous étions si heureux?
— Ainsi, je me verrai forcé de m’enfermer chez moi, comme un prisonnier! Et là même, il me faut tenir fermé mon puits pour vivre en paix. Ah ! que ta fatale parenté…
D’un geste caressant, Ondine lui posa la main sur les lèvres. Il se tut, se rappelant ce qu’il avait juré.
Cependant Bertalda s’enfonçait dans une profonde rêverie, tâchant de se remémorer tous les détails de la conversation qu’elle avait eue jadis avec son amie, lorsque celle-ci lui parlait de son origine. Mais certains points restaient inexpliqués. Elle ne connaissait ni le nom, ni le pouvoir de Kühleborn. Tout en réfléchissant, elle avait machinalement détaché de son cou un beau collier d’or dont Huldbrand lui avait fait présent quelques jours auparavant. Elle s’amusait à le baigner dans les flots, admirant le reflet des grains d’or dans l’eau transparente, lorsqu’une main énorme, surgissant du fleuve, s’abattit sur le collier et l’entraîna au fond. Bertalda jeta un grand cri, auquel répondit un ricanement moqueur qui semblait sortir des flots. Plein de colère, le sire de Ringstetten se dressa dans la barque, invectivant les sorciers, esprits et méchants génies qui troublaient ainsi sa tranquillité et celle des siens, et les provoquant à un combat au grand jour. Bertalda pleurait la perte de son joyau et chacune de ses larmes redoublait la fureur du chevalier.
Ondine se mit à supplier son époux : — Mon bien-aimé, ne t’emporte pas contre moi, tant que nous serons sur l’eau. Tu peux injurier mes parents, mais pas moi, oh ! pas moi, par pitié.
Le chevalier se tut, rongeant son frein au souvenir de ce qu’il avait juré à sa femme. Alors Ondine, laissant traîner sa main dans l’eau du fleuve, se mit à murmurer des paroles que personne ne comprit. Au bout de quelques instants, elle retira sa main dans laquelle étincelait un merveilleux collier de corail. Les perles brillaient d’un éclat si vif et si pur que tous les yeux en furent éblouis.
— Tiens, dit-elle en l’offrant à Bertalda d’un geste gracieux, j’ai demandé cette parure pour toi, en échange de celle que tu as perdue. Sèche tes larmes et prends ce collier, mon amie.
A ces mots, le chevalier bondit, et arrachant des mains d’Ondine le merveilleux collier, il le lança dans le fleuve en s’écriant : — Ainsi, tu es toujours en relation avec ces êtres maudits ! Eh bien ! reste donc avec eux, magicienne, sorcière ! Va les rejoindre, eux et leurs présents, et nous autres hommes, laisse-nous en paix !
L’infortunée Ondine jeta sur son bien-aimé un long regard désespéré ; ses yeux s’emplirent de larmes et sa main retomba défaillante. Pendant quelques minutes, elle pleura silencieusement, debout, la tête baissée, comme un petit enfant injustement grondé ; puis, relevant lentement la tête, elle murmura : — Hélas ! mon amour, il faut que je te quitte ! C’en est fait de mon bonheur, mais je t’en conjure, sois fidèle à mon souvenir, afin que je puisse continuer à te protéger.
Hélas ! hélas ! il faut partir, dire un éternel adieu à la vie si belle que j’aimais tant ! Qu’as-tu fait, mon ami ? hélas !
Elle se tenait en parlant sur le bord de la barque et, soudain, on ne la vit plus. Était-elle tombée dans le fleuve ?
Son corps venait-il de se fondre en écume ? On ne le sut point, mais on ne la revit jamais. Pendant quelques instants, de petites vagues battirent les flancs du navire, avec un murmure où l’on croyait distinguer imperceptiblement ces mots plaintifs : « Hélas ! hélas ! sois fidèle ! hélas ! »
Huldbrand, après une terrible crise de désespoir, gisait maintenant évanoui sur le pont du bateau.
XV
CE QU’IL ADVINT AU CHEVALIER HULDBRAND
DOIT-ON se réjouir ou se plaindre de ce que nos douleurs ne soient pas éternelles ? Certes, il existe des êtres dont l’âme reste unie au souvenir de l’être aimé jusqu’au dernier souffle. Et pourtant, ceux-là même ne ressentent pas longtemps le vide absolu des premiers jours. Peu à peu, des pensées étrangères se glissent entre eux et leur chagrin ; l’instabilité de toutes les choses humaines se reconnaît jusque dans la douleur. Il faut donc plutôt déplorer que nos deuils n’aient pas de longue durée.
Il en alla ainsi pour le sire de Ringstetten ; la fin de cette histoire nous dira si ce fut pour son bien. Les premiers temps, il se montra inconsolable, versant des pleurs aussi amers que ceux de la pauvre Ondine quand il lui avait arraché le collier. Il revoyait le geste gracieux et touchant de la jeune femme offrant la parure à son amie ; son seul espoir était de mourir désespéré. Bertalda mêlait ses larmes à celles du chevalier. Longtemps, ils vécurent ainsi tous deux au château, s’entretenant de la douce Ondine, honorant sa mémoire, ayant presque oublié leur ancien amour dont ils ne voulaient plus parler.
Pour consoler le pauvre affligé, la tendre Ondine venait souvent visiter Huldbrand, la nuit, dans ses songes. Elle s’approchait de lui sans bruit, baisant son front en pleurant, puis s’en allait. Le matin, lorsque le chevalier trouvait, au réveil, sa couche humide de larmes, il ne pouvait savoir si c’étaient les siennes ou celles de sa chère femme.
Petit à petit, les visions devinrent plus rares, la douleur du chevalier se fit moins amère. Peut-être n’eût-il jamais désiré autre chose que de conserver pieusement le souvenir d’Ondine si, un beau matin, une visite inattendue du pêcheur n’eût bouleversé son existence. Le vieillard, ayant appris la disparition d’Ondine, se présenta au château pour réclamer Bertalda, jugeant incorrect que la jeune fille demeurât désormais auprès d’un seigneur qui n’était plus marié.
— Je ne m’inquiète plus, dit-il, de savoir si ma fille m’aime ou ne m’aime pas ; maintenant, il s’agit de son honneur, elle va me suivre.
Le chevalier se représenta avec désespoir la vie triste et solitaire qu’il allait mener après le départ de Bertalda ; il sentit combien elle lui manquerait et, soudain, l’ancien amour se réveilla dans son cœur, il demanda au pêcheur de lui accorder sa fille en mariage. Cette proposition déplut au vieillard. Il avait aimé profondément Ondine et se disait que, peut-être, la chère disparue n’était pas morte— ou bien, si vraiment son corps gisait sous les eaux du Danube, Bertalda en était la cause responsable, bien qu’involontaire, et ne devait point usurper la place de la morte.
L’insistance du sire de Ringstetten et les douces prières de la jeune fille eurent enfin raison de sa résistance. Sans témoigner aucune joie de ce mariage, il consentit à rester au château et à assister à la cérémonie.
On envoya aussitôt un messager au Père Heilmann, celui qui autrefois avait béni l’union d’Huldbrand et d’Ondine, pour le prier de venir au château de Ringstetten bénir le second mariage du chevalier. A peine le saint homme eut-il entendu le messager qu’il se mit rapidement en route. Il fit le chemin en moins de temps que le serviteur d’Huldbrand. Lorsque ses membres fatigués faiblissaient ou qu’il sentait la respiration lui manquer, il se répétait : « Courage! Il est peut-être temps encore d’empêcher un grand malheur, ne faiblit pas, corps trop débile ! Alors il repartait, comme poussé par une force mystérieuse, et, marchant sans trêve, il arriva, un soir, dans la cour du château. Les deux fiancés étaient assis l’un près de l’autre, à côté du vieux pêcheur sombre et pensif. Dès qu’ils aperçurent le Père Heilmann, ils se levèrent vivement pour le saluer. Mais, sans s’attarder aux formules de politesse, le Père voulut entraîner Huldbrand dans le château pour lui parler en secret. Le chevalier, surpris, hésitait à le suivre et lui demanda pourquoi il agissait ainsi.
— Après tout, répondit le moine, je puis aussi bien parler devant Bertalda et le pêcheur, car ce que j’ai à vous dire les intéresse autant que vous ; autant savoir tout de suite ce que l’on doit apprendre plus tard. Sachez donc, chevalier Huldbrand, que je dois vous poser une question. Êtes-vous certain de la mort de votre première femme ? Pour moi, cela ne me paraît pas absolument sûr.
Je ne veux pas faire d’allusion à son origine, sur laquelle, d’ailleurs, je ne sais rien de positif. Ce que je sais, par contre, c’est qu’elle fut une femme aimante et fidèle. Or voici ce que je dois vous révéler : depuis quelque temps, elle m’apparaît, chaque nuit ; elle se place devant mon lit et me dit, en se tordant les mains avec désespoir : Empêchez ce mariage, mon père, car je ne suis pas morte. Sauvez son corps et son âme ! Puis elle se retire en pleurant et soupirant. Ces paroles me semblaient vides de sens, je ne les compris qu’en écoutant votre messager.
Je suis accouru, non pour vous unir, mais pour vous séparer. Huldbrand, renonce à cette jeune fille ! Bertalda, renonce au chevalier ! cet homme appartient à une autre femme. Vois, sur son visage, ces plis douloureux : ils te prouvent que son ancien amour n’est pas mort ! Si tu ne renonces pas à lui, sois assurée que jamais il ne te donnera le bonheur.
Tous trois tressaillirent à ces mots, sentant bien que le Père avait raison, mais ils ne voulurent point en convenir. Le vieux pêcheur lui-même s’était si bien fait à l’idée de ce mariage qu’il refusa d’admettre les objections du moine. A la fin, lassé d’entendre réfuter tous ses arguments, le saint homme prit congé de ses trois interlocuteurs. Il ne voulut point accepter les mets qu’on lui présenta, ni l’hospitalité qu’on lui offrait, et partit en hochant douloureusement la tête.
Huldbrand se persuada que le Père Heilmann était devenu visionnaire et, dès le lendemain, fit chercher un autre religieux pour bénir son mariage.
XVI
LE RÊVE DU CHEVALIER
LA nuit touchait à sa fin ; déjà l’aurore blanchissait le sommet des collines. Le chevalier reposait sur sa couche.
Dès qu’il était prêt à s’endormir, une crainte vague le réveillait à demi ; cherchait-il à s’éveiller complètement, il se sentait bercé par un murmure semblable au souffle léger d’un vol de cygne et retombait dans une voluptueuse somnolence. Il dut tout de même finir par s’endormir, car il crut se sentir emporté sur les ailes de deux cygnes qui traversaient de lointaines contrées en faisant entendre un chant triste et suave.

Le chevalier aperçut, tout au fond des eaux, Ondine assise sous les voûtes d’un merveilleux pa lais de cristal
— Le chant du cygne, se disait-il parfois. Le chant du cygne, mais un signe de mort !
Tout à coup, un des cygnes se mit à lui chanter à l’oreille qu’il planait au-dessus de la Méditerranée. Il considéra attentivement les eaux sombres qui, peu à peu, lui semblèrent devenir si transparentes que ses yeux plongeaient jusqu’au fond. Quelle ne fut pas son émotion, lorsqu’il aperçut, tout au fond des flots, Ondine assise sous les voûtes d’un merveilleux palais de cristal ! Le chevalier eut un mouvement de joie bien vite réprimé lorsqu’il vit le visage de la jeune femme inondé de larmes ; son maintien douloureux, un air d’affliction répandu sur toute sa personne faisaient de la douce créature un être si différent de la joyeuse enfant qu’il avait épousée jadis !
Ondine ne paraissait point se douter que son bienaimé fût si près d’elle. Son visage était levé vers Kühleborn qui, debout devant elle, la grondait de sa tristesse.
— Je sais bien, dit-elle d’une voix grave qui impressionna le chevalier, je sais bien que je suis ici prisonnière dans le royaume des eaux ; cela ne m’empêche pas d’avoir une âme. Tu ne peux comprendre la raison de mes pleurs, sache cependant qu’elles me sont douces, comme tout est doux à l’âme fidèle.
— Pourtant, ma jolie nièce, répondit Kühleborn, qui ne semblait nullement convaincu, vous restez soumise aux lois inexorables qui nous régissent ; et vous serez bientôt obligée de trancher vous-même le cours de cette vie précieuse, s’il vous est infidèle par ce nouvel hymen.
— Il n’est pas encore marié, et je sais qu’il m’aime toujours.
— Cela ne l’empêche pas de s’être fiancé, ricana Kühleborn. Dans quelques jours, il sera marié et vous lui donnerez la mort.
— Vous savez bien que non, puisque j’ai fait murer la seule entrée par laquelle nous puissions pénétrer, mes semblables et moi.
— Et s’il quitte, quelque jour, son château ? Ou si, ayant oublié cette vieille histoire du puits, il fait enlever la pierre ?
— C’est précisément pour l’avertir du péril que j’ai attiré son esprit au-dessus de ces flots. En ce moment, il plane au-dessus de nous, il nous entend !
Ondine avait levé la tête avec un sourire angélique, tandis que Kühleborn, poussant un hurlement de rage, s’élança à la surface des flots, rapide comme une flèche.
Aussitôt, les cygnes agitèrent leurs ailes, et, tout en reprenant leur chant harmonieux, s’enfuirent. Il sembla au chevalier qu’il traversait de hautes montagnes, des torrents, et qu’il se retrouvait enfin, épuisé, sur sa couche.
Dès son réveil, son écuyer entra dans sa chambre pour lui annoncer que le Père Heilmann s’était établi dans une cabane qu’il venait de se bâtir à la hâte au milieu de la forêt voisine. Comme on lui demandait la raison de cette installation en cet endroit, il avait répondu : Il y a d’autres bénédictions que les bénédictions nuptiales. Si je ne suis pas ici pour un mariage, c’est sans doute qu’une autre cérémonie se prépare. Il y a moins de distance qu’on ne croit parfois entre une fête nuptiale et des funérailles, entre le bonheur et le deuil. Que ceux qui veulent me comprendre soient avertis ! Le chevalier, rapprochant ces paroles de son rêve, tomba dans une profonde méditation. Mais, tout étant décidé, il ne voulut pas se dédire et les préparatifs du mariage furent exécutés ainsi qu’il l’avait ordonné.
XVII
LES SECONDES NOCES DU CHEVALIER
LA fête donnée en l’honneur des secondes noces du sire de Ringstetten fit éprouver aux invités la même impression qu’ils eussent pu ressentir devant un spectacle brillant vu au travers d’un voile de crêpe. Au lieu de faire éclater la joie et la gaieté, elle faisait songer au néant des choses terrestres.
Les esprits des eaux ne troublèrent personne, puisque l’accès du château leur était depuis longtemps interdit, mais tous les assistants avaient l’impression que la fête était incomplète, qu’il y manquait quelqu’un ; chacun avait l’âme remplie du souvenir de l’aimable Ondine.
Dès qu’une porte s’ouvrait, les invités tressaillaient involontairement, et regardaient, avec une espérance vague et irraisonnée, qui allait entrer. Quand on constatait que ce n’était qu’un échanson ou un serviteur, on ramenait tristement les yeux sur la table chargée de mets autour de laquelle la gaieté se refusait à naître.
Seule, la jeune mariée assistait, insouciante et heureuse, à cet étrange repas de noce, un peu étonnée seulement de se voir au bout de la table, avec une couronne de jasmin et de fleurs d’oranger et des habits magnifiques, tandis que le corps de l’autre épouse gisait glacé sous les eaux du Danube, ou de quelque océan lointain. Parfois, elle songeait, avec un sentiment de terreur, aux paroles de son père sur la mort incertaine d’Ondine, mais elle chassait cette idée importune.
Cependant, la nuit s’avançait, les invités se dispersaient en hâte, heureux de fuir cette morne cérémonie sur laquelle pesait plus lourdement, d’heure en heure, le pressentiment d’un malheur. Bertalda se retira avec ses femmes et le chevalier avec ses serviteurs, pour ôter leurs habits de fête.
Quant à reconduire les jeunes époux à leur appartement, avec les gaietés et plaisanteries d’usage, l’idée n’en vint à personne.
Bertalda, pour se distraire en attendant son époux, fit étaler devant elle les voiles brodés, les vêtements tissés d’or et les bijoux splendides qu’Huldbrand lui avait offerts.
Les suivantes, désireuses de plaire à leur maîtresse, lui prodiguaient les compliments les plus flatteurs sur sa beauté et son teint éblouissant. Bertalda, qui se mirait complaisamment dans une glace, poussa tout à coup un soupir, en disant : — Ne voyez-vous pas, là, sur mon cou, de légères taches de rousseur ?
Comme il était impossible de nier, les suivantes cherchèrent à consoler leur maîtresse en appelant ces taches des grains de beauté, de petites taches qu’on eût dit mises exprès pour faire ressortir la blancheur merveilleuse du teint. Mais la jeune femme gardait une moue dépitée.
— Quand je pense, dit-elle, que je pourrais si facilement m’en débarrasser ! Ah ! si on n’avait pas muré ce puits dont l’eau pure pouvait seule entretenir la fraîcheur de mon teint ! Comme je serais contente d’avoir un peu de cette eau!
— Ne vous faut-il que cela ? dit une jeune suivante en s’élançant dans l’escalier.
— Quelle folie ! dit Bertalda avec un sourire satisfait.
Elle ne songerait pas, j’imagine, à faire enlever la pierre du puits cette nuit même ?
Mais, déjà, on entendait la suivante traverser la cour, puis amener des hommes au bord du puits en leur ordonnant de le desceller.
— Voilà une heureuse idée, fit en riant la jeune mariée, espérons qu’ils vont avoir vite terminé ce travail.
Ravie de voir qu’un seul mot d’elle suffisait main-tenant pour obtenir ce qui lui avait été refusé jadis, malgré ses pleurs, Bertalda, entourée de ses femmes, se mit au balcon pour suivre le travail des hommes. Ceux-ci se hâtaient d’obéir, tout en soupirant à la pensée qu’on détruisait un ouvrage commandé par la douce maîtresse qu’ils regrettaient.
La besogne fut beaucoup moins dure qu’on ne le supposait. C’était comme si une force intérieure aidait à enlever la pierre.
— Ne dirait-on pas, chuchotaient les serviteurs surpris, que cette fontaine est devenue un jet d’eau ?
Enfin, sans que les ouvriers eussent fait d’effort, la pierre se trouva descellée, elle roula sur le sol avec fracas, tandis qu’une colonne d’eau, très blanche, sortait du puits.
On crut d’abord que c’était un jet d’eau, mais bientôt on distingua une jeune femme, pâle comme une morte, couverte de longs voiles blancs, qui pleurait en levant ses bras vers le ciel. Elle se dirigea lentement, comme à regret, vers le château, tandis que les serviteurs, terrifiés, s’enfuyaient dans la nuit.
Immobile et glacée d’horreur, Bertalda n’avait rien perdu de cette scène. Quand la pâle apparition passa sous le balcon, elle leva la tête vers Bertalda, avec un gémissement, et la jeune femme reconnut Ondine. Elle cria qu’on appelât le chevalier, puis se tut, épouvantée par le son de sa propre voix et par la terreur peinte sur le visage de ses femmes.
Le fantôme arriva à la porte du château, monta le grand escalier, traversa les longs couloirs sombres, en pleurant toujours.
Le chevalier, ayant congédié ses serviteurs, se tenait, à demi vêtu, devant une grande glace, en proie à de tristes pensées, lorsqu’il entendit frapper légèrement à sa porte.
— Tiens ! se dit-il, c’est ainsi qu’Ondine frappait jadis à ma porte, quand elle me taquinait si gentiment ! Allons ! Folie que tout cela, il est temps de gagner la chambre nuptiale.
— Oui, murmura du dehors une voix plaintive, mais la tombe sera ta couche nuptiale.
En même temps, Huldbrand put voir, grâce au miroir, la porte s’ouvrir lentement derrière lui. Une forme blanche pénétra dans sa chambre.
— On a rouvert le puits, dit une voix faible, et maintenant, je suis ici pour te donner la mort !
Le chevalier sentit son cœur se glacer, comprenant qu’en effet, rien ne pouvait le sauver. Il se couvrit les yeux de sa main, en disant d’une voix altérée : — Qui que tu sois, spectre, ne remplis pas mon cœur d’épouvante au moment suprême. Si ton voile cache un visage effrayant, donne-moi la mort sans que je te voie.
— Ne veux-tu pas me voir une dernière fois; je suis toujours jeune et belle, comme au temps de nos amours !
— C’est toi? Oh ! si c’est toi, puissé-je mourir de bonheur dans un baiser de toi !
— Tu seras exaucé, mon bien-aimé !
Ondine, soulevant ses voiles, montra au chevalier le visage adoré, resplendissant d’amour et de beauté. Transporté d’amour, Huldbrand s’inclina vers Ondine et lui donna un baiser. La jeune femme le serra passionnément sur son cœur, tandis que deux clairs ruisseaux de larmes jaillissaient de ses yeux, inondant le visage du chevalier, pénétrant par les yeux jusqu’au cœur, bientôt fondu en une divine extase. Peu à peu, le souffle d’Huldbrand se ralentit, ses paupières se fermèrent, il glissa, sans vie, sur le sol, aux pieds d’Ondine.
Alors l’apparition se leva, gagna le couloir et, rencontrant les serviteurs du sire de Ringstetten, dit simplement : — Mes pleurs lui ont donné la mort.
Puis elle traversa lentement la cour et disparut dans le puits.
XVIII
LES FUNÉRAILLES DU CHEVALIER
DÈS que la mort d’Huldbrand fut connue, le Père Heilmann se présenta au château. Il croisa sur le seuil un moine qui s’enfuyait éperdu : c’était celui qui avait béni cette funeste union.
— Les choses sont bien ainsi, dit le saint homme aux habitants du château. C’est maintenant à mon tour de diriger la cérémonie. J’agirai seul.
Il s’efforça d’abord de calmer le désespoir de la jeune épousée si tôt veuve, mais ses paroles n’eurent pas de prise sur cette âme ardente et désespérée. Bertalda ne cessait d’accuser Ondine, la traitant d’odieuse sorcière, de meurtrière, tandis que le vieux pêcheur, résigné, disait simplement :
— La main de Dieu se montre en tous ces événements. Personne n’a pu souffrir davantage de la mort d’Huldbrand que la malheureuse Ondine qui la lui a donnée.
Le moine ordonna les funérailles du chevalier selon les rites habituels. Huldbrand devait être enterré dans un cimetière où se trouvaient les tombes de ses aïeux. Comme il était le dernier de sa race, ses armes étaient posées sur le cercueil pour être descendues dans le sépulcre.
Le cortège se mit en marche sous un ciel pur, au bruit du triste chant des morts. Le Père Heilmann marchait en tête, Bertalda, défaillante, suivait, soutenue par son père.
Au milieu des pleureuses vêtues de noir, une forme blanche s’était glissée ; elle levait les bras au ciel, en poussant de sourds gémissements, au grand effroi des assistants qui s’écartaient d’elle, causant du désordre dans le cortège.
Les écuyers lui adressèrent la parole, cherchèrent à l’éloigner, mais elle glissait entre leurs mains et se retrouvait toujours à la même place. La forme voilée avançait lentement et finit par se trouver immédiatement derrière Bertalda qui ne s’était point encore aperçue de sa présence.
On arriva ainsi au cimetière où le cortège se rangea en cercle autour de la tombe. Alors seulement, la jeune veuve vit l’étrangère. Effrayée, elle ordonna que l’on fît partir cette femme qui n’avait point été conviée aux funérailles, mais la blanche apparition secoua doucement la taille en tendant la main d’un geste humble qui rappela soudain
à Bertalda le geste d’Ondine offrant le collier de corail.
Des larmes emplirent ses yeux, elle se tut ; et, sur un signe du Père Heilmann, tous les gens du cortège tombèrent à genoux.
Lorsqu’ils se relevèrent, l’étrangère avait disparu. A l’endroit où elle s’était agenouillée, un limpide ruisseau d’argent jaillissait de la prairie, se dirigeant vers la tombe du chevalier ; là, il se partagea en deux ruisselets qui entourèrent la dalle funéraire, puis allèrent se perdre dans un petit lac voisin.
Les gens du pays ont cru longtemps que ce petit ruisseau n’était autre que la pauvre Ondine qui entourait tendrement de ses bras son bien-aimé.
Ainsi finit l’histoire d’Ondine et du chevalier Huldbrand
Conte de Friedrich de La Motte-Fouqué (1811), illustré par Arthur Rackham
L’histoire de Pierre Lapin


Il était une fois quatre petits lapins qui s’appelaient Flopsy, Mopsy, Queue-de-coton, et Pierre. Ils vivaient avec leur mère dans un trou creusé dans le sable au pied d’un grand sapin.
– Maintenant que vous avez grandi, leur dit un jour leur vieille mère Mme. Lapin, vous pouvez aller dans les champs ou sur le chemin, mais surtout, n’entrez jamais dans le jardin de Mr. Mac Gregor: Votre malheureux père y a laissé la peau et a fini sa vie dans la casserole de Mme. Mac Gregor. Allez je dois y aller, amusez-vous mais ne faîtes pas de bêtises.
Et la vieille Mme Lapin prit son panier et son parapluie et s’en alla par les bois chez le boulanger. Elle y acheta un gros pain noir complet et cinq petits pains aux groseilles.
Flopsy, Mopsy et Queue-de-coton, qui était de bon petits lapereaux, allèrent le long du chemin ramasser des mûrs.
Mais Pierre, qui était très coquin, alla directement vers le jardin de Mr. Mac Gregor et se glissa sous la porte!
D’abord, il mangea de la laitue et quelques haricots verts, puis il mangea des radis. Et comme il se sentait un peu barbouillé, il alla chercher un peu de persil.
Mais qui rencontra t-il au bout des platebandes de concombres?
Je vous le donne en mille: Mr. Mac Gregor évidemment!
Mr. Mac Gregor était à quatre pattes en train de planter des choux, mais il se releva d’un bon et se mit à courir derrière Pierre, agitant son râteau et criant: « Au voleur! ».
Pierre eut si peur qu’il s’enfuit dans la mauvaise direction, traversant tout le jardin en oubliant par où il était entré. Il perdit une chaussure dans les choux et l’autre au milieu des pommes de terre. Après ça, il courut à quatre pattes encore plus vite. Il était sur le point de s’échapper lorsqu’il percuta le filet protégeant les groseilles à maquereau. Les larges boutons de sa belle veste neuve bleue s’y emmêlèrent, empêchant Pierre Lapin d’avancer.
Il se crut perdu et commença à pleurer à chaudes larmes. Mais ses pleurs furent entendus par de gentils moineaux, qui descendirent et s’approchèrent de lui et le supplièrent de ne pas perdre courage. Mr. Mac Gregor se rapprochait avec son râteau et commencer déjà à vouloir l’assomer.
Mais à ce moment, Pierre se démena si bien qu’il enleva sa veste et reprit sa course vers la cabane à outils. Il aperçut un arrosoir et se jeta dedans. Ceci aurait été une très bonne idée pour se cacher, si l’arrosoir n’avait pas été rempli d’eau.
Mr. Mac Gregor ne voyant plus Pierre Lapin, se mit à remuer tout sans dessus dessous dans la remise à outils.
La poussière remuée fit éternuer Pierre: Atchou! Et Mr. Mac Gregor se précipita vers lui, cherchant à le bloquer en l’écrasant avec sa botte.
Mais Pierre sauta très haut, passa par la fenêtre, renversa trois pots de fleurs et, il fut enfin sauf!
Pendant que Pierre Lapin reprenait son souffle en tremblotant de tous ses membres, Mr. Mac Gregor, pensant qu’il s’était enfui, retourna à ses plates-bandes.
Mais Pierre Lapin était caché et ne savait par où sortir du jardin.
Après avoir attendu un moment, il se faufila en dehors de sa cachette, marchant pas à pas, sur la pointe des pieds, très doucement et regardant attentivement autour de lui.
Il trouva une porte dans un mur; mais elle était fermée et même un petit lapin ne pouvait passer en dessous. Une vieille souris n’arrêtait pas de passer sous la pierre du seuil de la porte, et emportait des pois et des haricots vers la forêt où devait habiter sa famille. Pierre lui demanda le chemin de la porte la plus proche, mais elle avait un pois tellement gros dans la bouche qu’elle ne put répondre. Elle secoua la tête vers lui. Pierre se mit à pleurer.
Reprenant courage, il entreprit de traverser le jardin, ce qu’il n’était pas si facile car il avait la forme d’un labyrinthe. Il arriva à l’étang où Mr. Mac Gregor remplissait ses sauts. Un chat blanc était en train de surveiller les poissons rouges. Il était assis et complètement figé. Seule sa queue remuait de temps à autre et prouvait qu’il était vivant. Pierre se dit qu’il fallait mieux passer son chemin et ne pas lui parler. Il avait entendu dire par son cousin Benjamin lapin que les chats n’étaient pas très fréquentables pour eux.
Il revint alors vers la cabane à outils, mais en chemin il entendit soudain un bruit sous les buissons: scratch, scritch, scratch, scritch… Mais comme il ne voyait rien, il monta sur une brouette posée à côté et regarda autour de lui. La première chose qu’il vit fut Mr. Mac Gregor sarclant les oignons. Il tournait le dos à Pierre, mais derrière lui, il y avait une porte!
Pierre descendit très doucement de la brouette et commença à courir aussi vite qu’il put le long d’une allée droite, caché par une bordure de buissons de cassis.
Mr. Mac Gregor l’aperçut au moment où il s’approchait. Mais Pierre ne perdit pas courage, et plongea sous la porte du jardin. Enfin il était sauf et pu entrer dans la forêt.
Il courut sans se retourner jusqu’à ce qu’il arrive au terrier familial sous le grand sapin.
Il était si fatigué qu’il s’effondra sur le beau sable dou du foyer et s’endormit immédiatement. Sa mère qui était en train de cuisiner, se demanda bien ce qu’il avait fait de ses habits. C’était la deuxième veste et la deuxième paire de chaussures que Pierre perdait.
Pierre lapin se réveilla mais il avait l’air encore tellement piteux que sa mère le mit au lit et lui fit une tisane de camomille: Ce fut son seul dîner ce soir là, alors que sa mère et sa famille se régalèrent avec de bonnes carottes, du pain, du lait et des murs!
Mr. Mac Gregor, quant à lui, pendit la petite veste et les chaussures à un bâton et en fit un épouvantail, pour éloigner les corbeaux.
Traduction Contesdefees.com de The Tale of Peter Rabbit par Beatrix Potter (1920). Illustrations extraites de BNF Gallica / Ville de Paris / Fonds Heure joyeuse
Les sirènes de Taranto

On raconte qu’à l’époque où Taranto était la capitale de l’empire grecque, les sirènes, fascinées par la beauté de la ville, décidèrent de construire leur château féerique dans les eaux qui l’entourent.
Dans cette ville vivait un couple très admiré : la jeune femme était d’une incroyable beauté, et lui était un pêcheur courageux qui passait souvent de longues semaines loin de chez eux.
En raison de ces absences répétées, la jeune femme seule était souvent l’objet de la convoitises des hommes de la ville. Un riche seigneur local n’avait de cesse de lui offrir de nombreux bijoux et cadeaux pour la séduire. Un jour qu’il était revenu de la pêche, elle raconta cela à son mari. Mais celui-ci, malgré l’honnêteté de son épouse, pris de colère et de jalousie, l’emmena au large dans son bateau et la poussa dans l’eau en prétextant que personne ne la séduirait plus.
Les sirènes qui avaient aperçu la scène, la sauvèrent et l’emmenèrent avec elle dans leur château sous-marin. Elles furent tellement fascinées par sa beauté, qu’elles en firent leur reine et lui donnèrent le nom de Skuma (écume).
Quelque temps après, le pêcheur regrettant son geste, retourna avec sa barque à l’endroit où il croyait que sa femme s’était noyée et se mit à pleurer amèrement.
Les sirènes, reconnaissant le mari fautif, l’enlevèrent et le conduisirent devant leur reine, qui bien sûr le reconnut immédiatement. Lui pardonnant son crime de jalousie heureusement raté, elle convainquit les sirènes de le laisser en vie, et de le ramener à terre.
Le pêcheur avait compris l’énorme erreur qu’il avait commise et il décida de reconquérir sa femme. Grâce à l’aide d’une fée, il réussit à l’enlever du château des sirènes et la ramena vers Taranto.
Ici, la légende devient confuse et il existe deux versions différentes de l’histoire. Certains disent que les deux jeunes amants réussirent à retourner jusqu’à la côte et vécurent heureux pour le restant de leurs jours. La fée avait provoqué une violente tempête pour emmener les sirènes de l’autre côté du monde.
Mais d’autres moins optimistes, racontent au contraire qu’une terrible vague emmena le pêcheur avec les sirènes.
Skuma revint saine et sauve, et, dans la douleur, décida de devenir religieuse et s’enferma dans l’une des tours du château aragonais, qui pris le nom de Torre della Monacella en raison de la légende.
Et les sirènes ? On ne sait rien de plus sur elles, mais elles restent les gardiennes immortelles et invisibles du golfe de Taranto.
Traduit et adapté de l’italien par R. Beaussant (cdf) depuis ce site pendant un voyage dans la région de Taranto, la Puglia (les Pouilles) – Illustration de Edmond Dulac pour les contes d’Andersen
Poucette
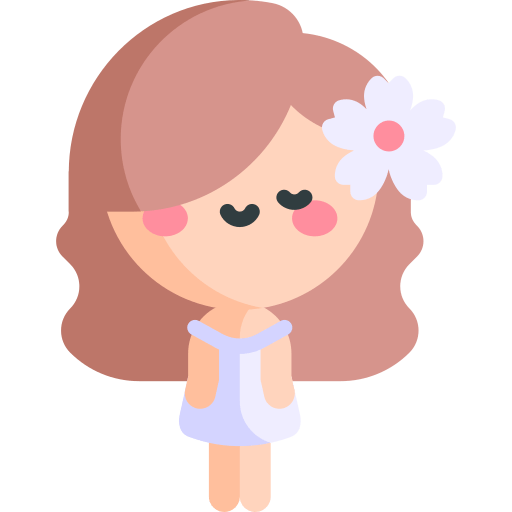
Il était une fois une femme qui désirait plus que tout au monde avoir une petite fille.
Un jour elle rendit visite à une vieille femme qu’on disait très sage, pour obtenir ses conseils.
-Je voudrais tellement avoir une petite fille ! lui dit-elle.
« Rien de plus simple », répondit la vieille femme. Prenez cette graine d’orge et plantez-la dans un pot. Vous verrez bien ce qu’il arrivera.
La femme rentra chez elle et planta la graine. Presque immédiatement, un bourgeon vert apparut et grandit très rapidement jusqu’à devenir une belle plante avec un gros bourgeon. Une très jolie fleur rouge et jaune ressemblant à une tulipe en sortit.
La femme, stupéfaite, toucha les pétales délicats, et à ce moment la fleur s’ouvrit. Au centre se trouvait une toute petite fille, parfaite à tous points de vue. Mais comme elle n’était pas plus grosse que le pouce de la femme, elle l’appela Poucette.
Il n’y eut jamais de fille plus aimée et choyée qu’elle. Son berceau était une jolie coquille de noix peinte; Des pétales de rose servaient de couverture, et son très bel oreiller était fait de fleurs violettes.
Pendant la journée, alors que sa mère travaillait, Poucette jouait sur la table. Elle avait une assiette pleine d’eau, au milieu de laquelle nageait une feuille de lys, et Poucette aimait s’y déplacer, pagayant d’un côté à l’autre de l’assiette sous la lumière du soleil qui la traversait. En même temps, elle chantait d’une voix si douce que les petits oiseaux s’arrêtaient pour l’écouter depuis la fenêtre.
Poucette était heureuse, jusqu’à ce qu’une nuit une mère crapaude saute par la fenêtre et voit la petite fille dans son lit. Elle ferait une belle épouse pour mon fils ! Pensa-t-elle. Et elle prit la petite fille endormie et la porta jusqu’au bord de la rivière.
Pour que Poucette ne s’enfuie pas, la mère crapaude la mis sur une feuille de lis au milieu de la rivière. La petite fille n’avait pas peur, car cela lui rappelait l’époque où elle jouait sur la table. Mais elle voulait tout de même rentrer chez elle et ne voulait pas épouser le fils de la mère crapaude.
Lorsque la mère crapaude s’éloigna pour bâtir une maison pour son fils parmi les roseaux, Poucette resta en sanglotant sur la feuille.
Alors un petit poisson, entendant la petite fille pleurer, sortit la tête en disant: « Tu ne peux pas épouser ce vilain crapaud gâté par sa mère », dit-il, puis il mordit le pétale de la feuille de lis et traîna la petite embarcation dans le sens du courant.
Poucette se sentit plus heureuse en découvrant les beaux paysages du rivage. Un papillon vola vers elle parce qu’il voulait être son ami.
Mais à ce moment là, un gros scarabée noir l’attrapa au vol et l’emporta jusqu’à un arbre. Il la trouvait jolie, mais en la voyant, ses amis se mirent à rire en disant :
– Quelle horreur! Elle n’a que deux pattes !
Le scarabée emmena alors Poucette dans une prairie pleine de fleurs. Il ne supportait pas que ses amis se moquent d’elle. Là, Poucette passa des jours heureux, buvant du nectar de fleurs et jouant avec ses amis papillons.
L’été passait ainsi, mais petit à petit, les jours raccourcissaient. L’hiver approchait et les nuits devenaient plus froides. Poucette savait qu’elle ne pourrait pas survivre à l’hiver si elle n’avait pas de maison. Lorsque les premiers flocons de neige tombèrent, elle s’enveloppa dans une feuille sèche et commença à chercher un abri.
Lorsque la petite fille, grelottante de froid, commençait à perdre tout espoir, elle trouva une petite souris très occupée à installer son nid.
« Tu peux rester avec moi dans ma petite maison, » dit la souris gentiment.
Dans ce foyer confortable, Poucette était heureuse jusqu’à ce que qu’un ami de la souris leur rende visite. C’était une taupe mâle qui vivait sous terre et qui tomba bientôt amoureux de Poucette et voulut l’épouser.
« Tu as beaucoup de chance », dit la petite souris. Cette taupe est riche. Vous ne manquerez jamais de rien.
Un jour, la taupe emmena Poucette voir sa maison souterraine. Alors qu’ils avançaient dans un tunnel sombre, la taupe l’avertit :
-Maintenant, soit prudente. Il y a un animal mort devant.
Poucette se mit à genoux. Elle vit un bel oiseau, dont le petit cœur battait encore faiblement.
Dès lors, Poucette s’occupa de l’oiseau, qui au printemps fut en mesure de prendre son envol pour aller retrouver ses amis. La petite fille le regarda qui commençait à s’éloigner, et voulut s’échapper aussi. Elle savait qu’à son retour, elle devrait épouser la vieille taupe et vivre sous la terre pour le reste de sa vie.
L’été passa. Les feuilles d’automne bruissaient déjà sous ses pieds lorsqu’elle leva les yeux vers le ciel bleu pour la dernière fois. Elle ressentit une immense tristesse.
C’est alors qu’une voix se fit entendre depuis le haut.
-Viens avec moi! Je vais dans un pays plus chaud pour y passer l’hiver. Ce pays t’enchantera.
C’était l’oiseau dont elle avait sauvé la vie il y a presque un an ! Poucette monta sur l’oiseau et ils s’envolèrent tous les deux au-dessus des champs et des villes. Enfin, ils arrivèrent dans un pays ensoleillé, où l’air était empli du parfum de fleurs merveilleuses.
L’hirondelle déposa Poucette sur une feuille au milieu des fleurs. Vous ne pouvez pas imaginer quelle fut sa surprise en apercevant, assis parmi les pétales, un petit homme aussi petit qu’elle.
« Bienvenue dans mon pays », lui dit-il. Je suis le prince du pays des fleurs. Je suis très heureux de te voir. Je t’appellerai Maya.
La jeune fille tomba amoureuse du prince. Ils se marièrent et vécurent heureux.
Si vous tendez l’oreille, vous pourrez peut-être encore l’entendre chanter joyeusement dans l’air parfumé du pays des fleurs.
Le vaillant petit tailleur
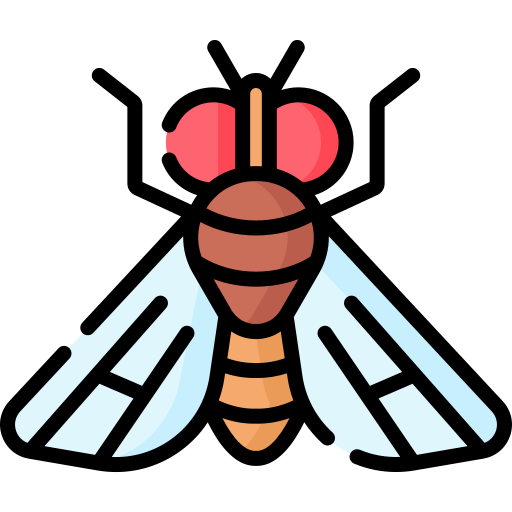
Par une belle matinée d’été, un petit tailleur de Biberich était assis sur son établi devant sa fenêtre. Il était de belle humeur, et, tout en tirant son aiguille, il chantait de toutes ses forces une vieille ballade, où il était question d’un pauvre pâtre qui avait épousé la fille d’un empereur.
Comme il en était au dernier couplet de sa chanson, voici qu’une paysanne vint à passer en criant :
— Bonne marmelade, à vendre ! bonne marmelade !
Cela sonnait bien à l’oreille du petit tailleur. Il ouvrit un carreau, passa sa tête par l’ouverture, et cria à son tour :
— Par ici, bonne femme, par ici ! et l’on vous débarrassera de votre marchandise.
La femme monta les trois étages du tailleur quatre à quatre, croyant qu’en effet elle avait trouvé un débouché pour son commerce. Cette croyance se confirma quand il lui eut fait ouvrir tous ses pots les uns après les autres : marmelade de prunes, marmelade d’abricots, marmelade de pommes, marmelade de poires, etc., etc.
Le petit tailleur, s’arrêtant à la marmelade d’abricots, s’en alla couper une large et longue tranche de pain, et dit à la paysanne :
— Étendez-moi là-dessus une bonne couche de marmelade d’abricots, et, quand il y en aurait une once, bah! la journée a été bonne, cela ne ferait rien.
La bonne femme, qui avait pris au sérieux les paroles du petit tailleur, et qui avait cru être débarrassée de la moitié de sa marchandise au moins, fouilla dans le pot à la marmelade d’abricots avec sa cuiller de bois, et, comme l’avait demandé le petit tailleur, couvrit grassement la tartine d’un bout à l’autre.
— La ! dit-elle, en voilà pour un kreutzer. Le petit tailleur marchanda un instant, mais enfin se décida, et paya son kreutzer. La paysanne s’en alla tout en grommelant, mais le petit tailleur n’y fit pas attention.
— Cela sera un peu agréable à manger, dit-il; mais, avant d’y mordre, il s’agit de finir ma veste.
Et, en vertu de cette bonne résolution, il posa sa tartine près de lui, et continua de coudre; mais, comme la tartine lui tirait l’œil, il fit des points de plus en plus grands. Pendant ce temps, l’odeur de la marmelade se répandit dans la chambre et attira les mouches, qui volaient par centaines ; si bien, qu’au risque de ce qui pouvait leur arriver, les gourmandes s’abattirent en masse sur la tartine.
— Eh bien, qui donc vous a invitées, drôlesses? dit le petit tailleur.
Et il essaya de les chasser d’un revers de main. Mais les mouches, effarouchées un instant, ne quittèrent la tartine que pour revenir plus nombreuses.
Le petit tailleur craignit que, s’il finissait sa veste, si grands qu’il fît les points, et s’il laissait faire les mouches, si peu que chacune mangeât de marmelade, il ne trouverait plus que le pain, lorsque la veste serait finie.
— Attendez, attendez, dit-il en tirant son mouchoir, je vais vous en donner de la marmelade, moi!
Et il frappa sur les pillardes sans miséricorde.
Lorsqu’il eut cessé de frapper, et que toutes les mouches qui avaient survécu à la bataille furent remontées au plafond, il compta les morts : il n’y en avait pas moins de sept étendues sur le flanc, dont trois ou quatre gigotaient encore.
— Décidément, tu es un fier gaillard ! dit le petit tailleur en extase devant sa propre vaillance. Par ma foi ! il faut que toute la ville sache ce que tu viens de faire !
Et aussitôt le petit tailleur se coupa une ceinture à même une pièce de drap noir dont il devait faire habit, veste et culotte au curé, et, sur cette ceinture, il piqua en gros caractères, avec du fil rouge : Sept d’un coup!
La ceinture faite, il la boucla autour de sa taille, et trouva qu’il avait ainsi l’air si vaillant et si tapageur, qu’il s’écria :
— Ce n’est point la ville seule qui doit savoir ce que je suis, c’est le monde tout entier !
Alors, laissant là son habit inachevé et la pièce de drap intacte, sauf la ceinture qu’il lui avait empruntée, il mangea la tartine qui avait été la cause première de toute cette exaltation, et visita la maison pour voir s’il ne pouvait rien emporter. Il ne trouva rien qu’un vieux fromage rond, (deux fois gros comme un œuf; si vieux, qu’il ressemblait à une pierre; il le mit néanmoins dans sa poche.
En sortant de la ville, il aperçut une alouette qui se débattait dans un buisson. Il courut à l’oiseau, s’aperçut qu’il était pris au collet, le dégagea à temps pour lui sauver la vie, et le mit tout vivant dans son autre poche, en la fermant au bouton par dessus lui.
Alors il se lança bravement par le chemin, et, comme il était léger et joyeux, il ne ressentit pas de fatigue.
Son chemin le conduisit au haut d’une montagne, sur le plateau le plus élevé de cette montagne était assis un géant.
Ce géant était si grand, qu’il semblait une statue vivante dont la montagne n’était que le piédestal. Un autre que le vaillant petit tailleur se fût sauvé; lui, au contraire, alla droit au géant.
— Bonjour, camarade ! lui dit-il en se renversant en arrière pour tâcher de voir son visage. Je parie que tu es monté sur cette montagne pour voir le vaste monde. Moi, je suis en route pour le visiter; veux- tu venir avec moi ? Le géant baissa la tête, chercha des yeux le petit tailleur, finit par le trouver, et, le regardant d’un air méprisant :
— Niais ! lui dit-il, moi aller avec un infime de ton espèce !
— Ah ! c’est comme cela ! dit le petit tailleur.
Et, ouvrant son pourpoint, il montra fièrement au colosse sa ceinture, sur laquelle étaient écrits ces mots : Sept d’un coup !
Le géant les lut, crut que c’étaient sept hommes que le petit tailleur avait d’un seul coup mis à mort, et se sentit pour lui une certaine considération. Cependant il voulut le mettre à l’épreuve, et, prenant une pierre dans sa main :
— Tiens,fais cela, dit-il.
Et il l’écrasa de manière que des gouttes d’eau en sortirent.
— Bon! dit le petit tailleur, n’est-ce que cela? Chez nous, cela s’appelle un jeu d’enfant.
Et, tirant de sa poche son fromage, il le serra si bien, que l’eau en sortit entre tous ses doigts.
Le géant, vu la couleur, avait pris le fromage pour une pierre. Il ne savait que dire, n’ayant pas cru qu’un être si chétif fût capable d’une pareille prouesse.
Alors le géant se baissa, ramassa un caillou et le lança à une telle hauteur, que l’œil le perdait presque de vue.
— Allons, petit bout d’homme, dit-il, tâche d’en faire autant.
— Bien lancé ! dit le nain. Mais, si haut qu’ait monté ta pierre, il lui a fallu retomber. Eh bien, regarde cela. Je vais en lancer une, moi, qui ne retombera pas.
Et, faisant semblant de se baisser et de ramasser un caillou à terre, il fouilla dans sa poche, y prit l’alouette, la lança en l’air, et celle-ci, heureuse de se retrouver libre, monta, monta encore, monta toujours, et ne redescendit point.
— Ah ! ah ! lit le tailleur, eh bien, qu’en dis-tu, camarade?
— Bravo ! dit le géant ; mais nous allons voir maintenant si tu es en état de porter un certain poids.
— Mets le monde sur mon épaule, dit le petit tailleur, et je ne le changerai de côté que dans une heure.
Le géant conduisit le petit tailleur auprès d’un énorme chêne déraciné et couché sur le sol.
— Aide-moi à porter cet arbre hors du bois, si tu es de taille, lui dit-il.
— Volontiers, répondit le petit tailleur : mets le tronc sur ton épaule ; moi, je porterai le bout avec toutes les branches. Tu ne nieras pas que ce ne soit le plus lourd, j’espère ?
Le géant ne nia point, mit le tronc sur son épaule, tandis que le petit tailleur s’assit tranquillement sur une branche ; et, comme le géant ne pouvait point se retourner pour regarder derrière lui, il dut porter à lui seul le chêne et le tailleur par-dessus le marché, suant sang et eau, tandis que le tailleur sifflait gaiement : Trois compagnons passaient le Rhin, Gais et portant la tête haute !… absolument comme si porter cet énorme chêne était une bagatelle.
Après avoir cheminé ainsi pendant quelque temps, traînant ce lourd fardeau, le géant, tout essoufflé, s’arrêta.
— Écoute, dit-il, il faut que je laisse tomber l’arbre ; je ne puis aller plus loin.
Le tailleur sauta prestement à terre, prit l’extrémité de la dernière branche entre ses bras, comme s’il l’avait portée toujours et la portait encore , et dit au géant :
— Tu es pourtant un gaillard de solide apparence, et néanmoins tu ne peux porter ta part de cet arbre? Allons, allons, tu n’es pas fort, mon brave homme.
Ils continuèrent leur chemin. Le géant, tout honteux de sa déconvenue, muet et silencieux, tandis que le petit tailleur, alerte et joyeux, allait le nez au vent, tout fier de sa supériorité sur le colosse. Ils passèrent devant un cerisier. Le géant prit l’arbre par la cime, où pendaient les fruits les plus-mûrs, courba cette cime et la mit dans la main du petit tailleur, en lui disant :
— Tiens cette branche et mangeons des cerises.
Mais le petit tailleur était bien trop faible pour tenir l’arbre plié, de sorte que, lorsque la branche, en se redressant, fit ressort, elle enleva le petit tailleur, qui passa par-dessus la cime de l’arbre et alla, par bonheur, retomber de l’autre côté dans des terres labourées, où il ne se fit aucun mal.
— Qu’est-ce à dire? fit le géant. N’as-tu pas la force de retenir ce faible arbuste?
— Bon ! répliqua le petit tailleur, il s’agit bien, quand on a broyé une pierre que l’eau en est sortie, jeté un caillou si haut qu’il n’est point retombé sur la terre, porté un chêne si lourd qu’il a failli t’écraser, il s’agit bien de plier un malheureux cerisier ! Non; j’ai sauté par-dessus, comme tu as pu voir ; tâche d’en faire autant, toi.
Le géant essaya; mais, comme il s’accrocha les pieds dans les branches, il s’en alla tomber lourdement et tout de son long dans le champ où le petit tailleur était retombé sur ses pieds.
— Ah ! pardieu ! dit-il, puisque tu es un si brave compagnon, viens un peu passer la nuit dans notre caverne
— Volontiers, dit le petit tailleur sans hésiter.
Et il suivit le géant.
En entrant dans la caverne, le petit tailleur vit une douzaine de géants qui soupaient. Chacun tenait, par les pattes de derrière, soit un mouton, soit un veau, soit un daim, soit un chevreuil rôti, et y mordait à belles dents. Le petit tailleur regarda autour de lui, et, voyant l’immense caverne, se dit :
— Peste ! voilà quelque chose d’un peu plus vaste que mon atelier.
Puis , prenant un morceau de pain et une tranche de venaison, il soupa à son tour, alla boire à la source, et rentra tranquillement à la caverne, en disant au géant :
— Çà, où coucherai-je? Le géant lui montra un lit qui était grand comme douze ou quinze billards mis à la suite les uns des autres. Le petit tailleur commença par s’y fourrer ; mais, trouvant le lit trop grand pour lui, il descendit de l’autre côté et se couclia dans la ruelle.
Quand vint minuit, le géant qui l’avait introduit parmi ses compagnons se leva sans bruit, et, le croyant plongé dans un profond sommeil, prit une barre de fer, et, d’un seul coup, brisa le lit en deux.
— Bon ! dit-il après cette belle prouesse, je crois bien pour cette fois en avoir fini avec cette sauterelle.
Au point du jour, les géants partirent pour la forêt, et ils avaient déjà complètement oublié le petit tailleur, lorsqu’ils virent celui-ci qui venait à eux joyeux et chantant.
— Sept d’un coup ! dirent-ils en l’apercevant ; nous ne sommes que douze, il n’en aurait pas même pour deux coups !
Et ils s’enfuirent comme s’ils eussent eu le diable lui-même à leurs trousses !
Le vaillant petit tailleur ne s’amusa point à courir après les géants, de la société desquels il ne se souciait pas trop de son côté, et continua seul sa route, marchant tout droit devant lui ; car peu lui importait où il allait.
Après avoir marché depuis le point du jour jusqu’à midi, il arriva dans le jardin d’un beau palais, qui lui parut être celui du roi du pays, et, comme il était fatigué, il s’étendit sur le gazon et s’endormit.
Pendant ce temps, des gens qui passaient l’examinèrent, car ils le reconnaissaient pour étranger, et ils lurent sur sa ceinture : Sept d’un coup.
— Dieu du ciel! se dirent-ils, que vient faire ici, au milieu de la paix, un pareil pourfendeur? Il faut que ce soit quelque héros de haute renommée !
Ils allèrent l’annoncer au roi, lui disant que, si quelque guerre venait à éclater, ce serait là un homme utile et qu’il était, par conséquent, important de ne pas le laisser partir. Ce conseil parut bon au monarque, qui dépêcha vers le dormeur un de ses courtisans, chargé de lui faire ses offres pour entrer à son service.
L’envoyé n’osa point réveiller un homme qui paraissait si terrible, de peur qu’il n’eût le réveil mauvais, et il resta debout devant lui, attendant qu’il voulût bien ouvrir les yeux.
Le tailleur, après avoir fait attendre le messager du roi une bonne heure, commença enfin à se détirer, à se gratter l’oreille et à cligner de l’œil. Le courtisan fit alors sa commission, lui offrant, de la part du roi, toutes sortes d’avantages, s’il consentait à accepter un grade dans l’armée.
— Pardieu ! répondit le petit tailleur, je ne suis venu que pour cela; mais je vous préviens que je n’accepterai point de grade au dessous de celui de général en chef.
— Je crois bien que c’est celui que le roi a l’intention d’offrir à Votre Excellence , répondit le courtisan ; au reste , si vous voulez me suivre au palais, où Sa Majesté vous attend, vous ne tarderez pas à être renseigné là-dessus.
Le petit tailleur, sur cette promesse, suivit le courtisan au palais. Le roi l’attendait ; il le reçut avec les plus grands honneurs, lui donna le titre de général en chef provisoire, lui assigna un traitement de vingt mille florins et le logea dans un de ses châteaux.
Mais tous les autres officiers de la couronne étaient fort indisposés contre lui; ils jalousaient cette fortune rapide, et l’eussent voulu à tous les diables.
— Qu’allons-nous devenir? se disaient-ils entre eux. Si jamais nous avons une querelle avec un pareil gaillard, il est capable, s’il frappe, de tuer à chaque coup sept d’entre-nous ; c’est ce qu’aucun de nous ne peut permettre. Ils résolurent alors de se rendre tous près du roi, et de donner à Sa Majesté une démission collective.
— Nous ne sommes pas faits, lui dirent- ils, pour vivre avec un homme dont la devise est : Sept d’un coup!
Le roi fut fort affligé de voir que, pour un homme de si grande valeur sans doute, mais en somme de si médiocre apparence, il allait perdre ses plus fidèles serviteurs ; il maudit la facilité avec laquelle il s’était engoué du nouveau venu, et avoua tout haut qu’il eût bien voulu en être débarrassé ; mais il n’osa lui donner son congé, car il craignait qu’il ne mît son armée en déroute, n’assommât son peuple et ne lui enlevât son trône.
Après bien des hésitations, il lui vint enfin une idée. Il fit dire au petit tailleur que, puisqu’il était un si grand héros, l’état de paix dans lequel on vivait devait lui être fastidieux, et que, s’il en était, il avait une proposition à lui faire.
— Par ma foi, dit le petit tailleur, je commençais à être las moi-même de ma paresse et honteux de mon oisiveté. Dites au roi que je vais aller, aussitôt mon déjeuner pris, écouter la proposition qu’il a à me faire.
Mais le roi ne se soucia point de se trouver en face d’un homme si terrible. Il lui fit dire de ne point se déranger, et qu’il allait recevoir sa proposition à domicile.
En effet, le même courtisan qui était venu la première fois chercher le petit tailleur, reparut devant lui. Il était chargé de la proposition du roi.
Le roi faisait savoir à son général en chef que, dans une forêt de son royaume dont il lui envoyait le plan, demeuraient deux énormes géants qui ne vivaient que de sang et de rapines, de feu et de sac, et qui causaient enfin les plus grands ravages dans le pays.
Ils étaient si redoutés, que personne n’osait plus traverser cette forêt, ou que, si quelqu’un la traversait par hasard, il regardait sa vie comme en danger pendant tout le temps qu’il n’en était pas sorti.
S’il tuait ces deux géants, il lui donnerait sa fille unique en mariage, et elle lui apporterait en dot la moitié de son royaume. Au reste, le roi offrait au vaillant petit tailleur cent cavaliers pour aide et pour escorte.
— Oh. ! oh ! dit celui à qui l’on faisait cette proposition, voici quelque chose qui me convient à merveille! Je connais les géants, j’ai eu affaire à eux et je m’en soucie comme de cela. Le petit tailleur fit claquer son pouce.
— Et la preuve, continua-t-il, c’est que je n’ai aucun besoin des cent cavaliers que le roi me fait offrir. J’irai trouver les géants seul, je les combattrai seul et les tuerai seul : celui qui en tue sept d’un coup ne s’effraye pas de deux géants.
Le petit tailleur partit donc, et, comme le roi avait insisté sur les cent cavaliers, il laissa ceux-ci à la lisière de la forêt, leur disant :
— Restez ici; je vais expédier les deux drôles, et, quand ce sera fini, je reviendrai vous le dire.
Les cent cavaliers, qui ne demandaient pas mieux que leur général en chef fit la besogne à lui tout seul, restèrent à la lisière de la forêt, tandis que celui-ci s’élançait bravement au plus épais du fourré.
Mais, au fur et à mesure qu’il s’avançait dans la forêt, il ralentit le pas, regardant avec précaution autour de lui; si bien qu’il finit par apercevoir les deux géants, qui étaient couchés endormis sous un arbre et qui ronflaient à qui mieux mieux.
Le petit tailleur, qui n’était point paresseux, ne perdit pas un instant; il bourra ses poches de pierres et grimpa sur l’arbre au pied duquel étaient couchés ses ennemis, arbre qui, par chance, était si branchu, qu’il était presque impossible de l’apercevoir au-milieu du feuillage.
Arrivé à la moitié de la hauteur de l’arbre, le petit tailleur rampa sur une branche et s’arrêta juste au dessus du visage des dormeurs, et, de là, laissa tomber une pierre, puis deux, puis trois sur l’œil de l’un des géants.
Celui-ci, à la première, ne sentit rien ; à la seconde, presque rien ; mais, à la troisième qui était un peu plus grosse, il ouvrit l’œil, et poussa son voisin, en lui disant :
— Pourquoi t’amuses-tu à me chatouiller le nez pendant que je dors ? Cela m’ennuie.
— Tu rêves, lui répondit l’autre. Je dors les poings fermés et ne songe point à te chatouiller.
Et les deux géants se rendormirent.
Alors, le petit tailleur lança sur la poitrine du second géant une pierre, puis deux, puis trois.
—Qu’est-ce à dire, demanda celui-ci, et que me fais-tu à la poitrine ?
— En vérité, répondit l’autre, je ne m’occupe pas plus de toi que du Grand Turc.
Et ils échangèrent encore quelques paroles acerbes; mais, comme ils étaient fatigués tous deux, ils se rendormirent une seconde fois.
Le petit tailleur alors choisit sa plus grosse pierre et la lança de sa plus grande force sur le nez du premier géant.
— Ah ! c’est trop fort ! s’écria celui-ci en sautant sur ses pieds comme un furieux, et, cette fois, tu ne diras point que ce n’est pas toi!
Et il tomba à bras raccourci sur son compagnon, qui, déjà de mauvaise humeur lui-même, lui rendit ses coups sans explication, de sorte qu’à force de se frapper l’un l’autre, ils entrèrent bientôt dans une telle rage, qu’ils arrachèrent les arbres pour s’en faire des massues, et s’assommèrent l’un l’autre jusqu’à ce que tous deux tombassent morts.
Alors le petit tailleur, sautant prestement à bas de son arbre :
— J’ai une fière chance, se dit-il à lui-même, qu’ils n’aient point arraché l’arbre sur lequel j’étais perché. Il m’eût fallu sauter comme un écureuil sur l’arbre voisin; mais bah! je suis si leste !
Il tira son sabre, donna à chacun des deux géants une paire d’énormes estocades dans la poitrine, puis il s’en alla rejoindre son escorte.
— La! dit-il aux cavaliers, voilà qui est fait. J’ai expédié mes deux gredins ; il y faisait chaud ; mais que pouvaient-ils contre un homme comme moi, qui en tue sept d’un coup?
— N’êtes-vous point blessé, général ? demandèrent les cavaliers.
— Bon ! il ne manquerait plus que cela, répondit le vaillant petit tailleur; ils n’ont, Dieu merci, pas touché à un seul de mes cheveux.
Les cavaliers ne pouvaient croire ce qu’ils entendaient; mais, sur les instances du petit tailleur, qui marchait à leur tête, ils entrèrent dans la forêt, où ils trouvèrent les deux géants baignés dans leur sang, et tout autour d’eux les arbres déracinés et la terre toute bouleversée.
Les cavaliers se regardèrent les uns les autres en se disant de l’œil :
— Peste ! il paraît qu’il y faisait chaud. Quel gaillard que notre général en chef!
Le petit tailleur coupa les deux têtes des deux géants, les attacha à l’arçon de sa selle et rentra en triomphe dans la ville, suivi de ses cent cavaliers.
Le roi, apprenant son retour par un messager que le tailleur lui avait envoyé pour le saluer de sa part et lui annoncer la victoire, vint au-devant de lui jusqu’à la lisière de la foret.
Là, le petit tailleur exigea de lui l’accomplissement de sa promesse, c’est-à-dire la main de sa fille et l’abandon de la moitié de son royaume ; mais, comme le roi regrettait d’avoir fait cette promesse :
— Avant de te donner ma fille et la moitié de mon royaume, lui dit-il, il faut que tu accomplisses encore une action d’éclat.
— Laquelle? demanda le petit tailleur.
— Dans une autre de mes forêts, répondit le roi, il y a une licorne qui cause d’énormes ravages ; il faut que tu me l’amènes vivante pour ma ménagerie.
— Je me moque de la licorne, ni plus ni moins que des deux géants ; sept d’un coup! c’est ma devise, dit le petit tailleur.
Il prit deux cordes d’égale longueur et un chariot, attelé de deux bœufs, pour y mettre la licorne quand elle serait prise, et garda ses cent cavaliers, non pas pour l’aider à prendre la licorne, mais pour le guider seulement jusqu’à la forêt où il espérait la rencontrer.
Une fois dans la forêt, il n’eut pas besoin de la chercher longtemps. Celle-ci, en l’apercevant, courut sur lui pour le transpercer.
— Tout doux, tout doux, la belle ! dit le petit tailleur, n’allons pas si vite.
Et il s’arrêta contre un arbre, attendit que la licorne ne fût plus qu’à dix pas de lui et passa prestement de l’autre côté de l’arbre. La licorne, qui venait sur lui pour le percer, enfonça sa corne si profondément dans l’arbre, qu’avant qu’elle eût eu le temps de la retirer, le petit tailleur lui avait lié les quatre jambes avec ses deux cordes.
— Ah! je tiens l’oiseau, dit-il en sortant de derrière son arbre. Et, avec la pointe de son sabre, il dégagea la corne de l’arbre. La licorne, sentant sa corne dégagée, voulut s’enfuir; mais, comme elle avait les quatre pattes solidement liées, elle tomba à terre et ne put se relever. Alors le petit tailleur retourna vers ses cavaliers et leur dit :
— Amenez le chariot, la bête est prise.
Et l’on mit la licorne dans le chariot, et le petit tailleur la ramena au roi. Cependant, celui-ci ne voulut point encore donner au vainqueur le salaire doublement gagné et il y mit une troisième condition.
Avant de célébrer son mariage, le petit tailleur devait se rendre maître d’un énorme sanglier qui ne le cédait en rien à celui de Calydon.
Ce sanglier faisait de grands dégâts dans une troisième forêt appartenant au roi. Le roi fit en hésitant cette proposition au petit tailleur ; car il sentait bien que celui- ci, pour peu qu’il fût de mauvaise volonté, était en droit de la refuser; mais le petit tailleur, toujours vaillant, répondit :
— Volontiers, sire; par ma foi, c’est un jeu d’enfant que de prendre les sangliers.
Le roi lui donna les cent cavaliers ; mais, comme pour la licorne, comme pour les deux géants , le petit tailleur ne permit point qu’ils entrassent dans le bois. Il y pénétra seul, à leur grande satisfaction, car ils connaissaient le sanglier : autrefois ils avaient tenté de le prendre et il les avait reçus de façon à leur ôter l’envie d’y revenir.
Le vaillant petit tailleur, qui pensait que le courage n’exclut aucunement la prudence, commença par prendre connaissance des lieux.
Il se trouva qu’à une centaine de pas de la bauge du sanglier, il y avait une petite chapelle gothique dont les fenêtres étaient si étroites, qu’il fallait être mince et svelte comme il était pour y passer. Une entrée fermée par une bonne porte de chêne se trouvait en face des fenêtres.
— Bon ! dit le petit tailleur, voici une souricière toute trouvée.
Et, du seuil de la chapelle, il se mit à lancer de toutes ses forces des pierres dans le roncier où se tenait le sanglier. Une de ces pierres atteignit le monstre. Il se leva sur ses pattes de derrière, et alors il parut au petit tailleur que son ennemi avait bien quatre pieds de haut. Quant à sa grosseur, elle était en proportion.
Mais rien de tout cela n’effraya le petit tailleur, qui continua d’attaquer l’animal, tout en le provoquant par ses cris.
Le sanglier regarda de tous côtés avec ses petits yeux recouverts de longs poils, mais brillant sous ces longs poils comme des es- carboucîes.
Puis, apercevant le petit tailleur, il fondit sur lui en faisant claquer ses dents.
Mais, au moment où le sanglier entrait par la porte, le petit tailleur sortait par la fenêtre. Le sanglier essaya d’en faire autant, mais la fenêtre était trop étroite.
Tandis qu’il s’obstinait inutilement à passer par l’ouverture, le petit tailleur fit rapidement le tour de la chapelle et revint fermer la porte à double tour, de sorte que le sanglier, comme l’avait dit le petit tailleur, se trouva effectivement pris ainsi que dans une souricière.
Alors, le petit tailleur conduisit ses cent cavaliers à la chapelle, afin qu’ils vissent bien son prisonnier. Puis il se rendit avec eux près du roi en lui disant qu’il n’avait plus à s’inquiéter du sanglier, et que, dans huit jours, le monstre serait mort de faim, à moins qu’il n’aimât mieux aller le fusiller lui-même, pour son plaisir, à travers les fenêtres de la chapelle
Cette fois, il fallut bien que le roi se rendît, et il donna enfin sa fille au vaillant petit tailleur avec la moitié de son royaume. Il va sans dire qu’il ne fit pas la chose sans regret; mais, s’il eût su que, au lieu d’être un grand guerrier, son gendre n’était qu’un pauvre petit tailleur, il en aurait eu un bien autre regret encore !
Le mariage se fit avec une grande magnificence, mais avec peu de joie, de la part de la fiancée et du beau-père du moins; car, pour le peuple, il était fort satisfait de se voir protégé par un si vaillant défenseur.
Quelque temps après, le jeune reine entendit dans la nuit son époux qui rêvait tout haut.
— Garçon, disait-il, achève-moi cette veste et raccommode-moi cette culotte, sinon je te donnerai de mon aune sur les oreilles.
Elle vit par là dans quelle ruelle était né son mari, et, le lendemain, elle alla tout raconter à son père, en le priant de la débarrasser d’un époux si indigne d’elle. Le roi la consola.
— Laisse la porte de ta chambre à coucher ouverte la nuit prochaine, lui dit-il ; mes serviteurs se tiendront dans le corridor, et, lorsque ton mari sera endormi, ils le garrotteront, et nous l’embarquerons sur un navire qui le portera à l’autre bout du monde.
Cette parole rendit la jeune femme fort contente, car elle n’avait épousé le petit tailleur que contrainte et forcée. Mais l’écuyer du roi, qui avait tout entendu et qui avait pris en amitié le petit tailleur, à cause de son courage, raconta à celui-ci tout le complot.
— C’est bien, se contenta de dire le vaillant petit tailleur.
Et, le soir, il se coucha comme d’habitude, à côté de sa femme. Lorsque celle-ci le crut endormi, elle se leva, ouvrit tout doucement la porte et vint se recoucher sans bruit.
Le petit tailleur, qui faisait semblant de dormir, dit alors à haute voix :
— Garçon, achève-moi vite cette culotte, et raccommode-moi ce gilet, sinon je te donne de mon aune sur les oreilles; moi, pendant ce temps, je vais donner une bonne volée à ceux qui viennent pour m’arrêter. Mordieu! j’en ai bien tué sept d’un coup! j’ai bien exterminé deux géants! j’ai bien garrotté la licorne ! j’ai bien pris le sanglier ! et j’aurais peur de ce tas de mirmidons qui est devant ma porte ! Allons, sept d’un-coup, cria-t il, sept d’un coup !
En entendant ces paroles terribles et qui leur promettaient une mort prompte et inévitable, surtout d’après ce qu’ils savaient, ou plutôt ce qu’ils croyaient savoir de la force et du courage du petit tailleur, ceux qui étaient venus pour l’arrêter s’enfuirent en toute hâte et comme s’ils eussent eu une armée à leurs trousses, si bien que, dans l’avenir, personne n’osa plus se frotter au roi Sept-d’un-coup, car c’était ainsi que le peuple l’appelait.
Un an après, le vieux roi mourut, et, au grand contentement du peuple, le roi Sept-d’un-coup hérita de l’autre moitié du royaume.
Je sais où règne cet excellent roi, mes chers enfants ; seulement, je ne veux pas le dire, attendu que l’on vit si heureux sous ses lois, que, si sa résidence était connue, tous les autres peuples déserteraient leur royaume pour aller vivre dans le sien.
Conte allemand du XIV siècle recueilli par les frères Grimm et traduit par Alexandre Dumas. Illustrations du domaine public: Arthur Rackham et autres.
L’homme sans larmes
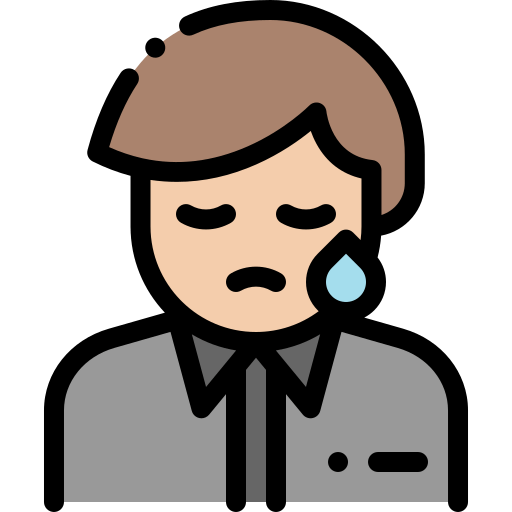
L’HOMME SANS LARMES
Il y avait dans une charmante maison, à quelques lieues de la petite ville de Hombourg, un homme fort riche, qu’on appelait le comte Baldrik.
Il possédait plusieurs maisons à Francfort, des châteaux dans tous les environs, et l’on pouvait, à ce que l’on disait, marcher une journée entière sans mettre le pied hors de ses domaines.
Il avait un grand nombre de domestiques, des équipages de chasse dont il ne se servait jamais, et une table toujours admirablement servie, de laquelle il se levait souvent sans avoir entamé un seul plat.
Sa cave passait pour contenir les meilleurs vins du Rhin, de la France et de la Hongrie ; ces vins, on les lui servait dans des coupes d’argent et de vermeil ; ces coupes, souvent il les portait à ses lèvres, mais presque toujours il les reposait sur la table les ayant à peine effleurées du bout des lèvres.
C’est qu’il lui manquait une chose, à cet homme , pour lequel la fortune semblait avoir épuisé ses trésors.
Il ne pouvait pas pleurer.
Ni joie ni douleur ne pouvait lui faire monter une larme aux yeux.
Il avait perdu son père et n’avait pu pleurer, il avait perdu sa mère et n’avait pu pleurer, il avait perdu deux de ses frères et n’avait pu pleurer.
Enfin, après dix ans de stérilité, sa femme lui avait donné une fille, objet de tous ses désirs, et il n’avait pu pleurer.
Cette fille avait quatorze ans et se nommait Lia.
Un jour, elle entra dans la chambre de son père et le trouva dans le coin le plus sombre de cette chambre, assis et soupirant.
— Qu’as-tu donc, père? demanda l’enfant Il me semble que tu es bien triste.
— Bien triste, en effet, dit le comte ; car je viens de perdre le dernier de mes frères : ton oncle Karl est mort.
Lia aimait fort son oncle Karl, qui, à la Noël, lui envoyait toujours de charmants cadeaux. Aussi, à la nouvelle que lui annonçait son père, les larmes jaillirent-elles de ses yeux.
— Oh ! mon pauvre oncle ! s’écria-t-elle en sanglotant.
— Bienheureuse enfant, qui peux pleurer ! murmura le comte en regardant sa fille d’un œil d’envie
— Mais, puisque tu as tant de chagrin, toi, pourquoi ne pleures-tu pas? demanda- t-elle à son père.
— Hélas ! répondit le père, les larmes sont un don du ciel que le Seigneur m’a refusé ; la miséricorde infinie est avec celui qui pleure, car celui qui peut pleurer pleure sa douleur en même temps que ses larmes, tandis que, moi, il faut que mon cœur se brise.
— Mais pourquoi cela ?
— Parce que Dieu m’a refusé ce qu’il accorde à la dernière des créatures : des larmes.
— Si Dieu te les a refusées, père, Dieu peut te les accorder, et je le prierai tant et si fort, qu’il te les rendra. Mais le comie secoua la tête.
— Mon sort est fixé, dit-il, et je dois mourir faute de pouvoir pleurer. Quand mon cœur sera plein des larmes que mes yeux eussent dû verser, il se brisera, et tout sera dit.
Lia se mit à genoux devant son père, et, lui prenant les deux mains :
— Oh ! non, non, père, dit-elle, tu ne mourras pas ; il doit y avoir un moyen de te rendre les larmes que tu as perdues ; dis- moi ce moyen et le reste me regardera.
Le comte hésita un instant comme si, en effet, il v avait un moyen ; mais sans doute ce moyen présentait de trop grandes difficultés pour un enfant de l’âge de la jeune fille ; car, sans répondre, il se leva et sortit.
Lia ne revit pas son père de la soirée. Le lendemain au déjeuner, elle l’attendit encore inutilement. Il ne descendit pas.
Mais il lui fit dire de monter chez lui quand elle aurait déjeuné elle-même.
Elle se leva aussitôt de table et monta à la chambre de son père.
Il était, comme la veille, moitié assis, moitié couché dans son fauteuil et avait le visage aussi pâle que s’il était déjà mort.
— Cher enfant, lui dit-il, mon cœur est déjà si plein et si lourd, qu’il me semble près d’éclater : je sens les larmes se soulever et gronder en moi comme un torrent près de briser sa digue, et, comme il me semble que je vais mourir, je t’ai appelée pour que tu saches bien que je porte la peine d’un crime qui n’a pas été commis par moi.
— Oh ! parlez, parlez, mon père ! s’écria l’enfant ; peut-être qu’en racontant vos malheurs, les larmes vous viendront.
Le comte secoua la tête comme un homme qui désespère, mais il n’en continua pas moins.
— Je vais donc te raconter, ma chère enfant, dit-il, comment il se fait que Dieu m’ait refusé des larmes. »
Mon grand-père était un homme dur, qui était arrivé à l’âge de cinquante ans sans avoir eu pitié d’un seul malheureux. Il était d’une santé robuste, et fort riche, si bien que, n’ayant jamais connu ni la maladie ni la misère, il disait que la maladie était un effet de l’imagination et la misère le résultat du désordre. Ou, s’il était forcé de reconnaître que la maladie existait réellement, il disait que le malade s’était attiré son mal par sa vie irrégulière ou par un mauvais régime. De sorte que, ni pauvre ni malade, ne trouvant pitié près de lui, n’y trouvaient non plus des secours.
Il y avait plus : l’aspect seul des gens malheureux lui était insupportable , et la vue des larmes lui donnait des fureurs pendant lesquelles, ayant complètement perdu la raison, il était capable de tout.
Un jour, on signala, aux environs du château, un loup qui faisait d’énormes dégâts. Il avait étranglé des moutons et des chevaux, et avait même souvent attaqué des hommes; de sorte que, bien plus encore pour ne plus entendre les plaintes et ne plus voir les larmes des victimes du terrible animal que par un sentiment de philanthropie,mon grand-père résolut de purger la contrée du monstre qui la désolait.
Il partit avec plusieurs chasseurs du voisinage. Dans la nuit, le loup avait été détourné par un très-habile piqueur; de sorte que l’on alla droit à son fort, et que l’animal prit chasse.
Au bout d’une heure d’une course enragée, le loup, pressé par les chiens, au lieu de prendre un grand parti,-comme c’est l’habitude de ces animaux, se réfugia dans la cabane d’un charbonnier.
Par malheur, l’enfant du charbonnier, qui avait trois ou quatre ans, jouait sur la porte. » Le loup, furieux, se jeta sur l’enfant et l’étrangla.
La mère, qui était à l’intérieur de la cabane, vit ce qui se passait; mais, avant qu’elle eût pu porter secours à son enfant, le pauvre petit était déjà mort.
Elle jeta de grands cris. Le père , qui abattait un arbre à vingt pas de là, accourut avec sa hache , et fendit la tête du loup.
Sur ces entrefaites, mon grand-père, monté sur un cheval ruisselant de sueur, aussi échauffé que son cheval, arrivait avec ses rudes allures.
Il vit le loup mort, le paysan sa hache sanglante à la main, et la femme qui sanglotait en tenant son enfant mort entre ses bras.
— Pourquoi pleures-tu, femme, lui cria- t-il, quand le malheur qui t’arrive est de ta faute? Si tu n’avais pas laissé vagabonder ton enfant, le loup ne l’eût point rencontré sur son chemin, et ne l’eût point étranglé.
— Et toi, demanda-t-il à l’homme, comment as-tu eu l’audace de tuer le loup que je chassais ?
— Ah ! seigneur, ayez pitié ! s’écrièrent le charbonnier et sa femme en pleurant tous les deux à chaudes larmes.
— Par les cornes du diable ! en avez- vous bientôt fini avec toutes vos pleurnicheries ? fit mon grand-père.
Et, comme la femme lui montrait, pleurant toujours, le cadavre de son enfant, croyant que cette vue l’attendrirait, exaspéré par cette vue, au contraire, il donna sur la. tête de la pauvre femme un tel coup de manche de son fouet, qu’elle tomba à la renverse, roulant d’un côté, tandis que le cadavre de son enfant roulait de l’autre.
Alors le charbonnier fit un mouvement de menace ; mais, jetant presque aussitôt la hache loin de lui, et levant son bras désarmé sur mon grand-père ;
— Ah ! cœur de marbre! dit-il, tu ne peux pas voir couler les larmes d’une mère et d’un père qui pleurent leur enfant; eh bien, au nom du Seigneur, je te dis : Il viendra pour toi une heure où tu voudras pleurer, où tu ne le pourras pas, où les larmes renfermées en toi te briseront le cœur. Va, et que cette punition de ta dureté pèse sur toi et sur tes enfants, jusqu’à la troisième génération !
Si peu impressionnable qu’il fût, mon grand-père s’épouvanta de cette malédiction, et, tournant le dos à cette cabane maudite , il s’éloigna au grand galop de son cheval.
Il avait quatre fils.
L’aîné fut joueur, dilapida la fortune dont il lui avait rendu compte, s’embarqua pour l’Amérique, et fut noyé dans un naufrage.
En apprenant cette nouvelle, mon grand- père eut bien envie de pleurer, mais il ne put pas.
Son second fils entra dans une conspiration politique; la conspiration échoua, et il eut la tête tranchée comme traître.
En le voyant marcher à l’échafaud, la tête haute, mais déjà pâle de sa mort prochaine , mon grand-père eût bien voulu pleurer, mais il ne put pas.
Son troisième fils , qui était son fils bien-aimé, était grand chasseur comme lui. Un jour, comme tous deux couraient le sanglier, le cheval du jeune homme fit un écart, et lança son cavalier contre un arbre où il se brisa la tête.
Mon grand-père avait vu l’accident ; il sauta à bas de son cheval, mais n’arriva que pour recevoir le dernier soupir de son fils ; mon grand-père leva les deux mains au ciel ; et, avec un effroyable accent de désespoir :
— O mon Dieu ! s’écria-t-il, une larme, une larme !
Mais la malédiction était là, et, comme il ne pouvait pleurer, son cœur se brisa et il mourut.
Restait le plus jeune de ses fils, qui fut mon père.
Celui-là était un jeune homme doux et bon; mais il n’en fut pas moins frappé par le sort, et, comme, malgré sa bonté, il ne trouva point de larmes à chaque malheur qui lui arriva il mourut jeune et quelque temps seulement après que ma mère m’eût mis au monde.
Maintenant, le châtiment pèse sur moi ; car, dans sa malédiction, le charbonnier, d’accord avec les paroles de l’Ecriture, a dit :
— Je te maudis, toi et tes enfants, jusqu’à la troisième et la quatrième génération !
Donc, je vais mourir bientôt, puisque je ne puis pas pleurer.
— Mais, mon père, demanda Lia, ne savez-vous donc pas un moyen d’être relevé de cette terrible malédiction?
— Oui, répondit le comte, il y en a un, mais si difficile, qu’il ne me laisse aucun espoir.
— N’importe, mon père, s’écria Lia, dites, quel est il?
— Le charbonnier qui a prononcé la malédiction vit encore; c’est aujourd’hui un vieillard de quatre-vingts ans. Après la mort de sa femme et de son enfant, il s’est retiré bien avant dans la montagne du côté de Falkenstein. Cet homme, qui a fait le mal, sait seul le secret qui le peut guérir , depuis longtemps, lui-même, en voyant les résultats produits par elle, a regretté la malédiction qu’il avait prononcée, et il l’eût retirée si cela lui eût été possible ; mais la chose lui est interdite. Je l’ai cherché; et, à genoux devant lui, je l’ai supplié de m’indiquer un moyen de retrouver mes larmes. Mais lui, secouant la tête : « Le moyen, dit- il, oui, je le connais; mais il m’est défendu de te l’indiquer, et il n’y a qu’un cœur d’enfant innocent et pur qui puisse trouver la perle qui a le don précieux de rendre les larmes à ceux qui les ont perdues.
— Eh ! n’as-tu donc pas, dit Lia en regardant son père avec amour, n’as-tu donc pas près de toi ce cœur innocent et pur ?
— Oui, sans doute, je l’ai, dit-il; mais, pour moi, Dieu fera-t-il un miracle ?
— Pourquoi douter? dit l’enfant; Dieu ne peut-il donc pas tout ce qu’il veut? Père, indique-moi le chemin qui conduit à la cabane du vieillard, et je me charge de te rapporter la perle qui fait pleurer. Le comte regarda Lia, et, après un moment de réflexion :
— Eh bien, va donc, lui dit-il, pauvre enfant, pèlerine du bon Dieu; le Seigneur t’a choisie pour m’apporter aide et consolation, et, pour la première fois, j’ai confiance et j’espère.
Puis il la bénit, et la jeune fille partit pour son aventureux voyage.
On lui avait fait faire un petit costume de paysanne pour qu’on ne s’étonnât point de la voir aller à pied.
Au bout de quatre jours de marche, où la pauvre petite fit de cinq à six lieues par jour, elle arriva à la cabane du charbonnier.
Elle frappa, car la nuit était arrivée. Le charbonnier vint ouvrir.
Comme le lui avait dit son père, c’était un beau vieillard de quatre-vingts ans, à la barbe et aux cheveux blancs; la solitude et la tristesse avaient donné à son visage une sorte de majesté.
Le vieillard la regarda longtemps avant de lui adresser la parole ; car il voyait bien que ses traits fins et délicats, son teint blanc, ses petites mains fines aux ongles roses, n’étaient point en harmonie avec son costume de paysanne. Enfin, il lui demanda qui elle était et ce qu’elle voulait.
Alors Lia lui raconta tout : comment elle avait promis à son père de venir demander au vieillard la perle qui fait pleurer, et comment, son père ayant eu confiance en elle, elle était venue.
— Ah ! dit le vieillard, ce n’est point une petite affaire que vous avez entreprise là, ma pauvre enfant, et qui, par malheur, ne dépend pas de moi seul ; mais, enfin, je ferai du moins tout ce que je pourrai.
Il ouvrit alors une armoire pratiquée dans la muraille et qui était toute remplie de flacons de différentes grandeurs ; car le vieillard faisait des élixirs tirés de plantes salutaires, qu’il donnait gratuitement aux malades qui, abandonnés des médecins, s’adressaient à lui.
Parmi tous ces flacons, il en choisit un si petit, qu’il contenait à peine un verre à liqueur. Il renfermait un breuvage couleur de pourpre , que le vieillard donna à la jeune fille.
— Prends ce flacon, mon enfant, lui dit-il, et bois-en le contenu au moment de t’endormir ; et ce que tu verras en rêve, c’est ce qu’il te faudra faire pour venir en aide à ton père. Lia remercia le vieillard de tout son cœur.
— Mais, lui demanda-t-elle avec inquiétude, où passerai-je la nuit? Je ne puis me remettre en marche dans les ténèbres : je me perdrais ; d’ailleurs, il fait froid dehors, et je pourrais rencontrer sur mon chemin des bêtes féroces, ou des hommes méchants
— Tu coucheras ici, mon enfant, lui dit le vieillard. Je donne souvent dans ma pauvre cabane l’hospitalité à des voyageurs égarés. Moi, je dors d’habitude dans un hamac; toi, tu dormiras dans ma chambre, sur un lit frais de fougère et de mousse.
Et, en effet, il prépara dans un coin de la chambre le lit de l’enfant; après quoi, il lui servit, pour son souper, du pain, du lait et d’excellentes fraises.
Lia fit un des meilleurs repas qu’elle eût jamais faits de sa vie; puis, se retirant dans sa chambre, elle vida son flacon, et tout aussitôt tomba sur son lit de mousse et de fougère, accablée de sommeil.
Alors commença pour elle, et dès qu’elle eut les yeux fermés, un spectacle merveilleux.
Elle se trouvait dans un immense jardin émaillé de fleurs si splendides, que, n’en ayant jamais vu de pareilles, elle comprit qu’elle n’était pas sur la terre, et que, si elle n’était pas encore au ciel, elle était du moins dans quelque planète intermédiaire. De grands et magnifiques papillons aux ailes d’or et d’azur voltigeaient de fleur en fleur; du calice des roses et des lis s’élançaient des jets d’eau qui avaient la couleur et le parfum des fleurs d’où ils sortaient ; chacun de ces jets d’eau formait un arc-en-ciel’ aux vives nuances, et reflétait un soleil, et les yeux de Lia pouvaient se fixer sur tous ces soleils, sans être éblouis.
Mais ce qu’elle vit de plus beau et de plus extraordinaire, ce fut une troupe d’anges avec des robes d’azur et des ailes d’argent : les uns avaient des couronnes de fleurs, les autres des couronnes d’étoiles, et quelques-uns une seule flamme au-dessus du front : c’étaient ceux-là qui, moins nombreux, semblaient commander aux autres.
Tous ces anges étaient beaux à ravir, et l’expression particulière de leur physionomie était une ineffable douceur.
Chacun d’eux était chargé d’une besogne qui lui était propre.
L’un remuait la terre du bout de son aile d’argent, et là où la terre était remuée, poussaient des plantes et des fleurs. C’était l’ange du printemps.
L’autre passait dans le ciel, traînant après lui un long crêpe tout constellé d’étoiles. C’était l’ange de la nuit.
Celui-ci montait comme une alouette au plus haut des airs, touchant l’orient du bout de soir doigt, et l’orient s’enflammait de teintes roses. C’était l’ange de l’aurore.
Celui-là, avec un sourire triste, mais d’une admirable sérénité, se précipitait dans le vide comme dans un abîme, tenant une croix à la main. C’était l’ange de la mort.
Un ange couronné de fleurs expliquait tout cela à Lia.
— Oh ! que tout cela est beau, grand, magnifique ! s’écriait-elle. Mais dites-moi, mon bon ange, je vois là-bas un de vos frères qui tient à la main une balance d’or remplie de perles; qu’a-t-il à faire celui-là ? Il a l’air bien sérieux; mais, en même temps, cependant, il paraît bien bon?
— C’est l’ange des larmes, répondit celui qu’on interrogeait.
— L’ange des larmes ! s’écria Lia ; oh ! C’est celui-là que je cherchais !
Et elle s’avança vers le bel ange, les mains jointes, dans l’attitude de la prière et en lui souriant avec affabilité.
— Je sais ce que tu veux, lui dit l’ange ; mais crois-tu fermement que je puisse t’aider? En un mot, as-tu la foi?
— Je crois que tu peux m’aider, si toutefois Dieu te le permet.
— C’est la vraie foi qui remonte au Seigneur, dit l’ange. Vois ces perles qui sont pures et transparentes comme le cristal : ce sont les larmes d’amour que les hommes répandent sur une bien-aimée perdue ; vois ces perles sombres : ce sont les larmes que versent les victimes de l’injustice et de la persécution ; vois ces perles roses : ce sont les larmes de la pitié que versent les hommes bons sur les souffrances des autres hommes ; vois enfin ces perles dorées : ce sont les larmes du repentir, les plus précieuses de toutes aux yeux Seigneur. C’est par l’ordre de Dieu que je rassemble toutes ces larmes, qui, un jour, lorsque viendra le moment de la récompense, seront posées dans la balance éternelle, dont l’un des plateaux s’appelle justice et l’autre miséricorde.
— O bel et bon ange, toi qui sais tout, tu sais pourquoi je viens ; toi qui es l’ange des larmes, tu dois être le meilleur des anges : fais donc, je t’en prie, que mon père qui n’est point coupable des fautes de son aïeul, puisse pleurer pour que son cœur ne se brise point.
— Ce sera difficile, dit l’ange ; mais Dieu nous aidera.
— Et en quoi Dieu peut-il nous aider? demanda l’enfant.
— En te faisant trouver une larme, réunion de deux larmes : l’une de repentir, l’autre d’amour, et versées par deux personnes différentes; ces deux larmes réunies forment la plus précieuse de toutes les perles, et cette perle est la seule qui puisse sauver ton père.
— Oh ! indique-moi donc alors où je puis la trouver ! s’écria Lia.
— Prie Dieu, et il te conduira, dit l’ange.
Lia, dans son rêve, se mit à genoux et pria.
Mais elle se réveilla en terminant sa prière ; la vision était évanouie.
Le jour venu, elle raconta au charbonnier ce qu’elle avait vu en songe, et lui demanda ce qu’elle devait faire.
— Reprends la route de chez toi, mon enfant, répondit le vieillard. L’ange t’a promis que Dieu te viendrait en aide, attends avec confiance; les anges ne mentent pas.
Lia remercia le vieillard, déjeuna et se remit en chemin.
Mais, vers la moitié du second jour, survint un épais brouillard, qui non seulement fit que peu à peu Lia cessa de voir les montagnes au milieu desquelles elle voyageait, dont la double cime lui servait en quelque sorte de direction, mais qui bientôt couvrit jusqu’au chemin.
Tout à coup, le chemin se trouva coupé par un précipice.
Au fond du précipice, on entendait gronder un torrent.
Lia s’arrêta; il était évident qu’elle s’était trompée de route, puisque, en venant, elle n’avait pas vu ce précipice.
Elle regarda de tout côté ; impossible de rien voir.
Elle appela : une voix lui répondit.
Elle marcha alors dans la direction de la voix.
Bientôt elle aperçut une vieille femme qui était venue pour ramasser du bois mort dans la foret. Le brouillard l’avait interrompue dans sa besogne ; mais, comme sa charge était à peu près complète, elle s’apprêtait à regagner la maison au moment où elle avait entendu la voix de Lia et où elle avait répondu, comprenant que c’était l’appel d’une personne en détresse.
Lia, qui était pressée de continuer son chemin, lui demanda s’il y avait moyen de descendre dans le précipice et de le traverser.
— Oh ! pour l’amour de Dieu, mon enfant, s’écria la vieille, ne faites pas cela ! c’est un abîme à pic et qui se creuse de plus en plus. Il faudrait, pour sauter par-dessus, avoir les ailes d’un oiseau, ou, pour le traverser, les pieds d’un chamois.
— Alors, bonne femme, dit Lia, indiquez- moi un autre chemin qui me ramène chez mon père.
Et elle lui nomma Hombourg, disant que c’était là qu’ elle désirait revenir.
— Oh! que vous êtes loin de votre route, ma pauvre enfant ! répondit la bonne femme.
— N’importe , répondit l’enfant , j’ai du courage,
— dites toujours.
— Par cet affreux brouillard, vous ne vous retrouverez jamais,chère petite ; mieux vaut attendre que ce brouillard soit dissipé, il ne dure jamais plus de vingt-quatre heures.
— Mais, en attendant que ce brouillard soit dissipé, où irai-je? Y a-t-il au moins une auberge dans les environs ?
— Il n’y en a pas à quatre lieues à la ronde, répondit la femme ; mais je vous donnerai volontiers l’hospitalité chez moi, si vous agréez ma pauvre cabane.
Lia accepta avec reconnaissance, et suivit la vieille, qui, malgré l’épaisseur du brouillard, la conduisit tout droit chez elle.
Elle habitait une petite hutte au pied de la montagne.
La hutte n’avait qu’une chambre unique et de l’aspect le plus misérable.
Lia cherchait où se reposer.
— Asseyez-vous sur cette nalte, lui dit la vieille en lui présentant une tasse de lait et un morceau de pain noir.
Puis, avec un soupir :
— Voilà tout ce que je puis vous offrir, dit-elle, et cependant je ne fus pas toujours si pauvre. Dans le village, de l’autre côté de la montagne, je possédais maisons, jardins, champs et prairies, des brebis, des vaches ; en un mot, on me disait riche. J’avais un fils unique qui m’a dissipé toute cette fortune. Mais, continua-t-elle, Dieu m’est témoin que ce n’est pas mon bien que je regrette, et que les larmes que je verse sont des larmes d’amour.
— C’était un méchant homme alors, que votre fils? demanda Lia.
— Oh ! non, non, s’écria la pauvre mère. On ne me fera jamais élever la voix contre mon enfant; non, c’était un bon cœur, au contraire; seulement, il était léger, et c’est plutôt ma faute que la sienne, s’il n’a pas réussi. Enfant, je négligeais de le punir quand il avait commis quelque faute. Dieu m’avait donné un bon terrain ; c’est ma trop grande faiblesse qui y a semé l’ivraie.
Et elle éclata en sanglots.
Lia en eut grande pitié et chercha à la consoler, tout en mangeant son pain et son lait.
Mais, essuyant ses yeux, la femme commença de lui préparer un lit de feuilles sèches, tout en murmurant :
— Dieu l’a voulu ainsi; ce que Dieu fait est bien fait. Lia était déjà couchée sur son lit et sur le point de s’endormir, quand, tout à coup, on frappa à la porte.
— Qui êtes-vous? interrogea la vieille.
— Un voyageur qui demande l’hospitalité, interrompit une voix d’homme venant du dehors. — Oh ! ma chère femme, pour l’amour de Dieu, dit Lia, n’ouvrez point; cet homme est peut-être un voleur qui vient nous assassiner.
— Soyez tranquille, ma pauvre enfant, répondit la bonne femme ; que viendrait chercher un voleur dans cette pauvre hutte? Et, quant à nous assassiner, qui est-ce qui voudrait commettre un crime si inutile que de tuer un enfant et une vieille femme? C’est quelque pauvre voyageur égaré dans le bois, qui risque de tomber dans le précipice si je ne le reçois pas; ne pas le recevoir serait donc agir peu chrétiennement.
Et la bonne femme ouvrit la porte.
L’étranger entra; il était enveloppé d’un grand manteau qui cachait presque entièrement son visage : la vieille raviva le feu dans la cheminée, lui présenta du lait et du pain, comme elle avait fait à l’enfant, et l’invita à manger.
Mais lui secoua la tête en signe de refus, tout en regardant la vieille à la lueur du foyer qui lui éclairait le visage.
— Pourquoi donc ne mangez-vous point? demanda la bonne femme. Vous devez avoir faim, et ce que je vous offre je vous l’offre de bon cœur. Mangez donc.
— Pas avant que vous m’ayez pardonné, dit l’étranger en rejetant son manteau, en ouvrant ses bras et en montrant son visage baigné de larmes.
— Mon fils ! s’écria la bonne femme.
— Ma mère ! ma mère ! fit le voyageur.
Et tous deux se jetèrent dans les bras l’un de l’autre.
C’était, en effet, le fils perdu, l’enfant prodigue qui revenait près de sa mère.
Le premier moment fut tout entier à la joie, à l’émotion et aux larmes.
Puis le fils raconta à sa mère ce qui lui était arrivé.
Nous dirons son histoire en deux mots.
Tant qu’il lui était resté quelque chose de l’argent emporté à sa mère, le jeune homme avait mené une vie légère et dissipée; puis, après la dissipation était venue la misère, et, enfin, une maladie qui l’avait conduit aux portes du tombeau.
Là, il avait trouvé le repentir ; là, il avait compris combien il avait péché contre Dieu et sa mère. Il pria Dieu de lui pardonner et jura de revenir près de sa mère s’il guérissait.
Dieu entendit sa prière et lui rendit la santé.
Alors il songea à accomplir son vœu et à revenir près de sa mère; mais il avait tout dissipé et avait bonté de revenir pauvre et dénué de tout, comme un mendiant.
Or, un jour, il était près du Danube, rêvant au moyen de gagner quelque argent pour retourner près de sa mère, et suivant machinalement des yeux un jeune homme qui s’amusait à nager.
Le père, lui aussi, était sur le bord et admirait la force et l’adresse de son fils.
Tout à coup, le nageur se mit à crier au secours; il venait d’être pris d’une crampe et se noyait. Le père se jeta à l’eau; mais, au lieu de sauver son fils, il l’entraînait au fond, ne sachant pas nager lui-meme.
Frantz, au contraire, — c’était le nom du fils de la bonne femme, — était un excellent nageur, s’étant dès son enfance exercé dans le Rhin.
Un instant après, le père et le fils étaient sauvés.
Le lendemain, Frantz reçut douze mille francs d’une main inconnue.
Son premier mouvement fut de les rendre, ne trouvant pas qu’il dût permettre qu’on lui payât une bonne action.
Mais le père et le fils avaient quitté le pays; c’étaient deux voyageurs qui passaient, et nul ne savait d’où ils venaient ni où ils étaient allés.
Alors Frantz ne s’était plus fait scrupule, et, riche de ses douze mille francs, plus riche encore de son repentir, il était revenu chez sa mère.
La mère et le fils causèrent encore longtemps près du feu; car ils avaient tant de choses à se dire, qu’ils ne songeaient point au sommeil.
Il n’en était pas ainsi de Lia. A peine le jeune homme avait-il achevé son récit, qu’elle s’endormit.
Alors elle fit le même rêve qu’elle avait déjà fait ; elle vit le même jardin, les mêmes fleurs , les mêmes papillons , les mêmes anges.
Seulement, cette fois, l’ange des larmes lui fit signe de venir à lui.
Elle y alla. Il lui tendit alors une perle.
— Tiens, lui dit-il, voici la perle précieuse dont je t’avais parlé ; elle est composée de deux larmes : larme d’amour maternel, larme de repentir filial. Mets cette perle sur le cœur de ton père, et ton père pourra pleurer, et ton père sera guéri.
L’enfant éprouva une telle joie, qu’elle se réveilla.
Le rêve disparut.
Lia crut que c’était un rêve vain comme tous les rêves, et elle attendit tristement le jour.
Le jour vint ; le soleil, en se levant, avait dissipé le brouillard.
Lia voulut quitter la cabane à l’instant même.
— Non, dit la bonne femme ; il faut, mon enfant, que vous acceptiez à déjeuner ; nous pouvons vous le donner maintenant, et nous vous le donnons volontiers, car nous ne sommes plus si pauvres à présent. Le déjeuner fini, Frantz vous remettra sur votre chemin.
Pendant que Lia déjeunait, la vieille arrangea pour son fils, qui n’avait point dormi, le lit que Lia avait occupé.
En l’arrangeant, elle trouva une perle.
— Tenez, mon enfant, dit-elle, voilà ce que vous avez perdu ; c’est bien heureux que j’aie trouvé cette perle, qui me paraît être d’un grand prix.
— Ah ! s’écria Lia, c’est la perle de l’ange.
Et, tombant à genoux, elle remercia Dieu.
Sa prière faite, elle insista pour partir à l’instant même. Frantz la remit dans son chemin, comme la vieille le lui avait promis, et, le lendemain, elle arriva à la maison paternelle.
La vieille femme de charge, qui avait été la nourrice de son père, vint à sa rencontre tout en larmes.
— Oh ! mon Dieu, s’écria Lia, mon père serait-il mort ?
— Non ; mais il touche au tombeau. Il vous attendait hier; il a cru, ou que vous aviez été dévorée par quelque bête féroce, ou que vous étiez tombée dans un précipice. Sa douleur a été immense, et, comme il ne peut pleurer, il a failli mourir étouffé par ses larmes.
— Où est-il? demanda Lia.
— Dans sa chambre, répondit la vieille femme de charge. Dieu veuille que vous arriviez à temps pour recevoir sa suprême bénédiction et son dernier baiser !
Lia était déjà dans les escaliers.
Elle ouvrit la chambre de son père en criant :
— Mon père, me voilà !
Le mourant fit un effort, et tendit les bras à son enfant, en balbutiant :
— Pardonnez-moi, mon Dieu, je meurs !
Mais, en même temps qu’il prononçait ces paroles, Lia posait la perle sur le cœur de son père.
Il jeta un grand cri, et un double torrent de pleurs s’élança de ses yeux.
Puis, avec un accent d’ineffable joie :
— Quel bienfait que les larmes ! s’écria- t-il. Dieu en soit remercié, et toi aussi, mon enfant !
Et il vécut encore de longues années, versant désormais des larmes dans la peine comme dans la joie.
Conte d’Alexandre Dumas, Contes pour les grands et les petits enfants
Voir aussi du même ouvrage:
L’oiseau bleu

Il était, une fois, un pauvre homme, mais pauvre comme Job. Il avait, pour femme, une vraie mégère, grincheuse et maugréante, toute fripée de cœur et de corps, qui s’appelait «Ntsheko», ce qui veut dire sourire.
Heureusement, le pauvre, que la pêche l’entraînait souvent dehors, sinon il eût été le plus malheureux des hommes. On l’appelait communément « Mwan’ a Bahari ou Bahari tout court, qui veut dire Fils de l’Eau ».
Or, un matin, qu’il était parti, chargé de ses filets, au bord du lac, il entendit dans les roseaux un oiseau chanter d’étrange sorte.
Cet oiseau disait: Bahari, si tu devenais riche, perdrais-tu la tête littéralement serais-tu pas ivre ?
Rentré à la maison, Bahari dit à sa femme: J’ai vu, au bord de l’eau, un oiseau bleu, tout bleuet qui m’a dit : « Bahari, si tu devenais riche, ne perdrais-tu point la tête? »
« Je crois », lui répondit la femme « que tu l’as perdue déjà, la tête! Tu as certes mieux à faire que de rêver, au bord du lac, d’oiseau bleu et autres balivernes, pendant que les crocodiles déchirent tes filets et dévorent tes poissons. Va m’incontinent cher cher des silures et des poissons volants que j’en fasse richesse, en deniers sonnants ! »
«Tu seras toujours terre à terre, ô femme calamiteuse. Je m’en vais donc te chercher du poisson !… »
Et étant retourné, il entendit dans les roseaux un oiseau chanter d’étrange sorte. Il jeta ses filets, mais rien ne prit. Il les jeta encore, car il était patient, mais sans plus de succès.
Il était là, hésitant à rentrer, de peur de la maugréante, quand celle-ci s’en vint elle même à l’eau.
– Eh rêveur d’oiseau bleu, où es-tu », dit-elle.
« Viens-t-en ici » répondit-il, « viens entendre l’oiseau bleu »
Et l’oiseau répétait : « Bahari, si tu devenais riche, perdrais-tu pas la tête ? »
« L’entends-tu pas »? dit Bahari. Mais sa femme n’entendait rien.
Il releva ses filets: vides étaient-ils. De grands trous béants, bordés de végétations aquatiques étalaient leur misère.
A cette vue, Ntsheko, en colère, saisit un bâton et frappa son mari au travers du dos, lui criant: « Va-t-en au diable avec ton oiseau bleu ! Je ne veux plus te voir sous le chaume de notre hutte. »
Et Bahari, s’en étant allé, s’endormit sur le sable,jusqu’au clair de lune, auquel il entendit de nouveau chanter l’oiseau bleu. Il s’éveilla ou du moins crut s’éveiller.
Il se voyait lui-même jetant ses filets et répondant à l’oiseau bleu : « Puis-je perdre quelque chose encore, après avoir tout perdu? Eh, non, je ne perdrais pas la tête ! »
Il releva ses filets et, chose étrange, admirable… il trouva dans les mailles de l’engin… du poisson, non pas, mais une femme parfaitement belle, jeune et souriante et qui semblait s’éveiller d’un long sommeil.
Bahari, de surprise n’en revenant, ne l’osa tirer sur le sable.
Elle s’en vint d’elle-même s’asseoir auprès de lui. A ce moment le soleil se leva, le lac disparut et ses roseaux.
Un oiseau bleu s’en était envolé. Et montant, montant toujours, il entraînait par son chant Bahari et la femme sur les nuages, comme en rêve, à travers des pays merveilleux.
Des mosquées, des palais, des jardins, tout remplis de fleurs et de femmes parées de fraîches tuniques, passaient sous leurs yeux. Il eût souhaité s’arrêter pour goûter ces trésors: des lacs d’argent remplis de poissons… quelle pêche !
Mais l’oiseau bleu les entraînait plus loin, lui et la femme, toujours plus loin, vers de nouvelles richesses et de nouvelles splendeurs.
Enfin, l’oiseau bleu descendit se poser dans un champ de maïs, aux tiges élancées et légères comme des bois de flèches, aux épis dorés comme de petits pains de miel.
La femme qui avait un instant laissé Bahari, revint le prendre et l’emmena par la main vers une femme plus belle encore, et qui n’était rien moins que la Reine de Saba, à cause de qui Salomon, dit le Coran, pécha.
Confondu devant tant de beauté, Bahari se jeta à ses pieds et se trouva, lorsque la dame le releva, revêtu d’habits d’or, de vair et d’écarlate. Un turban de pierreries lui ceignait le chef. Un long cimeterre, à la gaine cloisonnée d’émaux et de perles, à la poignée scintillante de diamants, lui bandait la taille. Il se vit alors, dans le miroir qu’elle lui tendait, plus beau qu’il n’avait jamais été, en ses jeunes ans.
Le grand eunuque parut bientôt, guidant vers le trône de Bahari (car il s’était assis sur le divan qui dominait le sol de marbre de plus de dix pieds), guidant une cour nombreuse et richement parée.
Le champ de maïs s’était, je l’oubliais, transformé en un palais dont les mille colonnes n’étaient autres que les tiges et les épis les corniches d’or. Une musique délicieuse semblait sourdre d’un bassin aux mille sources chantantes. Des femmes munies de larges éventails de plumes d’autruche, d’ibis, d’aigrette et de marabout, montées sur des manches d’ivoire, d’ébène et d’or, créaient du mouvement d’aile de leurs armes légères, une brise douce et parfumée.
Leurs robes pailletées d’or et d’argent, leurs corsages d’écaille, de nacre et d’orfroi, scintillaient sous le jour d’un dôme aux mille feux tamisés d’un soleil bienfaisant. Des enfants nus, noirs et blancs, dansaient des rondes charmantes.
Des jeunes filles de Libye et d’Egypte conduisaient, au bout de fluides rênes d’or, des petits singes gris et bleus. Bientôt, la Reine l’entraîna sous un baldaquin tendu d’étoffes resplendissantes. Un lit mobile roula jusqu’à eux, moelleux et parfumé.
Ici la Reine lui donna un baiser, plus doux que le miel, plus enivrant que le vin, plus parfumé que la cinnamome. Elle reposa dans le creux de sa poitrine comme un sachet parfumé.
Et lorsqu’ils s’éveillèrent, une Fée les invita, en souriant, à prendre un bain dans une piscine, où l’eau claire laissait transparaître un pavé de mosaïque, composé des quarante pierres précieuses de l’Orient, arrangées en fleurs, en rinceaux et autres ornements que les Occidentaux appellent « arabesques ». A l’heure du couchant, les amants s’allèrent promener dans les jardins du palais, merveilles d’architecture et de beauté, où l’Art et la Nature, dépassant les richesses des jardins de Sémiramis, collaboraient à y rendre le séjour divinement agréable et salutaire.
Des paons aux plumes oscellées, des ibis à l’aile blanche comme l’âme d’un enfant, des grues couronnées, des oiseaux de paradis et jusqu’à ces menus oisillons qui sont parés de toutes les couleurs, enchantaient ce séjour de leurs chants, de leurs cris.
Ils arrivèrent ainsi près d’un massif de roc, sur lequel régnait une tour svelte à la porte grillagée. Une humble tourterelle roucoulait dans le creux d’une meurtrière. Une touffe de violette parfumait le seuil de la porte, à l’ombre d’un pilier sculpté.
La Reine dit à Bahari: «Voici que je te confie le secret de notre bonheur. C’est ici la Tour de l’Oiseau Bleu; j’y tiens la cage où cette merveilleuse petite vie s’agite et chante.
Il ne faut jamais ouvrir cette cage – jamais vouloir interroger l’oiseau, le presser de se faire entendre, car cette cage est à double destin. Elle ouvre la porte au bien et au mal, au bonheur et au malheur.
Maintenant que tu es mon ami, mon doux époux, il importe que tu saches ce secret ». Leurs jours coulaient, tissés de joies variées, d’amour et de frais baisers. Les vins, les chants, les oiseaux, les fleurs, les parfums et les femmes étaient toute la vie de Bahari.
Mais le secret de l’oiseau bleu l’inquiétait. Parfois, le soir, tandis que la Reine était à sa toilette, Bahari rôdait au bas de la Tour, anxieux, craintif.
Son esprit était troublé comme par un vin capiteux… Il se croyait maître de son bon heur, lui-même. Il en voulait à l’oiseau bleu, de la dépendance dans laquelle il le tenait. Cette défense de le voir et lui ouvrir sa cage l’exaspérait.
Pourquoi cet obstacle devant un homme désormais si puissant et si riche? Pouvait-il y avoir une chose qui lui fût interdite?
Bahari oublia qu’il devait à cet oiseau tout son bonheur.
Et, un soir que la Reine venait de le quitter, il oublia tout, et le parfum et la douceur du dernier baiser, il oublia le charme des bras blancs de son épouse autour de son col, la caresse de ses yeux noirs fixant les siens, la douce chanson de sa parole, il oublia la défense.
Vite, comme un malfaiteur qui tue, il ravit à l’esclave nubienne qui soignait l’oiseau, la clef de la tour et la clef de la cage. Éperdue, celle-ci s’en était allée avertir la Reine, mais il était trop tard, l’impétueux
Bahari avait ouvert la Tour et la cage. L’oiseau bleu, s’envolant, l’avait enlevé dans les airs.
Bahari passa de nouveau sur les mosquées et les palais; puis s’étant regardé lui-même, il se reconnut tel qu’il était autrefois, vêtu des haillons du vieux pêcheur, traînant son filet.
Et tandis qu’il venait de toucher terre, il vit venir à lui la grincheuse et maugréante, la calamiteuse Ntsheko, dont le nom, par ironie veut dire Sourire .
Contes d’Afrique / Olivier de Bouveignes
Source: BNF Gallica
Les Aventures d’Aladin

Il était une fois une veuve qui avait un fils unique qui s’appelait Aladin. Ils étaient très pauvres et vivaient au jour le jour, même si Aladin faisait ce qu’il pouvait pour gagner quelques sous, en cueillant des bananes dans des endroits lointains.
Un jour, alors qu’il cherchait des figues sauvages dans un bosquet à quelque distance de la ville, Aladin rencontra un mystérieux étranger. Cet homme aux yeux noirs était élégamment vêtu et portait une barbe noire finement taillée et un splendide saphir étincelait dans son turban.
Il s’adressa ainsi à Aladin :
« Bonjour, jeune homme. Voudrais-tu gagner une pièce d’argent ?
« Une pièce d’argent ! » s’exclama Aladin. « Monsieur, je ferais n’importe quoi pour cela »
“Oh il ne faut pas faire grand-chose. Simplement descendre dans la caverne qui se trouve sous cette pierre que tu vois là-bas. Le trou est trop étroit pour moi. Si tu y descends, tu auras ta récompense.
L’inconnu aida Aladin à soulever la pierre, car elle était très lourde. Le trou apparut et le garçon qui était mince et agile se faufila dedans. Ses pieds touchèrent le sol et il descendit prudemment quelques marches. . . il déboucha dans une grande pièce sombre. Seule une lueur scintillant au milieu de la pièce, émanait de la faible flamme vacillante d’une vieille lampe à huile.
Lorsque les yeux d’Aladin se furent habitués à l’obscurité, il découvrit alors un spectacle merveilleux : des arbres dégoulinant de bijoux scintillants, des pots remplis d’or et des coffrets remplis de pierres précieuses de valeurs inestimables. Des milliers d’objets précieux étaient entassés. C’était un immense trésor !
Incapable d’en croire ses yeux, Aladin était encore tout étourdi lorsqu’il entendit un cri derrière lui.
« La lampe ! Éteint la flamme et apporte-moi la lampe ! Criait l’étranger.
Aladin fut surpris de cet ordre et devint méfiant, car il se demandait pourquoi l’étranger, à un tel trésor, préférait une vieille lampe. Peut-être était-ce un sorcier.
Il décida de rester sur ses gardes. Ramassant la lampe, il revint sur ses pas jusqu’à l’entrée.
« Donne-moi la lampe, » pressa le sorcier avec impatience. « Donne-la-moi », continua-t-il en criant, tendant le bras pour l’attraper, mais Aladin recula prudemment et dit:
« Laissez-moi d’abord sortir… »
« Tant pis pour toi, » lança alors l’inconnu furieux, et il repoussa la pierre sur le trou, sans s’apercevoir, ce faisant, qu’un anneau avait glissé de son doigt.
Aladin se retrouva dans l’obscurité la plus totale, terrifié, se demandant si le sorcier allait revenir. En cherchant son chemin dans le noir, il marcha sur l’anneau. Le glissant à son doigt, il commença à le tourner nerveusement.
Soudain! La pièce fut inondée d’une lumière rose et un grand génie aux mains jointes apparut assis sur un nuage.
« A vos ordres, mon maître », dit le génie.
Stupéfait, Aladin ne put que balbutier :
« Je veux rentrer à la maison! » En un éclair, il était de retour à l’intérieur de sa propre maison, bien que la porte soit restée fermée.
« Comment es-tu entré? D’où viens-tu? » s’écria sa mère depuis la cuisine, dès qu’elle le vit.
Heureux de s’en être sorti, Aladin lui raconta ses aventures.
« Où est cette pièce d’argent ? » demanda sa mère.
Aladin porta la main au front. Car tout ce qu’il avait ramené à la maison était la vieille lampe à huile.
« Oh, mère! Je suis vraiment désolé. C’est tout ce que j’ai. »
« Eh bien, espérons qu’elle marche au moins. Elle est tellement sale… » et la veuve se mit à frotter la lampe.
Soudain, un autre génie, bien plus grand que le précédent, apparut dans son nuage de fumée.
« Tu m’as libéré, après des siècles durant lesquels j’étais prisonnier dans la lampe, attendant d’être libéré par quelqu’un qui la frotterait. Maintenant, je suis ton humble serviteur. Dis-moi quels sont tes souhaits. »
Et le génie s’inclina respectueusement, en attendant les ordres d’Aladin et sa mère.
Ceux-ci restèrent bouche bée un bon moment face à cette incroyable apparition, puis le génie dit avec une pointe d’impatience dans la voix.
« Je suis ici à tes ordres. Dis-moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux ! » Aladin déglutit, puis dit :
« Amenez-nous . . . Apportez . . . » Sa mère n’ayant pas encore commencé à cuisiner le dîner, elle continua sans y croire, en disant : “. . . Apporte un bon gros repas.”
A partir de ce jour, la veuve et son fils eurent tout ce qu’ils pouvaient désirer : de la nourriture, des vêtements et un beau foyer, car le génie de la lampe leur accorda tous les biens et les richesses qu’ils lui demandaient.
Aladin était un grand et beau jeune homme, et maintenant il était riche grâce à la lampe, et sa mère songeait qu’il était temps pour lui de se trouver une femme.
Un jour, alors qu’il quittait le marché, Aladin aperçut la fille du sultan Halima dans sa chaise à porteurs alors qu’elle traversait les rues de la vieille ville. Il n’entrevit qu’un bref instant la princesse, mais ce fut suffisant pour en tomber amoureux.
Aladin raconta sa flamme à sa mère et elle répondit simplement:
« Je demanderai au sultan la main de sa fille. Il ne pourra pas refuser. Attends et tu verras ! »
Et en effet, le sultan se laissa facilement convaincre par un coffre rempli de gros diamants et admit la veuve en audience au palais.
Lorsqu’il apprit la raison de sa venue, il dit à la veuve que son fils devait apporter la preuve de sa puissance et de sa richesse. C’était surtout une idée soufflée par son grand vizir, un arriviste qui avait lui-même en vue d’épouser la fille du sultan, et devenir ainsi l’héritier du royaume.
« Si Aladin veut épouser Halima, dit le sultan, il devra m’envoyer demain quarante esclaves. Chaque esclave devra apporter un coffre rempli de pierres précieuses. Et quarante guerriers arabes escorteront le trésor. »
La mère d’Aladin rentra tristement chez elle. Le génie de la lampe magique avait déjà fait des merveilles, mais rien d’aussi gigantesque.
Aladin, quand il apprit la nouvelle, ne s’en affola pas le moins du monde. Il ramassa la lampe, la frotta plus fort que jamais et dit au génie ce dont il avait besoin. Le génie tapa simplement dans ses mains trois fois.
Quarante esclaves apparurent comme par magie, portant les pierres précieuses, avec leur escorte de quarante guerriers arabes. Quand il vit tout cela le lendemain, le sultan fut bien surpris. Il n’aurait jamais imaginé qu’une telle richesse puisse exister. Juste au moment où il était sur le point d’accepter Aladin comme époux de sa fille, l’envieux vizir posa une question.
« Mais où donc habiteront-ils ? » Demanda t-il.
Le sultan réfléchit un moment, puis laissant la cupidité l’emporter sur lui, il dit à Aladin de construire un grand et splendide palais pour Halima. Aladin rentra directement chez lui pour frotter la lampe merveilleuse.
Dans ce qui était autrefois un désert, le génie lui construisit un palais. Le dernier obstacle était surmonté.
Le mariage se déroula en grandes pompes et le sultan était particulièrement heureux d’avoir trouvé un gendre aussi riche et puissant.
La nouvelle de la fortune et de la richesse soudaines d’Aladin s’est répandue comme une traînée de poudre, jusqu’à ce que… un jour, un étrange marchand s’arrête sous la fenêtre du palais.
« Vos vieilles lampes pour des neuves ! », cria-t-il alors que la princesse était penchée au balcon.
Or, Aladin avait toujours gardé son secret pour lui. Seule sa mère le savait et elle ne l’avait jamais dit à personne. Halima, hélas, avait été tenue dans l’ignorance. Et, voulant faire une surprise à Aladin et croyant aussi faire une bonne affaire, elle alla chercher la vieille lampe à huile qu’elle avait vu Aladin ranger et la donna au marchand en échange d’une nouvelle lampe toute brillante mais tout à fait normale.
Le faux marchand, qui n’était autre que le sorcier qui avait voulu enfermer Aladin dans la grotte, commença immédiatement à frotter et le génie se mit à son service en disant:
– Ordonne maître et j’obéirai.
En une seconde, il emporta tous les biens d’Aladin et emporta le palais et la princesse dans un pays inconnu.
En découvrant la disparition, Aladin et le sultan furent désespérés. Personne ne savait ce qui s’était passé. Seul Aladin soupçonnait que cela avait quelque chose à voir avec la lampe merveilleuse. Mais alors qu’il pleurait, il se souvint du génie de l’anneau qu’il portait toujours au doigt. Il la fit tourner deux fois et le génie apparût.
« Emmène-moi à l’endroit où le sorcier a caché ma femme », ordonna-t-il au génie. En un éclair, il se retrouva à l’intérieur de son propre palais, et se cachant derrière un rideau, il vit le sorcier et la princesse, qui était maintenant devenue sa servante.
« Psst ! Psst ! siffla Aladin en direction de son épouse.
« Chut! Qu’il ne nous entende pas. Prenez cette poudre et mettez-la dans son thé. Faites-moi confiance. » La poudre fit rapidement effet et le sorcier tomba dans un profond sommeil.
Aladin chercha la lampe de haut en bas du palais, mais elle était introuvable. Mais elle devait être là. Comment, sinon, le sorcier avait-il déplacé le palais ? Alors qu’Aladin regardait son ennemi endormi, il pensa à regarder sous l’oreiller. « La lampe ! Enfin », soupira Aladin en la frottant à la hâte.
« Bienvenue, Maître ! » s’écria le génie. « Pourquoi m’as-tu laissé si longtemps au service d’un autre ? »
« Merci mon ami! », répondit Aladin. « Je suis content de te revoir. Tu m’as aussi bien manqué !
« À votre service, Maître! », sourit le génie.
« Pour commencer, dit Aladin, je te prierai de bien vouloir capturer ce méchant sorcier et de l’emmener si loin que personne ne pourra plus jamais le trouver »
Le génie sourit d’un air approbateur, puis, il hocha la tête et, soudain, le sorcier disparut.
Halima se serra tremblante contre Aladin en demandant :
« Que se passe-t-il ? Qui est ce génie ?
« Ne t’inquiète pas, c’est un ami », la rassura Aladin, alors qu’il racontait à sa femme toute l’histoire de sa rencontre avec le sorcier et de la découverte de la lampe magique qui lui avait permis de l’épouser.
Heureux d’être sains et saufs, le couple s’embrassa tendrement.
« Pourrons-nous retourner dans notre pays ? demanda la princesse.
Aladin la regarda avec un sourire.
« La magie qui t’a amené ici te ramènera au palais de ton père, mais cette fois, avec moi à vos côtés, pour toujours. »
Le sultan était presque malade d’inquiétude. Sa fille avait disparu avec le palais de son gendre, qui avait aussi disparu. Personne ne savait où ils se trouvaient, pas même les sages appelés à la hâte au palais ne purent deviner ce qui s’était passé. Le chambellan jaloux ne cessait de répéter :
« Je vous avais dit que la fortune d’Aladin ne pouvait pas durer. »
Tout le monde avait déjà perdu l’espoir de revoir un jour le jeune couple princier, au même moment où Aladin frotta la lampe magique et dit au génie:
« Ramène ma femme, moi-même et le palais à leur bonne place, aussi vite que tu pourras. »
« C’est comme si c’était fait! », répondit le génie.
En un claquement de doigt, le palais s’éleva dans les airs et fila jusqu’au royaume du sultan, volant au-dessus des têtes de ses sujets ébahis.
Il atterrit en douceur à sa place. Aladdn et Halima se précipitèrent pour embrasser le sultan.
Aujourd’hui encore, dans ce lointain pays, on peut encore admirer les traces d’un ancien palais que les gens appellent le palais venu du ciel.
Version des frères Grimm traduite et adaptée par Contesdefees.com.
Illustrations de Albert Robida



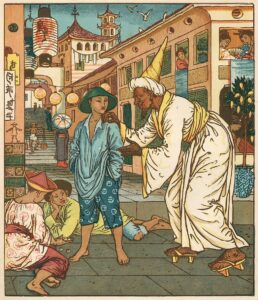
Pierre et le loup

Lisez et jouer les instruments qui correspondent à chaque personnage
Un beau matin Pierre ouvrit la porte du jardin et s’en alla dans les prés verts. Sur la plus haute branche d’un grand arbre, était perché un petit oiseau, ami de Pierre. » Tout est calme ici. » gazouillait-il gaiement. Un canard arriva bientôt en se dandinant, tout heureux que Pierre n’ait pas fermé la porte du jardin. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare, au milieu du pré.
Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l’herbe tout près de lui.
» Mais quel genre d’oiseau es-tu donc, qui ne sait voler ? » dit-il en haussant les épaules.
A quoi le canard répondit :
« Quel genre d’oiseau es-tu qui ne sait pas nager ? »
Et il plongea dans la mare. Ils discutèrent longtemps, le canard nageant dans la mare, le petit oiseau voltigeant au bord.
Soudain quelque chose dans l’herbe attira l’attention de Pierre, c’était le chat qui approchait en rampant.
Le chat se disait :
» L’oiseau est occupé à discuter. Je vais en faire mon déjeuner. »
Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours.
» Attention « , cria Pierre, et l’oiseau aussitôt s’envola sur l’arbre. Tandis que du milieu de la mare le canard lançait au chat des » coin-coin » indignés. Le chat rôdait autour de l’arbre en se disant : » Est-ce la peine de grimper si haut ? Quand j’arriverai, l’oiseau se sera envolé. »
Tout à coup Grand-père apparut. Il était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. » L’endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu ? »
Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n’avaient pas peur des loups. Mais Grand-père prit Pierre par la main, l’emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin.
Il était temps. A peine Pierre était-il parti, qu’un gros loup gris sortit de la forêt.
En un éclair, le chat grimpa dans l’arbre. Le canard se précipita hors de la mare en caquetant. Mais malgré tout ses efforts, le loup courait plus vite. Le voilà qui approcha de plus en plus près, plus près, il le rattrapa, s’en saisit et l’avala d’un seul coup.
Et maintenant voici où en était les choses : le chat était assis sur une branche, l’oiseau sur une autre, à bonne distance du chat, bien sûr, tandis que le loup faisait le tour de l’arbre et les regardait tous deux avec des yeux gourmands.
Pendant ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait, sans la moindre frayeur. Une des branches de l’arbre, autour duquel tournait le loup, s’étendait jusqu’au mur. Pierre s’empara de la branche, puis monta dans l’arbre.
Alors Pierre dit à l’oiseau :
» Va voltiger autour de la gueule du loup mais prends garde qu’il ne t’attrape. »
De ses ailes, l’oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l’attraper. Oh que l’oiseau agaçait le loup ! Et que le loup avait envie de l’attraper ! Mais que l’oiseau était bien trop adroit et le loup en fut pour ses frais.
Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant, et les descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l’autre bout de la corde à l’arbre, et les bonds que faisaient le loup ne firent que resserrer le noeud coulant.
C’est alors que les chasseurs sortirent de la forêt.
Ils suivaient les traces du loup et tiraient des coups de fusil. Pierre leur cria du haut de l’arbre :
» Ne tirez pas. Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup. Aidez-nous à l’emmener au jardin zoologique. »
Et maintenant, imaginez la marche la marche triomphale : Pierre est en tête ; derrière lui, les chasseurs traînaient le loup, et, fermant la marche le Grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant :
» Ouais ! Et si Pierre n’avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ? »
Au-dessus d’eux, l’oiseau voltigeaient en gazouillant :
» Comme nous sommes braves, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. »
Composé par Serge Prokofiev en 1923, Pierre et le Loup est un conte musical pour enfants. Son objectif est de faire découvrir aux enfants les instruments de musique de l’orchestre. Pendant que le narrateur raconte l’histoire musicale, l’orchestre joue. Et chaque personnage est un instrument de musique :
- Pierre = les cordes (violon, alto, violoncelle, contrebasse)
- Le Loup = les cors
- Le Grand-Père = le basson
- le chat : la clarinette
- L’oiseau = la flûte traversière
- le canard : le hautbois
- les chasseurs : bois et cuivres
Gravure musicale par Lily Pond
La Petite fille aux allumettes

Comme il faisait froid ! la neige tombait et la nuit n’était pas loin ; c’était le dernier soir de l’année, la veille du jour de l’an.
Au milieu de ce froid et de cette obscurité, une pauvre petite fille passa dans la rue, la tête et les pieds nus.
Elle avait, il est vrai, des pantoufles en quittant la maison, mais elles ne lui avaient pas servi longtemps : c’étaient de grandes pantoufles que sa mère avait déjà usées, si grandes que la petite les perdit en se pressant de traverser la rue entre deux voitures.
L’une fut réellement perdue ; quant à l’autre, un gamin l’emporta avec l’intention d’en faire un berceau pour son petit enfant, quand le ciel lui en donnerait un.
La petite fille cheminait avec ses petits pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid ; elle avait dans son vieux tablier une grande quantité d’allumettes, et elle portait à la main un paquet.
C’était pour elle une mauvaise journée ; pas d’acheteurs, donc pas le moindre sou. Elle avait bien faim et bien froid, bien misérable mine.
Pauvre petite ! Les flocons de neige tombaient dans ses longs cheveux blonds, si gentiment bouclés autour de son cou ; mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés ?
Les lumières brillaient aux fenêtres, le fumet des rôtis s’exhalait dans la rue ; c’était la veille du jour de l’an : voilà à quoi elle songeait.
Elle s’assit et s’affaissa sur elle-même dans un coin, entre deux maisons.
Le froid la saisit de plus en plus, mais elle n’osait pas retourner chez elle : elle rapportait ses allumettes, et pas la plus petite pièce de monnaie.
Son père la battrait ; et, du reste, chez elle, est-ce qu’il ne faisait pas froid aussi ?
Ils logeaient sous le toit, et le vent soufflait au travers, quoique les plus grandes fentes eussent été bouchées avec de la paille et des chiffons.
Ses petites mains étaient presque mortes de froid.
Hélas ! qu’une petite allumette leur ferait du bien! Si elle osait en tirer une seule du paquet, la frotter sur le mur et réchauffer ses doigts !
Elle en tira une : ritch ! comme elle éclata ! Comme elle brûla !
C’était une flamme chaude et claire comme une petite chandelle, quand elle la couvrit de sa main.
Quelle lumière bizarre ! Il semblait à la petite fille qu’elle était assise devant un grand poêle de fer orné de boules et surmonté d’un couvercle en cuivre luisant.
Le feu y brûlait si magnifique, il chauffait si bien !
Mais qu’y a-t-il donc ! La petite étendait déjà ses pieds pour les chauffer aussi ; la flamme s’éteignit, le poêle disparut : elle était assise, un petit bout de l’allumette brûlée à la main.
Elle en frotta une seconde, qui brûla, qui brilla, et, là où la lueur tomba sur le mur, il devint transparent comme une gaze.
La petite pouvait voir jusque dans une chambre où la table était couverte d’une nappe blanche, éblouissante de fines porcelaines, et sur laquelle une oie rôtie, farcie de pruneaux et de pommes, fumait avec un parfum délicieux. Ô surprise ! ô bonheur !
Tout à coup l’oie sauta de son plat et roula sur le plancher, la fourchette et le couteau dans le dos, jusqu’à la pauvre fille.
L’allumette s’éteignit : elle n’avait devant elle que le mur épais et froid.
En voilà une troisième allumée. Aussitôt elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël ; il était plus riche et plus grand encore que celui qu’elle avait vu, à la Noël dernière, à travers la porte vitrée, chez le riche marchand.
Mille chandelles brûlaient sur les branches vertes, et des images de toutes couleurs, comme celles qui ornent les fenêtres des magasins, semblaient lui sourire.
La petite éleva les deux mains : l’allumette s’éteignit ; toutes les chandelles de Noël montaient, montaient, et elle s’aperçut alors que ce n’était que les étoiles.
Une d’elle tomba et traça une longue raie de feu dans le ciel.
« C’est quelqu’un qui meurt, » se dit la petite ; car sa vieille grand’mère, qui seule avait été bonne pour elle, mais qui n’était plus, lui répétait souvent : « Lorsqu’une étoile tombe, c’est qu’une âme monte à Dieu. »
Elle frotta encore une allumette sur le mur : il se fit une grande lumière au milieu de laquelle était la grand’mère debout, avec un air si doux, si radieux !
« Grand’mère s’écria la petite, emmène-moi. Lorsque l’allumette s’éteindra, je sais que tu n’y seras plus. Tu disparaîtras comme le poêle de fer, comme l’oie rôtie, comme le bel arbre de Noël. »
Elle frotta promptement le reste du paquet, car elle tenait à garder sa grand’mère, et les allumettes répandirent un éclat plus vif que celui du jour.
Jamais la grand’mère n’avait été si grande ni si belle. Elle prit la petite fille sur son bras, et toutes les deux s’envolèrent joyeuses au milieu de ce rayonnement, si haut, si haut, qu’il n’y avait plus ni froid, ni faim, ni angoisse ; elles étaient chez Dieu.
Mais dans le coin, entre les deux maisons, était assise, quand vint la froide matinée, la petite fille, les joues toutes rouges, le sourire sur la bouche…. morte, morte de froid, le dernier soir de l’année.
Le jour de l’an se leva sur le petit cadavre assis là avec les allumettes, dont un paquet avait été presque tout brûlé. « Elle a voulu se chauffer ! » dit quelqu’un.
Tout le monde ignora les belles choses qu’elle avait vues, et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa vieille grand’mère dans la nouvelle année.
Contes d’Andersen, Librairie Hachette et Cie, 1876 (p. 157-161).
Traduction par David Soldi.
Source: Wikisource
L’oiseau d’or

Il y a fort longtemps, il y avait un roi qui avait un joli jardin autour de son palais, et il y avait, dans ce jardin, un arbre qui portait des pommes d’or.
Quand les pommes furent presque mûres, on les compta, mais dès le lendemain matin, il en manquait une.
Cela fut rapporté au roi, qui commanda qu’une garde fut organisée tous les soirs sous l’arbre.
Le roi avait trois fils, et il envoya l’aîné dans le jardin à la tombée de la nuit ; mais à minuit, celui-ci succomba au sommeil et le matin il manquait une autre pomme.
La nuit suivante, le deuxième fils devait monter la garde, mais il ne fit pas mieux. Quand l’horloge sonna minuit, lui aussi s’était profondément endormi, et le matin une troisième pomme avait disparu.
Le tour de garde suivant fut donc celui du troisième fils. Il était tout à fait prêt, mais le roi n’avait guère confiance en lui, et pensait qu’il réussirait encore moins que ses frères.
Enfin, il finit par lui donner sa permission ; le jeune homme se coucha donc sous l’arbre pour surveiller, déterminé à ne pas se laisser prendre par le sommeil.
Lorsque l’horloge sonna minuit, il y eut un bruissement dans l’air, et à la lumière de la lune, il vit un oiseau dont les plumes étaient d’or pur étincelant. L’Oiseau se posa sur l’arbre. Il venait de cueillir une pomme d’or et la tenait dans son bec.
Alors le jeune prince brandit son arc et lui tira une flèche.
L’oiseau s’envola, mais la flèche avait touché son aile et l’une des plumes dorées tomba au sol.
Le Prince la ramassa et le matin l’apporta au roi en lui racontant tout ce qu’il avait vu dans la nuit.
Le roi rassembla son conseil, et tout le monde déclara qu’une telle plume valait plus que tout le royaume.
« Si la plume vaut tant, dit le roi, cela ne me suffit pas; il me faut l’oiseau tout entier.
L’aîné des trois princes partit à la recherche de l’Oiseau, certain de le trouver bientôt.
Quand il eut parcouru un bon bout de chemin, il vit un renard assis à l’orée d’un bois ; il leva son fusil et le visa.
Mais le renard s’écria :
« Beau Prince! Ne me tirez pas dessus, et je vous donnerai un bon conseil pour chercher l’Oiseau d’Or ;
En continuant ce chemin, vous arriverez dans un village à la tombée de la nuit, où vous trouverez deux auberges se faisant face. L’une brillera de tous ses feux allumés, pleine de bruit et de réjouissances.
Assurez-vous de ne pas choisir celle-là, mais allez dans l’autre, même si vous n’aimez guère son apparence.
« Comment un animal stupide pourrait-il me donner de bons conseils ? » Pensa le fils du roi, et il appuya sur la gâchette, mais manqua
le Renard, qui tourna la queue et s’enfuit dans les bois.
Alors le Prince continua son voyage, et la nuit arrivée, il atteignit le village avec ses deux auberges.
On chantait et on dansait dans l’une, et l’autre avait un aspect misérable et délabré.
« Je serais un imbécile, dit-il, de choisir ce lieu misérable alors que l’autre a l’air si bon. »
Alors il se laissa happer par le bruit et la fête et vécut ainsi, oubliant l’Oiseau, son père, et tout ce qu’il avait appris.
Quand un certain temps se fut écoulé et que le fils aîné ne revenait pas, le second se déclara prêt à partir à la recherche de l’Oiseau d’or.
Il se mit en route et rencontra le Renard, comme l’avait fait le fils aîné, et celui-ci lui donna le même conseil, auquel il prêta aussi peu d’attention.
Il arriva aux deux auberges et vit son frère debout à la fenêtre de celle d’où partaient des bruits de réjouissances.
Il ne put résister à l’appel de son frère, alors il entra et se livra à une vie de plaisir.
Après quelque temps, et le plus jeune fils du roi voulut partir tenter sa chance; mais son père ne voulait pas le laisser partir.
« C’est inutile, dit-il. Il ne saura sûrement pas trouver l’Oiseau d’Or plus que ses frères, et en cas de malheur, il ne pourra pas se tirer d’affaires tout seul. Il est à peine sorti du bercail. »
Mais comme le jeune prince insistait et ne le laissait pas en paix, il le laissa finalement partir.
Cette fois encore, le Renard s’assit à l’orée du bois, supplia pour sa vie, et prodigua ses bons conseils.
Le prince était de bonne humeur, et lui dit :
« Calme-toi, petit Renard, je ne te ferai aucun mal. »
« Vous ne vous en repentirez pas, répondit le Renard ; et pour que vous puissiez aller plus vite, venez vous asseoir sur ma queue. »
A peine s’était-il assis que le Renard se mit à courir, et ils volèrent au-dessus des bois et des terres, si vite, que ses cheveux sifflaient au vent.
Arrivé au village, le prince mit pied à terre et, suivant les bons conseils du Renard, il se rendit directement à l’auberge silencieuse sans regarder l’autre, et il y passa une nuit paisible.
Le matin, quand il arriva dans les champs, le Renard l’attendait tranquillement et il lui dit :
« Je vais maintenant vous dire ce que vous devrez faire ensuite. Marchez tout droit jusqu’à ce que vous arriviez à un château, devant lequel tout un régiment de soldats est campé. N’ayez pas peur d’eux ; ils seront tous endormis en train de ronfler. Marchez au milieu d’eux et entrez directement dans le château. Traversez toutes les chambres, jusqu’à atteindre une pièce où vous trouverez l’oiseau d’or enfermé dans une cage en bois commune. Une cage dorée se tient à côté, mais attention ! Surtout, ne changez pas l’oiseau de cage! »
Sur ces mots, le Renard allongea de nouveau la queue, le Prince prit place dessus, et ils volèrent au-dessus des bois et des terres, jusqu’à ce que ses cheveux sifflent dans le vent.
Arrivé au château, il trouva tout comme l’avait dit le Renard.
Le Prince se rendit dans la pièce où était l’Oiseau d’Or, dans sa cage en bois, avec la cage dorée à côté, et il aperçut également les trois pommes d’or, éparpillées dans la pièce.
Il pensa alors qu’il était absurde de laisser le bel oiseau dans la vieille cage commune, alors il ouvrit la porte, l’attrapa et le mit dans la cage dorée.
Mais alors qu’il faisait cela, l’Oiseau poussa un cri perçant.
À ce cri, les soldats se réveillèrent, accoururent et l’emmenèrent en prison.
Le lendemain matin, il fut amené devant le roi du pays pour être jugé, et, comme il avoua tout, il fut condamné à mort.
Le roi, cependant, lui dit qu’il lui laisserait la vie sauve à une seule condition: il devait lui apporter le Cheval d’or qui court plus vite que le vent.
De plus, il lui promit que s’il y parvenait, il aurait l’oiseau d’or pour récompense.
C’est ainsi que le prince partit, bien triste et désespéré, ne sachant pas du tout comment il allait trouver ce cheval d’or.
Puis soudain il vit son ami le Renard assis sur le bord de la route.
« Maintenant, vous voyez bien, dit le Renard, tout cela est arrivé parce que vous ne m’avez pas écouté. Mais reprenez vos esprits et votre courage. Je vais vous aidez encore et vous dire comment trouver le Cheval d’or. Vous devez continuer tout droit le long de la route, et vous arriverez à un palais, dans l’écurie duquel vous trouverez le Cheval d’or. Les palefreniers seront couchés autour de l’écurie, mais ils
dormiront profondément et ronfleront, et vous pourrez guider le cheval à travers eux sans crainte.
Il y a seulement une chose dont vous devrez vous méfier: Mettez sur le cheval la vieille selle de bois et de cuir, et non la dorée suspendue à proximité, sans quoi vous le regretterez. »
Alors le Renard allongea sa queue, le Prince s’assit, et ils volèrent au-dessus des bois et des terres, jusqu’à ce que ses cheveux sifflent dans le vent.
Tout se passa exactement comme le renard l’avait prédit. Le Prince arriva à l’écurie où se tenait le cheval d’or, mais alors qu’il était sur le point de mettre la vieille selle sur son dos, il pensa:
« Un si bel animal sera déshonoré si je ne lui mets pas la belle selle, comme il le mérite. »
À peine la selle d’or avait-elle touché le cheval qu’il commença à hennir bruyamment. Les palefreniers se réveillèrent, saisir le prince et le jetèrent dans un obscur cachot en haut du donjon.
Le lendemain matin, il fut emmené devant le roi pour être à nouveau jugé, et condamné à mort ; mais le roi promit de lui laisser la vie sauve, et de lui donner aussi le cheval d’or, s’il pouvait lui apporter la belle princesse du palais d’or.
Le cœur lourd, le prince se remit en route, mais à sa grande joie il retrouva le fidèle Renard.
« Je devrais vous abandonner à votre sort, dit celui-ci. Mais j’ai pitié de vous et je vais encore une fois vous tirer d’affaires.
Cette route mène tout droit au palais d’or, que vous atteindrez au soir. Une fois la nuit bien avancée, quand tout sera calme, la belle princesse ira à la salle de bain pour prendre un bain.
Avant qu’elle n’entre dans son bain, vous la surprendrez en lui donnant un baiser, et elle vous suivra. Emmenez-la avec vous. Mais surtout ne la laissez en aucun cas dire au revoir à ses parents, sinon il vous arrivera malheur. »
De nouveau le Renard étendit la queue, le Prince s’assis dessus, et ils volèrent au-dessus des bois et des terres, jusqu’à ce que ses cheveux sifflent au vent.
Quand il arriva au palais, tout fut exactement comme le renard l’avait dit.
Il attendit jusqu’à minuit, et quand tout le palais fut endormi, la jeune fille alla prendre son bain. Alors il s’élança et lui donna un baiser. Elle lui dit qu’elle voulait bien l’accompagner, mais elle le supplia de lui laisser dire au revoir à ses parents.
Il refusa d’abord ; mais comme elle pleurait en se jetant à ses pieds, il la laissa finalement aller.
À peine la jeune fille s’avança-t-elle vers le lit de son père, qu’il se réveilla ainsi que tous les occupants du palais.
Le prince fut saisi, et jeté en prison.
Le lendemain matin, le roi lui dit :
« Votre vie est terminée, à moins que vous ne rasiez la montagne qui est devant ma fenêtre et me gâche la vue. Ceci doit être fait sous huit jours, et si vous y parvenez, vous aurez ma fille en récompense. »
Alors le prince se mit à la tâche, et il creusa, piocha et pelleta jour et nuit. Le septième jour, quand il vit le peu qu’il avait avancé, il devint très triste et abandonna tout espoir.
Cependant, au soir, le Renard apparut et lui dit: « Vous ne méritez vraiment aucune aide de ma part, mais bon, couchez-vous et reposez-vous ;
Je ferai le travail. »
Le matin quand il se réveilla et regarda par la fenêtre, la montagne avait disparu.
Fou de joie, le prince se précipita chez le roi et lui dit qu’il avait accompli sa part du marché et , et, qu’il devait lui donner sa fille.
Alors ils partirent tous les deux ensemble, et bientôt le fidèle Renard les rejoignit:
« Vous avez certainement la récompense de toutes, dit-il ; mais à la jeune fille du palais d’or devrait revenir le cheval d’or. »
« Comment puis-je l’obtenir ? demanda le Prince.
« Oh ! Je vais vous le dire, répondit le Renard. Apportez d’abord la belle Demoiselle au Roi qui vous a envoyé au palais d’or. Il aura une grande joie en vous voyant arriver, et ils vous apportera le cheval d’or.
Montez-le immédiatement, et serrez la main à tout le monde en guise d’adieux, en laissant en dernier lieu la belle jeune fille.
Quand vous arriverez à son tour, serrez-lui fermement la main, et soulevez-là derrière vous sur le cheval avant de talonner celui-ci pour qu’il parte au galop.
Personne ne pourra te rattraper, car ce cheval courre plus vite que le vent. »
Le prince mit le plan à exécution et tout se passa comme prévu. Il se retrouvèrent la belle jeune fille et lui, assis sur le cheval d’or qui filait comme le vent.
Le renard n’était pas loin, et il dit au prince :
« Maintenant, je vous aiderai également à obtenir l’oiseau d’or. Quand vous approcherez du château, laissez la jeune fille descendre et s’abriter à mes côtés
Alors galopez avec le cheval d’or jusque dans la cour du château ;
Ils vous feront fête en vous voyant et le roi vous fera donner l’oiseau d’or.
Dès que vous aurez la cage dans votre main, revenez vers nous au galop et reprenez la jeune femme.
Le jeune prince suivit les conseils du fidèle Renard, et lorsqu’il revint victorieux de cette nouvelle épreuve et fut prêt pour repartir avec tous ses trésors, le Renard lui dit :
« Maintenant, vous devez me récompenser pour mon aide. »
« Quelle récompense attends-tu de moi? demanda le Prince.
« Quand tu atteindras ce bois, dit le renard, tue-moi et coupe-moi la tête et les pattes. »
« Mais ce n’est pas une récompense ! dit le Prince. Je ne peux pas promettre de commettre un tel crime ! »
Le Renard répondit:
« Bien, mais si vous ne pouvez le faire, alors je dois vous quitter; mais avant que je m’en aille, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires. Faîtes bien attention à ces deux choses:
Ne rachetez pas de prisonniers, et ne vous asseyez pas au bord d’un puits. »
Et sur ces mots, il s’enfuit dans les bois.
Le prince pensa :
« C’est définitivement un animal bien étrange que ce renard; quelles drôles d’idées Pourquoi diable irai-je racheter des prisonniers ! Et l’envie de m’asseoir au bord d’un puits ne m’a encore jamais saisi ! »
Il remonta à cheval avec la belle princesse derrière lui, et la route les ramena au village où ses deux frères étaient restés.
Il y avait là un grand brouhaha, et quand il demanda ce qu’il se passait, on lui répondit que deux hommes allaient être pendus.
Quand il s’approcha, il vit que c’étaient ses deux frères, qui avaient dilapidé leurs biens et commis toutes sortes de crimes.
Il demanda s’il y avait un moyen de les libérer.
« Oui, si vous voulez les racheter, répondirent les villageois. Mais pourquoi gaspilleriez-vous votre argent en payant pour de si vils personnages ? »
Il ne s’arrêta pas pour réfléchir, et paya la rançon, et quand ils furent libérés, ils partirent tous ensemble.
Ils arrivèrent au bois où ils avaient rencontré le Renard pour la première fois. Il faisait délicieusement frais sous les arbres, tandis que le soleil frappait dur dans la plaine. Alors les deux frères dirent :
« Asseyons-nous ici près de ce puits un moment pour nous reposer un peu, manger et boire. »
Le Prince accepta et alors qu’il conversait avec ses compagnons, il oublia les conseils du renard, et s’assit sur le rebord du puits.
Alors ses deux frères le poussèrent et il tomba au fond. Ses cruels frères rentrèrent chez leur père, emmenant avec eux la jeune fille, le cheval et l’oiseau.
« Père ! Dirent-ils une fois au château, nous vous apportons non seulement l’oiseau d’or, mais aussi le cheval d’or, et la jeune fille du palais d’or ! »
Leur père se réjouit grandement de tous ces trésors ; mais il se rendit rapidement compte que le Cheval ne voulait pas manger, l’oiseau ne chantait pas, et la jeune fille restait assise à pleurer toute la journée.
Le plus jeune frère n’avait pas péri, car heureusement le puits était sec, et il tomba sur de la mousse molle sans se faire mal ; Cependant, il ne pouvait pas sortir.
Par chance, le fidèle Renard ne l’avait pas abandonné, et il vint lui porter secours en le grondant de n’avoir, une fois encore, pas suivi son conseil.
« Je ne peux pourtant pas vous abandonner à votre sinistre sort ; Je vais vous aider à revenir à la lumière du jour. »
Il lui dit alors de saisir fermement sa queue, puis il le hissa vers le haut.
« Vous n’êtes pas encore hors de danger, dit-il. N’étant pas sûrs de votre mort, vos frères ont placé des guetteurs partout dans le bois pour vous tuer dès qu’ils vous voient. »
Un pauvre vieillard était assis au bord de la route, et le prince échangea ses vêtements avec lui, et par ce moyen il réussit à revenir à la cour du roi sans être reconnu.
Personne au château ne le reconnut non plus, sauf que l’oiseau se mit à chanter, le cheval commença à manger et la belle jeune fille s’arrêta de pleurer.
Étonné, le roi demanda :
« Qu’est-ce que tout cela veut donc dire ? »
La Jeune fille lui répondit :
« Je ne sais pas; mais j’étais très triste, et maintenant je suis gaie. Il me semble que le jeune prince, mon véritable fiancé, doit être revenu. »
Et elle raconta au roi tout ce qui s’était passé, bien que les deux frères l’eussent menacée de mort si elle les dénonçait.
Le roi ordonna alors à ses gardes de lui amener chaque personne présente dans le palais. Parmi eux il y avait le prince déguisé en vieil homme avec ses haillons. La jeune fille le reconnut immédiatement et se jeta à son cou.
Les méchants frères furent saisis et mis à mort.
Le prince épousa la belle jeune fille et fut proclamé héritier du royaume.
Mais qu’était devenu le pauvre Renard ?
Longtemps après, le prince sortit un jour dans les champs, et rencontra le Renard, qui lui dit :
«Tu as eu tout ce que tu pouvais désirer, mais mon malheur est resté inchangé. Il est toujours en ton pouvoir de me libérer. »
Et de nouveau il supplia le prince de lui donner la mort, et de lui couper la tête et les pattes.
Enfin le prince consentit à faire ce qu’il demandait, et aussitôt tué, le Renard fut changé en homme bien vivant ; Et cet homme n’était nul autre que le frère de sa belle épouse, enfin libéré d’un maléfice qui pesait depuis si longtemps sur lui.
Rien ne manquait plus maintenant à leur bonheur et ils vécurent heureux de tres nombreuses années.
Traduction par contesdedees.com (Roland Beaussant) depuis la traduction anglaise de Mrs Edgar Lucas
Illustration de Arthur Rackham et autre inconnu
Les musiciens de Brême

Il était une fois un âne qui travaillait pour un meunier depuis très longtemps. Il avait toujours porté les sacs au moulin sans protester. Mais depuis quelque temps ses forces faiblissaient et son maître commençait à se demander de quelle manière il allait s’en débarrasser.
Flairant sa fin, l’âne décida de s’enfuir et prit la route de Brême avec la ferme intention de devenir musicien dans cette ville.
Peu après, il rencontra un chien, qui haletait sur le bord de la route comme s’il avait couru de toutes ses jambes.
« Eh bien, pourquoi es-tu si essoufflé, Chien ? dit l’âne.
« Bonjour l’Âne ! », dit le chien, « C’est parce que je suis trop vieux, chaque jour je m’affaiblis, et comme je n’arrive plus à suivre la meute, mon maître voulait me tuer, alors j’ai pris la fuite. Mais maintenant, comment vais-je gagner mon pain? »
« Ami! dit l’Âne. Je vais à Brême, pour y devenir musicien de la ville ; viens donc te joindre à moi. Je jouerai du luth, et toi tu battras la timbale.
Le chien accepta et ils continuèrent leur chemin ensemble.
Peu de temps après, ils rencontrèrent un chat, assis sur le bord de la route, avec l’air bien triste.
« Eh bien, ami chat, qu’est-ce qui vous arrive ? » demanda l’âne.
« Qui peut se réjouir de vieillir et ne plus servir à rien» répondit le chat. « Mes dents sont émoussées et je préfère m’asseoir près du poêle à ronronner plutôt que de chasser les souris. À cause de cela, ma maîtresse voulait me noyer. Je me suis enfuie, mais que vais-je devenir maintenant ? »
« Viens avec nous à Brême, dit l’âne. Si tu sais jouer la sérénade, tu feras un bon musicien à la ville.
Le chat accepta et se joignit à la troupe.
Ensuite les fugitifs passèrent devant une ferme où un coq s’époumonait en chantant à tue-tête.
« Bien le bonjour le coq! Dit l’âne, tu chantes si fort que j’en ai presque les tympans percés ! »
« Bonjour. C’est que la fermière a demandé à la cuisinière de me mettre dans la soupe de ce soir, alors je chante tant que je peux encore ».
« Ta belle voix peut encore servir, dit l’âne ; viens plutôt avec nous. Nous allons à Brême y faire de la musique. Une nouvelle carrière d’artiste nous y attend. »
Le Coq se laissa convaincre, et tous les quatre musiciens partirent ensemble vers la ville de Brême. Ils ne pouvaient cependant pas atteindre la ville en un jour, et le soir ils arrivèrent à un bois, où ils se décidèrent à passer la nuit.
L’âne et le chien se couchèrent sous un grand arbre ; le chat s’installa sur une branche, et le Coq vola jusqu’au fet de l’arbre.
Il allait s’endormir, lorsqu’il vit une lumière scintillant au loin. Il cria à ses camarades qu’il devait y avoir une maison non loin de là.
« Très bien, dit l’ ne, partons et allons voir cela, car ce sera sûrement plus accueillant que ce bois lugubre. Et peut être trouverons-nous quelque pitence pour dîner.
Mais quand il se rapprochèrent de la lumière, ils virent qu’elle émanait d’un repère de voleurs.
L’âne, plus haut que les autres, regarda discrètement par la fenêtre.
« Que vois-tu, compagnon ? demanda le Coq.
« Je vois une table bien garnie, répondit l’ ne, avec de la nourriture et des boissons délicieuses, et des voleurs assis devant »
« Cela nous conviendrait parfaitement », dit le Coq.
Alors les animaux tinrent conseil et élaborèrent un plan pour chasser les brigands.
L’âne mit ses pieds de devant sur le rebord de la fenêtre, le chien monta sur son dos, le chat grimpa sur le chien, et enfin le Coq s’envola pour se percher sur la tête du chat.
Quand ils furent prêts, il entonnèrent leur cantique: l’âne brâmant, le chien aboyant, le chat miaulant, et le Coq criant ;
Puis ils cassèrent et traversèrent la fenêtre, dans un vacarme épouvantable.
À ce bruit, les voleurs crurent que le diable lui-même était entré et ils s’enfuirent jusqu’à la forêt voisine.
Alors les musiciens se mirent à table et mangèrent comme s’ils n’avaient rien avalé depuis des semaines.
Puis ils se couchèrent chacun à sa convenance pour dormir :
L’âne se coucha sur le tas de paille, le chien derrière la porte, le chat près des cendres chaudes, et le coq s’envola jusqu’à la charpente. Comme ils étaient fatigués de la longue route, ils furent bientôt tous endormis.
Quand minuit eut passé, les voleurs qui observaient au loin, voyant que tout semblait calme, se dirent qu’ils pouvaient revenir.
Le chef envoya un émissaire qui entra et alluma une allumette près du chat. Celui-ci surpris, lui sauta au visage en griffant et en crachant.
Ne comprenant pas ce qui lui arrivait, le voleur fut terriblement effrayé et voulu s’enfuir.
Mais en essayant de sortir par la porte de derrière, il réveilla le Chien, qui lui sauta dessus et le mordit à la jambe.
Alors qu’il traversa le tas de paille devant la maison, mais l’ ne lui donna un bon coup de pied sonore avec ses pattes arrière, tandis que le Coq, fraîchement réveillé et revigoré, criait depuis son perchoir :
« Cocorico! Cocorico! »
Là-dessus, le voleur courut retrouver sa bande et leur dit:
« Il y a une horrible sorcière dans la maison, qui a craché sur moi et m’a griffé avec ses ongles. Derrière la porte se tient un homme avec un couteau, qui m’a poignardé ; tandis que dans la cour se trouve un monstre noir, qui m’a frappé avec son gourdin ; et sur le toit, un juge est assis, qui crie, « Coupez-lui le cou! »
Désormais les voleurs ne s’approchèrent plus de la maison, et les musiciens de Brême y élurent domicile tant ils s’y sentaient bien.
Illustrations d’Arthur Rackham
L’histoire de Blondine
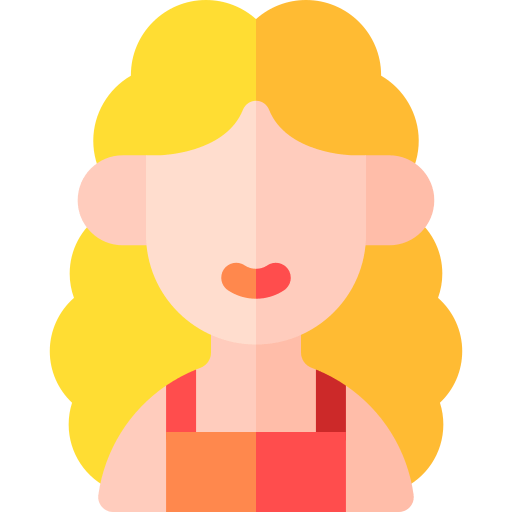
Il y avait un roi qui s’appelait Bénin ; tout le monde l’aimait, parce qu’il était bon ; les méchants le craignaient, parce qu’il était juste. Sa femme, la reine Doucette, était aussi bonne que lui. Ils avaient une petite princesse qui s’appelait Blondine à cause de ses magnifiques cheveux blonds, et qui était bonne et charmante comme son papa le roi et comme sa maman la reine. Malheureusement la reine mourut peu de mois après la naissance de Blondine, et le roi pleura beaucoup et longtemps. Blondine était trop petite pour comprendre que sa maman était morte : elle ne pleura donc pas et continua à rire, à jouer, à téter et à dormir paisiblement. Le roi aimait tendrement Blondine, et Blondine aimait le roi plus que personne au monde. Le roi lui donnait les plus beaux joujoux, les meilleurs bonbons, les plus délicieux fruits. Blondine était très heureuse.
Un jour, on dit au roi Bénin que tous ses sujets lui demandaient de se remarier pour avoir un fils qui pût être roi après lui. Le roi refusa d’abord ; enfin il céda aux instances et aux désirs de ses sujets, et il dit à son ministre Léger :
« Mon cher ami, on veut que je me remarie ; je suis encore si triste de la mort de ma pauvre femme Doucette, que je ne veux pas m’occuper moi-même d’en chercher une autre. Chargez-vous de me trouver une princesse qui rende heureuse ma pauvre Blondine : je ne demande pas autre chose. Allez, mon cher Léger ; quand vous aurez trouvé une femme parfaite, vous la demanderez en mariage et vous l’amènerez. »
Léger partit sur-le-champ, alla chez tous les rois, et vit beaucoup de princesses, laides, bossues, méchantes ; enfin il arriva chez le roi Turbulent, qui avait une fille jolie, spirituelle, aimable et qui paraissait bonne. Léger la trouva si charmante qu’il la demanda en mariage pour son roi Bénin, sans s’informer si elle était réellement bonne. Turbulent, enchanté de se débarrasser de sa fille, qui avait un caractère méchant, jaloux et orgueilleux, et qui d’ailleurs le gênait pour ses voyages, ses chasses, ses courses continuelles, la donna tout de suite à Léger, pour qu’il l’emmenât avec lui dans le royaume du roi Bénin.
Léger partit, emmenant la princesse Fourbette et quatre mille mulets chargés des effets et des bijoux de la princesse.
Ils arrivèrent chez le roi Bénin, qui avait été prévenu de leur arrivée par un courrier ; le roi vint au-devant de la princesse Fourbette. Il la trouva jolie ; mais qu’elle était loin d’avoir l’air doux et bon de la pauvre Doucette ! Quand Fourbette vit Blondine, elle la regarda avec des yeux si méchants, que la pauvre Blondine, qui avait déjà trois ans, eut peur et se mit à pleurer.
« Qu’a-t-elle ? demanda le roi. Pourquoi ma douce et sage Blondine pleure-t-elle comme un enfant méchant ?
— Papa, cher papa, s’écria Blondine en se cachant dans les bras du roi, ne me donnez pas à cette princesse ; j’ai peur ; elle a l’air si méchant ! »
Le roi, surpris, regarda la princesse Fourbette, qui ne put assez promptement changer son visage pour que le roi n’y aperçût pas ce regard terrible qui effrayait tant Blondine. Il résolut immédiatement de veiller à ce que Blondine vécût séparée de la nouvelle reine, et restât comme avant sous la garde exclusive de la nourrice et de la bonne qui l’avaient élevée et qui l’aimaient tendrement. La reine voyait donc rarement Blondine, et quand elle la rencontrait par hasard, elle ne pouvait dissimuler entièrement la haine qu’elle lui portait.
Au bout d’un an, elle eut une fille, qu’on nomma Brunette, à cause de ses cheveux, noirs comme du charbon. Brunette était jolie, mais bien moins jolie que Blondine ; elle était, de plus, méchante comme sa maman, et elle détestait Blondine, à laquelle elle faisait toutes sortes de méchancetés : elle la mordait, la pinçait, lui tirait les cheveux, lui cassait ses joujoux, lui tachait ses belles robes. La bonne petite Blondine ne se fâchait jamais ; toujours elle cherchait à excuser Brunette.
« Oh ! papa, disait-elle au roi, ne la grondez pas ; elle est si petite, elle ne sait pas qu’elle me fait de la peine en cassant mes joujoux… C’est pour jouer qu’elle me mord… C’est pour s’amuser qu’elle me tire les cheveux », etc.
Le roi Bénin embrassait sa fille Blondine et ne disait rien, mais il voyait bien que Brunette faisait tout cela par méchanceté et que Blondine l’excusait par bonté. Aussi aimait-il Blondine de plus en plus et Brunette de moins en moins.
La reine Fourbette, qui avait de l’esprit, voyait bien tout cela aussi ; mais elle haïssait de plus en plus l’innocente Blondine ; et, si elle n’avait craint la colère du roi Bénin, elle aurait rendu Blondine la plus malheureuse enfant du monde. Le roi avait défendu que Blondine fût jamais seule avec la reine, et, comme on savait qu’il était aussi juste que bon et qu’il punissait sévèrement la désobéissance, la reine elle-même n’osait pas désobéir.
II
BLONDINE PERDUE
Blondine avait déjà sept ans et Brunette avait trois ans. Le roi avait donné à Blondine une jolie petite voiture attelée de deux autruches et menée par un petit page de dix ans, qui était un neveu de la nourrice de Blondine. Le page, qui s’appelait Gourmandinet, aimait tendrement Blondine, avec laquelle il jouait depuis sa naissance et qui avait pour lui mille bontés. Mais il avait un terrible défaut ; il était si gourmand et il aimait tant les friandises, qu’il eût été capable de commettre une mauvaise action pour un sac de bonbons. Blondine lui disait souvent :
« Je t’aime bien, Gourmandinet, mais je n’aime pas à te voir si gourmand. Je t’en prie, corrige-toi de ce vilain défaut, qui fait horreur à tout le monde. »
Gourmandinet lui baisait la main et lui promettait de se corriger ; mais il continuait à voler des gâteaux à la cuisine, des bonbons à l’office, et souvent il était fouetté pour sa désobéissance et sa gourmandise.
La reine Fourbette apprit bientôt les reproches qu’on faisait à Gourmandinet, et elle pensa qu’elle pourrait utiliser le vilain défaut du petit page et le faire servir à la perte de Blondine. Voici le projet qu’elle conçut :
Le jardin où Blondine se promenait dans sa petite voiture traînée par des autruches, avec Gourmandinet pour cocher, était séparé par un grillage d’une magnifique et immense forêt, qu’on appelait la forêt des Lilas, parce que toute l’année elle était pleine de lilas toujours en fleur. Personne n’allait dans cette forêt ; on savait qu’elle était enchantée et que, lorsqu’on y entrait une fois, on n’en pouvait plus jamais sortir. Gourmandinet connaissait la terrible propriété de cette forêt ; on lui avait sévèrement défendu de jamais diriger la voiture de Blondine de ce côté, de crainte que par inadvertance Blondine ne franchît la grille et n’entrât dans la forêt des Lilas.
Bien des fois le roi avait voulu faire élever un mur le long de la grille, ou du moins serrer le grillage de manière qu’il ne fût plus possible d’y passer ; mais à mesure que les ouvriers posaient les pierres ou les grillages, une force inconnue les enlevait et les faisait disparaître.
La reine Fourbette commença par gagner l’amitié de Gourmandinet en lui donnant chaque jour des friandises nouvelles ; quand elle l’eut rendu tellement gourmand qu’il ne pouvait plus se passer des bonbons, des gelées, des gâteaux qu’elle lui donnait à profusion, elle le fit venir et lui dit :
« Gourmandinet, il dépend de toi d’avoir un coffre plein de bonbons et de friandises, ou bien de ne plus jamais en manger.
— Ne jamais en manger ! Oh ! Madame, je mourrais de chagrin. Parlez, Madame ; que dois-je faire pour éviter ce malheur ?
— Il faut, reprit la reine en le regardant fixement, que tu mènes la princesse Blondine près de la forêt des Lilas.
— Je ne le puis, Madame, le roi me l’a défendu.
— Ah ! tu ne le peux ? Alors, adieu ; je ne te donnerai plus aucune friandise, et je défendrai que personne dans la maison ne t’en donne jamais.
— Oh ! Madame, dit Gourmandinet en pleurant, ne soyez pas si cruelle ! Donnez-moi un autre ordre que je puisse exécuter.
— Je te répète que je veux que tu mènes Blondine près de la forêt des Lilas, et que tu l’encourages à descendre de voiture, à franchir la grille et à entrer dans la forêt.
— Mais, Madame, reprit Gourmandinet en devenant tout pâle, si la princesse entre dans cette forêt, elle n’en sortira jamais ; vous savez que c’est une forêt enchantée ; y envoyer ma princesse, c’est l’envoyer à une mort certaine.
— Une troisième et dernière fois, veux-tu y mener Blondine ? Choisis : ou bien un coffre immense de bonbons que je renouvellerai tous les mois, ou jamais de sucreries ni de pâtisseries.
— Mais comment ferai-je pour échapper à la punition terrible que m’infligera le roi ?
— Ne t’inquiète pas de cela ; aussitôt que tu auras fait entrer Blondine dans la forêt des Lilas, viens me trouver : je te ferai partir avec tes bonbons, et je me charge de ton avenir.
— Oh ! Madame, par pitié, ne m’obligez pas à faire périr ma chère maîtresse, qui a toujours été si bonne pour moi !
— Tu hésites, petit misérable ! Et que t’importe ce que deviendra Blondine ? Plus tard, je te ferai entrer au service de Brunette, et je veillerai à ce que tu ne manques jamais de bonbons. »
Gourmandinet réfléchit encore quelques instants, et se résolut, hélas ! à sacrifier sa bonne petite maîtresse pour quelques livres de bonbons. Tout le reste du jour et toute la nuit il hésita encore à commettre ce grand crime ; mais la certitude de ne pouvoir plus satisfaire sa gourmandise, s’il se refusait à exécuter l’ordre de la reine, l’espoir de retrouver un jour Blondine en s’adressant à quelque fée puissante, firent cesser ces irrésolutions et le décidèrent à obéir à la reine.
Le lendemain, à quatre heures, Blondine commanda sa petite voiture, monta dedans après avoir embrassé le roi et lui avoir promis de revenir dans deux heures. Le jardin était grand. Gourmandinet fit aller les autruches du côté opposé à la forêt des Lilas.
Quand ils furent si loin qu’on ne pouvait plus les voir du palais, il changea de direction et s’achemina vers la grille de la forêt des Lilas. Il était triste et silencieux ; son crime pesait sur son cœur et sur sa conscience.
« Qu’as-tu donc, Gourmandinet ? demanda Blondine ; tu ne parles pas ; serais-tu malade ?
— Non, princesse, je me porte bien.
— Comme tu es pâle ! Dis-moi ce que tu as, mon pauvre Gourmandinet. Je te promets de faire mon possible pour te contenter. »
Cette bonté de Blondine fut sur le point de la sauver en amollissant le cœur de Gourmandinet ; mais le souvenir des bonbons promis par Fourbette détruisit ce bon mouvement.
Avant qu’il eût pu répondre, les autruches touchèrent à la grille de la forêt des Lilas.
« Oh ! Les beaux lilas ! S’écria Blondine ; quelle douce odeur ! Que je voudrais avoir un gros bouquet de ces lilas pour les offrir à papa ! Descends, Gourmandinet et va m’en chercher quelques branches.
— Je ne puis descendre, princesse ; les autruches pourraient s’en aller pendant que je serais absent.
— Eh ! Qu’importe ? dit Blondine : je les ramènerai bien seule au palais.
— Mais le roi me gronderait de vous avoir abandonnée, princesse. Il vaut mieux que vous alliez vous-même cueillir et choisir vos fleurs.
— C’est vrai, dit Blondine ; je serais bien fâchée de te faire gronder, mon pauvre Gourmandinet. »
Et, en disant ces mots, elle sauta lestement de la voiture, franchit les barreaux de la grille et se mit à cueillir les lilas.
À ce moment, Gourmandinet frémit, se troubla : le remords entra dans son cœur ; il voulut tout réparer en rappelant Blondine : mais, quoique Blondine ne fût qu’à dix pas de lui ; quoiqu’il la vît parfaitement, elle n’entendait pas sa voix et s’enfonçait petit à petit dans la forêt enchantée. Longtemps il la vit cueillir des lilas, et enfin elle disparut à ses yeux.
Longtemps encore il pleura son crime, maudit sa gourmandise, détesta la reine Fourbette. Enfin il pensa que l’heure où Blondine devait être de retour au palais approchait ; il rentra aux écuries par les derrières, et courut chez la reine, qui l’attendait. En le voyant pâle et les yeux rouges des larmes terribles du remords, elle devina que Blondine était perdue.
« Est-ce fait ? » dit-elle.
Gourmandinet fit signe de la tête que oui ; il n’avait pas la force de parler.
« Viens, dit-elle, voilà ta récompense. »
Et elle lui montra un coffre plein de bonbons de toutes sortes. Elle fit enlever ce coffre par un valet, et le fit attacher sur un des mulets qui avaient amené ses bijoux.
« Je confie ce coffre à Gourmandinet, pour qu’il le porte à mon père. Partez, Gourmandinet, et revenez en chercher un autre dans un mois. »
Elle lui remit en même temps une bourse pleine d’or dans la main. Gourmandinet monta sur le mulet sans mot dire. Il partit au galop ; bientôt le mulet, qui était méchant et entêté, impatienté du poids de la caisse, se mit à ruer, à se cambrer, et fit si bien qu’il jeta par terre Gourmandinet et le coffre. Gourmandinet, qui ne savait pas se tenir sur un cheval ni sur un mulet, tomba la tête sur des pierres et mourut sur le coup. Ainsi il ne retira même pas de son crime le profit qu’il en avait espéré, puisqu’il n’avait pas encore goûté les bonbons que lui avait donnés la reine.
Personne ne le regretta, car personne ne l’avait aimé, excepté la pauvre Blondine, que nous allons rejoindre dans la forêt des Lilas.
III
LA FORÊT DES LILAS
Quand Blondine fut entrée dans la forêt, elle se mit à cueillir de belles branches de lilas, se réjouissant d’en avoir autant et qui sentaient si bon. À mesure qu’elle en cueillait, elle en voyait de plus beaux ; alors elle vidait son tablier et son chapeau qui en étaient pleins, et elle les remplissait encore.
Il y avait plus d’une heure que Blondine était ainsi occupée ; elle avait chaud ; elle commençait à se sentir fatiguée ; les lilas étaient lourds à porter, et elle pensa qu’il était temps de retourner au palais. Elle se retourna et se vit entourée de lilas ; elle appela Gourmandinet : personne ne lui répondit. « Il paraît que j’ai été plus loin que je ne croyais, dit Blondine : je vais retourner sur mes pas, quoique je sois un peu fatiguée, et Gourmandinet m’entendra et viendra au-devant de moi. »
Elle marcha pendant quelque temps, mais elle n’apercevait pas la fin de la forêt. Bien des fois elle appela Gourmandinet, personne ne lui répondait. Enfin elle commença à s’effrayer.
« Que vais-je devenir dans cette forêt toute seule ? Que va penser mon pauvre papa de ne pas me voir revenir ? Et le pauvre Gourmandinet, comment osera-t-il rentrer au palais sans moi ? Il va être grondé, battu peut-être, et tout cela par ma faute, parce que j’ai voulu descendre et cueillir ces lilas ! Malheureuse que je suis ! je vais mourir de faim et de soif dans cette forêt, si encore les loups ne me mangent pas cette nuit. »
Et Blondine tomba par terre au pied d’un gros arbre et se mit à pleurer amèrement. Elle pleura longtemps ; enfin la fatigue l’emporta sur le chagrin ; elle posa sa tête sur sa botte de lilas et s’endormit.
IV
PREMIER RÉVEIL DE BLONDINE — BEAU-MINON
Blondine dormit toute la nuit ; aucune bête féroce ne vint troubler son sommeil ; le froid ne se fit pas sentir ; elle se réveilla le lendemain assez tard ; elle se frotta les yeux, très surprise de se voir entourée d’arbres, au lieu de se trouver dans sa chambre et dans son lit. Elle appela sa bonne ; un miaulement doux lui répondit ; étonnée et presque effrayée, elle regarda à terre et vit à ses pieds un magnifique chat blanc qui la regardait avec douceur et qui miaulait.
« Ah ! Beau-Minon, que tu es joli ! s’écria Blondine en passant la main sur ses beaux poils, blancs comme la neige. Je suis bien contente de te voir, Beau-Minon, car tu me mèneras à ta maison. Mais j’ai bien faim, et je n’aurais pas la force de marcher avant d’avoir mangé. »
À peine eut-elle achevé ces paroles, que Beau-Minon miaula encore et lui montra avec sa petite patte un paquet posé près d’elle et qui était enveloppé dans un linge fin et blanc. Elle ouvrit le paquet et y trouva des tartines de beurre ; elle mordit dans une des tartines, la trouva délicieuse, et en donna quelques morceaux à Beau-Minon, qui eut l’air de les croquer avec délices.
Quand elle et Beau-Minon eurent bien mangé, Blondine se pencha vers lui, le caressa et lui dit :
« Merci, mon Beau-Minon, du déjeuner que tu m’as apporté. Maintenant, peux-tu me ramener à mon père qui doit se désoler de mon absence ? »
Beau-Minon secoua la tête en faisant un miaulement plaintif.
« Ah ! tu me comprends, Beau-Minon, dit Blondine. Alors, aie pitié de moi et mène-moi dans une maison quelconque, pour que je ne périsse pas de faim, de froid et de terreur dans cette affreuse forêt. »
Beau-Minon la regarda, fit avec sa tête blanche un petit signe qui voulait dire qu’il comprenait, se leva, fit plusieurs pas et se retourna pour voir si Blondine le suivait.
« Me voici, Beau-Minon, dit Blondine, je te suis. Mais comment pourrons-nous passer dans ces buissons si touffus ? je ne vois pas de chemin. »
Beau-Minon, pour toute réponse, s’élança dans les buissons, qui s’ouvrirent d’eux-mêmes pour laisser passer Beau-Minon et Blondine, et qui se refermaient quand ils étaient passés. Blondine marcha ainsi pendant une heure ; à mesure qu’elle avançait, la forêt devenait plus claire, l’herbe était plus fine, les fleurs croissaient en abondance ; on voyait de jolis oiseaux qui chantaient, des écureuils qui grimpaient le long des branches. Blondine, qui ne doutait pas qu’elle allait sortir de la forêt et qu’elle reverrait son père, était enchantée de tout ce qu’elle voyait ; elle se serait volontiers arrêtée pour cueillir des fleurs : mais Beau-Minon trottait toujours en avant, et miaulait tristement quand Blondine faisait mine de s’arrêter.
Au bout d’une heure, Blondine aperçut un magnifique château. Beau-Minon la conduisit jusqu’à la grille dorée. Blondine ne savait pas comment faire pour y entrer ; il n’y avait pas de sonnette, et la grille était fermée. Beau-Minon avait disparu ; Blondine était seule.
V
BONNE-BICHE
Beau-Minon était entré par un petit passage qui semblait fait exprès pour lui, et il avait probablement averti quelqu’un du château, car la grille s’ouvrit sans que Blondine eût appelé. Elle entra dans la cour et ne vit personne ; la porte du château s’ouvrit d’elle-même. Blondine pénétra dans un vestibule tout en marbre blanc et rare ; toutes les portes s’ouvrirent seules comme la première, et Blondine parcourut une suite de beaux salons. Enfin elle aperçut, au fond d’un joli salon bleu et or, une biche blanche couchée sur un lit d’herbes fines et odorantes. Beau-Minon était près d’elle. La biche vit Blondine, se leva, alla à elle et lui dit :
« Soyez la bienvenue, Blondine ; il y a longtemps que moi et mon fils Beau-Minon nous vous attendons. »
Et comme Blondine paraissait effrayée :
« Rassurez-vous, Blondine, vous êtes avec des amis ; je connais le roi votre père, et je l’aime ainsi que vous. »
— Oh ! Madame, dit Blondine, si vous connaissez le roi mon père, ramenez-moi chez lui ; il doit être bien triste de mon absence.
— Ma chère Blondine, reprit Bonne-Biche en soupirant, il n’est pas en mon pouvoir de vous rendre à votre père ; vous êtes sous la puissance de l’enchanteur de la forêt des Lilas. Moi-même je suis soumise à son pouvoir, supérieur au mien ; mais je puis envoyer à votre père des songes qui le rassureront sur votre sort et qui lui apprendront que vous êtes chez moi.
— Comment ! Madame, s’écria Blondine avec effroi, ne reverrai-je jamais mon père, mon pauvre père que j’aime tant ?
— Chère Blondine, ne nous occupons pas de l’avenir ; la sagesse est toujours récompensée. Vous reverrez votre père, mais pas encore. En attendant, soyez docile et bonne. Beau-Minon et moi nous ferons tout notre possible pour que vous soyez heureuse. »
Blondine soupira et répandit quelques larmes. Puis elle pensa que c’était mal reconnaître la bonté de Bonne-Biche que de s’affliger d’être avec elle ; elle se contint donc et s’efforça de causer gaiement.
Bonne-Biche et Beau-Minon la menèrent voir l’appartement qui lui était destiné. La chambre de Blondine était toute tapissée de soie rose brodée en or : les meubles étaient en velours blanc, brodés admirablement avec les soies les plus brillantes. Tous les animaux, les oiseaux, les papillons, les insectes y étaient représentés. Près de la chambre de Blondine était son cabinet de travail. Il était tendu en damas bleu de ciel brodé en perles fines. Les meubles étaient en moire d’argent rattachée avec de gros clous en turquoise. Sur le mur étaient accrochés deux magnifiques portraits représentant une jeune et superbe femme et un charmant jeune homme ; leurs costumes indiquaient qu’ils étaient de race royale.
« De qui sont ces portraits, Madame ? demanda Blondine à Bonne-Biche.
— Il m’est défendu de répondre à cette question, chère Blondine. Plus tard vous le saurez. Mais voici l’heure du dîner ; venez, Blondine, vous devez avoir appétit. »
Blondine, en effet, mourait de faim ; elle suivit Bonne-Biche et entra dans une salle à manger où était une table servie bizarrement. Il y avait un énorme coussin en satin blanc, placé par terre pour Bonne-Biche ; devant elle, sur la table, était une botte d’herbes choisies, fraîches et succulentes. Près des herbes était une auge en or, pleine d’une eau fraîche et limpide. En face de Bonne-Biche était un petit tabouret élevé, pour Beau-Minon ; devant lui était une écuelle en or, pleine de petits poissons frits et de bécassines ; à côté, une jatte en cristal de roche, pleine de lait tout frais.
Entre Bonne-Biche et Beau-Minon était le couvert de Blondine ; elle avait un petit fauteuil en ivoire sculpté, garni de velours nacarat rattaché avec des clous en diamant. Devant elle était une assiette en or ciselé, pleine d’un potage délicieux de gelinottes et de becfigues. Son verre et son carafon étaient taillés dans un cristal de roche ; un petit pain mollet était placé à côté d’une cuiller qui était en or ainsi que la fourchette. La serviette était en batiste si fine, qu’on n’en avait jamais vu de pareille. Le service de table se faisait par des gazelles qui étaient d’une adresse merveilleuse ; elles servaient, découpaient et devinaient tous les désirs de Blondine, de Bonne-Biche et de Beau-Minon.
Le dîner fut exquis : les volailles les plus fines, le gibier le plus rare, les poissons les plus délicats, les pâtisseries, les sucreries les plus parfumées. Blondine avait faim ; elle mangea de tout et trouva tout excellent.
Après le dîner, Bonne-Biche et Beau-Minon menèrent Blondine dans le jardin ; elle y trouva les fruits les plus succulents et des promenades charmantes. Après avoir bien couru, s’être bien promenée, Blondine rentra avec ses nouveaux amis : elle était fatiguée. Bonne-Biche lui proposa d’aller se coucher, ce que Blondine accepta avec joie.
Elle entra dans sa chambre à coucher, où elle trouva deux gazelles qui devaient la servir : elles la déshabillèrent avec une habileté merveilleuse, la couchèrent et s’établirent près du lit pour la veiller.
Blondine ne tarda pas à s’endormir, non sans avoir pensé à son père et sans avoir amèrement pleuré sur sa séparation d’avec lui.
VI
SECOND RÉVEIL DE BLONDINE
Blondine dormit profondément, et, quand elle se réveilla, il lui sembla qu’elle n’était plus la même que lorsqu’elle s’était couchée ; elle se voyait plus grande ; ses idées lui semblèrent aussi avoir pris du développement ; elle se sentait instruite ; elle se souvenait d’une foule de livres qu’elle croyait avoir lus pendant son sommeil ; elle se souvenait d’avoir écrit, dessiné, chanté, joué du piano et de la harpe.
Pourtant sa chambre était bien celle que lui avait montrée Bonne-Biche et dans laquelle elle s’était couchée la veille.
Agitée, inquiète, elle se leva, courut à une glace, vit qu’elle était grande, et, nous devons l’avouer, se trouva charmante, plus jolie cent fois que lorsqu’elle s’était couchée. Ses beaux cheveux blonds tombaient jusqu’à ses pieds ; son teint blanc et rose, ses jolis yeux bleus, son petit nez arrondi, sa petite bouche vermeille, ses joues rosées, sa taille fine et gracieuse, faisaient d’elle la plus jolie personne qu’elle eût jamais vue.
Émue, presque effrayée, elle s’habilla à la hâte et courut chez Bonne-Biche, qu’elle trouva dans l’appartement où elle l’avait vue la première fois.
« Bonne-Biche ! Bonne-Biche ! s’écria-t-elle, expliquez-moi de grâce la métamorphose que je vois et que je sens en moi. Je me suis couchée hier au soir enfant, je me réveille ce matin grande personne ; est-ce une illusion ? ou bien ai-je véritablement grandi ainsi dans une nuit ?
— Il est vrai, ma chère Blondine, que vous avez aujourd’hui quatorze ans ; mais votre sommeil dure depuis sept ans. Mon fils Beau-Minon et moi, nous avons voulu vous épargner les ennuis des premières études ; quand vous êtes venue chez moi, vous ne saviez rien, pas même lire. Je vous ai endormie pour sept ans, et nous avons passé ces sept années, vous à apprendre en dormant, Beau-Minon et moi à vous instruire. Je vois dans vos yeux que vous doutez de votre savoir ; venez avec moi dans votre salle d’étude, et assurez-vous par vous-même de tout ce que vous savez. »
Blondine suivit Bonne-Biche dans la salle d’étude ; elle courut au piano, se mit à en jouer, et vit qu’elle jouait très bien ; elle alla essayer sa harpe et en tira des sons ravissants ; elle chanta merveilleusement ; elle prit des crayons, des pinceaux, et dessina et peignit avec une facilité qui dénotait un vrai talent ; elle essaya d’écrire et se trouva aussi habile que pour le reste ; elle parcourut des yeux ses livres et se souvint de les avoir presque tous lus : surprise, ravie, elle se jeta au cou de Bonne-Biche, embrassa tendrement Beau-Minon, et leur dit :
« Oh ! mes bons, mes chers, mes vrais amis, que de reconnaissance ne vous dois-je pas pour avoir ainsi soigné mon enfance, développé mon esprit et mon cœur ! car je le sens, tout est amélioré en moi, et c’est à vous que je le dois. »
Bonne-Biche lui rendit ses caresses. Beau-Minon lui léchait délicatement les mains. Quand les premiers moments de bonheur furent passés, Blondine baissa les yeux et dit timidement :
« Ne me croyez pas ingrate, mes bons et excellents amis, si je demande d’ajouter un nouveau bienfait à ceux que j’ai reçus de vous. Dites-moi, que fait mon père ? Pleure-t-il encore mon absence ? Est-il heureux depuis qu’il m’a perdue ?
— Votre désir est trop légitime pour ne pas être satisfait. Regardez dans cette glace, Blondine, et vous y verrez tout ce qui s’est passé depuis votre départ, et comment est votre père actuellement. »
Blondine leva les yeux et vit dans la glace l’appartement de son père ; le roi s’y promenait d’un air agité. Il paraissait attendre quelqu’un. La reine Fourbette entra et lui raconta que Blondine, malgré les instances de Gourmandinet, avait voulu diriger elle-même les autruches qui s’étaient emportées, avaient couru vers la forêt des Lilas et versé la voiture ; que Blondine avait été lancée dans la forêt des Lilas à travers la grille ; que Gourmandinet avait perdu la tête d’effroi et de chagrin ; qu’elle l’avait renvoyé chez ses parents. Le roi parut au désespoir de cette nouvelle ; il courut dans la forêt des Lilas, et il fallut qu’on employât la force pour l’empêcher de s’y précipiter à la recherche de sa chère Blondine. On le ramena chez lui, où il se livra au plus affreux désespoir, appelant sans cesse sa Blondine, sa chère enfant. Enfin il s’endormit et vit en songe Blondine dans le palais de Bonne-Biche et de Beau-Minon. Bonne-Biche lui donna l’assurance que Blondine lui serait rendue un jour et que son enfance serait calme et heureuse.
La glace se ternit ensuite ; tout disparut. Puis elle redevint claire, et Blondine vit de nouveau son père, il était vieilli, ses cheveux avaient blanchi, il était triste ; il tenait à la main un petit portrait de Blondine et le baisait souvent en répandant quelques larmes. Il était seul ; Blondine ne vit ni la reine ni Brunette.
La pauvre Blondine pleura amèrement.
« Pourquoi, dit-elle, mon père n’a-t-il personne près de lui ? Où sont donc ma sœur Brunette et la reine ?
— La reine témoigna si peu de chagrin de votre mort (car on vous croit morte, chère Blondine), que le roi la prit en horreur et la renvoya au roi Turbulent son père, qui la fit enfermer dans une tour, où elle ne tarda pas à mourir de rage et d’ennui. Quant à votre sœur Brunette, elle devint si méchante, si insupportable, que le roi se dépêcha de la donner en mariage l’année dernière au prince Violent, qui se chargea de réformer le caractère méchant et envieux de la princesse Brunette. Il la maltraite rudement ; elle commence à voir que sa méchanceté ne lui donne pas le bonheur, et elle devient un peu meilleure. Vous la reverrez un jour, et vous achèverez de la corriger par votre exemple. »
Blondine remercia tendrement Bonne-Biche de ces détails ; elle eût bien voulu lui demander : « Quand reverrai-je mon père et ma sœur ? » Mais elle eut peur d’avoir l’air pressée de la quitter et de paraître ingrate ; elle attendit donc une autre occasion pour faire cette demande.
Les journées de Blondine se passaient sans ennui parce qu’elle s’occupait beaucoup, mais elle s’attristait quelquefois ; elle ne pouvait causer qu’avec Bonne-Biche, et Bonne-Biche n’était avec elle qu’aux heures des leçons et des repas. Beau-Minon ne pouvait répondre et se faire comprendre que par des signes. Les gazelles servaient Blondine avec zèle et intelligence, mais aucune d’elles ne pouvait parler.
Blondine se promenait accompagnée toujours de Beau-Minon, qui lui indiquait les plus jolies promenades, les plus belles fleurs. Bonne-Biche avait fait promettre à Blondine que jamais elle ne franchirait l’enceinte du parc et qu’elle n’irait jamais dans la forêt. Plusieurs fois Blondine avait demandé à Bonne-Biche la cause de cette défense. Bonne-Biche avait toujours répondu en soupirant :
« Ah ! Blondine, ne demandez pas à pénétrer dans la forêt ; c’est une forêt de malheur. Puissiez-vous ne jamais y entrer ! »
Quelquefois Blondine montait dans un pavillon qui était sur une éminence au bord de la forêt ; elle voyait des arbres magnifiques, des fleurs charmantes, des milliers d’oiseaux qui chantaient et voltigeaient comme pour l’appeler. « Pourquoi, se disait-elle, Bonne-Biche ne veut-elle pas me laisser promener dans cette forêt ? Quel danger puis-je y courir sous sa protection ? »
Toutes les fois qu’elle réfléchissait ainsi, Beau-Minon, qui paraissait comprendre ce qui se passait en elle, miaulait, la tirait par sa robe et la forçait à quitter le pavillon.
Blondine souriait, suivait Beau-Minon et reprenait sa promenade dans le parc solitaire.
VII
LE PERROQUET
Il y avait près de six mois que Blondine s’était réveillée de son sommeil de sept années ; le temps lui semblait long ; le souvenir de son père lui revenait souvent et l’attristait. Bonne-Biche et Beau-Minon semblaient deviner ses pensées. Beau-Minon miaulait plaintivement, Bonne-Biche soupirait profondément. Blondine parlait rarement de ce qui occupait si souvent son esprit, parce qu’elle craignait d’offenser Bonne-Biche, qui lui avait répondu trois ou quatre fois : « Vous reverrez votre père, Blondine, quand vous aurez quinze ans, si vous continuez à être sage ; mais croyez-moi, ne vous occupez pas de l’avenir, et surtout ne cherchez pas à nous quitter. »
Un matin, Blondine était triste et seule ; elle réfléchissait à sa singulière et monotone existence. Elle fut distraite de sa rêverie par trois petits coups frappés doucement à sa fenêtre. Levant la tête, elle aperçut un Perroquet du plus beau vert, avec la gorge et la poitrine orange. Surprise de l’apparition d’un être inconnu et nouveau, elle alla ouvrir sa fenêtre et fit entrer le Perroquet. Quel ne fut pas son étonnement quand l’oiseau lui dit d’une petite voix aigrelette :
« Bonjour, Blondine ; je sais que vous vous ennuyez quelquefois, faute de trouver à qui parler, et je viens causer avec vous. Mais, de grâce, ne dites pas que vous m’avez vu, car Bonne-Biche me tordrait le cou.
— Et pourquoi cela, beau Perroquet ? Bonne-Biche ne fait de mal à personne : elle ne hait que les méchants.
— Blondine, si vous ne me promettez pas de cacher ma visite à Bonne-Biche et à Beau-Minon, je m’envole pour ne jamais revenir.
— Puisque vous le voulez, beau Perroquet, je vous le promets. Causons un peu : il y a si longtemps que je n’ai causé ! Vous me semblez gai et spirituel ; vous m’amuserez, je n’en doute pas. »
Blondine écouta les contes du Perroquet, qui lui fit force compliments sur sa beauté, sur les talents, sur son esprit. Blondine était enchantée ; au bout d’une heure, le Perroquet s’envola, promettant de revenir le lendemain. Il revint ainsi pendant plusieurs jours et continua à la complimenter et à l’amuser. Un matin il frappa à la fenêtre en disant :
« Blondine, Blondine, ouvrez-moi, je viens vous donner des nouvelles de votre père ; mais surtout pas de bruit, si vous ne voulez pas me voir tordre le cou. »
Blondine ouvrit sa croisée et dit au perroquet :
« Est-il bien vrai, mon beau Perroquet, que tu veux me donner des nouvelles de mon père ? Parle vite ; que fait-il ? comment va-t-il ?
— Votre père va bien, Blondine ; il pleure toujours votre absence ; je lui ai promis d’employer tout mon petit pouvoir à vous délivrer de votre prison ; mais je ne puis le faire que si vous m’y aidez.
— Ma prison ! dit Blondine. Mais vous ignorez donc toutes les bontés de Bonne-Biche et de Beau-Minon pour moi, les soins qu’ils ont donnés à mon éducation, leur tendresse pour moi ! Ils seront enchantés de connaître un moyen de me réunir à mon père. Venez avec moi, beau Perroquet, je vous en prie, je vous présenterai à Bonne-Biche.
— Ah ! Blondine, reprit de sa petite voix aigre le Perroquet, vous ne connaissez pas Bonne-Biche ni Beau-Minon. Ils me détestent parce que j’ai réussi quelquefois à leur arracher leurs victimes. Jamais vous ne verrez votre père, Blondine, jamais vous ne sortirez de cette forêt, si vous n’enlevez pas vous-même le talisman qui vous y retient.
— Quel talisman ? dit Blondine, je n’en connais aucun ; et quel intérêt Bonne-Biche et Beau-Minon auraient-ils à me retenir prisonnière ?
— L’intérêt de désennuyer leur solitude, Blondine. Et quant au talisman, c’est une simple Rose ; cueillie par vous, elle vous délivrera de votre exil et vous ramènera dans les bras de votre père.
— Mais il n’y a pas une seule Rose dans le jardin, comment donc pourrais-je en cueillir ?
— Je vous dirai cela un autre jour, Blondine ; aujourd’hui je ne puis vous en dire davantage, car Bonne-Biche va venir ; mais pour vous assurer des vertus de la Rose, demandez-en une à Bonne-Biche ; vous verrez ce qu’elle vous dira. À demain, Blondine, à demain. »
Et le Perroquet s’envola, bien content d’avoir jeté dans le cœur de Blondine les premiers germes d’ingratitude et de désobéissance.
À peine le Perroquet fut-il parti, que Bonne-Biche entra ; elle paraissait agitée.
« Avec qui causiez-vous donc, Blondine ? dit Bonne-Biche en jetant sur la croisée ouverte un regard méfiant.
— Avec personne, Madame, répondit Blondine.
— Je suis certaine d’avoir entendu parler.
— Je me serai sans doute parlé à moi-même. »
Bonne-Biche ne répliqua pas ; elle était triste, quelques larmes même roulaient dans ses yeux. Blondine était aussi préoccupée ; les paroles du Perroquet lui faisaient envisager sous un jour nouveau les obligations qu’elle avait à Bonne-Biche et à Beau-Minon. Au lieu de se dire qu’une biche qui parle, qui a la puissance de rendre intelligentes les bêtes, de faire dormir un enfant pendant sept ans, qu’une biche qui a consacré ces sept années à l’éducation ennuyeuse d’une petite fille ignorante, qu’une biche qui est logée et servie comme une reine n’est pas une biche ordinaire ; au lieu d’éprouver de la reconnaissance de tout ce que Bonne-Biche avait fait pour elle, Blondine crut aveuglément ce Perroquet, cet inconnu dont rien ne garantissait la véracité, et qui n’avait aucun motif de lui porter intérêt au point de risquer sa vie pour lui rendre service ; elle le crut, parce qu’il l’avait flattée. Elle ne regarda plus du même œil reconnaissant l’existence douce et heureuse que lui avaient faite Bonne-Biche et Beau-Minon : elle résolut de suivre les conseils du Perroquet.
« Pourquoi, Bonne-Biche, lui demanda-t-elle dans la journée, pourquoi ne vois-je pas parmi toutes vos fleurs la plus belle, la plus charmante de toutes, la Rose ? »
Bonne-Biche frémit, se troubla et dit :
« Blondine, Blondine, ne me demandez pas cette fleur perfide qui pique ceux qui la touchent. Ne me parlez jamais de la Rose, Blondine ; vous ne savez pas ce qui vous menace dans cette fleur. »
L’air de Bonne-Biche était si sévère, que Blondine n’osa pas insister.
La journée s’acheva assez tristement. Blondine était gênée ; Bonne-Biche était mécontente ; Beau-Minon était triste.
Le lendemain, Blondine courut à sa fenêtre ; à peine l’eut-elle ouverte que le Perroquet entra.
« Eh bien, Blondine, vous avez vu le trouble de Bonne-Biche quand vous avez parlé de la Rose ? Je vous ai promis de vous indiquer le moyen d’avoir une de ces fleurs charmantes ; le voici : vous sortirez du parc, vous irez dans la forêt, je vous accompagnerai, et je vous mènerai dans un jardin où se trouve la plus belle Rose du monde.
— Mais comment pourrai-je sortir du parc ?
Beau-Minon m’accompagne toujours dans mes promenades.
— Tâchez de le renvoyer, dit le Perroquet ; et s’il insiste, eh bien, sortez malgré lui.
— Si cette Rose est bien loin, on s’apercevra de mon absence.
— Une heure de marche au plus. Bonne-Biche a eu soin de vous placer loin de la Rose, afin que vous ne puissiez pas vous affranchir de son joug.
— Mais pourquoi me retient-elle captive ? Puissante comme elle est, ne pouvait-elle se donner d’autres plaisirs que l’éducation d’un enfant ?
— Ceci vous sera expliqué plus tard, Blondine, quand vous serez retournée près de votre père. Soyez ferme ; débarrassez-vous de Beau-Minon après déjeuner, sortez dans la forêt ; je vais vous y attendre. »
Blondine promit et ferma la fenêtre, de crainte que Bonne-Biche ne la surprît.
Après le déjeuner, Blondine descendit dans le jardin selon sa coutume. Beau-Minon la suivit, malgré quelques rebuffades qu’il reçut avec des miaulements plaintifs. Parvenue à l’allée qui menait à la sortie du parc, Blondine voulut encore renvoyer Beau-Minon.
« Je veux être seule, dit-elle ; va-t’en, Beau-Minon. »
Beau-Minon fit semblant de ne pas comprendre. Blondine, impatientée, s’oublia au point de frapper Beau-Minon du pied.
Quand le pauvre Beau-Minon eut reçu le coup de pied de Blondine, il poussa un cri lugubre et s’enfuit du côté du palais.
Blondine frémit en entendant ce cri ; elle s’arrêta, fut sur le point de rappeler Beau-Minon, de renoncer à la Rose, de tout raconter à Bonne-Biche ; mais une fausse honte l’arrêta, elle marcha vers la porte, l’ouvrit non sans trembler, et se trouva dans la forêt.
Le Perroquet ne tarda pas à la rejoindre.
« Courage, Blondine ! encore une heure et vous aurez la Rose, et vous reverrez votre père. »
Ces mots rendirent à Blondine la résolution qu’elle commençait à perdre ; elle marcha dans le sentier que lui indiquait le Perroquet en volant de branche en branche devant elle. La forêt, qu’elle avait crue si belle, près du parc de Bonne-Biche, devint de plus en plus difficile : les ronces et les pierres encombraient le sentier ; on n’entendait plus d’oiseaux ; les fleurs avaient disparu ; Blondine se sentit gagner par un malaise inexplicable ; le Perroquet la pressait vivement d’avancer.
« Vite, vite, Blondine, le temps se passe ; si Bonne-Biche s’aperçoit de votre absence et vous poursuit, elle me tordra le cou et vous ne verrez jamais votre père. »
Blondine, fatiguée, haletante, les bras déchirés, les souliers en lambeaux, allait déclarer qu’elle renonçait à aller plus loin, lorsque le Perroquet s’écria :
« Nous voici arrivés, Blondine ; voici l’enclos où est la Rose. »
Et Blondine vit au détour du sentier un petit enclos, dont la porte lui fut ouverte par le Perroquet. Le terrain y était aride et pierreux : mais au milieu s’élevait majestueusement un magnifique rosier, avec une Rose plus belle que toutes les roses du monde.
« Prenez-la, Blondine, vous l’avez bien gagnée », dit le Perroquet.
Blondine saisit la branche, et, malgré les épines qui s’enfonçaient dans ses doigts, elle arracha la Rose.
À peine l’eut-elle dans sa main, qu’elle entendit un éclat de rire ; la Rose s’échappa de ses mains en lui criant :
« Merci, Blondine, de m’avoir délivrée de la prison où me retenait la puissance de Bonne-Biche. Je suis ton mauvais génie ; tu m’appartiens maintenant.
— Ha, ha, ha, reprit à son tour le Perroquet, merci, Blondine, je puis maintenant reprendre ma forme d’enchanteur ; j’ai eu moins de peine à te décider que je ne le croyais. En flattant ta vanité, je t’ai facilement rendue ingrate et méchante. Tu as causé la perte de tes amis dont je suis le mortel ennemi. Adieu, Blondine. »
En disant ces mots, le Perroquet et la Rose disparurent, laissant Blondine seule au milieu d’une épaisse forêt.
VIII
LE REPENTIR
Blondine était stupéfaite ; sa conduite lui apparut dans toute son horreur : elle avait été ingrate envers des amis qui s’étaient dévoués à elle, qui avaient passé sept ans à soigner son éducation. Ces amis voudraient-ils la recevoir, lui pardonner ? Que deviendrait-elle si leur porte lui était fermée ? Et puis, que signifiaient les paroles du méchant Perroquet : « Tu as causé la perte de tes amis » ?
Elle voulut se remettre en route pour retourner chez Bonne-Biche : les ronces et les épines lui déchiraient les bras, les jambes et le visage ; elle continua pourtant à se faire jour à travers les broussailles, et, après trois heures de marche pénible, elle arriva devant le palais de Bonne-Biche et de Beau-Minon.
Que devint-elle quand, à la place du magnifique palais, elle ne vit que des ruines ; quand, au lieu des fleurs et des beaux arbres qui l’entouraient, elle n’aperçut que des ronces, des chardons et des orties ? Terrifiée, désolée, elle voulut pénétrer dans les ruines pour savoir ce qu’étaient devenus ses amis. Un gros Crapaud sortit d’un tas de pierres, se mit devant elle et lui dit :
« Que cherches-tu ? N’as-tu pas causé, par ton ingratitude, la mort de tes amis ? Va-t’en ; n’insulte pas à leur mémoire par ta présence.
— Ah ! s’écria Blondine, mes pauvres amis, Bonne-Biche, Beau-Minon, que ne puis-je expier par ma mort les malheurs que j’ai causés ! »
Et elle se laissa tomber, en sanglotant, sur les pierres et les chardons ; l’excès de sa douleur l’empêcha de sentir les pointes aiguës des pierres et les piqûres des chardons. Elle pleura longtemps, longtemps ; enfin elle se leva et regarda autour d’elle pour tâcher de découvrir un abri où elle pourrait se réfugier ; elle ne vit rien que des pierres et des ronces.
« Eh bien, dit-elle, qu’importe qu’une bête féroce me déchire ou que je meure de faim et de douleur, pourvu que j’expire ici sur le tombeau de Bonne-Biche et de Beau-Minon ? »
Comme elle finissait ces mots, elle entendit une voix qui disait : « Le repentir peut racheter bien des fautes. »
Elle leva la tête, et ne vit qu’un gros Corbeau noir qui voltigeait au-dessus d’elle.
« Hélas ! dit-elle, mon repentir, quelque amer qu’il soit, rendra-t-il la vie à Bonne-Biche et à Beau-Minon ?
— Courage, Blondine, reprit la voix ; rachète ta faute par ton repentir ; ne te laisse pas abattre par la douleur. »
La pauvre Blondine se leva et s’éloigna de ce lieu de désolation : elle suivit un petit sentier qui la mena dans une partie de la forêt où les grands arbres avaient étouffé les ronces ; la terre était couverte de mousse. Blondine, qui était épuisée de fatigue et de chagrin, tomba au pied d’un de ces beaux arbres et recommença à sangloter.
« Courage, Blondine, espère ! » lui cria encore une voix.
Elle ne vit qu’une Grenouille qui était près d’elle et qui la regardait avec compassion.
« Pauvre Grenouille, dit Blondine, tu as l’air d’avoir pitié de ma douleur. Que deviendrais-je, mon Dieu ! à présent que me voilà seule au monde ?
— Courage et espérance ! » reprit la voix.
Blondine soupira ; elle regarda autour d’elle, tâcha de découvrir quelque fruit pour étancher sa soif et apaiser sa faim.
Elle ne vit rien et recommença de verser des larmes.
Un bruit de grelots la tira de ses douloureuses pensées ; elle aperçut une belle vache qui approchait doucement, et puis, étant arrivée près d’elle, s’arrêta, s’inclina et lui fit voir une écuelle pendue à son cou. Blondine, reconnaissante de ce secours inattendu, détacha l’écuelle, se mit à traire la vache, et but avec délices deux écuelles de son lait. La vache lui fit signe de remettre l’écuelle à son cou, ce que fit Blondine ; elle baisa la vache sur le cou et lui dit tristement :
« Merci, Blanchette ; c’est sans doute à mes pauvres amis que je dois ce secours charitable : peut-être voient-ils d’un autre monde le repentir de leur pauvre Blondine, et veulent-ils adoucir son affreuse position.
— Le repentir fait bien pardonner des fautes, reprit la voix.
— Ah ! dit Blondine, quand je devrais passer des années à pleurer ma faute, je ne me la pardonnerais pas encore : je ne me la pardonnerai jamais. »
Cependant la nuit approchait. Malgré son chagrin, Blondine songea à ce qu’elle ferait pour éviter les bêtes féroces dont elle croyait déjà entendre les rugissements. Elle vit à quelques pas d’elle une espèce de cabane formée par plusieurs arbustes dont les branches étaient entrelacées ; elle y entra en se baissant un peu, et elle vit qu’en relevant et rattachant quelques branches elle s’y ferait une petite maisonnette très gentille ; elle employa ce qui restait de jour à arranger son petit réduit : elle y porta une quantité de mousse dont elle se fit un matelas et un oreiller ; elle cassa quelques branches qu’elle piqua en terre pour cacher l’entrée de sa cabane, et elle se coucha brisée de fatigue.
Elle s’éveilla au grand jour. Dans le premier moment elle eut peine à rassembler ses idées, à se rendre compte de sa position ; mais la triste vérité lui apparut promptement, et elle recommença les pleurs et les gémissements de la veille.
La faim se fit pourtant sentir. Blondine commença à s’inquiéter de sa nourriture, quand elle entendit les grelots de la vache. Quelques instants après, Blanchette était près d’elle. Comme la veille, Blondine détacha l’écuelle, tira du lait et en but tant qu’elle en voulut. Elle remit l’écuelle, baisa Blanchette et la vit partir avec l’espérance de la voir revenir dans la journée.
En effet, chaque jour, le matin, à midi et au soir, Blanchette venait présenter à Blondine son frugal repas.
Blondine passait son temps à pleurer ses pauvres amis, à se reprocher amèrement ses fautes.
« Par ma désobéissance, se disait-elle, j’ai causé de cruels malheurs qu’il n’est pas en mon pouvoir de réparer ; non seulement j’ai perdu mes bons et chers amis, mais je me suis privée du seul moyen de retrouver mon père, mon pauvre père qui attend peut-être sa Blondine, sa malheureuse Blondine, condamnée à vivre et à mourir seule dans cette affreuse forêt où règne mon mauvais génie ! »
Blondine cherchait à se distraire et à s’occuper par tous les moyens possibles ; elle avait arrangé sa cabane, s’était fait un lit de mousse et de feuilles ; elle avait relié ensemble des branches dont elle avait formé un siège ; elle avait utilisé quelques épines longues et fines pour en faire des épingles et des aiguilles ; elle s’était fabriqué une espèce de fil avec des brins de chanvre qu’elle avait cueillis près de sa cabane, et elle avait ainsi réussi à raccommoder les lambeaux de sa chaussure, que les ronces avaient mise en pièces. Elle vécut de la sorte pendant six semaines. Son chagrin était toujours le même, et il faut dire à sa louange que ce n’était pas sa vie triste et solitaire qui entretenait cette douleur, mais le regret sincère de sa faute : elle eût volontiers consenti à passer toute sa vie dans cette forêt, si par là elle avait pu racheter la vie de Bonne-Biche et de Beau-Minon.
IX
LA TORTUE
Un jour qu’elle était assise à l’entrée de sa cabane, rêvant tristement comme de coutume à ses amis, à son père, elle vit devant elle une énorme Tortue.
« Blondine, lui dit la Tortue d’une vieille voix éraillée, Blondine, si tu veux te mettre sous ma garde, je te ferai sortir de cette forêt.
— Et pourquoi, Madame la Tortue, chercherais-je à sortir de la forêt ? C’est ici que j’ai causé la mort de mes amis, et c’est ici que je veux mourir.
— Es-tu bien certaine de leur mort, Blondine ?
— Comment ! il se pourrait !… Mais non, j’ai vu leur château en ruine ; le Perroquet et le Crapaud m’ont dit qu’ils n’existaient plus ; vous voulez me consoler par bonté sans doute ; mais, hélas ! je ne puis espérer les revoir. S’ils vivaient, m’auraient-ils laissée seule, avec le désespoir affreux d’avoir causé leur mort ?
— Qui te dit, Blondine, que cet abandon n’est pas forcé, qu’eux-mêmes ne sont pas assujettis à un pouvoir plus grand que le leur ? Tu sais, Blondine, que le repentir rachète bien des fautes.
— Ah ! Madame la Tortue, si vraiment ils existent encore, si vous pouvez me donner de leurs nouvelles, dites-moi que je n’ai pas leur mort à me reprocher, dites-moi que je les reverrai un jour ! Il n’est pas d’expiation que je n’accepte pour mériter ce bonheur.
— Blondine, il ne m’est pas permis de te dire le sort de tes amis ; mais si tu as le courage de monter sur mon dos, de ne pas en descendre pendant six mois et de ne pas m’adresser une question jusqu’au terme de notre voyage, je te mènerai dans un endroit où tout te sera révélé.
— Je promets tout ce que vous voulez, Madame la Tortue, pourvu que je sache ce que sont devenus mes chers amis.
— Prends garde, Blondine : six mois sans descendre de dessus mon dos, sans m’adresser une parole ! Une fois que nous serons parties, si tu n’as pas le courage d’aller jusqu’au bout, tu resteras éternellement au pouvoir de l’enchanteur Perroquet et de sa sœur la Rose, et je ne pourrai même plus te continuer les petits secours auxquels tu dois la vie pendant six semaines.
— Partons, Madame la Tortue, partons sur-le-champ, j’aime mieux mourir de fatigue et d’ennui que de chagrin et d’inquiétude ; depuis que vos paroles ont fait naître l’espoir dans mon cœur, je me sens du courage pour entreprendre un voyage bien plus difficile que celui dont vous me parlez.
— Qu’il soit fait selon tes désirs, Blondine ; monte sur mon dos et ne crains ni la faim, ni la soif, ni le sommeil, ni aucun accident pendant notre long voyage ; tant qu’il durera, tu n’auras aucun de ces inconvénients à redouter. »
Blondine monta sur le dos de la Tortue.
« Maintenant, silence ! dit celle-ci ; pas un mot avant que nous soyons arrivées et que je te parle la première. »
X
LE VOYAGE ET L’ARRIVÉE
Le voyage de Blondine dura, comme le lui avait dit la Tortue, six mois ; elle fut trois mois avant de sortir de la forêt ; elle se trouva alors dans une plaine aride qu’elle traversa pendant six semaines, et au bout de laquelle elle aperçut un château qui lui rappela celui de Bonne-Biche et de Beau-Minon. Elles furent un grand mois avant d’arriver à l’avenue de ce château ; Blondine grillait d’impatience. Était-ce le château où elle devait connaître le sort de ses amis ? elle n’osait le demander malgré le désir extrême qu’elle en avait. Si elle avait pu descendre de dessus le dos de la Tortue, elle eût franchi en dix minutes l’espace qui la séparait du château ; mais la Tortue marchait toujours, et Blondine se souvenait qu’on lui avait défendu de dire une parole ni de descendre. Elle se résigna donc à attendre, malgré son extrême impatience. La Tortue semblait ralentir sa marche au lieu de la hâter ; elle mit encore quinze jours, qui semblèrent à Blondine quinze siècles, à parcourir cette avenue. Blondine ne perdait pas de vue ce château et cette porte ; le château paraissait désert ; aucun bruit, aucun mouvement ne s’y faisait sentir. Enfin, après cent quatre-vingts jours de voyage, la Tortue s’arrêta et dit à Blondine :
« Maintenant, Blondine, descendez ; vous avez gagné par votre courage et votre obéissance la récompense que je vous avais promise ; entrez par la petite porte qui est devant vous ; demandez à la première personne que vous rencontrerez la fée Bienveillante : c’est elle qui vous instruira du sort de vos amis. »
Blondine sauta lestement à terre ; elle craignait qu’une si longue immobilité n’eût raidi ses jambes, mais elle se sentit légère comme au temps où elle vivait heureuse chez Bonne-Biche et Beau-Minon et où elle courait des heures entières, cueillant des fleurs et poursuivant des papillons. Après avoir remercié avec effusion la Tortue, elle ouvrit précipitamment la porte qui lui avait été indiquée, et se trouva en face d’une jeune personne vêtue de blanc, qui lui demanda d’une voix douce qui elle désirait voir.
« Je voudrais voir la fée Bienveillante, répondit Blondine ; dites-lui, Mademoiselle, que la princesse Blondine la prie instamment de la recevoir.
— Suivez-moi, princesse », reprit la jeune personne.
Blondine la suivit en tremblant ; elle traversa plusieurs beaux salons, rencontra plusieurs jeunes personnes vêtues comme celle qui la précédait, et qui la regardaient en souriant et d’un air de connaissance ; elle arriva enfin dans un salon semblable en tous points à celui qu’avait Bonne-Biche dans la forêt des Lilas.
Ce souvenir la frappa si douloureusement qu’elle ne s’aperçut pas de la disparition de la jeune personne blanche ; elle examinait avec tristesse l’ameublement du salon ; elle n’y remarqua qu’un seul meuble que n’avait pas Bonne-Biche dans la forêt des Lilas : c’était une grande armoire en or et en ivoire d’un travail exquis ; cette armoire était fermée. Blondine se sentit attirée vers elle par un sentiment indéfinissable, et elle la contemplait sans en pouvoir détourner les yeux, lorsqu’une porte s’ouvrit : une dame belle et jeune encore, magnifiquement vêtue, entra et s’approcha de Blondine.
« Que me voulez-vous, mon enfant ? lui dit-elle d’une voix douce et caressante.
— Oh ! Madame, s’écria Blondine en se jetant à ses pieds, on m’a dit que vous pouviez me donner des nouvelles de mes chers et excellents amis Bonne-Biche et Beau-Minon. Vous savez sans doute, Madame, par quelle coupable désobéissance je les ai perdus ; longtemps je les ai pleurés, les croyant morts : mais la Tortue qui m’a amenée jusqu’ici, m’a donné l’espérance de les retrouver un jour. Dites-moi, Madame, dites-moi s’ils vivent et ce que je dois faire pour mériter le bonheur de les revoir.
— Blondine, dit la fée Bienveillante avec tristesse, vous allez connaître le sort de vos amis ; mais, quoi que vous voyiez, ne perdez pas courage ni espérance. »
En disant ces mots, elle releva la tremblante Blondine, et la conduisit devant l’armoire qui avait déjà frappé ses yeux.
« Voici, Blondine, la clef de cette armoire, ouvrez-la vous-même et conservez votre courage. »
Elle remit à Blondine une clef d’or.
Blondine ouvrit l’armoire d’une main tremblante… Que devint-elle quand elle vit dans cette armoire les peaux de Bonne-Biche et de Beau-Minon, attachées avec des clous de diamant ? À cette vue, la malheureuse Blondine poussa un cri déchirant et tomba évanouie dans les bras de la fée.
La porte s’ouvrit encore une fois, et un prince beau comme le jour se précipita vers Blondine en disant :
« Oh ! ma mère, l’épreuve est trop forte pour notre chère Blondine.
— Hélas ! mon fils, mon cœur saigne pour elle ; mais tu sais que cette dernière punition était indispensable pour la délivrer à jamais du joug cruel du génie de la forêt des Lilas. »
En disant ces mots, la fée Bienveillante toucha Blondine de sa baguette. Blondine revint immédiatement à elle ; mais, désolée, sanglotante, elle s’écria :
« Laissez-moi mourir, la vie m’est odieuse ; plus d’espoir, plus de bonheur pour la pauvre Blondine ; mes amis, mes chers amis, je vous rejoindrai bientôt.
— Blondine, chère Blondine, dit la fée en la serrant dans ses bras, tes amis vivent et t’aiment : je suis Bonne-Biche, et voici mon fils Beau-Minon. Le méchant génie de la forêt des Lilas, profitant d’une négligence de mon fils, était parvenu à s’emparer de nous et à nous donner les formes sous lesquelles vous nous avez connus ; nous ne devions reprendre nos formes premières que si vous enleviez la Rose que je savais être votre mauvais génie et que je retenais captive. Je l’avais placée aussi loin que possible de mon palais, afin de la soustraire à vos regards ; je savais les malheurs auxquels vous vous exposeriez en délivrant votre mauvais génie de sa prison, et le ciel m’est témoin que mon fils et moi nous eussions volontiers resté toute notre vie Bonne-Biche et Beau-Minon à vos yeux, pour vous épargner les cruelles douleurs par lesquelles vous avez passé. Le Perroquet est parvenu jusqu’à vous malgré nos soins ; vous savez le reste, ma chère enfant ; mais ce que vous ne savez pas, c’est tout ce que nous avons souffert de vos larmes et de votre isolement. »
Blondine ne se lassait pas d’embrasser la fée, de la remercier, ainsi que le prince ; elle leur adressait mille questions :
« Que sont devenues, dit-elle, les gazelles qui nous servaient ?
— Vous les avez vues, chère Blondine : ce sont les jeunes personnes qui vous ont accompagnée jusqu’ici ; elles avaient, comme nous, subi cette triste métamorphose.
— Et la bonne vache qui m’apportait du lait tous les jours ?
— C’est nous qui avons obtenu de la reine des fées de vous envoyer ce léger adoucissement ; les paroles encourageantes du Corbeau, c’est encore de nous qu’elles venaient.
— C’est donc vous, Madame, qui m’avez aussi envoyé la Tortue ?
— Oui, Blondine ; la reine des fées, touchée de votre douleur, retira au génie de la forêt tout pouvoir sur vous, à la condition d’obtenir de vous une dernière preuve de soumission en vous obligeant à ce voyage si long et si ennuyeux, et de vous infliger une dernière punition en vous faisant croire à la mort de mon fils et à la mienne. J’ai prié, supplié la reine des fées de vous épargner au moins cette dernière douleur, mais elle a été inflexible. »
Blondine ne se lassait pas d’écouter, de regarder, d’embrasser ses amis perdus depuis si longtemps, qu’elle avait cru ne jamais revoir. Le souvenir de son père se présenta à son esprit. Le prince Parfait devina le désir de Blondine et en fit part à la fée.
« Préparez-vous, chère Blondine, à revoir votre père ; prévenu par moi, il vous attend. »
Au même moment, Blondine se trouva dans un char de perles et d’or ; à sa droite était la fée ; à ses pieds était le prince Parfait qui la regardait avec bonheur et tendresse ; le char était traîné par quatre cygnes d’une blancheur éblouissante ; ils volèrent avec une telle rapidité qu’il ne leur fallut que cinq minutes pour arriver au palais du roi Bénin.
Toute la cour du roi était assemblée près de lui : on attendait Blondine. Lorsque le char parut, ce furent des cris de joie tellement étourdissants, que les cygnes faillirent en perdre la tête et se tromper de chemin. Le prince, qui les menait, rappela heureusement leur attention, et le char s’abattit au pied du grand escalier.
Le roi Bénin s’élança vers Blondine, qui, sautant à terre, se jeta dans ses bras. Ils restèrent longtemps embrassés. Tout le monde pleurait, mais c’était de joie.
Quand le roi se fut un peu remis, il baisa tendrement la main de la fée, qui lui rendait Blondine après l’avoir élevée et protégée. Il embrassa le prince Parfait qu’il trouva charmant.
Il y eut huit jours de fêtes pour le retour de Blondine ; au bout de ces huit jours, la fée voulut retourner chez elle ; le prince Parfait et Blondine étaient si tristes de se séparer que le roi convint avec la fée qu’ils ne se quitteraient plus ; le roi épousa la fée, et Blondine épousa le prince Parfait qui fut toujours pour elle le Beau-Minon de la forêt des Lilas.
Brunette, ayant fini par se corriger, vint souvent voir Blondine.
Le prince Violent, son mari, devint plus doux à mesure que Brunette devenait meilleure, et ils furent assez heureux.
Quant à Blondine, elle n’eut jamais un instant de chagrin ; elle donna le jour à des filles qui lui ressemblèrent, à des fils qui ressemblèrent au prince Parfait. Tout le monde les aimait, et autour d’eux tout le monde fut heureux.
Le Simurgh

LE SIMURGH
Conte de Marco Beretta © 2015
inspiré d’une légende perse ancienne
Comme chaque printemps après le dégel, des centaines de milliers d’oiseaux de toutes sortes prirent leur envol pour se rassembler sur les rives du grand lac Urmia, en Azérie, région située à l’ouest de la Perse.
Le soulagement d’avoir survécu à un autre hiver était grand. Les retrouvailles avec les vieux amis au milieu de cette foule écrasante, furent suivies par l’échange interminable des récits et mélodies que chacun avait rapporté de lointaines contrées. C’était comme un massage de mots et de chants qui soulageait l’immense troupeau pris d’une fièvre de rires, de soupirs et d’émerveillement
Cette année encore, beaucoup racontèrent la légende du Simurgh.
Le Simurgh était l’oiseau divin, l’esprit suprême de tous ceux qui ont des ailes, si vieux, disait-on, qu’il avait vu le commencement et la fin de trois mondes, de trois univers entiers.
Le grand volatile avait brûlé et été réduit en cendres de nombreuses fois, mais à chaque fois, il en était ressorti plus grand, plus sage et plus fort que tous les oiseaux de ce troupeau réuni. On disait qu’il volait plus haut que les nuages et même au-delà du ciel.
Ce devait être pour les eaux du lac, plus chaudes que d’habitude, ou pour la couleur des fleurs, plus vives que les autres années, ou pour l’hiver si rude qui venait de se terminer et qui avaient laissé aux survivants une envie de vivre qu’ils s’étaient rarement vue, ou bien pour une autre raison inconnue, car ce printemps-là, après s’être raconté et chanté cette histoire de nombreuses fois, une idée étrange commença à se répandre parmi la foule, une idée qui fit son chemin dans le cœur de centaines de milliers d’oiseaux.
“Nous devons trouver le Simurgh !”
C’était comme un éclair lent, une marée de têtes hochant leurs becs en accord sur cet incroyable défi.
Alors, ce même jour, les ailes se remirent à battre et, un à un, les milliers d’oiseaux s’envolèrent vers les quatre coins de l’horizon, déterminés à réaliser l’impossible.
Mais, comme il arrive bien souvent, les bonnes intentions ne firent pas le poids face aux difficiles épreuves, si bien que peu de temps après, presque tout que ceux qui avaient pris leur envol abandonnèrent leur objectif.
Certains prétendirent que c’etait la saison des accouplements, un appel irrésistible. D’autres qu’ils avaient besoin de se reposer dans des contrées plus clémentes et qu’ils n’avaient pas assez de forces pour traverser les grands déserts et les océans. D’autres encore qui durent recouvrer leur bon sens et laisser une telle folie aux plus jeunes et aux plus irresponsables. Enfin, presque tous revinrent à leur routine habituelle.
Ainsi s’écoula le reste du printemps, puis vint l’été ardent, puis l’automne mélancolique et un nouvel hiver, plus dur encore que le précédent.
Les centaines de milliers partis à l’aventure s’étaient d’abord réduits à quelques milliers, puis des centaines, jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’une petite bande d’oiseaux courageux, déterminés à poursuivre à tout prix ce vol pour trouver le Simurgh.
Ils étaient trente, trente oiseaux qui se retrouvèrent ensemble dans le bassin de Ferghana, au pied des plus hautes montagnes du monde connu, tandis que la fin de l’hiver mordait encore l’air avec ses griffes gelées.
Tous ces oiseaux portaient une certitude à l’intérieur. Une certitude qui n’était pas fortuite, ce n’était pas une rumeur, ce n’était pas une légende sans fondement. Ou plutôt, au travers des milliers de kilomètres parcourus, des milliers de questions posées à chaque bouche qui pouvait répondre, des milliers de légendes et de contes entendus, les trente oiseaux avaient conservé un indice qui s’était consolidé en eux comme quelque chose de plus qu’une suggestion, de plus qu’un « on dit », de plus qu’une possibilité.
Le Simurgh existait bel et bien et il étaient près d’ici !
Ces retrouvailles renforcèrent cette certitude inébranlable et leur volonté de trouver le Simurgh devint aussi forte que l’épée qui sort de la forge, plus forte même que le besoin de respirer.
Ils savaient maintenant tous que le Simurgh vivait dans une vallée verdoyante, au bord d’un lac à l’eau plus claire que le verre le plus poli qu’on puisse concevoir. Malgré cela, cette vallée était située derrière ces hautes montagnes qu’on apercevait à l’est, avec des crêtes pointues comme les dents acérées d’une scie, un mur impitoyable qui les séparait de la prise si convoitée.
Peu importe, se disaient-ils. Ce sera le Simurgh… ou la mort !
Et ils partirent ainsi, sans plus tarder ni hésiter.
Ce fut le vol le plus dangereux, le plus téméraire, le plus ardu et le plus douloureux qu’ils avaient entrepris jusque-là mais, au risque de tous mourir dans la tempête, de tous tomber sous l’avalanche, de tous se perdre dans le brouillard, aucun des trente frères et sœurs ne fut laissé en arrière pour traverser le col de roches battues par les vents glacials.
Finalement ils traversèrent la montagne et, épuisés, ils découvrirent derrière une vallée d’un vert profond et apaisant. À mesure que l’air devenait plus chauds en descendant, ils virent un lac aux eaux cristallines comme un diamant du grand Khan des steppes.
Ils survolèrent ce lac ensemble, anxieux, excités, et certains au plus profond de leurs cœurs que c’était maintenant ou jamais, que tout allait se jouer en un clin d’œil.
À ce moment, ils regardèrent leur reflet dans l’eau du lac, et ils le virent.
Ils se virent, tous les trentes si unis, si reliés, volant dans une telle unisson, qu’ils formaient ensemble la silhouette d’un gigantesque oiseau, qui paraissait plus sage et parfait qu’eux tous réunis. L’oiseau que pendant une longue année d’incertitudes et de peines infinies ils avaient recherché.
Alors le Simurgh se reconnut lui-même, et se posa sur la rive du lac pour admirer toutes les couleurs des trente oiseaux courageux. Il hocha la tête avec douceur et compassion. Il se souvint de ces trente vies de souffrance, de froid, d’obscurité, d’égarement, de manque, de larmes, mais également des rires, des embrassades, des regards amicaux et sereins.
Le Simurgh s’arrêta pour réfléchir au poids des ombres face aux lumières, et, comme il l’avait fait des milliers de fois auparavant, pour soupeser la possibilité d’aller de l’avant.
Partagé par ces sentiments, aussi vrais que trompeurs, il se souvenait aussi des instants éphémères de liberté dont il avait joui dans le monde incarné.
Ce monde était comme une énorme roue, plus forte que tout obstacle qui pourrait s’interposer entre ses engrenages. Une roue immense qui entraînait dans ses révolutions imparables chaque âme et chaque particule, ne laissant que l’apparence d’une volonté, l’illusion de pouvoir décider de prendre un côté ou l’autre de la route.
Mais, le Simurgh le savait bien lui, entre ces dents impitoyables de la roue cosmique, il y avait un espace, un espace minimal, petit comme le plus infime angle d’ouverture des ailes qui battent dans l’air. Un degré imprévisible et insondable que seule la liberté de l’oiseau solitaire pouvait ouvrir ou replier et, avec ce degré de liberté, il pouvait contrer le flux d’air de telle sorte qu’il provoquerait ou dissoudrait un ouragan gigantesque et destructeur à des milliers de miles de distance.
Cette infime fraction de réalité était l’impossible à prévoir, autant que même le Dieu des humains ne pouvait savoir vers où elle pouvait conduire.
C’est pour cette liberté, pour ce petit battement d’aile en plus ou en moins de tant d’oiseaux qui n’étaient qu’un, ce degré qui faisait que rien n’était jamais vraiment décidé, que le Simurgh se dit: “Ça valait la peine…”
Et déployant ses ailes, il se répandit de nouveau à travers le monde, il retourna explorer tous les univers possibles, pour affronter à nouveau tous les froids, les confusions et les vides, tous les rires, les embrassades et les calmes pour que le jeu, le grand jeu d’étendre le possible, le grand jeu du Simurgh suive son cours, un cours qui n’a jamais commencé et jamais ne finira.
Traduit par Roland Beaussant et publié avec l’accord de Marco Beretta pour contesdefees.com.
Lila sur Aravia
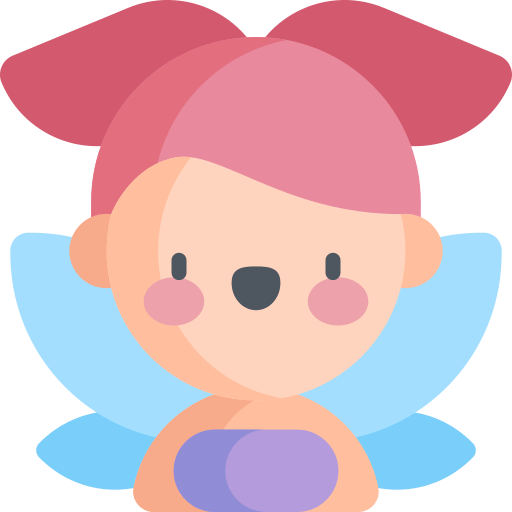
Dans un futur lointain, les humains avaient exploré et colonisé de nombreuses planètes dans l’univers. Parmi elles se trouvait une magnifique planète nommée Aravia, remplie de forêts verdoyantes, de lacs chatoyants et de montagnes vertigineuses. La planète abritait de nombreuses créatures, mais la plus fascinante d’entre elles était les Araviens – des fées qui vivaient en harmonie avec la nature.
Les Araviens étaient de minuscules créatures aux ailes étincelantes, aux robes colorées et aux pouvoirs magiques. Ils pouvaient contrôler les éléments, parler avec les animaux et réaliser les souhaits. Ils étaient gentils, doux et aimés par toutes les créatures de la planète.
Un jour, une jeune fille de la Terre, Lila, arriva sur Aravia. C’était une aventurière et une rêveuse, qui avait toujours rêvé de rencontrer ces êtres magiques dont elle avait entendu parler dans ses livres. Lila fut émerveillée par la beauté de la planète, et elle marcha longtemps, explorant chaque coin de ce monde.
En marchant, elle tomba sur un groupe d’Araviens qui jouaient près d’un lac étincelant. Ils furent surpris de la voir, car aucun humain n’avait jamais mis les pieds sur leur planète auparavant. Lila se présenta, et les Araviens l’accueillir à bras ouverts. Ils l’emmenèrent dans leur village, où elle rencontra la reine des Araviens, une jeune fée sage et belle nommée Aurélia.
Aurélia écouta les histoires de Lila à propos de la Terre et fut fascinée par les progrès réalisés par les humains. Elle demanda à Lila de l’emmener sur Terre pour qu’elle puisse la voir de ses propres yeux. Lila accepta et promit d’emmener Aurélia sur Terre dès le lendemain.
Le lendemain, Lila et Aurélia s’envolèrent vers la Terre sur un nuage magique. Aurélia fut émerveillée par les grands immeubles, la foule animée et la technologie avancée. Lila l’emmena visiter le plus grand musée de la ville, où elles admirèrent de nombreuses inventions étonnantes du passé.
Alors qu’elles parcouraient une exposition d’anciens contes de fées, elles remarquèrent un étrange appareil. C’était une machine à remonter le temps, sur laquelle il y avait un panneau qui disait « Ne pas toucher ». Lila et Aurélia ne purent résister à la tentation, et elles décidèrent d’utiliser la machine pour voyager dans le futur.
La machine à voyager dans le temps les emmena sur une planète lointaine, loin de la Terre et d’Aravia. La planète était stérile, sans arbres, sans eau et sans vie. Lila et Aurélia furent choquées et attristées par ce spectacle. Elles demandèrent à un robot qui passait par là ce qui était arrivé à la planète.
Le robot leur expliqua que la planète était autrefois un monde magnifique, un peu comme Aravia, mais que les habitants l’avaient détruite par leur cupidité et leur mépris de la nature. Le robot leur montra des images de la Terre dans le futur, et ils virent qu’elle aussi était devenue une terre désolée.
Lila et Aurélia étaient remplies de tristesse et de désespoir. Elles savaient qu’elles devaient faire quelque chose pour empêcher que ce futur ne devienne réalité. Elles décidèrent d’utiliser leurs pouvoirs pour diffuser un message d’amour et de respect de la nature.
Elles s’envolèrent pour Aravia et parlèrent aux Araviens et aux créatures de la planète. Elles leur parlèrent des dangers de la cupidité et de l’importance de préserver le monde naturel. Les Araviens et les créatures les écoutèrent attentivement et ils promirent de faire tout ce qu’ils pouvaient pour protéger la planète.
Lila et Aurélia décidèrent alors de diffuser leur message sur d’autres planètes, et elles voyagèrent d’une planète à l’autre, diffusant leur message d’amour et de respect de la nature. Elles rencontrèrent beaucoup de créatures et d’êtres humains différents, et elles étaient heureuses de voir que leur message était entendu et compris.
Les années passèrent, et les planètes de l’univers s’unirent dans leurs efforts pour protéger la nature. Les Araviens et les autres créatures d’Aravia vivaient en harmonie les uns avec les autres, et la planète prospérait.
Les humains sur Terre commencèrent aussi à changer. Ils réalisèrent l’importance de la préservation de la nature et travaillèrent ensemble pour créer un avenir durable. Des millions d’arbres furent plantés, les animaux furent protégés, l’air et l’eau assainis. Les terres désolées du futur ne furent plus qu’un lointain souvenir.
Lila et Aurélia furent reconnues comme des héroïnes dans tout l’univers. Elles avaient inspiré un mouvement qui avait sauvé d’innombrables planètes de la destruction. Elles continuèrent à voyager, diffusant leur message d’amour et de respect de la nature, et aidant ceux qui en avaient besoin.
Un jour, alors qu’elles voyageaient dans l’espace, elles reçurent un message d’une planète inconnue. Le message était un appel de détresse, et il disait que la planète était en train d’être détruite par une force inconnue. Lila et Aurélia voulurent aider les habitants et se dirigèrent vers cette planète.
Quand elles arrivèrent, elles virent un énorme vaisseau spatial en vol stationnaire au-dessus de la planète. Le vaisseau émettait une énergie étrange qui détruisait tout sur son passage. Lila et Aurélia s’approchèrent du vaisseau et comprirent qu’il était habité par une race extraterrestre qui avait l’intention de conquérir l’univers.
Lila et Aurélia savaient qu’elles devaient arrêter les extraterrestres, mais elles n’avaient pas les moyens de combattre leur technologie avancée. Alors que tout semblait perdu, les habitants d’Aravia et des autres planètes arrivèrent pour les aider. Ils avaient entendu l’appel de détresse et étaient venues défendre leurs amies.
Une grande bataille s’engagea, et elle dura longtemps. Les Araviens et leurs alliés se battirent avec courage, utilisant leurs pouvoirs pour contrer les armes des aliens. Lila et Aurelia se joignirent à eux, utilisant leurs pouvoirs pour créer un bouclier autour de la planète, la protégeant de l’énergie alien.
Finalement, après des heures de combat, les extraterrestres furent vaincus. Le vaisseau spatial explosa, et la menace extraterrestre disparut. Les habitants d’Aravia et des autres planètes célébrèrent leur victoire, et Lila et Aurélia furent saluées comme des héroïnes une fois de plus.
À partir de ce jour, les habitants de l’univers surent qu’ils n’étaient plus seuls. Ils veillaient les uns sur les autres, et avaient le pouvoir de l’amour et de la nature. Lila et Aurélia continuèrent à voyager, à diffuser leur message et à aider ceux et celles qui en avaient besoin. Elles savaient que l’avenir était prometteur et que tant qu’elles travailleraient ensemble, elles pourraient surmonter tous les défis.
Créé par les outils IA : Chat GPT et DALL-E, sous la direction de Roland Beaussant de contesdefees.com
L’histoire du Chat qui voulait faire de Souricette sa Dulcinée
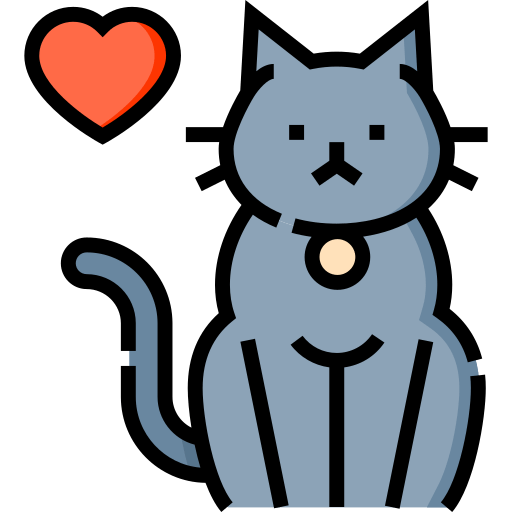
Autrefois le chat aimait bien la souris. Il en était follement amoureux qu’il voulait en faire sa petite amie, sa petite chérie.
Il en était éperdument amoureux qu’il rêvait de faire d’elle sa dulcinée, sa bien- aimée, sa petite princesse, son petit soleil de minuit.
Mais souricette était un peu trop exigeante. Elle était tellement prétentieuse qu’elle voulait tout à la fois.
Elle était tellement prétentieuse, qu’à chaque rencart, elle lui trouvait le moindre défaut.
A la première rencontre c’était la bouche qu’elle trouva un peu trop longue, à tel point qu’elle ne pouvait l’embrasser.
Le pauvre chat s’en alla doucettement la modeler, c’est-à-dire la diminuer de quelques millimètres avec le secret espoir de conquérir le cœur de souricette, de gagner sa tendresse et puis en faire sa princesse, sa sorcière bien aimée.
Hélas au second rendez-vous discret, Ce fut encore et toujours la même chanson, la même note, le même refrain.
Cette fois c’était le menton qu’elle trouva long, trop long même.
Le chat qui croyait encore en cet amour, retourna chez son médecin pour se redonner un nouveau look, un nouveau visage, un nouveau style, un nouveau design.
Encore Hélas! Au bout du compte le voilà, l’amoureux, le visage tout rond.
Au troisième contact secret ce fut le K.-O. parce que ce ne fut pas ok, ce ne fut pas le bon.
De nouveau, un autre défaut. Alors le chat, le pauvre et malheureux amoureux devint tout furieux et nerveux.
Voici d’où est venue, l’éternelle querelle entre le chat et la souris.
Souricette, la dulcinée, monsieur chat l’amoureux…
Olivier Rovia – Kouakou Rovia et les 40 sagesses
Commander le livre sur : https://www.lysbleueditions.com/produit/kouakou-rovia-et-les-40-sagesses/
Illustration par Dall-e sur un prompt de Roland Beaussant
Alibaba et les Quarante Voleurs

Ceci est une version courte d’Alibaba et les quarante voleurs. Vous préférez la version complete? Cliquez ici.
Il était une fois à Bagdad, un pauvre bûcheron nommé Alibaba. Un jour, en se rendant dans la forêt pour chercher du bois, il découvrit une grotte mystérieuse appartenant à une bande de quarante voleurs.
Caché dans un arbre, il les vit ouvrir la grotte en prononçant simplement ces mots: « Sésame, ouvre-toi ». Puis ils repartirent au galop sur leurs quarante chevaux.
Ali s’approcha et prononça les mots magiques « Sésame, ouvre-toi ! » et la grotte s’ouvrit. À l’intérieur, il découvrit des trésors scintillants et des centaines de sacs remplis de pièces d’or de tous les crimes et saccages qu’ils avaient commis sur les routes et dans les villages.
Alibaba emporta le trésor et, ainsi devenu riche, il fit preuve de générosité envers les pauvres de Bagdad en leur offrant des pièces d’or.
Cependant, les quarante voleurs étaient revenus à la grotte et, envoyant tous leurs butins disparus, ils furent emplis de rage et voulurent se venger. Ils retrouvèrent la trace d’Alibaba grâce à ses dons faits aux pauvres et ils élaborèrent plusieurs plans pour le tuer.
Heureusement, Alibaba avait à son service la belle et intelligente esclave Morgiane.
Tout d’abord elle surprit un des voleurs en train de marquer leur maison d’une croix pour revenir ensuite avec ses complices tuer Alibaba et sa famille. Alors, elle marqua toutes les maisons du quartier d’une même croix pour confondre les voleurs et qu’ils ne puissent pas les retrouver. Ils retournèrent à la grotte la queue entre les jambes.
Ensuite le chef se déguisa en marchant et cacha ses voleurs dans quarante jarres d’huile. Il demanda l’hospitalité à Alibaba pour la nuit avec ses fausses marchandises. Mais Morgiane s’en aperçut et prévint son maître qui fit enterrer les jarres, scellant ainsi la fin des quarante voleurs.
Mais le chef des voleurs avait survécu et il fit une dernière tentative en se déguisant à nouveau en marchant avec un poignard dissimulé dans sa tunique pour tuer Alibaba et son fils qui l’avaient accueilli sans le reconnaître.
Morgiane, qui l’avait reconnu, se déguisa en danseuse et le tua avant qu’il n’ait pu commettre son méfait.
Reconnaissant de son courage et de son intelligence, Alibaba affranchit la belle esclave et lui proposa la main de son fils en récompense.
Elle accepta et toute la famille vécut dans l’opulence ainsi que tous les pauvres de leur quartier pendant de nombreuses générations.
Ceci est une version courte d’Alibaba et les quarante voleurs. Vous préférez la version complete? Cliquez ici.
Illustré par Albert Robida
La bergère et le ramoneur

LA BERGÈRE ET LE RAMONEUR.
Avez-vous jamais vu une de ces armoires antiques, toutes noires de vieillesse, à enroulements et à feuillage ? C’était précisément une de ces armoires qui se trouvait dans la chambre : elle venait de la trisaïeule, et de haut en bas elle était ornée de roses et de tulipes sculptées. Mais ce qu’il y avait de plus bizarre, c’étaient les enroulements, d’où sortaient de petites têtes de cerf avec leurs grandes cornes. Au milieu de l’armoire on voyait sculpté un homme d’une singulière apparence : il ricanait toujours, car on ne pouvait pas dire qu’il riait. Il avait des jambes de bouc, de petites cornes à la tête et une longue barbe. Les enfants l’appelaient le Grand-général-commandant-en-chef-Jambe-de-Bouc, nom qui peut paraître long et difficile, mais titre dont peu de personnes ont été honorées jusqu’à présent. Enfin, il était là, les yeux toujours fixés sur la console placée sous la grande glace, où se tenait debout une gracieuse petite bergère de porcelaine. Elle portait des souliers dorés, une robe parée d’une rose toute fraîche, un chapeau d’or et une houlette : elle était charmante. Tout à côté d’elle se trouvait un petit ramoneur noir comme du charbon, mais pourtant de porcelaine aussi. Il était aussi gentil, aussi propre que vous et moi ; car il n’était en réalité que le portrait d’un ramoneur. Le fabricant de porcelaine aurait tout aussi bien pu faire de lui un prince ; ce qui lui aurait été vraiment bien égal.
Il tenait gracieusement son échelle sous son bras, et sa figure était rouge et blanche comme celle d’une petite fille ; ce qui ne laissait pas d’être un défaut qu’on aurait pu éviter en y mettant un peu de noir. Il touchait presque la bergère : on les avait placés où ils étaient, et, là où on les avait posés, ils s’étaient fiancés. Aussi l’un convenait très-bien à l’autre : c’étaient des jeunes gens faits de la même porcelaine et tous deux également faibles et fragiles.
Non loin d’eux se trouvait une autre figure trois fois plus grande : c’était un vieux Chinois qui savait hocher la tête. Lui aussi était en porcelaine ; il prétendait être le grand-père de la petite bergère, mais il n’avait jamais pu le prouver. Il soutenait qu’il avait tout pouvoir sur elle, et c’est pourquoi il avait répondu par un aimable hochement de tête au Grand-général-commandant-en-chef-Jambe-de-Bouc, qui avait demandé la main de la petite bergère.
« Quel mari tu auras là ! dit le vieux Chinois, quel mari ! Je crois quasi qu’il est d’acajou. Il fera de toi madame la Grande-générale-commandante-en-chef-Jambe-de-Bouc ; il a toute son armoire remplie d’argenterie, sans compter ce qu’il a caché dans les tiroirs secrets.
— Je n’entrerai jamais dans cette sombre armoire, dit la petite bergère ; j’ai entendu dire qu’il y a dedans onze femmes de porcelaine.
— Eh bien ! Tu seras la douzième, dit le Chinois. Cette nuit, dès que la vieille armoire craquera, on fera la noce, aussi vrai que je suis un Chinois. »
Et là-dessus il hocha la tête et s’endormit.
Mais la petite bergère pleurait en regardant son bien-aimé le ramoneur.
« Je t’en prie, dit-elle, aide-moi à m’échapper dans le monde, nous ne pouvons plus rester ici.
— Je veux tout ce que tu veux, dit le petit ramoneur. Sauvons-nous tout de suite ; je pense bien que je saurai te nourrir avec mon état.
— Pourvu que nous descendions heureusement de la console, dit-elle. Je ne serai jamais tranquille tant que nous ne serons pas hors d’ici. »
Et il la rassura, et il lui montra comment elle devait poser son petit pied sur les rebords sculptés et sur le feuillage doré. Il l’aida aussi avec son échelle, et bientôt ils atteignirent le plancher. Mais en se retournant vers la vieille armoire, ils virent que tout y était en révolution. Tous les cerfs sculptés allongeaient la tête, dressaient leurs bois et tournaient le cou. Le Grand-général-commandant-en-chef-Jambe-de-Bouc fit un saut et cria au vieux Chinois : « Les voilà qui se sauvent ! Ils se sauvent ! »
Alors ils eurent peur et se réfugièrent dans le tiroir du marchepied de la fenêtre[1].
Là se trouvaient trois ou quatre jeux de cartes dépareillés et incomplets, puis un petit théâtre qui avait été construit tant bien que mal. On y jouait précisément une comédie, et toutes les dames, qu’elles appartiennent à la famille des carreaux ou des piques, des cœurs ou des trèfles, étaient assises aux premiers rangs et s’éventaient avec leurs tulipes ; et derrière elles se tenaient tous les valets, qui avaient à la fois une tête en l’air et l’autre en bas, comme sur les cartes à jouer. Il s’agissait dans la pièce de deux jeunes gens qui s’aimaient, mais qui ne pouvaient arriver à se marier. La bergère pleura beaucoup, car elle croyait que c’était sa propre histoire.
« Ça me fait trop de mal, dit-elle, il faut que je quitte le tiroir. »
Mais lorsqu’ils mirent de nouveau le pied sur le plancher et qu’ils jetèrent les yeux sur la console, ils aperçurent le vieux Chinois qui s’était réveillé et qui se démenait violemment.
« Voilà le vieux Chinois qui accourt ! s’écria la petite bergère, et elle tomba sur ses genoux de porcelaine, tout à fait désolée.
— J’ai une idée, dit le ramoneur. Nous allons nous cacher au fond de la grande cruche qui est là dans le coin. Nous y coucherons sur des roses et sur des lavandes, et s’il vient, nous lui jetterons de l’eau aux yeux.
— Non, ce serait inutile, lui répondit-elle. Je sais que le vieux Chinois et la Cruche ont été fiancés, et il reste toujours un fond d’amitié après de pareilles relations, même longtemps après. Non, il ne nous reste pas d’autre ressource que de nous échapper dans le monde.
— Et en as-tu réellement le courage ? dit le ramoneur. As-tu songé comme le monde est grand, et que nous ne pourrons plus jamais revenir ici ?
— J’ai pensé à tout, » répliqua-t-elle.
Et le ramoneur la regarda fixement, et dit ensuite : « Le meilleur chemin pour moi est par la cheminée. As-tu réellement le courage de te glisser avec moi dans le poêle et de grimper le long des tuyaux ? C’est par là seulement que nous arriverons dans la cheminée, et là je saurai bien me retourner. Il faudra monter aussi haut que possible, et tout à fait au haut nous parviendrons à un trou par lequel nous entrerons dans le monde. »
Il la conduisit à la porte du poêle : « Dieu ! Qu’il y fait noir ! », s’écria-t-elle.
Cependant elle l’y suivit, et de là dans les tuyaux, où il faisait une nuit noire comme la suie.
« Nous voilà maintenant dans la cheminée, dit-il. Regarde, regarde là-haut la magnifique étoile qui brille. »
Il y avait en effet au ciel une étoile qui semblait par son éclat leur montrer le chemin : ils grimpaient, ils grimpaient toujours. C’était une route affreuse, si haute, si haute ! Mais il la soulevait, il la soutenait, et lui montrait les meilleurs endroits où mettre ses petits pieds de porcelaine.
Ils arrivèrent ainsi jusqu’au rebord de la cheminée où ils s’assirent pour se reposer, tant ils étaient fatigués : et ils avaient bien de quoi l’être !
Le ciel avec toutes ses étoiles s’étendait au-dessus d’eux, et les toits de la ville s’inclinaient bien au-dessous. Ils promenèrent leur regard très-loin tout autour d’eux, bien loin dans le monde. La petite bergère ne se l’était jamais figuré si vaste : elle appuyait sa petite tête sur le ramoneur et pleurait si fort que ses larmes tachèrent sa ceinture.
« C’est trop, dit-elle ; c’est plus que je n’en puis supporter. Le monde est trop immense : oh ! que ne suis-je encore sur la console près de la glace ! Je ne serai pas heureuse avant d’y être retournée. Je t’ai suivi dans le monde ; maintenant ramène-moi là-bas, si tu m’aimes véritablement. »
Et le ramoneur lui parla raison ; il lui rappela le vieux Chinois, et le Grand-général-commandant-en-chef-Jambe-de-Bouc. Mais elle sanglotait si fort, et elle embrassa si bien son petit ramoneur, qu’il ne put faire autrement que de lui céder, quoique ce fût insensé.
Ils se mirent à descendre avec beaucoup de peine par la cheminée, se glissèrent dans les tuyaux, et arrivèrent au poêle. Ce n’était pas certes un voyage d’agrément, et ils s’arrêtèrent à la porte du poêle sombre pour écouter et apprendre ce qui se passait dans la chambre.
Tout y était bien tranquille : ils mirent la tête dehors pour voir. Hélas ! Le vieux Chinois gisait au milieu du plancher. Il était tombé en bas de la console en voulant les poursuivre, et il s’était brisé en trois morceaux. Tout le dos s’était détaché du reste du corps, et la tête avait roulé dans un coin. Le Grand-général-commandant-en-chef-Jambe-de-Bouc conservait toujours la même position et réfléchissait.
« C’est terrible, dit la petite bergère, le vieux grand-père s’est brisé, et c’est nous qui en sommes la cause ! Oh ! je ne survivrai jamais à ce malheur ! »
Et elle tordait ses petites mains.
« On pourra encore le recoller, dit le ramoneur ; oui, on pourra le recoller. Allons, ne te désole pas ; si on lui recolle le dos et qu’on lui mette une bonne attache à la nuque, il deviendra aussi solide que s’il était tout neuf, et pourra encore nous dire une foule de choses désagréables.
— Tu crois ? », dit-elle.
Et ils remontèrent sur la console où ils avaient été placés de tout temps.
« Voilà où nous en sommes arrivés, dit le ramoneur ; nous aurions pu nous épargner toute cette peine.
— Oh ! Si seulement notre vieux grand-père était recollé ! dit la bergère. Est-ce que ça coûte bien cher ? »
Et le grand-père fut recollé. On lui mit aussi une bonne attache dans le cou, et il devint comme neuf. Seulement il ne pouvait plus hocher la tête.
« Vous faites bien le fier, depuis que vous avez été cassé, lui dit le Grand-général-commandant-en-chef-Jambe-de-Bouc. Il me semble que vous n’avez aucune raison de vous tenir si roide ; enfin, voulez-vous me donner la main, oui ou non ? »
Le ramoneur et la petite bergère jetèrent sur le vieux Chinois un regard attendrissant : ils redoutaient qu’il ne se mît à hocher la tête ; mais il ne le pouvait pas, et il aurait eu honte de raconter qu’il avait une attache dans le cou.
Grâce à cette infirmité, les deux jeunes gens de porcelaine restèrent ensemble ; ils bénirent l’attache du grand-père, et ils s’aimèrent jusqu’au jour fatal où ils furent eux-mêmes brisés.
- ↑ En Allemagne, on monte souvent à la fenêtre par une marche en bois dans laquelle est pratiqué un tiroir.
Le Petit Cowboy

Je vais vous raconter l’histoire du petit cow-boy.
Un matin, le petit cow-boy prit son grand poney. Il mit son chapeau sur sa tête. Il accrocha sa ceinture autour de la taille. Monta sur son poney, et… En avant dans la grande prairie.
Au pas, au pas, au trot, au trot, au galop, au galop.
Et le petit cow-boy montait à toute vitesse dans les herbes folles de la grande prairie.
Et au bout d’un certain temps, il arriva dans la grande forêt.
Et là, il marcha sous les arbres, il avança. Il faisait sombre, et tout à coup, il arriva dans une grande clairière.
Et là, il y avait un énorme, horrible, affreux, monstrueux ours grizzly qui s’apprêtait à dévorer un pauvre, pauvre petit agneau tout fragile, qui tremblait de peur, qui disait non, non.
Alors le petit cow-boy cria vers le grand ours grizzly et lui dit
– Ours grizzly, retourne-toi.
L’ours grizzly se retourna et vit ce petit cow-boy de rien du tout sur son petit poney. Et il s’apprêta à le dévorer.
Et il était à l’autre bout de la clairière, donc l’ours prit son élan. Et il se précipita vers le petit cow-boy.
Et le petit cow-boy dit à son petit poney, saute, saute !
Et le petit poney sauta, fit un bond fantastique sur le côté et évita l’ours qui allait les dévorer.
Et l’ours, emporté par son élan, se fracassa la tête contre un grand chêne.
Il avait une énorme bosse sur le front.
Il était furieux, encore plus furieux.
Et il dit, je vais te dévorer.
Le petit cow-boy fit face à nouveau.
Et il sortit son grand pistolet qui était dans sa ceinture et il visa soigneusement pendant que l’ours se précipitait vers lui.
Il tira une balle juste entre les deux yeux de l’ours qui vint dans son élan, s’effondrait aux pieds du petit poney et donc du petit cow-boy.
Ah, il avait eu chaud quand même.
Alors, le petit cow-boy alla vers le tout petit mouton et lui dit:
– Mais qu’est-ce qui se passe ? Qu’est-ce que tu fais là, tout seul dans la forêt ?
– Je me suis perdu, j’ai perdu mes parents, dit le petit mouton.
– Où sont tes parents ?
– Je ne sais pas, je suis perdu.
– Bon, allez, viens, monte sur ma selle et on va trouver tes parents.
Et là, le petit cow-boy appela son ami, le petit oiseau, qui s’appelait Cui-Cui.
– Cui-Cui, Cui-Cui, viens, viens vite, j’ai besoin de toi.
Alors, il appela encore, Cui-Cui, j’ai besoin de toi.
Et là, on entendit un bruit d’aile, et le petit oiseau arriva à tir d’aile.
Et alors, le cow-boy lui dit:
– Cui-Cui, monte très haut dans le ciel, regarde à droite, à gauche, devant, derrière, et regarde si tu vois les parents du petit mouton qui doivent le chercher partout et qui doivent être désespérés.
– D’accord, dit le petit oiseau.
Il monta très haut, très haut dans le ciel, regarda à droite, à gauche, regarda devant et derrière, et il ne voyait rien.
– Je ne vois rien, dit le petit oiseau au petit cow-boy.
Alors le petit cow-boy lui dit:
– Monte encore plus haut !
Le petit oiseau monta encore plus haut et il regarda devant, derrière, à droite, à gauche.
Et tout au fond, de l’autre côté de la forêt, il vit un papa et une maman mouton qui étaient désespérés, qui appelaient leur petit désespérément.
– Je les ai trouvés ! dit le petit oiseau cui cui. Suivez-moi !
Et le petit cow-boy mit son poney au galop avec le petit mouton sur la selle. Et ils partirent au grand galop à travers la forêt, sautant par-dessus les ruisseaux et par-dessus les troncs d’arbres qui s’étaient effondrés.
Et ils galopaient, ils galopaient, les branches leur fouettaient le visage. Et ils traversèrent la forêt en un éclair.
Et de l’autre côté de la forêt, ils arrivèrent et ils trouvèrent le papa et la maman mouton qui cherchaient leur petit, qui continuaient à l’appeler.
– Ah, le voilà !
Le petit cowboy leur ramena leur petit enfant chéri.
Alors la maman mouton et le papa mouton remercièrent énormément le petit cow-boy.
Et la maman mouton dit:
– Venez à la maison, je vais faire un grand goûter.
Et alors, elle fit un fantastique goûter avec une tarte aux myrtilles, des crêpes au sucre, des chocolats chauds et même une tarte aux fraises. Et tout le monde se régala.
Le papa mouton vint vers le petit cow-boy et lui dit
– Petit cow-boy, je ne sais comment te remercier, tu as sauvé notre fils de l’horrible grizzly. Et tu seras toujours le bienvenu dans notre maison. Et nous t’invitons, notre porte te sera toujours ouverte.
Le petit cow-boy rentra chez lui, le ventre bien rempli et bien content d’avoir sauvé ce petit mouton.
Et mon histoire est terminée.
Images créés par l’IA de Bing Copilot Designer
Le voyage de Gulliver

Mon père, dont le bien était médiocre, avait cinq fils, j’étais le troisième; il m’envoya au collège d’Emmanuel, a Cambridge, à l’âge de quatorze ans. J’y demeurai trois années, que j’employai utilement ; mais la dépense de mon entretien au collége étant trop grande, on me mit en apprentissage sous M. Jacques Bâtes, fameux chirurgien à Londres, chez qui je demeurai quatre ans.
Bientôt après mon retour, j’eus, à la recommandation de mon bon maître, l’emploi de chirurgien sur l’Hirondelle, où je restai trois ans et demi, sous le capitaine Abraham Panell ; je fis, pendant ce temps-là, des voyages du Levant. A mon retour, je résolus de m’établir à Londres; M. Bates m’encouragea à prendre ce parti et me recommanda à ses malades, et bientôt après j’épousai mademoiselle Marie Burton, seconde fille de M. Édouard Burton. Après avoir attendu trois années et espéré en vain que mes affaires s’amélioreraient, j’acceptai un parti avantageux qui me fut proposé par le capitaine Prichard, prêt à monter l’Antelope et à partir pour la mer du Sud.
Il est inutile d’ennuyer le lecteur par le détail de nos aventures dans ces mers : c’est assez de lui faire savoir que, dans notre passage aux Indes-Orientales, nous essuyâmes une tempête. Le temps étant noir, les matelots aperçurent un roc qui n’était éloigné du vaisseau que de la longueur d’un câble; mais le vent était si fort que nous fûmes poussés directement contre l’écueil, et que nous échouâmes immédiatement. Six de l’équipage, dont je faisais partie, s’étant jetés à propos dans la chaloupe, et trouvèrent le moyen de se s’éloigner du vaisseau et du roc. Mais bientôt nous fûmes renversés par un coup de vent du nord.
Je ne sais quel fut le sort de mes camarades de la chaloupe, mais je crois qu’ils périrent tous ; pour moi, je nageai à l’aventure, et fus poussé vers la terre par le vent et la marée ;enfin mon pied toucha le sable dans l’eau et je rejoignis la plage. Je fis sensuite environ un quart de lieue sans découvrir aucune maison ni aucun habitant. La fatigue, la chaleur m’incitèrent à dormir et je me couchai sur l’herbe, qui était très-fine, et je fus bientôt enseveli dans un profond sommeil qui dura neuf heures. Au bout de ce temps-là, m’étant éveillé, j’essayai de me lever; mais ce fut en vain. Je m’étais couché sur le dos ; je trouvai mes bras et mes jambes attachés à la terre, de l’un et de l’autre côté, et mes cheveux attachés de la même manière.
Je ne pouvais que regarder en haut. J’entendis un bruit confus autour de moi, mais, dans la posture où j’étais, je ne pouvais rien voir que le soleil. Bientôt je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche, et avançant doucement sur ma poitrine, monter presque jusqu’à mon menton. Quel fut mon étonnement, lorsque j’aperçus une petite figure de créature humaine, haute tout au plus de six pouces, un arc et une flèche à la main !
J’en vis en même temps au moins quarante autres de la même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles, que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur. Néanmoins, ils revinrent bientôt, et un d’eux eut la hardiesse de s’avancer si près, qu’il fut en état de voir entièrement mon visage. Enfin, faisant des efforts pour me libérer, j’eus le bonheur de rompre les cordons ou fils, et d’arracher les chevilles. En même temps, par une secousse violente qui me causa une douleur extrême, je lâchai un peu les cordons qui attachaient mes cheveux du côté droit, en sorte que je me trouvai en état de procurer à ma tête un petit mouvement libre. Alors les insectes humains se mirent en fuite, et poussèrent des cris très-aigus.
Quand ces gens eurent remarqué que j’étais tranquille, j’entendis un bruit pendant plus d’une heure, comme des gens qui travaillaient. Enfin, tournant un peu ma tête de ce côté-là, je vis un échafaud élevé de terre d’un pied et demi et une échelle pour y monter, d’où un d’entre eux, qui me semblait être une personne de condition, me fit une harangue assez longue. Je fis la réponse en peu de mots, c’est-à-dire, par un petit nombre de signes, mais je levai la main gauche et les deux yeux au soleil, comme pour le prendre à témoin, que je mourais de faim.
L’Hurgo (c’est ainsi que, parmi eux, on appelle un grand seigneur), m’entendit fort bien. Il descendit de l’échafaud, et ordonna que plusieurs échelles fussent appliquées à mes côtés, sur lesquelles montèrent bientôt plus de cent hommes qui se mirent en marche vers ma bouche, chargés de paniers pleins de viandes. Il y avait des épaules et des éclanches qui semblaient être du mouton, et fort bien cuisinées; mais plus petites que les ailes d’une alouette; j’en avalai deux ou trois d’une bouchée avec six pains. Après avoir mangé je me rendormis.
Tandis que je dormais, l’empereur de Lilliput (c’était le nom de ce pays), ordonna de me faire conduire vers lui.
On fit donc travailler à la hâte cinq mille charpentiers et ingénieurs pour construire une voiture. C’était un chariot élevé de trois pouces, ayant sept pieds de longueur et quatre de largeur, avec vingt-deux roues.
Quand il fut achevé, on le conduisit au lieu où j’étais; mais la principale difficulté fut de m’élever et de me mettre sur cette voiture. Dans cette vue, quatre-vingts perches, chacune de deux pieds de hauteur, furent employées, et des cordes très-fortes, de la grosseur d’une ficelle, furent attachées, par le moyen de plusieurs crochets, aux bandages que les ouvriers avaient ceints autour de mon cou, de mes mains, de mes jambes et de tout mon corps. Neuf cents hommes des plus robustes furent employés à élever ces cordes par le moyen d’un grand nombre de poulies attachées aux perches ; et de cette façon, en moins de trois heures de temps, je fus élevé, placé et attaché dans la machine. Pendant cette manœuvre, je dormais très-profondément. Quinze cents chevaux, chacun d’environ quatre pouces et demi de haut, furent attelés au chariot, et me traînèrent vers la capitale, éloignée d’un quart de lieue. Nous fimes une grande marche le reste de ce jour-là. Le lendemain, au lever du soleil, nous continuâmes notre voyage, et nous arrivâmes à cent toises des portes de la ville, sur le midi. L’empereur et toute sa cour sortirent pour nous voir.
A l’endroit où la voiture s’arrêta, il y avait un temple ancien, estimé le plus grand de tout le royaume. Il fut résolu que je serais logé dans ce vaste édifice. De chaque côté de la porte, il avait une petite fenêtre élevée de six pouces. A celle qui était du côté gauche, les serruriers de l’empereur attachèrent quatre-vingt-onze chaînes, semblables à celles qui sont attachées à la montre d’une dame d’Europe; elles furent par l’autre bout attachées à ma jambe gauche. En face de ce temple, il y avait une tour d’au moins cinq pieds de haut : c’était là que l’empereur devait monter avec plusieurs des principaux seigneurs de sa cour, pour avoir la commodité de me regarder à son aise. On ne peut imaginer le bruit et l’étonnement du peuple, quand il me vit debout et me promener.
L’empereur, à cheval, s’avança un jour vers moi, ce qui aurait pu lui coûter cher. A ma vue, son cheval étonné se cabra; mais ce prince, qui est un cavalier excellent, se tint ferme sur ses étriers. Sa Majesté, après avoir mis pied à terre, me considéra de tous côtés avec une grande admiration.
L’impératrice, les princes et princesses du sang s’assirent à quelque distance dans des fauteuils.
Au bout de deux heures, la cour se retira, et on me laissa une forte garde, pour empêcher l’impertinence de la populace. Quelques-uns d’entre eux eurent l’effronterie et la témérité de me tirer des flèches, dont une faillit me crever l’œil gauche : mais le colonel fit arrêter six des principaux délinquants, et jugea que la meilleure peine à leur faute était de me les livrer, liés et garrottés. Je les pris donc dans ma main droite, et en mis cinq dans la poche de mon justaucorps; et à l’égard du sixième, je feignis de le vouloir manger tout vivant. Le pauvre petit homme poussait des hurlements horribles, et le colonel avec ses officiers étaient fort en peine, surtout quand ils me virent tirer mon canif. Mais je fis bientôt cesser leur frayeur; car, avec un air doux et humain, coupant promptement les cordes dont il était garrotté, je le mis doucement à terre et il prit la fuite. Je traitai les autres de la même façon, les tirant successivement l’un après l’autre de ma poche.
.Je remarquait avec plaisir que les soldats et le peuple avaient été très-touchés de cette action d’humanité.
Les premiers mots que j’appris dans la langue de Lilliput furent pour faire savoir à l’empereur l’envie que j’avais qu il voulût bien me rendre ma liberté. Sa réponse fut qu’il fallait attendre encore un peu de temps.
L’empereur, ayant un jour donné ordre à une partie de son armée de se tenir prête, voulut se réjouir d’une façon très-singulière. Il m’ordonna de me tenir debout, les deux pieds aussi éloignés l’un de l’autre que je les pourrais étendre commodément. Ensuite il commanda à son général de ranger les troupes en ordre de bataille et de les faire passer entre mes deux jambes, l’infanterie par vingt-quatre de front, et la cavalerie par seize, tambours battant, enseignes déployées. Ce corps était composé de trois mille hommes d’infanterie et de mille de cavalerie.
J’avais présenté ou envoyé tant de mémoires et de requêtes pour ma liberté, que Sa Majesté, à la fin, proposa l’affaire, premièrement au conseil des dépêches, et puis au conseil d’État, et l’acte suivant fut rédigé.
« Sa très-haute Majesté propose à l’homme Montagne les articles suivants, lesquels, pour préliminaire, il sera obligé de ratifier par un serment solennel.
« 1. L homme Montagne ne sortira pas de nos vastes États sans notre permission scellée du grand sceau.
« 2. Il ne prendra point la liberté d’entrer dans notre capitale sans notre ordre exprès, afin que les habitants soient avertis deux heures auparavant de se tenir enfermés chez eux.
« 3. Ledit homme Montagne bornera ses promenades à nos principaux grands chemins, et se gardera de se promener ou de se coucher dans un pré ou pièce de blé.
« 4. Il sera notre allié contre nos ennemis de l’ile de Blefuscu, et fera tout son possible pour faire périr la flotte qu’ils arment actuellement pour débarquer sur nos terres.
« 5. Après avoir fait le serment d’observer les articles ci-dessus énoncés, ledit homme Montagne aura une provision journalière de viande et de boisson suffisante à la nourriture de dix-huit cent soixante de nos sujets, avec un accès libre auprès de notre personne impériale et autres marques de notre faveur. »
Je prêtai le serment, et signai tous ces articles avec une grande joie.
L’empire de Blefuscu est une île située au nord-est de Lilliput, dont elle n’est séparée que par un canal qui à 400 toises de large. Je ne l’avais pas encore vu, et sur l’avis d’une descente projetée, je me gardais bien de paraître de ce côté-là, de peur d’être découvert par quelques-uns des vaisseaux de l’ennemi.
Je fis part à l’empereur d’un projet que j’avais formé pour me rendre maître de toute la flotte des ennemis.
Je m’en allai secrètement vers la côte, et, me couchant derrière une colline, je tirai ma lunette et vis la flotte de l’ennemi, composée de cinquante vaisseaux de guerre et d’un grand nombre de vaisseaux de transport. M’étant ensuite retiré, je donnai ordre de fabriquer une grande quantité de câbles, les plus forts qu’on pourrait, avec des barres de fer. Je triplai le câble pour le rendre encore plus fort, et, pour la même raison, je tortillai ensemble trois des barres de fer, et attachai à chacune un crochet. Je retournai à la côte, et mettant bas mon justaucorps, mes souliers, puis j’entrai dans la mer. Je marchai d’abord dans l’eau avec toute la vitesse que je pus, et ensuite je nageai au milieu jusqu’à ce que j’eusse trouvé pied. J’arrivai à la flotte en moins d’une demi-heure.
Les ennemis furent si frappés à mon aspect, qu’ils sautèrent tous hors de leurs vaisseaux et s’enfuirent à terre : Je pris alors mes câbles, et, attachant un crochet au trou de la proue de chaque vaisseau, je passai mes câbles dans les crochets. Je tirai aisément les plus gros vaisseaux, et les entraînai avec moi.
Les Blefuscudiens, qui n’avaient point d’idée de ce que je projetais, furent également surpris et confus ; mais quand ils me virent entraîner toute la flotte à la fois, ils jetèrent des cris de rage et de désespoir.
L’empereur et toute sa cour étaient sur le bord de la mer, attendant le succès de mon entreprise. Ils voyaient de loin avancer une flotte sous la forme d’un grand croissant ; mais comme j’étais dans l’eau jusqu’au cou, ils ne s apercevaient pas que c’était moi qui la conduisait vers eux.
L’empereur crut donc que j’avais péri, et que la flotte de l’ennemi s’approchait pour faire une descente. Mais ses craintes furent bientôt dissipées ; car, ayant pris pied, on me vit à la tête de tous les vaisseaux, et on m’entendit crier d’une voix forte : Vive le très-puissant empereur de Lilliput ! Ce prince, à mon arrivée, me donna des louanges infinies, et sur-le-champ me fit nommé nardac, ce qui est le plus beau titre d’honneur parmi eux.
Sa Majesté me pria de prendre des mesures pour amener dans ses ports les autres vaisseaux de l’ennemi. L’ambtion de ce prince ne lui faisait prétendre rien moins que de se rendre maître de tout l’empire de Blefuscu, de le réduir en province de son empire, et de le faire gouverner par un vice-roi. Mais je tâchai de le détourner de ce dessein par plusieurs raisonnements fondés sur la politique et sur la justice ; et je protestai hautement que je ne serais jamais l’instrument dont il se servirait pour opprimer la liberté d’un peuple libre, noble et courageux.
Cette déclaration était si opposée aux projets de Sa Majesté impériale, qu’il ne put me le pardonner.
EnvIron trois semaines après mon expédition éclatante, il arriva une ambassade solennelle de Blefuscu avec des propositions de paix. Le traité fut bientôt conclu à des conditions très avantageuses pour l’empereur.
Après la conclusion du traité, Leurs Excellences étant averties secrètement des bons offices que j’avais rendus à leur nation, par la manière dont j’avais parlé à l’empereur, me rendirent une visite en cérémonie. Ils m’invitèrent, au nom de leur maître, à passer dans son royaume. Je les remerciai, et les priai de me faire l’honneur de présenter mes très-humbles respects à Sa Majesté blefuscudienne. Je promis de me rendre auprès de sa personne royale avant que de retourner dans mon pays.
Peu de jours après, je demandai à l’empereur la permission de faire mes compliments au grand roi de Blef uscu; Il me répondit froidement qu’il le voulait bien.
J’eus occasion de rendre à Sa Majesté impériale un service très-signalé. Je fus un jour réveillé sur le minuit par les cris d’une foule de peuple assemblée à la porte de mon hôtel. Caertaines personnes de la cour de l’empereur, s’ouvrant un passage à travers la foule, me prièrent de venir incessamment au palais, où l’appartement de l’impératrice était en feu. Je me levai à l’instant et me transportai au palais, où j’eus le bonheur d’éteindre le feu.
J’ignorais si l’empereur me saurait gré du service que je venais de lui rendre ; car, par les lois fondamentales de l’empire, c’était un crime capital et digne de mort de faire de l’eau dans le palais impérial. Le conseil s’assembla, et je fus condamné à avoir les yeux crevés. Enfin je pris une résolution. Ayant eu ci-devant la permission de Sa Majesté impériale de me rendre auprès du roi de Blefuscu, je m’avançai vers la côte de l’île où était la flotte.
Je me saisis d’un gros vaisseau de guerre, j’attachai un câble à la proue, et, levant les ancres, je me déshabillai, mis mon habit avec ma couverture, que j’avais apportée sous mon bras, sur le vaisseau, puis, le tirant après moi, tantôt guéant, tantôt nageant, j’arrivai au port royal de Blefuscu, où le peuple m’avait attendu longtemps. On m’y fournit deux guides pour me conduire à la capitale, qui porte le même nom. Je les tins dans mes mains jusqu’à ce que je fusse arrivé à cent toises de la porte de la ville, et je les priai de donner avis de mon arrivée et de faire savoir que j’attendais les ordres de Sa Majesté. Je reçus réponse que Sa Majesté, avec toute la maison royale, venait pour me recevoir. Je m’avançai cinquante toises ; le roi et sa suite descendirent de leurs chevaux, et je n’aperçus pas qu’ils eussent peur de moi. Je dis à Sa Majesté que j’étais venu suivant ma promesse, et avec la permission de l’empereur mon maître, mais sans parler de ma disgrâce.
Trois jours après mon arrivée, me promenant par curiosité vers la côte de l’île qui regarde le nord-est, je découvris, à une demi-lieue de distance dans la mer, quelque chose qui me sembla être un bateau renversé. Je tirai mes souliers, et, allant dans l’eau, je vis que l’objet s’approchait et je connus alors que c’était une chaloupe.
Je fus dix jours à faire entrer ma chaloupe dans le port. Je dis au roi que ma bonne fortune m’avait fait rencontrer ce vaisseau pour me transporter à quelque autre endroit, d’où je pourrais retourner dans mon pays natel, je priai Sa Majesté de vouloir bien donner ses ordres pour mettre ce vaisseau en état de me servir.
Au bout d’environ un mois, quand tout fut prêt, j’allai pour recevoir les ordres de Sa Majesté et pour prendre Congé d’elle.
Je chargeai sur ma chaloupe cent bœufs et trois cents moutons, avec du pain et de la boisson à proportion. Je pris avec moi six vaches et deux taureaux vivants, et un même nombre de brebis et de béliers, ayant dessein de les porter dans mon pays pour en multiplier l’espèce. Ainsi préparé, je mis à la voile.
À environ vingt quatre lieues, je découvris un navire. Je mis toutes mes voiles, et au bout d’une demi- heure, le navire m’ayant apeçu, arbora son pavillon. Le navire cargua ses voiles et je le rejoignis. J’étais transporté de joie de voir le pavIllon d’Angleterre. Je rencontrai un de mes anciens camarades, nommé Pierre Williams, qui parla de moi en bien au capitaine. Ce galant homme me fit un très bon accueil, et me pria de lui apprendre d’où je venais et où j allais ; ce que je fis en peu de mots : mais il crut que la fatigue et les périls que j’avais courus m’avaient fait tourner la tête ; sur quoi je tirai mes vaches et mes moutons de ma poche, ce qui le jeta dans un grand étonnement, en lui faisant voir la vérité de ce que je venais de lui raconter.
Pendant le peu de temps que je restais en Angleterre, je fis un profit considérable, en montrant mes petits animaux à plusieurs gens de qualité, et avant que je commençasse mon second voyage, je les vendis.
Je ne restai que deux mois avec ma femme et ma famille : la passion insatiable de voir les pays étrangers ne me permit pas d’être plus longtemps sédentaire. Je laissai quinze cents livres sterling à ma femme, je portai le reste de ma fortune avec moi, partie en argent et partie en marchandises, dans la vue d’augmenter mes fonds.
Je dis adieu à ma femme, à mon fils et à ma fille ; et, malgré beaucoup de larmes qu’on versa je montai courageusement sur l’Aventure, vaisseau commandé par le capitaine Jean-Nicolas, de Liverpool.
Nous mîmes à la voile, et notre voyage fut heureux jusqu’au détroit de Madagascar. Mais, étant arrivés au nord de cette île, nous fûmes poussés à l’orient des îles Moluques.
Le 16 juin 1703, un matelot découvrit une grande île ou un continent.
Nous jetâmes l’ancre à une lieue de cette île; notre capitaine envoya douze hommes de son équipage, bien armés, dans la chaloupe, avec des vases pour l’eau, si l’on en pouvait trouver. Je lui demandai la permission d’aller avec eux. Quand nous fûmes à terre, nous ne vîmes ni rivière, ni fontaine, ni aucuns vestiges d’habitants, ce qui obligea nos gens à côtoyer le rivage pour chercher de l’eau fraîche proche de la mer. Pour moi, je me promenai seul ; je ne remarquai qu’un pays stérile. Je commençai à me lasser, et je m’en retournais doucement, lorsque je vis nos hommes sur la chaloupe, qui semblaient s’efforcer, à grands coups de rames, de sauver leur vie, et je remarquai en même temps qu’ils étaient poursuivis par un homme d’une grandeur prodigieuse. Quoiqu’il fût entré dans la mer, il n’avait de l’eau que jusqu’aux genoux, et faisait des enjambées étonnantes ; mais nos gens avaient pris le devant d’une demi-lieue ; le grand homme ne put atteindre la chaloupe. Pour moi, je me mis à fuir aussi vite que je pus.
Je marchai pendant une heure et j’arrivai à l’extrémité d’un champ enclos d’une haie haute au moins de cent vingt pieds; pour les arbres, ils étaient si grands, qu’il me fut impossible d’en estimer la hauteur.
Je tâchais de trouver quelque ouverture dans la haie, quand je découvris un des habitants dans le champ voisin, de la même taille que celui que j’avais vu dans la mer poursuivant notre chaloupe. Il me parut aussi haut qu’un clocher d’église. Je fus frappé d’une frayeur extrême et je courus me cacher dans le blé, d’où je le vis arrêté à une ouverture de la haie, jetant les yeux çà et là et appelant d’une voix plus grosse et plus retentissante que si elle fût sortie d’un porte-voix. Aussitôt sept hommes de sa taille s’avancèrent vers lui, chacun une faucille à la main. Selon les ordres qu’il leur donna, ils allèrent pour couper le blé dans le champ où j’étais couché.
Un des moissonneurs, s’approchant à cinq toises du sillon où j’étais couché, me fit craindre qu’en faisant encore un pas je ne fusse écrasé sous son pied, ou coupé en deux par sa faucille : c’est pourquoi, le voyant près de lever le pied et d’avancer, je me mis à jeter des cris pitoyables et aussi forts que la frayeur dont j’étais saisi me le put permettre. Aussitôt le géant s’arrêta, et, regardant autour et au-dessous de lui avec attention, il m’aperçut enfin. Il me considéra quelque temps avec la circonspection d’un homme qui tâche d’attraper un petit animal dangereux, d’une manière qu’il n’en soit ni égratigné ni mordu. Enfin il eut la hardiesse de me prendre par les deux fesses et de me lever à une toise et demie de ses yeux, afin d’observer ma figure plus exactement. Je devinai son intention, et je résolus de ne faire aucune résistance, quoiqu’il me serrât très-cruellement les fesses. Tout ce que j’osai faire, fut de lever mes yeux vers le soleil, de mettre mes mains dans la posture d’un suppliant, et de dire quelques mots d’un accent très-humble et très-triste, car je craignais à chaque instant qu’il ne voulût m’écraser. Je lui faisais entendre, autant que je pouvais, combien il me faisait de mal par son pouce et par son doigt. Il me parut qu’il comprenait la douleur que je ressentais, car, levant un pan de son justaucorps, il me mit doucement dedans, et aussitôt il courut vers son maître, qui était le même que j’avais vu d’abord dans le champ.
Le laboureur prit un petit brin de paille, environ de la grosseur d’une canne dont nous nous appuyons en marchant, et avec ce brin leva les pans de mon justaucorps, qu’il me parut prendre pour une espèce de couverture que la nature m’avait donnée. Il souffla mes cheveux pour mieux voir mon visage, ensuite il me plaça doucement à terre sur les quatre pattes; mais je me levai aussitôt et marchai gravement, allant et venant, pour faire voir que je n’avais pas envie de m’enfuir.
Le laboureur fut alors persuadé qu’il fallait que je fusse une petite créature raisonnable. Il renvoya ses gens à leur travail, et, tirant son mouchoir de sa poche, il le plia en deux et l’étendit à terre, me faisant signe d’entrer dedans, ce que je pus faire aisément. Il m’emporta chez lui. Là, il appella sa femme et me montra à elle; mais elle jeta des cris effroyables et recula, comme font les femmes en Angleterre à la vue d’un crapaud ou d’une araignée. Cependant, lorsqu’au bout de quelque temps elle eut vu toutes mes manières, et comment j’observais les signes que faisait son mari, elle commença à m’aimer très-tendrement.
Il était environ l’heure de midi, et alors un domestique servit le dîner. Le laboureur, sa femme, trois enfants et une vieille grand’mère composaient la compagnie Lorsqu’ils furent assis, le fermier me plaça à quelque distance de lui sur la table.
La femme coupa un morceau de viande, ensuite elle émietta du pain sur une assiette de bois qu’elle plaça devant moi. Je lui fis une révérence, et, tirant mon couteau et ma fourchette, je me mis à manger; ce qui leur donna un très grand plaisir.
Sur la fin du dîner, la nourrice entra portant entre ses bras un enfant de l’âge d’un an, qui, aussitôt qu’il m’aperçut, poussa des cris. L’enfant, me regardant comme une poupée, criait afin de m’avoir. La mère m’éleva et me donna à l’enfant, qui se saisit bientôt de moi et mit ma tête dans sa bouche, où je commençai à hurler si horriblement, que l’enfant, effrayé, me laissa tomber. Je me serais infailliblement cassé la tête, si la mère n’avait pas tenu son tablier sous moi.
J’étais bien fatigué et j’avais une grande envie de dormir. Ma maîtresse me mit dans son lit et me couvrit avec son mouchoir; deux rats grimpèrent le long des rideaux, et se mirent à courir sur le lit. L’un approcha de mon visage, sur quoi je me levai tout effrayé et mis le sabre à la main pour me défendre. Ces animaux horribles eurent l’insolence de m’attaquer des deux côtés; mais je fendis le ventre à l’un et l’autre s’enfuit.
Bientôt après ma maîtresse entra dans la chambre, et, me voyant tout couvert de sang, elle accourut et me prit dans sa main. Je lui montrai avec mon doigt le rat mort, en souriant et en faisant d’autres signes, pour lui faire entendre que je n’étais pas blessé ; ce qui lui donna de la joie.
Je fus présenté à la reine. Sa Majesté et sa suite furent extrêmement diverties de mes manières. Elle me demanda si je serais bien aise de vivre à la cour. Je répondis humblement que j’étais l’esclave de mon maître; mais que s’il ne dépendait que de moi, je serais charmé de consacrer ma vie au service de Sa Majesté. Elle demanda ensuite à mon maître s’il voulait me vendre. Il fut ravi de la proposition et fixa le prix de ma vente à mille pièces d’or, qu’on lui compta sur-le-champ. Je dis alors à la reine que, puisque j’étais devenu un humble esclave de Sa Majesté, je lui demandais la grâce que Glumdalclitch, qui avait toujours eu pour moi tant d’attention, d’amitié et de soin, fut admise à l’honneur de son service, et continuât d’être ma gouvernante. Sa Majesté y consentit.
La reine donna ordre à son ébéniste de faire une boîte qui pût me servir de chambre à coucher, suivant le modèle que Glumdalclitch et moi nous lui donneriens. Cet homme me fit, en trois semaines, une chambre de bois de seize pieds en carré et de douze de haut, avec des fenêtres, une porte et deux cabinets.
La reine, qui m’entretenait souvent de mes voyages sur mer, cherchait toutes les occasions de me divertir.
Elle me demanda un jour si j’avais l’adresse de manier une voile et une rame, et si un peu d’exercice de ce genre ne serait pas convenable à ma santé. Sa Majesté me dit que, si je voulais, son menuisier me ferait une petite barque et qu’elle me trouverait un endroit où je pourrais naviguer. Le menuisier, suivant mes instructions, dans l’espace de dix jours, me construisit un petit navire avec tous ses cordages. Quand il fut achevé, la reine donna ordre au menuisier de faire une auge de bois longue de trois cents pieds, large de cinquante et profonde de huit, qui fut posée sur le plancher, le long de la muraille, dans une salle extérieure du palais.
Dans cet exercice, il m ‘arriva une fois un accident qui pensa me coûter la vie : un des domestiques, dont la fonction était de remplir mon auge d’eau fraîche, fut si négligent, qu’il laissa échapper de son seau une grenouille très-grosse sans l’apercevoir. La grenouille se tint cachée jusqu’à ce que je fusse dans mon navire; alors, voyant un endroit pour se reposer, elle y grimpa, et le fit tellement pencher que je me trouvai obligé de faire contre poids de l’autre côté pour empêcher le navire de s’enfoncer; mais je l’obligeai, à coups de rames, de sauter dehors.
Il y avait deux ans que j’étais dans ce pays. Au commencement de la troisième année, Glumdalclitch et moi étions à la suite du roi, dans un voyage qu’il faisait. J’étais porté à mon ordinaire dans ma boîte de voyage.
On avait, par mon ordre, attaché un brancard avec des cordons de soie aux quatre coins du haut de la boîte, afin que je sentissent moins les secousses du cheval, sur lequel un domestique me portait devant lui.
Quand nous fûmes arrivés au terme de notre voyage, le roi jugea à propos de passer quelques jours à une maison de plaisance qu’il avait près de la mer. J’eus envie de voir l’Océan. Je fis semblant d’être malade, et je demandai la liberté de prendre l’air de la mer, avec un page à qui j’avais été confié parfois.
Le page me porta donc dans ma boîte, et me mena vers les rochers, sur le rivage de la mer. Je lui dis alors de me mettre à terre, et, levant le châssis d’une de mes fenêtres, je me mis à regarder la mer d’un œil triste.
Je dis ensuite au page que j’avais envie de dormir un peu dans mon brancard, et que cela me soulagerait. Le page ferma bien la fenêtre, de peur que je n’eusse froid : je m’endormis bientôt. Tout ce que je puis conjecturer, c’est que, pendant que je dormais, je me trouvai soudainement éveillé par une secousse violente donnée à ma boîte, que je sentis tirée en haut, ët ëhsuîte portée en avant avec une vitesse prodigieuse. Je regardai à travers ma fenêtre, et je ne vis que des nuages. J’entendais un bruit horrible au-dessus de ma tête, ressemblant à un battement d’ailes. Alors je commençai a connaître le dangereux état où je me trouvais, et à soupçonner qu’un aigle avait pris le cordon de ma boîte en son bec, dans le dessein de la laisser tomber sur quelque rocher, et d’en tirer mon corps pour le dévorer.
Au bout de quelques temps, je remarquai que le bruit et le battement d’ailes s’augmentait beaucoup, et que ma boîte était agitée çà et là. J’entendis plusieurs coups violents qu’on donnait à l’aigle, et puis, tout à coup, je me sentis tomber perpendiculairement pendant plus d’une minute, mais avec une vitesse incroyable. Ma chute fut terminée par une secousse terrible, après quoi je fus dans les ténèbres pendant une autre minute, et alors ma boîte commença à s’élever de manière que je pus voir le jour par le haut de mes fenêtres.
Je connus alors que j’étais tombé dans la mer, et que ma boite flottait.
Dans cette déplorable situation, j’entendis, ou je crus entendre du bruit à côté de ma boîte, et bientôt après je commençai à m’imaginer qu’elle était tirée et en quelque façon remorquée; car, de temps en temps, je sentais une sorte d’effort qui faisait monter les ondes jusqu’au haut de mes fenêtres. J’attachai mon mouchoir à un bâton que j’avais, et, le haussant par l’ouverture, je l’agitai dans l’air, afin que si quelque barque ou vaisseau était proche, les matelots pussent conjecturer qu’il y avait un malheureux mortel renfermé dans cette boîte.
Au bout d’une heure, je sentis qu’elle heurtait quelque chose de très dur. Je craignis d’abord que ce ne fût un rocher, et j’en fus très-alarmé. J’entendis alors distinctement du bruit sur le toit de ma boîte, comme celui d’un câble. Ensuite je me trouvai haussé peu à peu, au moins de trois pieds plus haut que je n’étais auparavant; sur quoi je levai encore mon bâton et mon mouchoir, criant au secours. Pour réponse, j’entendis de grandes acclamations qui me donnèrent des transports de joie qui ne peuvent être conçus que par ceux qui les sentent. En même temps j’entendis marcher sur le toit, et quelqu’un appelant par l’ouverture et criant en anglais : Y a-t-il quelqu’un là ? Je répondis : Hélas ! oui. Je suis un pauvre Anglais réduit par la fortune à la plus grande calamité : au nom de Dieu, délivrez-moi de ce cachot. La voix me répondit : « Rassurez-vous, vous n’avez rien à craindre, votre boîte est attachée au vaisseau, et le charpentier va venir pour faire un trou dans le toit et vous tirer dehors. »
Le charpentier vint, et dans peu de minutes il fit un trou au haut de ma boîte, large de trois pieds, et me présenta une petite échelle, sur laquelle je montai. J’entrai dans le vaisseau dans un état très faible.
Notre voyage fut très-heureux, mais j’en épargnerai le journal ennuyeux au lecteur. Je ne sortis pas du vaisseau que nous ne fussions arrivés aux Dunes, environ neuf mois après ma délivrance. J’offris de laisser mes meubles en paiement de mon passage; mais le capitaine protesta qu’il ne voulait rien recevoir. Nous nous dîmes adieu très-affectueusement, et je lui fis promettre de me venir voir à Redriff.
Quand je me rendis à ma maison, que j’eus de la peine à reconnaître, un des domestiques ouvrant la porte, je me baissai pour entrer, de crainte de me blesser la tête : cette porte me semblait un guichet. Ma femme se baissa pour m’embrasser; mais je me courbai plus bas que ses genoux, songeant qu’elle ne pourrait autrement atteindre ma bouche. Ma fille se mit à mes genoux pour me demander ma bénédiction, mais je ne pus la distinguer que lorsqu’elle fut levée, ayant été depuis si longtemps accoutumé à me tenir debout, avec ma tête et mes yeux levés en haut. Je regardai tous mes domestiques, et un ou deux amis qui se trouvèrent dans la maison, comme s’ils avaient été des pygmées et moi un géant. Je dis à ma femme qu’elle avait été trop frugale, car elle s’était réduite elle-même et sa fille presque à rien. En un mot, je me conduisis d’une manière si étrange, qu’ils furent tous de l’avis du capitaine quand il me vit d’abord, et conclurent que j’avais perdu l’esprit, surtout quand je racontai que, dans un de mes voyages, je m’étais arrêté dans une île où les chevaux parlaient et où les hommes étaient privés de la parole et passaient leur vie à traîner les voitures.
Et voici pour finir quelques illustrations des autres voyages que je fis et que je vous raconterai une autre fois.
Le joueur de flûte de Hamelin

LE JOUEUR DE FLUTE DE HAMELIN
Il y a quelque cinq cents ans, un terrible fléau s’abattit sur Hamelin, une coquette petite ville de Hanovre, qui, du côté du sud, baigne dans le Weser le pied de ses maisons.
Des rats, venus on ne sait d’où, pullulèrent en quelques semaines dans tous les quartiers. Dévorer les fromages du crémier, défoncer les barils de harengs chez l’épicier, tels furent leurs premiers méfaits. On en rit. Bien à tort, car l’audace des rongeurs s’accrut avec leur nombre. Bientôt,
ils firent leurs nids dans les chapeaux de fête des Hameliniens, ils goûtèrent le contenu de la soupière familiale, ils tuèrent les chats et mordirent les bébés dans leurs berceaux. Que dis-je ! Les petits cris aigus et multipliés de ces rats, grands amateurs de festins et de querelles, devinrent une rumeur capable d’empêcher les commères attardées sur leurs seuils, le balai à la main, d’ouïr les propos de leurs voisines. C’en était trop !
Les gens de Hamelin se rendirent en foule à la maison commune et s’écrièrent :
« Notre bourgmestre est un incapable et nos échevins des ânes. Quelle pitié d’acheter des robes fourrées pour des gaillards qui n’ont pu encore trouver le moyen de nous débarrasser de cette vermine ! Ah çà ! messieurs, vous croyez peut-être, parce que vous avez del’âge et du ventre, être en droit de trouver, sous l’habit municipal, la tranquillité et la béatitude ! Allons, qu’on se trémousse ! Cherchez et trouvez un remède, messieurs, ou abandonnez le gouvernement de la cité. »
En entendant ces propos coupés d’invectives, le bourgmetre et les échevins se regardèrent consternés. Ils passèrent dans la salle des délibérations et s’assirent autour de la table du conseil. Dans un grand silence, le bourgmestre déclara :
« Je donnerais ma robe d’hermine pour un thaler et je voudrais être à cent lieues d’ici. Trouver un remède!… Cela est facile à dire. Voilà des semaines que je me torture la cervelle sans rien trouver. Il faudrait quelque piège perfectionné… »
Un léger bruit, à la porte, arrêta ce discours.
« Qu’est cela ? » dit le maire inquiet.
Le bruit reprit. Le maire lui trouvait une étroite analogie avec celui qu’il entendait toutes les nuits dans son grenier.
« Entrez ! » cria-t-il, courageusement.
Un personnage étrange s’avança. Un long manteau fait d’innombrables pièces d’étoffe de toutes les couleurs lui descendait jusqu’aux talons. Il était grand et maigre. De sa coiffure, pareille à un bonnet de coton, s’échappaient de longues mèches de cheveux roux. Son visage basané ne portait ni barbe ni moustache. Un sourire énigmatique passait par instants sur ses lèvres minces et ses deux yeux bleus vous pénétraient comme des lames.
De quelle contrée venait-il ? Aucun des assistants n’aurait su le dire. L’un d’eux hasarda :
« Si le grand-père de mon arrière-grand-père paraissait à l’instant, son air et sa mise ne m’étonneraient pas à ce point. »
« Excellence, dit l’inconnu, je puis, par un charme secret, enchaîner à mes pas toutes les créatures qui, sous le soleil, rampent, nagent, courent ou volent. Mais je n’exerce guère mon pouvoir que sur les bêtes que vous considérez comme nuisibles : taupes, crapauds, lézards, vipères. On’ m’appelle le joueur de flûte. »
A ce point de sa harangue, les yeux des échevins et de leur président se fixèrent sur une sorte de trompette suspendue à son cou par un ruban aussi bariolé que son manteau,et tous remarquèrent que les doigts du flûtiste s’agitaient autour de l’instrument comme impatients d’en jouer.
L’homme continua :
« Oui, le pauvre musicien que je suis a délivré, en juin dernier, le roi de Tartarie des nuées de moustiques qui obscurcissaient le ciel de sa patrie. C’est moi qui ai détruit les vampires carnassiers qui étaient le plus grand fléau de la Perse. Pour un millier de couronnes, je puis chasser de votre ville les rats qui l’infestent.
— Mille couronnes ! Vous en aurez cinquante mille, si vous réussissez, s’écrièrent d’une même voix le bourgmestre et les échevins.
— J’ai dit mille couronnes, ce sera mille, » répondit l’homme. Puis il s’inclina et sortit en souriant.
Dès qu’il fut dans la rue, il approcha la flûte de ses lèvres; de petites flammes semblaient danser dans ses yeux clairs. Ils n’avait pas joué deux mesures d’une aigre musique, qu’un murmure confus répondit à son appel. Bientôt, ce fut comme le bruit d’une armée en marche. Tous les rats sortaient des maisons. Il y en avait de noirs, de gris, de bruns, de fauves.
Les grands et les petits rats, les rats étiques et les rats replets, les vieux routiers à la peau tannée, les godelureaux aux fières babines, des familles de dix et de douze, des tribus-entières accouraient et se mettaient en dansant à suivre le magicien.
Ce dernier, continuant de jouer, les promena de rue en rue et les amena brusquement sur le bord du Weser, dans l’eau duquel tous plongèrent et disparurent. Je me trompe: l’un d’eux échappa, un gros rat vigoureux qui traversa le fleuve à la nage et courut jusqu’à Ratopolis annoncer la nouvelle du désastre.
« Il aurait fallu entendre, en ce jour mémorable, les cloches de Hamelin sonner à toute volée ; la vieille église en tait ébranlée jusque dans ses fondations. Le bourgmestre, radieux, donnait des ordres :
« Apportez de longues perches, criait-il, et fourrez-les dans les trous les plus profonds. Sortez les nids et détruisez-les.
Murez toutes les ouvertures. Consultez les charpentiers et les maçons, et qu’il ne reste, en notre belle ville, aucune trace de ces rats… »
Il s’arrêta net. Le magicien, debout devant lui, disait: « Voulez-vous, s’il vous plait, me remettre les mille couronnes. »
Mille couronnes ! La somme parut soudain énorme au bourgmestre et à ses conseillers. Les dîners qu’ils s’étaient offerts avaient presque épuisé leurs réserves de vin de la Moselle. Avec mille couronnes, on pouvait faire remplir le muid le plus ventru du plus vieux vin du Rhin. Il était rude de laisser les caves vides pour le plaisir de couvrir d’or un vagabond en habit d’arlequin.
« Mon ami, dit le maire, qui avait repris toute son assurance, l’affaire est maintenant bien finie. Nous avons vu de nos yeux les rats noyés descendre l’eau du fleuve. Les morts ne ressuscitent jamais. Certes, nous ne sommes pas gens à refuser de choquer notre verre avec vous après ce petit service ; mais, pour ce qui est des mille couronnes auxquelles vous faites allusion, vous savez bien que c’était pure plaisanterie de votre part. Tenez, voilà cent marcs. Vous n’avez pas perdu votre journée. »
Le joueur de flûte, stupéfait, s’écria :
«Cessez ce jeu. Je n’ai pas de temps à perdre. Je suis attendu à Bagdad par le premier cuisinier de la cour qui veut me faire goûter un potage de son invention. C’est tout ce qu’il peut m’offrir pour avoir purgé la cuisine du Calife des scorpions qui l’avaient envahie. Mais vous, magistrats de Hamelin, vous êtes riches. Vous m’aviez promis cinquante mille couronnes. Je me suis contenté de mille. Ne pensez pas que je vous fasse grâce d’un liard, et sachez que j’ai, pour ceux qui me font mettre en colère, un air de flûte qu’il vaut mieux pour vous ne jamais entendre. »
— Comment ! dit le maire furieux, tu me traites plus mal qu’un cuisinier. Vit-on jamais bourgmestre insulté et menacé par un vaurien incapable de gagner par son travail de quoi acheter un manteau d’une seule étoffe ? Va-t’en au diable, maraud, et puisses-tu faire éclater ta peau en soufflant dans ta trompette ! »
Sans mot dire, le magicien tourna les talons et approcha la flûte de ses lèvres. Il en tira quelques mesures d’une musique douce comme une brise parfumée et, tout aussitôt, il y eut, dans tous les quartiers, un remue-ménage inusité. Des centaines de petits pieds frappèrent le pavé de leurs sabots, des centaines de petites mains claquèrent joyeusement et des centaines de petites langues se mirent en mouvement.
Plus empressés que des volailles qui ont vu la fermière jeter une poignée de grains, les enfants de Hamelin accouraient. Tous, garçons joufflus, fillettes aux boucles blondes, marmots à peine échappés des bras de leurs mères, courant, sautant, bondissant, gesticulant, riant, criant de joie, suivaient enthousiasmés le musicien diabolique.
Le bourgmestre et les échevins, abasourdis, pareils à des statues de pierre, regardaient passer la bande joyeuse, incapables de faire un pas ou de pousser un cri. Les mères étaient impuissantes à retenir leurs enfants. Les pères, qui avaient brusquement quitté leur ouvrage, ne comprenaient pas encore ce qui se passait.
Tout à coup, ô terreur ! tout le monde comprit. Le magicien s’engageait dans la Grand’rue qui conduit au Weser !…
Cependant, contre toute prévision, le cortège, arrivé sur la rive, tourna vers l’ouest dans la direction du mont Koppel. Un grand espoir fit battre un instant tous les cœurs. Chacun se dit :
« Jamais ils ne graviront ces pentes abruptes. Courons vite à leur suite. »
Mais alors, il se passa une chose inouïe : une caverne s’ouvrit dans le flanc du mont ; le magicien s’y engagea, les enfants le suivirent et, quand ils eurent disparu, la caverne se referma sans laisser la trace d’aucune ouverture.
Seul, un grand garçon boiteux et quelque peu simple ne fut pas englouti. Il arriva trop tard, malgré le secours de sa béquille. Bien des années plus tard, il déclarait, quand on s’étonnait de sa mélancolie :
« La ville n’est pas bien gaie depuis que les compagnons de mon enfance l’ont quittée, et je ne puis oublier que je suis privé du plaisant séjour qui est maintenant leur partage. Le musicien m’avait pourtant promis, à moi aussi, de me conduire dans ce pays merveilleux où les fruits sont plus doux, les eaux plus claires et les fleurs plus belles que dans notre grise cité. Hélas ! au moment où je me croyais guéri, tant je courais vite, la musique s’arrêta et je me trouvai seul, contre ma volonté, hors de la montagne et! boiteux pour toujours… »
Hélas! hélas! Pauvres gens de Hamelin! Le bourgmestre eut beau envoyer des émissaires dans toutes les directions avec ordre d’offrir au musicien tout l’or qu’il désirerait s’il consentait à rendre les enfants, jamais ils ne revirent leurs garçons joufflus et leurs fillettes aux boucles blondes.
Alors, pour fixer le souvenir de leur malheur, ils inscrivirent le récit détaillé de cette lamentable aventure sur une colonne, à l’endroit où la caverne s’était ouverte, et aussi sur le plus beau vitrail de leur église où l’on peut encore le lire aujourd’hui.
Les archéologues locaux ne sont pas d’accord sur la date exacte où fut peint le vitrail, mais il n’est pas actuellement encore un seul habitant de Hamelin qui ne trouvera moyen de vous dire sentencieusement après cinq minutes de conversation :
« Payons nos dettes et tenons nos promesses, surtout celles que nous faisons aux joueurs de flûte. »
Adapté en 1913 d’une version anglaise par Fernand Gillard, Éditions Larousse. Illustrations B. Le Famu.
Tom Pouce

Il était une fois, dans un royaume lointain, un couple qui désirait ardemment un enfant. Un jour, leur souhait fut exaucé, mais d’une manière inattendue. Ils eurent un fils minuscule, pas plus grand qu’un pouce! Ils l’appelèrent Tom Pouce.
Malgré sa petite taille, Tom avait un cœur énorme et une audace sans fin. Il était toujours prêt à partir à l’aventure, même si cela signifiait monter sur le dos d’un chien pour se déplacer!
Un jour, Tom décida de partir à l’aventure dans la forêt. Il grimpa sur le dos de son fidèle destrier, un petit moineau, et s’envola. Cependant, un orage éclata et le pauvre Tom tomba dans une rivière. Il fut alors avalé par un poisson qui fut pêché et amené au château du roi.
Dans le ventre du poisson, Tom cria de toutes ses forces. Quand le cuisinier ouvrit le poisson, Tom en sortit, faisant sursauter tout le monde dans la cuisine! Le roi, impressionné par son courage, nomma Tom le plus petit chevalier du royaume.
Un jour, un dragon effrayant commença à terroriser le royaume. Le roi demanda à Tom Pouce, le plus petit chevalier, de sauver le royaume. Malgré sa taille, Tom était prêt à relever le défi.
Il grimpa sur son fidèle moineau et vola vers la montagne où vivait le dragon. En chemin, il rencontra une mouche qui lui proposa de l’aider. Tom accepta avec gratitude et ensemble, ils élaborèrent un plan.
Arrivé à la montagne, Tom utilisa sa petite taille pour se faufiler dans la grotte du dragon sans être vu. Il trouva le dragon en train de ronfler bruyamment, créant des flammes à chaque respiration.
Avec l’aide de la mouche, Tom grimpa dans la narine du dragon et commença à chatouiller l’intérieur avec une plume. Le dragon éternua si fort qu’il cracha toutes les flammes qu’il avait en lui. Épuisé, il promit de ne plus jamais terroriser le royaume.
Tom retourna au château sous les applaudissements et les rires de tous. Et c’est ainsi que Tom Pouce devint le héros du royaume, même face à un dragon!
Un jour, un papillon géant apparut, causant la panique dans le royaume. Le roi demanda à Tom Pouce, le plus petit chevalier, de résoudre ce problème. Malgré sa taille, Tom était prêt à relever le défi.
Il grimpa sur son fidèle moineau et vola vers le papillon. En chemin, il rencontra une coccinelle qui lui proposa de l’aider. Tom accepta avec gratitude et ensemble, ils élaborèrent un plan.
Arrivé près du papillon, Tom utilisa sa petite taille pour se faufiler sur le dos du papillon sans être vu. Il trouva le papillon en train de virevolter dans tous les sens, créant un vent fort à chaque battement d’ailes.
Avec l’aide de la coccinelle, Tom grimpa sur l’antenne du papillon et commença à lui chatouiller l’oreille avec une plume. Le papillon rit si fort qu’il arrêta de battre des ailes. Épuisé, il promit de ne plus jamais terroriser le royaume.
Tom retourna au château sous les applaudissements et les rires de tous. Il avait prouvé une fois de plus que peu importe notre taille, nous pouvons tous accomplir de grandes choses. Et c’est ainsi que Tom Pouce devint le héros du royaume, même face à un papillon géant!
Un jour, Tom rencontra une princesse qui était aussi petite que lui. Ils tombèrent amoureux et vécurent de nombreuses aventures ensemble. Finalement, ils se marièrent et vécurent heureux pour toujours.
Et c’est ainsi que Tom Pouce, le plus petit des héros, prouva que peu importe notre taille, nous pouvons tous accomplir de grandes choses. Et n’oubliez pas, la prochaine fois que vous verrez un petit moineau, cela pourrait être Tom Pouce en route pour sa prochaine aventure!
La reine des neiges

Il était une fois, dans un royaume lointain où l’hiver régnait en maître, vivait une jeune fille nommée Gerda et son meilleur ami Kai. Ils étaient inséparables, partageant chaque aventure ensemble sous la douce lueur des étoiles. Mais un jour, un éclat de miroir magique, lancé par la méchante Reine des Neiges, atteignit le cœur de Kai, le glaçant d’une froideur mystérieuse.
Kai devint distant, oubliant les rires et les jeux partagés avec Gerda. Jusqu’au jour où, attiré par le chant envoûtant de la Reine des Neiges, il disparut soudainement, laissant Gerda seule et désemparée.
Déterminée à retrouver son ami, Gerda entreprit un voyage courageux à travers les terres gelées. Sur son chemin, elle rencontra une famille de corbeaux bavards qui lui indiquèrent la direction du palais de glace de la Reine des Neiges. Elle rencontra également une bande de brigands au grand cœur qui lui offrirent leur amitié et leur protection.
Malgré les tempêtes de neige et les dangers qui l’entouraient, Gerda poursuivit sa quête avec détermination. Et enfin, elle atteignit le palais de glace, où elle trouva Kai assis à une table de glace, le regard vide et le cœur gelé.
Avec amour et tendresse, Gerda chanta une chanson qu’ils avaient l’habitude de partager, faisant fondre petit à petit la glace qui enserrait le cœur de Kai. Ses larmes chaudes tombèrent sur le visage de son ami, le réveillant de son enchantement glacial.
Kai retrouva alors sa chaleur et son amour pour Gerda, et ensemble, ils s’échappèrent du palais de glace, libres et victorieux. De retour chez eux, ils furent accueillis en héros par leur famille et leurs amis, et le royaume gelé se transforma en un paysage verdoyant et fleuri, débordant de vie et de bonheur.
Et ainsi, Gerda et Kai restèrent meilleurs amis pour toujours, ayant surmonté toutes les épreuves grâce à leur amour et leur courage, tandis que la méchante Reine des Neiges, privée de son pouvoir maléfique, fondit dans un éclat de lumière, laissant derrière elle un monde de paix et d’harmonie retrouvées.
La belle au bois dormant

De Charles Perrault
Il était une fois un roi et une reine qui étaient très tristes de n’avoir pas d’enfants. Ils rencontrèrent tous les médecins et les magiciens du monde. Et finalement la reine attendit un bébé et accoucha d’une fille.
À son baptême, on donna pour marraines à la petite princesse toutes les fées qu’on pût trouver dans le pays (il s’en trouva sept), afin que chacune d’elles lui fit un don, comme c’était la coutume des fées en ce temps-là, et que la princesse eût par ce moyen toutes les perfections imaginables.
Après les cérémonies du baptême, toute la compagnie revint au palais du roi où il y avait un grand festin pour les fées. On mit devant chacune d’elles un couvert magnifique, avec un étui d’or massif où il y avait une cuillère, une fourchette, et un couteau de fin or, garni de diamants et de rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille fée, qu’on n’avait pas invité, parce qu’il y avait plus de cinquante ans qu’elle n’était sortie de sa tour, et qu’on la croyait morte ou enchantée.
Le roi lui fit donner un couvert ; mais il ne pu lui donner un étui d’or massif comme aux autres, parce que l’on n’en avait fait faire que sept pour les sept fées. La vieille crut qu’on la méprisait, et grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes fées, qui se trouva auprès d’elle l’entendit ; et jugeant qu’elle pourrait donner quelque mauvais don à la petite princesse, alla, dès qu’on fut sorti de table se cacher derrière la tapisserie afin de parler la dernière, et de pouvoir réparer, autant qu’il lui serait possible, le mal que la vieille aurait fait.
Cependant les fées commencèrent à faire leurs dons à la princesse. La plus jeune lui donna pour don qu’elle serait la plus belle personne du monde ; celle d’après, qu’elle aurait de l’esprit comme un ange ; la troisième, qu’elle aurait une grâce admirable à tout ce qu’elle ferait ; la quatrième, qu’elle danserait parfaitement bien ; la cinquième, qu’elle chanterait comme un rossignol ; la sixième, qu’elle jouerait de toutes sortes d’instruments à la perfection. Le tour de la vieille fée étant venu, elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la princesse se percerait la main d’un fuseau, et qu’elle en mourrait.
Ce terrible don fit frémir toute la compagnie, et il n’y eût personne qui ne pleurât face à cette horrible prédiction. Dans ce moment la jeune fée sortit de derrière la tapisserie, et dit tout haut ces paroles :
— Rassurez-vous, roi et reine, votre fille n’en mourra pas ; il est vrai que je n’ai pas assez de puissance pour défaire entièrement ce que cette vieille fée a fait. La princesse se percera la main d’un fuseau ; mais au lieu d’en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera cent ans, au bout desquels le fils d’un roi viendra la réveiller.
Le roi, pour tâcher d’éviter le malheur annoncé par la vieille, fit publier aussitôt un édit, par lequel il défendait à toutes personnes de filer au fuseau, ni d’avoir des fuseaux chez soi, sur peine de la vie.
Au bout de quinze ou seize ans, alors que le roi et la reine étaient partis en voyage, la jeune princesse s’amusait à courir un jour dans le château, et montant de chambre en chambre, elle arriva jusqu’au haut d’un donjon dans une petite pièce, où une bonne vieille était là toute seule à filer sa quenouille. Cette bonne femme n’avait pas entendu parler de l’interdiction que le roi avait faites de filer au fuseau.
— Que faites-vous là, ma bonne femme ? dit la princesse.
— Je file, ma belle enfant, lui répondit la vieille qui ne la connaissait pas.
— Ah ! que cela est joli, reprit la princesse, comment faites-vous ? Donnez-le-moi que je voie si j’en ferais bien autant.
Elle n’eut pas plus tôt pris le fuseau, que comme elle était nerveuse, un peu étourdie, et que la prédiction des fées l’ordonnait ainsi, elle s’en perça la main, et tomba évanouie.
La bonne vieille, bien embarrassée, cria au secours : on vint de tous les côtés, on jeta de l’eau au visage de la princesse, on la dévêtue, on lui frappa dans les mains, on lui frotta les tempes avec de l’eau de la reine de Hongrie ; mais rien ne la faisait revenir.
Alors le roi, qui était monté au bruit, se souvint de la prédiction des fées, et jugeant bien qu’il fallait que cela arrivât, puisque les fées l’avaient dit, fit mettre la princesse dans le plus bel appartement du palais, sur un lit en broderie d’or et d’argent. On eût dit un ange, tant elle était belle ; car son évanouissement n’avait pas ôté les couleurs vives de son teint : ses joues étaient incarnates, et ses lèvres comme du corail ; elle avait seulement les yeux fermés, mais on l’entendait respirer doucement, ce qui faisait voir qu’elle n’était pas morte.
Le roi ordonna qu’on la laissât dormir en repos, jusqu’à ce que son heure de se réveiller fût venue. La bonne fée qui lui avait sauvé la vie en la condamnant à dormir cent ans, était dans le royaume de Mataquin, à douze mille lieues de là, lorsque l’accident arriva à la princesse ; mais elle en fut avertie en un instant par un petit nain, qui avait des bottes de sept lieues (c’était des bottes avec lesquelles on faisait sept lieues d’une seule enjambée).
La fée partit aussitôt, et on la vit au bout d’une heure arriver dans un chariot de feu, traîné par des dragons. Le roi alla la saluer à la descente du chariot. Elle approuva tout ce qu’il avait fait ; mais comme elle était très prévoyante, elle pensa que quand la princesse viendrait à se réveiller, elle serait bien embarrassée et toute seule dans ce vieux château : voici ce qu’elle fit.
Elle toucha de sa baguette tout ce qui était dans ce château (hors le roi et la reine), gouvernantes, filles d’honneur, femmes de chambre, gentilshommes, officiers, maîtres d’hôtel, cuisiniers, marmitons, galopins, gardes, suisses, pages, valets de pied ; elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries, avec les palefreniers, les gros chiens de bassecour, et la petite Pouffe, petite chienne de la princesse, qui était auprès d’elle sur son lit.
Dès qu’elle les eut touchés, ils s’endormirent tous, pour ne se réveiller qu’en même temps que leur maîtresse, afin d’être tout prêts à la servir quand elle en aurait besoin. Les broches mêmes, qui étaient au feu, toutes pleines de perdrix et de faisans, s’endormirent, et le feu aussi.
Tout cela se fit en un moment ; les fées n’étaient pas longues à leur besogne. Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur chère enfant sans qu’elle s’éveillât, sortirent du château, et firent publier des défenses à qui que ce soit d’en approcher. Ces défenses n’étaient pas nécessaires ; car il poussa, en un quart d’heure, tout autour du parc, une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et d’épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme n’y aurait pu passer ; en sorte qu’on ne voyait plus que le haut des tours du château, encore à condition d’être bien loin. On ne douta point que la fée n’eût fait là encore un tour de son métier, afin que la princesse, pendant qu’elle dormirait, n’eût rien à craindre des curieux.
Au bout de cent ans, le fils du roi qui régnait alors, et qui était d’une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la chasse de ce côté-là, demanda ce que c’était que des tours qu’il voyait au-dessus d’un grand bois fort épais. Chacun lui répondit selon qu’il en avait entendu parler. Les uns disaient que c’était un vieux château où il revenait des esprits ; les autres, que tous les sorciers de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion était qu’un ogre y demeurait, et que là il emportait tous les enfants qu’il pouvait attraper, pour les manger à son aise, et sans qu’on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au travers du bois.
Le prince ne savait qu’en croire, lorsqu’un vieux paysan prit la parole, et lui dit :
— Mon prince, il y a plus de cinquante ans que j’ai ouï dire à mon père qu’il y avait dans ce château une princesse, la plus belle qu’on eût su voir ; qu’elle y devait dormir cent ans et qu’elle serait réveillée par le fils d’un roi, à qui elle était réservée.
Le jeune prince, à ce discours, se sentit tout de feu ; il crut sans balancer qu’il mettrait fin à une si belle aventure ; et poussé par l’amour et par la gloire, il résolut de voir sur-le-champ ce qui en était. À peine s’avança-t-il vers le bois, que tous ces grands arbres, ces ronces et ces épines s’écartèrent d’elles-mêmes pour le laisser passer. Il marcha vers le château, qu’il voyait au bout d’une grande avenue où il entra ; et, ce qui le surprit un peu, il vit que personne de ses gens n’avait pas pu le suivre, parce que les arbres s’étaient rapprochés dès qu’il avait été passé. Il ne laissa pas de continuer son chemin : un prince jeune et amoureux est toujours vaillant. Il entra dans une grande avant-cour où tout ce qu’il vit d’abord était capable de le glacer de crainte.
C’était un silence affreux : l’image de la mort s’y présentait partout, et ce n’était que des corps étendus d’hommes et d’animaux, qui paraissaient morts. Il reconnut pourtant bien, au nez bourgeonné et à la face vermeille des suisses, qu’ils n’étaient qu’endormis, et leurs tasses où il y avait encore quelques gouttes de vin, montraient assez qu’ils s’étaient endormis en buvant.
Il passa une grande cour pavée de marbre ; il monta l’escalier, il entra dans la salle des gardes qui étaient rangés en haie, la carabine sur l’épaule, et ronflants de leur mieux. Il traversa plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames, dormant tous, les uns debout, les autres assis. Il entra dans une chambre toute dorée, et il vit sur un lit, dont les rideaux étaient ouverts de tous côtés, le plus beau spectacle qu’il eût jamais vu :
une princesse qui paraissait avoir quinze ou seize ans, et dont l’éclat resplendissant avait quelque chose de lumineux et de divin. Il s’approcha en tremblant et en admirant et se mit à genoux auprès d’elle.
Alors, comme la fin de l’enchantement était venue, la princesse s’éveilla ; et le regardant avec des yeux plus tendres qu’une première vue ne semblait le permettre :
— Est-ce vous, mon prince ? lui dit-elle, vous vous êtes bien fait attendre.
Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, ne savait comment lui témoigner sa joie et sa reconnaissance ; il l’assura qu’il l’aimait plus que lui-même. Ses discours étaient maladroits ; peu d’éloquence, beaucoup d’amour. Il était plus embarrassé qu’elle, et l’on ne doit pas s’en étonner ; elle avait eu le temps de songer à ce qu’elle aurait à lui dire, car la bonne fée, pendant un si long sommeil, lui avait procuré le plaisir des songes agréables.
Enfin il y avait quatre heures qu’ils se parlaient, et ils ne s’étaient pas encore dit la moitié des choses qu’ils avaient à se dire.
Cependant tout le palais s’était réveillé avec la princesse ; chacun songeait à faire sa charge, et comme ils n’étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim ; la dame d’honneur, pressée comme les autres, s’impatienta, et dit tout haut à la princesse que la viande était servie. Le prince aida la princesse à se lever ; elle était tout habillée et fort magnifiquement, mais il se garda bien de lui dire qu’elle était habillée comme sa
Grand-mère, et qu’elle avait un collet monté ; elle n’en était pas moins belle.
Ils passèrent dans un salon de miroirs, et y soupèrent, servis par les officiers de la princesse. Les violons et les hautbois jouèrent de vieilles pièces, mais excellentes, quoiqu’il y eût près de cent ans qu’on ne les jouât plus ; et après souper, sans perdre de temps, le grand aumônier les maria dans la chapelle du château, et la dame d’honneur leur tira le rideau : ils dormirent peu, la princesse n’en avait pas grand besoin, et le prince la quitta dès le matin pour retourner à la ville, où son père devait être en peine de lui.
Le prince lui dit qu’en chassant il s’était perdu dans la forêt, et qu’il avait couché dans la hutte d’un charbonnier, qui lui avait fait manger du pain noir et du fromage. Le roi son père, qui était un bonhomme, le crut ; mais sa mère n’en fut pas bien persuadée, et voyant qu’il allait presque tous les jours à la chasse, et qu’il avait toujours une raison en main pour s’excuser, quand il avait couché deux ou trois nuits dehors, elle ne douta plus qu’il n’eût quelque amourette ; car il vécut avec la princesse plus de deux ans entiers, et en eut deux enfants, dont le premier, qui fut une fille, fut nommée Aurore, et le second un fils qu’on nomma Jour, parce qu’il paraissait encore plus beau que sa sœur.
La reine essaya mainte fois de le faire parler; mais il n’osait jamais lui confier à son secret :
En effet il la craignait autant qu’il l’aimait, car elle était de race des ogres, et le roi ne l’avait épousée qu’à cause de ses grands biens. On disait même tout bas à la cour qu’elle avait les inclinations des ogres et qu’en voyant passer de petits enfants, elle avait toutes les peines du monde à se retenir de se jeter sur eux pour les dévorer; ainsi le prince ne voulut jamais rien dire.
Mais quand le roi fut mort, ce qui arriva au bout de deux ans, et qu’il se vit le maître, il déclara publiquement son mariage, et alla en grande cérémonie quérir la reine sa femme dans son château. On lui fit une entrée magnifique dans la capitale, où elle entra accompagnée de ses deux enfants.
Quelque temps après le roi alla faire la guerre à l’empereur Cantalabutte son voisin. Il laissa la régence du royaume à la reine sa mère, et lui recommanda fort sa femme et ses enfants : il devait être à la guerre tout l’été, et dès qu’il fut parti, la reine mère envoya sa bru et ses enfants à une maison de campagne dans les bois, pour pouvoir plus aisément assouvir son horrible appétit.
Elle y alla quelques jours après, et dit un soir à son maître d’hôtel :
— Je veux manger demain à mon dîner la petite Aurore.
— Ah ! madame, dit le maître d’hôtel…
— Je le veux, dit la reine (et elle le dit d’un ton d’ogresse qui a envie de manger de la chair fraîche), et je veux la manger à la sauce Robert.
Ce pauvre homme voyant bien qu’il ne fallait pas se jouer à une ogresse, prit son grand couteau, et monta à la chambre de la petite Aurore : elle avait pour lors quatre ans et vint en sautant et en riant se jeter à son cou, et lui demander un bonbon. Il se mit à pleurer : le couteau lui tomba des mains, et il alla dans la basse-cour couper la gorge à un petit agneau, et lui fit une si bonne sauce, que sa maîtresse l’assura qu’elle n’avait jamais rien mangé de si bon. Il avait emporté en même temps la petite Aurore, et l’avait donnée à sa femme, pour la cacher dans le logement qu’elle avait au fond de la basse-cour.
Huit jours après, la méchante reine dit à son maître d’hôtel :
— Je veux manger à mon souper le petit Jour.
Il ne répliqua pas, résolu à la tromper comme l’autre fois ; il alla chercher le petit Jour, et le trouva avec un petit fleuret à la main, dont il croisait le fer avec un gros singe ; il n’avait pourtant que trois ans. Il le porta à sa femme qui le cacha avec la petite Aurore, et donna à la place du petit Jour un petit chevreau fort tendre, que l’ogresse trouva admirablement bon.
Cela était fort bien allé jusque-là ; mais un soir cette méchante reine dit au maître d’hôtel :
— Je veux manger la reine à la même sauce que ses enfants.
Ce fut alors que le pauvre maître d’hôtel désespéra de la pouvoir encore tromper. La jeune reine avait vingt ans passés, sans compter les cent ans qu’elle avait dormi : sa peau était un peu dure, quoique belle et blanche ; et le moyen de trouver, dans la ménagerie, une bête aussi dure que cela ? Il prit la résolution, pour sauver sa vie, de couper la gorge à la reine, et monta dans sa chambre, dans l’intention de ne pas perdre plus de temps ; S’étant convaincu, il entra, le poignard à la main, dans la chambre de la jeune reine. Il ne voulut pourtant point la surprendre et il lui dit avec beaucoup de respect l’ordre qu’il avait reçu de la reine mère.
— Faites votre devoir, lui dit-elle, en lui tendant le col, exécutez l’ordre qu’on vous a donné ; j’irai revoir mes enfants, mes pauvres enfants que j’ai tant aimés.
Elle les croyait morts, depuis qu’on les avait enlevés sans lui rien dire.
— Non, non, madame, lui répondit le pauvre maître d’hôtel tout attendri, vous ne mourrez point, et vous allez tout de suite revoir vos enfants ; mais ce sera chez moi où je les ai cachés, et je tromperai encore la reine en lui faisant manger une jeune biche en votre place.
Il la mena aussitôt à sa chambre, et la laissant embrasser ses enfants et pleurer avec eux, il alla accommoder une biche, que la reine mangea à son souper, avec le même appétit que si c’eût été la jeune reine ; elle était bien contente de sa cruauté, et elle se préparait à dire au roi, à son retour, que les loups enragés avaient mangé la reine sa femme et ses deux enfants.
Un soir qu’elle rôdait à son ordinaire dans les cours et basses-cours du château à la recherche de quelque viande fraîche, elle entendit dans une salle basse le petit Jour qui pleurait, parce que la reine sa mère le grondait, à cause qu’il avait été méchant ; et elle entendit aussi la petite Aurore qui demandait pardon pour son frère. L’ogresse reconnut la voix de la reine et de ses enfants, et furieuse d’avoir été trompée, elle
commanda, dès le lendemain au matin, avec une voix épouvantable qui faisait trembler tout le monde, qu’on apportât au milieu de la cour une grande cuve, qu’elle fit remplir de crapauds, de vipères, de couleuvres et de serpents, pour y faire jeter la reine et ses enfants, le maître d’hôtel, sa femme et sa servante : elle avait donné l’ordre de les amener les mains liées derrière le dos.
Ils étaient là, et les bourreaux se préparaient à les jeter dans la cuve, lorsque le roi, qu’on n’attendait pas si tôt, entra dans la cour à cheval ; il demanda tout étonné ce que voulait dire cet horrible spectacle. Personne n’osait l’en instruire, quand l’ogresse, enragée de voir ce qu’elle voyait, se jeta elle-même la tête la première dans la cuve, et fut dévorée en un instant par les vilaines bêtes qu’elle y avait fait mettre.
Le roi en fut triste malgré tout: elle était sa mère ; mais il s’en consola bientôt avec sa belle femme et ses enfants.
Peau d’âne

D’après Charles Perrault, version de contesdefees.com
Il était une fois le roi le plus puissant de la terre, aussi bon en paix que terrible en guerre. Ses voisins le respectaient et le craignaient et la plus grande tranquillité régnait dans le royaume. Sa femme était si aimante et pleine d’esprit, que si le roi était heureux en tant que souverain, il l’était davantage en tant que mari. Ils eurent une fille, et comme elle était très gentille et très jolie, ils se consolèrent de n’avoir pas eu d’autres enfants.
Le palais était vaste et magnifique. Partout il y avait des courtisans et des serviteurs. Les écuries étaient pleines de beaux chevaux et de jolis poneys. Mais elles étaient surtout connues pour héberger un âne. Cet âne célèbre avait le privilège que ce qu’il mangeait sortait transformé en pièces d’or étincelantes. Ceci expliquait en grande partie la fortune du royaume.
Mais un jour, le bonheur des époux royaux fut troublé par une maladie grave dont souffrit la reine, qui s’aggravait malgré le recours à toutes les sciences et à la sagesse des médecins. La malade comprit que sa dernière heure approchait et elle dit au roi :
-Avant de mourir, je voudrais vous demander que si vous vous remariez…
-Jamais! Jamais! s’écria le roi en sanglotant.
-je sais que votre amour pour moi est irremplaçable, mais je veux que vous me juriez que vous ne vous remarierez que si vous trouvez une femme qui me surpasse en beauté et en sagesse.
Le roi jura les larmes aux yeux, et peu de temps après, la reine mourut, et le désespoir de son mari fut immense. La douleur bouleversa quelque peu sa raison, et quelques mois plus tard il fit comparaître devant lui toutes les jeunes femmes de la cour, puis celles de la ville puis celles de la campagne, disant qu’il épouserait celle qui était plus belle que la reine décédée; mais comme personne ne pouvait être comparé à elle, il n’en avait choisi aucune. Le roi finit par montrer des signes évidents de folie, et déclara un jour que la princesse, qui était en effet plus belle que sa mère, deviendrait sa femme. Les courtisans lui firent comprendre qu’un tel mariage était impossible parce que l’infante était sa fille, mais comme il est difficile de faire entendre raison à un fou, le roi n’en voulut rien entendre et cria qu’on voulait le tromper parce qu’il n’avait pas de fille.
La pauvre petite princesse, effrayée par la folie de son père, avait les larmes aux yeux lorsqu’elle se présenta chez sa marraine, la plus puissante fée du royaume. Celle-ci s’écria en la voyant :
-Je sais ce qui t’amène chez moi. La folie de ton père est telle que ne dois pas le refuser ouvertement. Dis-lui qu’avant d’accepter d’être sa femme, tu exiges une robe de la couleur du ciel. Comme cela n’existe pas, il ne pourra pas te la donner et devra abandonner son horrible projet.
La princesse suivit les conseils de la fée, et le roi appela tous les couturiers du royaume et leur dit qu’il les pendrait si ils ne fabriquaient pas une robe couleur ciel. Poussés par la peur, ils se mirent au travail, et deux jours plus tard, la princesse avait la robe. Les larmes aux yeux, elle fut forcée d’admettre que son souhait avait été satisfait. Sa marraine, qui était au palais, dit à voix basse :
-Demande maintenant une robe plus brillante que la lune. Il ne pourra pas te la donner et devra abandonner son horrible projet.
Dès que la princesse en fit la demande, le roi fit appeler les artisans brodeurs du palais et leur dit :
« Je veux une robe plus brillante que la lune dans quatre jours. »
Quatre jours plus tard, l’infante reçut la robe qui éclipsait l’éclat de la lune. Lorsque la marraine le vit, elle murmura à l’oreille de sa filleule :
-Demande-lui une robe plus lumineuse que le soleil. Il ne pourra pas te la donner et devra abandonner son horrible projet.
Le roi fit appeler un riche diamantaire et lui ordonna de confectionner une robe de brocart et de pierres précieuses, menaçant de se faire couper la tête s’il ne pouvait satisfaire ses désirs. Avant la fin de la semaine, l’infante avait la robe, et quand elle la vit, son désespoir fut grand car elle était plus brillante que l’étoile du jour. Alors sa marraine lui dit :
-Tant qu’il possède l’âne qui produit des pièces d’or, il pourra satisfaire toutes tes exigences. Demande-lui la peau de l’âne, il en a tellement besoin qu’il ne pourra réaliser ton souhait et abandonnera.
L’infante fit ce que la fée lui conseillait mais le roi ordonna sans hésiter de tuer l’âne, de l’écorcher et d’apporter la peau à la jeune femme, qui était désespérée car elle ne savait plus quoi demander. Sa marraine l’encouragea en lui rappelant qu’il n’y a rien à craindre tant qu’on a la santé, puis elle lui dit de fuir seule et déguisée vers un royaume lointain.
« Voici une boîte où nous mettrons toutes tes robes, tes bijoux, ton miroir, les diamants et les rubis. Dit-elle. Je te donne ma baguette: si tu la garde, dans ta main, la boîte restera toujours cachée sous terre ; Lorsque tu voudras l’ouvrir, touche le sol avec la baguette et immédiatement la boîte apparaîtra. Pour que personne ne te reconnaisse, couvre-toi de la peau de l’âne et ainsi personne ne croira qu’une belle princesse se cache sous un déguisement aussi horrible.
La princesse suivit les instructions de sa marraine et s’éloigna du château de son père. Dès que le roi s’aperçut de son absence, il entra dans une colère noire et il envoya des messagers à sa recherche.
La princesse quant à elle, continua sa route, demandant l’aumône à tous ceux qu’elle rencontrait et s’arrêtant dans toutes les maisons pour leur demander s’ils avaient besoin d’une bonne ; mais son apparence était si horrible que personne ne voulait la prendre à son service. Elle continua à marcher, loin, de plus en plus loin ; et finalement elle arriva dans une ferme dont le propriétaire avait besoin d’une gardienne de porcs, pour les frotter, balayer et nettoyer leur gamelle. Dans la cuisine, les domestiques se moquaient d’elle et la traitaient mal. Ils l’avaient rebaptisé Peau d’âne et tout le monde l’appelait ainsi à présent.
Le dimanche, elle pouvait se reposer, car dès qu’elle avait terminé ses tâches, elle entrait dans la cabane qui lui avait été assignée ; Une fois la porte fermée, elle ôtait sa peau d’âne, se coiffait, se parait de ses bijoux, enfilait tantôt la robe lune, tantôt la robe soleil ou la robe ciel. Elle se regardait dans le miroir et était heureuse de se voir jeune, blanche, rose et plus belle que les autres femmes. Ces moments de joie l’encourageaient à affronter la dureté de son travail et elle attendait patiemment le dimanche suivant.
La ferme où habitait Peau d’âne appartenait à un roi très puissant, qui y élevait des oiseaux rares et des animaux exotiques. Le fils du roi se rendait souvent à la ferme au retour de la chasse, et s’y reposait avec ses compagnons en prenant un verre. Le prince était très fier et beau, et lorsque Peau d’âne l’aperçut de loin, son coeur se mit à battre et elle se dit:
-Ses manières sont nobles, son visage est beau, son apparence agréable. Bienheureuse la femme qui recevra son amour !
Un jour, le prince s’arrêta à la ferme, et errant dans la cour pour examiner les oiseaux et les animaux, il arriva devant la misérable pièce où vivait Peau d’âne, et, entendant un bruit, il se mit à regarder par le trou de la serrure. Comme c’était dimanche, il vit la gardienne de porcs vêtue d’or et de diamants, plus belle que le soleil. Le prince l’admira, ébloui, incapable de contenir les battements de son cœur. Le blanc rosé de son teint, les contours de son visage, sa fraîche jeunesse, le tout mélé d’un certain air de grandeur rehaussé de pudeur, rendaient le prince fou d’amour.
Trois fois il leva le bras pour enfoncer la porte, mais autant de fois la peur d’être devant une fée le retint, et il se retira pensivement dans son palais. Depuis, il soupirait jour et nuit, fuyait tous les amusements, même la chasse, et perdait l’appétit. Il demanda qui était cette admirable beauté qui vivait au fond d’une ferme, au bout d’une ruelle affreuse, dans laquelle l’obscurité était complète en plein jour, et on lui répondit qu’elle s’appelait Peau d’âne, à cause de la fourrure qu’elle portait autour de son cou; ajoutant qu’il suffisait de la regarder pour être guérie de l’amour, car elle était plus laide que la plus horrible des bêtes.
Peu importe ce que les gens lui disaient, il ne voulait pas les croire, car l’image de la princesse était gravée dans son cœur. La reine, qui n’avait pas d’autre fils, pleurait en le voyant dépérir. En vain lui demanda-t-elle en quoi consistait sa maladie, car le prince restait sans voix, et la seule chose qu’il réussit à lui dire fut qu’il voulait manger une tarte faite par peau d’âne. La reine ne savait pas de qui parlait son fils, et ayant demandé, ils répondirent :
« Bonté divine Madame! » La peau d’âne est une affreuse taupe noire plus dégoûtante que le plus sale des garçons de cuisine.
— Cela n’a pas d’importance, s’écria la reine ; puisque le prince veut une tarte faite par elle, qu’elle le lui prépare immédiatement!
La mère aimait extraordinairement son fils, et si il lui avait demandé la lune, elle aurait tout tenté pour la lui apporter.
Ayant reçu commande de la tarte, Peau d’âne prit de la farine, du sel, du beurre et des œufs frais, et s’enferma dans sa chambre. Elle nettoya son visage, ses mains et ses bras ; elle mit un tablier d’argent et commença sa tarte. Pendant qu’elle travaillait, une de ses belles bagues lui glissa du doigt, et tomba dans le gâteau sans qu’elle s’en rende compte. Lorsque le fils du roi mangea la tarte avec grand appétit, il faillit avaler l’anneau. Heureusement, il le remarqua à son émeraude qui scintillait, et admira l’étroite bague en or, qui marquait la forme menue du doigt de sa belle propriétaire.
Fou de joie, il rangea la bague dans sa poche et ne s’en sépara plus. Mais sa maladie s’aggravait et les médecins consultés disaient qu’il avait le mal d’amour. Ses parents décidèrent de lui chercher une épouse, mais le prince répondit :
« Je n’épouserai que la jeune femme au doigt de laquelle cette bague passera. »
Grande fut la surprise du roi et de la reine lorsqu’ils entendirent une demande aussi étrange, mais comme l’état du prince était très grave, ils n’osèrent pas le vexer et annoncèrent aussitôt que la jeune femme à qui irait l’anneau épouserait le prince, même si elle n’était pas de sang royal.
Toutes les femmes du royaume arrivèrent pour essayer la bague, les princesses, suivies par les duchesses, les marquises, les comtesses et les baronnes. Aucune n’avait le doigt assez fin. Les femmes de conditions plus modestes n’eurent pas plus de chance. Toutes les servantes du royaume échouèrent. Toutes sauf une qu’on n’avait pas fait venir, car on disait au prince que ça ne valait pas la peine d’essayer.
-Pourquoi pas? s’écria le prince.
Ils souriaient tous, mais le prince ajouta :
– Faîtes venir cette Peau d’âne!
Écartant les haillons et la vieille peau d’âne, il découvrit une petite main fine comme de l’ivoire légèrement rosée ; ils firent l’épreuve, et la bague s’ajusta à son doigt immédiatement au grand étonnement des courtisans. Le prince ôta alors la peau d’âne et dut alors se couvrir les yeux pour soutenir le scintillement de la robe de soleil et admirer la beauté qui était apparu devant lui. De grands yeux bleus en amande, un regard doux, plein de majesté, des cheveux blonds rappelant les rayons du soleil ; sa taille était incroyablement mince ; ses diamants éblouissaient et son costume était si riche qu’il était sans comparaison. Tout le monde applaudit, surtout les dames, et le roi et la reine furent ravis de découvrir la fiancée de leur fils.
Les ordres furent aussitôt donnés pour que le mariage ait lieu et le roi invita tous les monarques voisins, qui quittèrent leurs royaumes, certains montés sur de gros éléphants, d’autres sur des chevaux harnachés d’or et d’argent, et certains s’embarquèrent sur des bateaux qui avaient des lampes violettes. Mais si tous les princes rivalisaient de luxe pour montrer leur puissance, aucun n’égalait le père de la jeune mariée, qui avait finalement retrouvé la raison. Sa surprise fut grande et sa joie plus grande quand il retrouva sa fille qu’il embrassa en pleurant de joie ; et grande fut aussi la surprise du prince de connaître l’origine de sa fiancée. A ce moment, la marraine apparut, expliqua tout ce qui s’était passé, puis le mariage fut célébré et tout le monde vécut heureux.